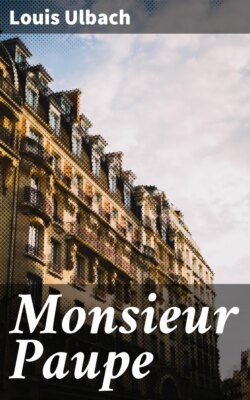Читать книгу Monsieur Paupe - Louis Ulbach - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
UN SOUVENIR DE BIVOUAC
ОглавлениеTable des matières
Marcienne, qui ne s’effrayait guère ordinairement des colères paternelles, parut cette fois légèrement alarmée de cet accès subit.
–Le comte t’aime bien! dit-elle en secouant la tête d’un air de contentement.
–Lui! Il me méprisait hier, comme le fumier de son écurie. Aujourd’hui, il a besoin d’un instrument, d’une dupe, et il essaie de me flatter.
–Il dit la vérité, papa.
–Je ne veux pas l’entendre dans sa bouche. Je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux; je n’ai pas besoin d’un certificat d’honneur et de probité, paraphé par ce noble ruiné, qui ne sait seulement pas ce que c’est que le travail.
–Il te parle de toi comme il pense, papa, puisque tu ne l’écouterais pas, s’il ne te parlait que de lui.
–Gamine!–répéta M. Paupe en s’excitant et en arpentant la chambre;–si je te racontais la vie de ce comte d’Arsonval, tu saurais si je dois tenir à ses paroles, à ses flatteries, lui qui n’a jamais fait œuvre de ses dix doigts, qui est né à l’étranger, qui est revenu avec l’émigration pour s’amuser, qui a épousé une fille de bourgeois riches, mais l’a rendue folle, et qui n’a pas su seulement obtenir des parents de sa femme une pension, un secours. Et cet inutile, ce vaniteux, ce dépensier, parce qu’il ne sait que faire de ses enfants, vient nous les mettre sur les bras?
–J’ai de bons bras, papa, dit Marcienne avec un rire sublime.
–Tu m’as empêché de le chasser. Tu as eu tort.
–Ce n’est pas moi, papa. C’est ton cœur qui t’a empêché.
–Non, c’est toi, toi seule! Mais tu ne feras pas que je ne haïsse cette famille par laquelle j’ai tant souffert.
–Ils souffrent aussi, papa. Il est inutile de les haïr, et il est bon de les aimer.
–D’ailleurs, comment veut-il que je les nourrisse, ses enfants? Il ne nous donnera pas d’argent, n’est-ce pas?
–Qu’importe! s’il nous donne deux fois plus de courage!
–Ah! je n’ai pas besoin qu’on me donne du courage, ni toi non plus. J’en ai assez; mais je ne veux pas faire un métier de sot.
–La charité n’est pas une sottise, papa.
Paupe ne trouva pas de réplique. Il fit un tour plus violent dans la chambre, se frappant le front de ses deux grosses mains calleuses, comme s’il lui était arrivé un grand malheur.
Pendant ce temps, Marcienne satisfaite, sortait en silence.
Paupe, au bout d’une seconde, entendit un remuement qui l’intrigua dans la pièce du fond. Il prit la lampe et alla regarder.
Marcienne, dans l’obscurité, avait tiré deux draps blancs d’une armoire, et essayait, en tâtonnant, d’étendre ces draps nouveaux sur sa petite couchette, dépouillée des draps du matin. Quand elle se vit surprise, elle mit un doigt sur sa bouche, et montrant le petit lit de son frère:
–Prends garde! ne fais pas de bruit,–dit-elle,–et cache la lumière.
–Tu n’y vois pas,–répondit Paupe, farouche encore, mais sur le même ton bas et précautionneux.
–La lampe réveillerait Maximilien.
Paupe mit sa main devant la lumière de la lampe, et, s’avançant dans la chambre, promena ses yeux autour de lui.
–Et toi,–demanda-t-il à sa fille,–où coucheras-tu?
–Là, répliqua Marcienne, en montrant une place entre sa couchette et le petit lit de son frère.
–Sur la terre nue? toi! Je ne veux pas de cela.
–Oh! je mettrai de la paille.
–Dis du fumier! Notre paille est toute mouillée. Attends, je vais t’arranger quelque chose de mieux.
Paupe alla dans la première pièce avec la lampe.
Marcienne, restée seule, eut un sourire silencieux, et sa bouche dilatée mima, pour se refermer, un baiser qui suivait la traînée lumineuse faite par son père.
Le tailleur rentra, en tenant touj ours avec précaution la lampe qu’il abritait de sa main; mais il serrait sous son bras un paquet de vieux habits, et quelques coupons de ratine.
Marcienne lui prit la lampe qu’elle posa à terre. Alors Paupe, s’agenouillant et pliant les guenilles de laine qu’il avait apportées, en fit une espèce de petit matelas, de petit lit, arrangeant bien les angles, faisant rentrer les morceaux qui débordaient, tâtant de la main à toutes les places, pour s’assurer que l’épaisseur était suffisante, et que Marcienne ne sentirait pas la dureté du sol.
–Tu seras mieux ainsi,–lui dit-il à demi-voix.–C’était comme cela que je m’arrangeais au bivouac.
Le bruit de la porte de la maison qui se rouvrait interrompit Paupe.
Il se releva, et passa dans la première chambre.
Marcienne le suivit avec la lampe; mais elle avait préparé, ce qui était un grand luxe, une chandelle, dans un chandelier de fer; et quand le comte d’Arsonval eut franchi la marche qui mettait le sol de la maison au-dessous de celui de la rue, M. Paupe qui avait repris subitement sa mauvaise humeur, fut ébloui par une illumination soudaine. La clarté de la lampe était doublée de la clarté de la chandelle.
Cette splendeur inusitée permettait de voir les deux enfants que le comte tenait par la main, et avec lesquels, très-pâle, les joues ruisselantes, il s’avança dans la chambre.
Le petit garçon, je l’ai dit, avait près de dix ans.
Il ne comprenait pas absolument ce qui se passait; mais il percevait le sens grave et mystérieux de cet événement qui l’amenait dans la nuit, si loin du château, et dans un pareil endroit.
Son père, en l’embrassant pendant la route, lui avait répété certainement qu’il allait vivre, pendant quelques jours, chez des gens qui n’étaient pas ses parents, mais qui auraient bien soin de lui; et l’enfant, partagé entre la curiosité de cette destinée inconnue, entre le chagrin que lui avait causé son père, et le petit sentiment de rébellion qu’il éprouvait à l’idée de subir la surveillance, l’amitié, la discipline d’étrangers et d’étrangers inférieurs, avait un petit air boudeur, irrité, qui l’aidait à combattre le sommeil.
La petite fille de cinq ans ne comprenait rien. On l’avait sans doute portée pendant la route. Elle eût été incapable de marcher, puisque son père la traînait un peu.
Ce n’était ni l’orgueil, ni le chagrin, ni le caprice, qui l’étourdissait. C’était le sommeil, le sommeil implacable, qui noyait ses petits yeux bleus, qui mettait sur ses lèvres ce baiser fondant, sous lequel sa bouche extasiée s’entrouvrait, et qui lui faisait porter à chaque pas son poing fermé à ses paupières. Elle avait tant joué, ce soir-là, et si longtemps, sur la pelouse!
Ces deux enfants étaient réellement beaux: le petit garçon avec sa mine dédaigneuse et hautaine, la petite fille avec son abandon.
Marcienne était devant la porte de la chambre et se trouvait vis-à-vis la porte d’entrée. Elle n’osait tendre tout à fait lès bras à la vision qu’on lui amenait; seulement, elle les ouvrait à demi. Elle avait l’air d’une de ces petites madones qui laissent tomber des rayons de leurs deux mains; et véritablement, quelque chose de doux, qu’elle ne pouvait définir, un feu et à la fois une fraîcheur, filtrait à travers ses veines et s’épanchait par ses regards, par sa bouche, par ses mains.
Cette enfant, confinée dans un devoir maternel quotidien qui prenait toute sa vie, avait une révélation nouvelle, et recevait la visitation d’un amour agrandi qui la conviait à une fonction plus haute. Tout son être suivait l’élancement de sa pensée, et surgissait.
Son visage blanc, qui se colorait si difficilement, pâlissait encore; mais le bleu profond, épanoui dans ses yeux comme une pervenche à travers la neige, attestait l’ambition supérieure de ce dévouement candide.
Paupe, stupéfait, laissait s’avancer le comte avec ses deux enfants. Mais Marcienne alla au-devant d’eux, et comme elle était de beaucoup la plus grande, elle se baissa pour mettre un baiser léger dans les boucles blondes de la petite fille.
Elle fut plus timide avec le petit garçon qui la toisait; elle lui effleura la main que celui-ci retira et mit dans sa poche. Et regardant M. d’Arsonval avec une autre caresse respectueuse dans le regard:
–Dites-moi leurs noms? demanda-t-elle.
–Il s’appelle Léo, elle se nomme Diane; répondit le comte en souriant, à travers ses pleurs, car le nom de ses enfants lui mettait un parfum aux lèvres.
–Eh bien! monsieur Léo, et vous, mademoiselle Diane, voulez-vous de moi pour vous servir?
Marcienne prononçait le mot servir avec une grâce sans humilité; c’était, dans sa bouche, l’équivalent du mot aimer.
M. Paupe, cependant, trouva le mot choquant, et laissa échapper un grognement.
–Soyez leur sœur aînée, dit M. d’Arsonval en poussant les enfants vers la jeune fille.
–Voyons, combien de temps resterez-vous absent? demanda brusquement le tailleur que ces sentimentalités irritaient.
–Huit jours, dix jours au plus. Je fais une démarche suprême; si elle ne réussit pas, je reviendrai en toute hâte.
–Et alors, que ferez-vous?
Le comte eut un geste de découragement et d’indécision.
–Je me résignerai à demander du service, dans l’armée, dans l’administration ou dans la diplomatie, à ce gouvernement nouveau que mon père n’eût pas servi.
–Pourquoi ne commencez-vous pas par là?
–Parce qu’avant de faire fléchir mes principes devant la nécessité, je veux épuiser toutes mes ressources.
–Nourrir et protéger ses enfants, c’est un principe qui me paraît au moins égal à celui d’une cocarde! répartit le tailleur en se croisant les bras et d’un air de tribun.
–Je le sais, monsieur Paupe, dit le comte avec simplicité; voilà pourquoi, avant de m’incliner devant l’homme qui a renié mon roi, je vais m’incliner devant l’homme qui m’a renié.
Le tailleur, satisfait de sa sentence, et intimidé de la réponse qu’elle avait provoquée, continua sur un ton moins rogue:
–Quand partez-vous?
–Dans deux heures, je serai en route pour Troyes; à Troyes, je prendrai la voiture de Châlons.
Marcienne s’était assise, et ayant les enfants devant elle, contre ses genoux, avait commencé avec eux une conversation à voix basse. Elle entendit les paroles du comte. Elle s’approcha de lui, en ramenant Léo et Diane:
–Embrassez-les, monsieur,–dit-elle d’une voix tremblante,–car mademoiselle Diane a bien sommeil.
Le comte souleva sa petite fille, la couvrit de baisers, et la rendit à Marcienne.
Puis, avant de l’embrasser à son tour, il arrêta Léo devant lui, par une imposition de la main sur sa tête, et le contemplant avec une tendresse navrante:
–Tu me promets d’être bien sage? lui demanda-t-il.
–Oui, répondit nettement l’enfant.
–D’obéir à M. Paupe?
L’enfant regarda le tailleur d’un air de menace plutôt que de soumission, et ne répondit pas.
–D’écouter mademoiselle Marcienne?
L’enfant regarda la petite fille, et son regard s’adoucit.
–Oui, murmura-t-il.
–Tu te souviendras, matin et soir, dans ta prière, de ta pauvre maman, bien malade, de ton père qui va souffrir?
–Oui! dit cette fois Léo d’une voix haute et presque éclatante.
M. d’Arsonval le baisa en retenant ses larmes; et comme Marcienne était placée tout contre Léo, il mit aussi un baiser sur le front de la jeune fille.
Marcienne en fut très-fière. Elle prit la chandelle et se dirigea vers la pièce du fond avec les enfants. Diane se laissait conduire.
Léo, sur le seuil de la chambre, s’arrêta, flaira comme un petit lion l’obscurité dans laquelle on voulait l’entraîner, se cabra, pour ainsi dire, et regardant de loin son père avec des yeux étincelants, lui fit un dernier appel, un dernier reproche silencieux.
Mais le comte étendit la main:
–Va! dit-il.
L’enfant, courbant la tète, non comme un être docile, mais comme un indompté qui, se dépitant contre la résistance, veut la vaincre autrement, suivit Marcienne et sa sœur dans la chambre du fond.
M. d’Arsonval avait tiré d’une de ses poches un petit paquet qu’il tendit à M. Paupe.
–Voici, dit-il, des bijoux de famille qui ont quelque valeur. S’il arrivait que mon absence se prolongeât, ou si, par hasard, je ne devais pas revenir, vous les vendriez…
–Et vos créanciers?
Le comte pâlit.
–Que votre délicatesse ne s’alarme pas, monsieur Paupe: j’ai le droit de disposer de ces bijoux.
–En êtes-vous bien sûr?
–L’huissier, qui a tout saisi chez moi, m’a permis d’emporter ces souvenirs.
–Ah!
M. d’Arsonval tendait touj ours le petit paquet; mais, pour rien au monde, le tailleur ne l’eût pris dans la main du comte. Il montra la table et dit:
–C’est bon, monsieur. J’accepte ce dépôt; vous le trouverez intact quand vous reviendrez.
–Je vous en prie, monsieur Paupe, s’il survenait quelque besoin imprévu…
–Mais, continua le tailleur, il est bien entendu que si vos créanciers le réclament.
–Je puis aussi,–dit timidement le comte d’Arsonval,–sur la petite somme que j’ai gardée pour mon voyage, vous donner…
–De quoi? une aumône? une charité?–répliqua Paupe d’une voix sourde, et en croisant sur sa poitrine ses deux poings fermés, comme pour se mettre en défense.–Attendez donc, monsieur d’Arsonval, que je vous aie rendu service, pour m’insulter.
–Oh! monsieur Paupe!
–C’est bon! c’est bon! puisque Marcienne le veut, j’accepte la charge! mais je l’accepte entière, complète; vous l’avez dit, c’est dans le sang des Paupe. Il ne me sera pas plus difficile de vous rendre vos enfants en bonne santé, et vos brimborions de famille en bon état, qu’il ne l’a été, à mon père, de vous rendre le château et le domaine; seulement, je ferai mieux que mon père. Il a eu tort de recevoir cette pension qui a l’air de vous donner un droit et m’en retire un.
–Votre père était l’ami du mien, monsieur Paupe, nous renouvellerons le pacte de famille.
Le tailleur regarda le comte en face, et ne put s’empêcher de démasquer toute sa haine.
–Moi! votre ami?
Le comte recula sous le regard de Paupe, comme si un fer rouge lui eût effleuré la peau.
Les deux hommes restèrent une minute l’un devant l’autre, étonnés, déconcertés; M. d’Arsonval se demandant pourquoi il confiait ses enfants à ce brutal; et Paupe s’admirant de ne pas chasser cet être détesté, qui lui demandait de prendre ses enfants en tutelle, au nom de leur amitié réciproque.
La morsure d’une inquiétude subite, et d’une haine féroce, leur tira le cœur pendant une minute.
Puis, le comte s’imagina qu’il voyait les yeux du tailleur s’adoucir; et il interpréta comme une exagération de fierté, comme une susceptibilité vaniteuse de paysan, cette ruade, démentie par le fait même; puisque les enfants dormaient dans la pièce à côté, sous le regard doux et aimant de Marcienne.
Il y avait une vague, mais réelle ressemblance après tout, entre le tailleur et sa fille. Un peu de l’azur des yeux bleus de celle-ci mettait un coin de ciel au-dessus de la tête de ce bourru.
Paupe, en effet, adoucissait involontairement sa mine féroce par la pensée même du triomphe qu’il avait obtenu, en laissant voir une bonne fois sa fureur et sa haine.
Il savourait, avec une immense satisfaction, l’abaissement de ce noble ruiné. Il avait bien surpris l’effroi du comte, et il en jouissait.
Faire peur est une des ambitions humaines les plus fréquentes, égale à l’ambition de faire envie; l’une et l’autre se servent. Paupe se trouvait de niveau avec le comte; ce qui valait presque mieux que de le dominer, puisqu’il s’était payé par cet effroi inspiré de toute l’envie dont il avait été si longtemps rongé.
–Vous ne m’empêcherez pas, monsieur Paupe,–reprit M. d’Arsonval avec une tristesse contenue,–d’avoir pour vous une grande reconnaissance, si vous ne voulez pas de mon amitié. Vous êtes fier, et vous avez raison de l’être, pour votre père et pour vous. Vous avez des préventions contre moi. Je les subirai, et j’espère les désarmer. Il me suffit que vous soyez honnête homme, et que vous acceptiez, au nom de l’honneur de votre nom, le cher dépôt que je vous confie. Quand je reviendrai, mes enfants –auront plaidé pour moi, et j’embrasserai de si bon cœur mademoiselle Marcienne, que vous me tendrez la main.
Ces paroles, dites pour émouvoir Paupe, irritèrent son orgueil. Il fut tenté de répondre:
–Quand vous reviendrez, je vous défendrai d’entrer ici; vous reprendrez dans la rue vos enfants, auxquels j’aurai fait l’aumône, et nous serons quittes.
Mais il se contenta de saluer M. d’Arsonval, qui faisait un mouvement pour se diriger vers la porte.
Il fallut au comte un bien grand courage pour quitter cette maison; pour n’y pas rentrer, quand il en eut franchi le seuil; pour ne pas courir à la chambre où ses enfants dormaient et y répandre une dernière fois son cœur.
Mais il était attendu à quelques pas, dans la rue, par la carriole qui devait l’emmener. Il voulait partir avant le jour et prévenir la curiosité bruyante que la grande nouvelle de sa catastrophe allait susciter dans tout le pays.
Paupe accompagna au dehors, machinalement, le comte d’Arsonval, n’ayant rien de plus à lui dire, n’ayant rien à en apprendre; mais une curiosité instinctive et une férocité paradoxale le poussaient à jouir jusqu’à la dernière seconde de ce chagrin dont il était, pour ainsi dire, le modérateur.
Le comte, pendant le court trajet de la maison à la voiture, acheva de donner les explications qui pouvaient être utiles, sur ses enfants, et aussi sur les espérances qui l’attiraient si loin de son pays. Il demanda au tailleur de vouloir bien prendre, au moins une fois, pendant son absence des nouvelles de la comtesse d’Arsonval qu’il avait placée dans un couvent, où sa maladie recevait des soins.
Le comte avait payé d’avance la pension pour trois ou quatre mois. C’était le terme que demandait un médecin de Troyes, pour s’assurer de la possibilité de la guérison.
Paupe reçut ces confidences et ces instructions, sans proférer une parole. Tout au plus, par une sorte de grognement vague, qui paraissait la formule embarrassée d’une protestation quelconque, répondait-il aux épanchements du comte.
M. d’Arsonval trouva, à la porte de la principale, auberge du pays, la voiture qui l’attendait. Aucun domestique du château n’accompagnait le comte. Sa voiture était une espèce de charrette garnie de paille, qu’un garçon de l’auberge devait conduire. Les chevaux et les voitures de M. d’Arsonval restaient au château, comme un gage, et ne lui appartenaient plus.
Paupe eut un tressaillement intérieur, en voyant monter dans cette voiture rustique l’homme qu’il avait vu si souvent gravir la montagne –en brillant équipage de chasse, ou se promener dans une calèche élégante, avec sa femme, jeune et jolie et ses enfants.
Toutes les passions basses, tapies dans la conscience du tailleur se redressèrent et furent tentées de consacrer leur victoire par un sifflement formidable, quand la voiture se mit en marche.
–A bientôt! dit le comte d’une voix étouffée,
–Bon voyage!répondit le tailleur, d’une voix presque éclatante.
La charrette commença, sur la terre dure, sur les cailloux et dans les ornières, ce bruit de ferraille, ce grincement des roues qui devait s’entendre pendant vingt minutes environ.
Paupe, immobile, les bras croisés sur la poitrine, la bouche écartée par une effroyable grimace que permettait la nuit, écoutait ce charivari, comme une mélodie, et l’applaudissait, quand un cahot, un sursant dans une ornière le rendait plus intense.
–Hue!–disait-il tout bas, poussant la charrette de son souffle;–va-t’en, et ne reviens pas, insolent, fainéant, imbécile, qui crois à ma générosité, et qui me confies tes enfants!
A mesure que la charrette s’éloignait, Paupe sentait revenir et se débattre en lui les fureurs qu’il avait laissé entrevoir à Me Herluison.
Marcienne n’était plus là. Seul, dans l’obscurité, avec lui-même, il se soulageait de l’embarras singulier ressenti dans la soirée, par ce débordement complet de sa haine.
Paupe s’en voulait des concessions faites. Il trouvait mille moyens qui ne lui étaient pas venus à l’esprit une demi-heure auparavant d’humilier, de torturer, d’écraser le comte.
Il aurait souhaité maintenant qu’un accident de la charrette ou qu’une réflexion du comte interrompît pour quelques instants le départ. Il serait accouru pour lapider de ses imprécations le niais qui était venu le provoquer chez lui.