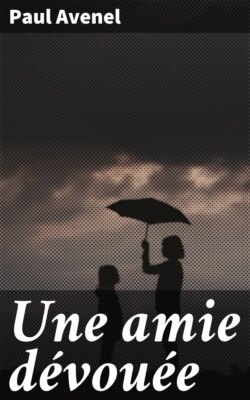Читать книгу Une amie dévouée - Paul Avenel - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
A LA RECHERCHE D’UN GENDRE
ОглавлениеTable des matières
En cherchant dans sa mémoire, M. Pythagore Graffinard se souvint qu’il avait à Châtellerault un sien ami qui avait un fils et que ce fils devait avoir de vingt-cinq à vingt-six ans.
Ce jeune homme pouvait donc être un bon parti pour sa fille.
Il avait connu son ami Fourcadin dans une belle position de fortune, et comme il Je savait d une économie excessive qui allait, en certaines occasions, jusqu’à l’avarice, il ne doutait pas qu’il eût doublé ou même triplé ses capitaux dans son commerce de couteaux.
En pensant à Fourcadin, il pensa à Châtellerault et il se dit: Cette ville est en province et la province a du bon pour l’élevage des gendres.
Il fit donc les réflexions suivantes:
J’ai toujours entendu dire que, depuis Charlemagne, Paris était la ville la plus pervertie de France. Il est donc prudent et sage, pour un père de famille, de chercher un gendre hors des murs de la grande cité: Châtellerault est mon affaire. Là, les mœurs doivent être douces et patriarcales, quoiqu’on y fabrique beaucoup de couteaux...
Ce n’est donc pas une raison, car il y a des gendarmes qui ont le cœur tendre comme la rosée, et il y a, à Nanterre, des rosières qui ont un cœur de marbre et une figure de cire. Pourquoi? That is the question!
Les mœurs de nos départements ont donc une supériorité incontestable sur les mœurs de la capitale.
La jeunesse doit donc avoir une dose de morale plus grande. Elle a de la tenue, et qui sait se tenir, jouit dans le monde d’une considération méritée.
La dépravation de la vie parisienne, le dé braillé de ses instincts sont autant de poisons subtils qui s’infiltrent dans les jeunes âmes. Cette intoxication porte un préjudice incalculable à l avenir des jeunes célibataires.
Jetez donc entre les bras d’un de ces roués du boulevard et d’estaminet une fille chaste et pure?
Le père sera le bourreau, l’enfant, la victime.
Et je veux que Rose soit heureuse.
Je vais donc écrire sur-le-champ à mon brave Fourcadin, et s’il y a moyen, ma fille deviendra sa bru.–Il est bien entendu que je n’influencerai en rien le choix de ma chère Rose.–Je veux qu’elle se marie selon son coeur; s’il y a de bons ménages sur terre, ce sont ceux-là.»
M. Graffinard passa dans son cabinet et se mit à son bureau.
Pendant que le parfumeur se disposait à demander un gendre au département de la Vienne, il se jouait dans son magasin une petite comédie qui aurait pu faire supposer que l’époux futur de sa fille habitait le département de la Seine.
Madame Aurore Graffinard montait en voiture, quand un jeune homme, qui depuis quelques instants était entré dans la rue Saint-Denis, se dirigea vers la maison de parfumerie. Il se retourna pour suivre des yeux la calèche qui emportait l’aimable boutiquière au bois de Vincennes, puis reporta son attention sur l’objet de sa pensée première. Il regarda à travers les glaces de la devanture du magasin; mademoiselle Rose était seule au comptoir. Il en ressentit une douce émotion.
La jeune fille, tout en paraissant fort occupée à un ouvrage de broderie, avait pu observer ce qui se passait dans la rue. Elle avait baissé un peu plus ses paupières pour mieux voir et sentait en elle un trouble indéfinissable qui la charmait... Il y a tant d’ivresse dans les premières émotions du coeur!
Le jeune homme s’assura d’un regard que M. Graffinard n’était pas là; il entra.
Rose détourna la tête pour cacher le léger incarnat qui venait d’envahir subitement le satin de ses joues. Elle voulait feindre de ne pas voir, mais elle faisait cela malhabilement, comme une innocente.
Si, en ce moment, on lui eût dit un mot, un seul mot, qui pût lui faire soupçonner qu’on lisait sur sa figure ce qui se passait en elle, au lieu de nier simplement, elle aurait caché son visage dans ses mains, comme font les enfants lorsqu’ils sont pris en faute.
Du reste, ceci fait son éloge.
Aujourd’hui qu’il n’y a plus d’enfants, les jeunes filles sont rares.
Le jeune homme salua mademoiselle Graffinard.
Elle rendit le salut en inclinant légèrement la tête en avant, et en prononçant le mot Monsieur d’une façon inintelligible.
L’amoureux, au bout de cinq minutes, vint au comptoir pour solder les objets de parfumerie qu’il avait choisis. Il fit à mademoiselle Rose un de ces compliments stéréotypés, que font, dans le monde, les gens honnêtes et timides.
Rose baissa les yeux, ses joues s’empourprèrent davantage. Pour se tirer d’embarras, elle remuait la monnaie dans le tiroir de son comptoir sans pouvoir se rendre compte combien elle avait à remettre sur la pièce de vingt francs qu’elle avait devant elle.
–Mais vous me rendez deux francs de trop, dit le jeune homme.
–Ah! c’est juste, répondit mademoiselle Graffinard.
–Et monsieur votre père se porte toujours bien?
–Mais oui, monsieur.
–Allons, tant mieux; mademoiselle, j’ai bien l’honneur de vous saluer.
A peine l’inconnu eut-il disparu, que Rose leva la main qu’elle avait posé sur le louis d’or. Elle le prit, le considéra attentivement, et, tirant un petit porte-monnaie en velours de sa poche, elle échangea la pièce contre une autre de même valeur, qu’elle jeta dans le tiroir.
C’est un souvenir de lui, se dit-elle; il lui a appartenu, ce beau louis: je veux le conserver toujours, il me servira de talisman. On dit, d’ailleurs, que lorsqu’on possède une pièce d’or qui a appartenu à une personne à laquelle on s’intéresse, elle vous sert de préservatif contre les mauvaises pensées et les accidents.»
Les gens naïfs sont superstitieux.
Une jeune fille peut donc croire aux dictons des bonnes femmes.
Il y a des légendes, des proverbes, des croyances qui se transmettent de génération en génération, en passant simplement de bouche en bouche. C’est ainsi que certaines absurdités, certaines âneries voyagent à travers les âges, sans avoir jamais eu de contradicteurs, parce que l’homme sérieux qui les entend lève les épaules et tourne le dos, sans se donner la peine de les réfuter. C’est un tort, car les ignorants, les imbéciles et les idiots les répètent, les propagent et les éternisent.
Que de ratures il y aurait à faire dans ce code verbal qu’on appelle la Sagesse des nations. Que de proverbes sont stupides!...
Comme on le voit, mademoiselle Rose n’était pas très avancée dans ses amours. Elle en était encore à ces préliminaires enfantins et charmants qui, pourtant, agitent le cœur en troublant la conscience.
On sent qu’on fait mal, mais on éprouve tant de bien! Si l’on ne va pas plus vite dans le chemin fleuri des sentiments, c’est que la conscience est là, comme un gendarme moustachu, sabre au côté. Elle ne quitte pas de l’œil ce pauvre cœur, et elle est toujours prête à l’arrêter au moindre écart.
Mademoiselle Graffinard avait vu pour la première fois M. Maxime à sa pension. Il était le frère aîné d’une de ses amies. Lorsque le jeune homme venait voir sa sœur, Rose l’avait rencontré au parloir. Elle avait causé plusieurs fois avec lui et l’avait même chargé, un jour, d’une lettre pour son père. Maxime connaissait le parfumeur et se trouvait très heureux d’obliger la jolie pensionnaire.
Quand Rose sortit de pension, Maxime fit une consommation exagérée de parfumerie, pour avoir un prétexte d’entrer dans le magasin qui recélait celle qu’il aimait. Il aurait pu employer d’autres moyens; mais, pour le moment, il avait choisi le plus simple, comme étant le plus naturel. Il n’avait pas l’étoffe d’un roué: il croyait à la religion de l’amour.
Ce fut donc avec une agréable émotion que mademoiselle Graffinard glissa son porte-monnaie dans la poche de sa robe, petite poche discrète, cachée entre deux plis d’étoffe, qui, pour la première fois, devenait complice d’un cœur qui s’éveille.
La jeune fille jeta un coup d’œil vers le fond du magasin, pour bien se convaincre de l’absence de son père. Puis, satisfaite de ne le voir ni l’entendre, sa physionomie reprit le calme de l’innocence. Elle se remit tranquillement à son travail de broderie, mais elle était toute à ses pensées, elle éprouvait un bonheur invisible.
M. Pythagore Graffinard, après avoir choisi dans une boîte sa meilleure plume de fer, était assis à son bureau, écrivant la lettre suivante:
«Mon cher Fourcadin,
Il y a longtemps que je n’ai eu le plaisir de vous serrer la main, mais croyez que je n’en suis pas moins votre ami tout dévoué, comme autrefois, lorsque vous habitiez la capitale. J’espère que vous avez toujours cette santé florissante qui faisait tant envie, jadis, aux souffreteux et poitrinaires de notre quartier. Je vois dans l’almanach Bottin-Didot que vous êtes un des premiers fabricants de Châtellerault, je vous en fais mon compliment bien sincère; et par contre je vous dirai que ma parfumerie va aussi son petit bonhomme de chemin. Je boulotte, je me plais dans la vie commerciale et ma fortune s’arrondit. J’ai une grande fille, douce, aimable, bonne, charmante.
Elle est en âge de se marier. Mais je lui voudrais trouver un parti convenable, quelque jeune homme riche de province, rangé, vertueux, honnête. Nos Parisiens sont trop dans le progrès, ils déraillent trop facilement de la ligne droite pour qu’un père de famille leur confie l’avenir de son enfant... Mais j’y pense, est-ce que vous n’avez pas un fils? Il me semble l’avoir embrassé, il y a une quinzaine d’années, à l’hôtel du Plat d’étain, où vous étiez descendu en revenant voir Paris. S’il est bon sujet et s’il est beau physiquement, expédiez-le-moi.–S’il plaît à ma fille, si ma fille lui plaît, c’est une affaire faite. Si ça vous va, mon cher Fourcadin, répondez-moi illico.
Votre vieil ami tout dévoué,
PYTHAGORE GRAFFINARD».
Notre excellent parfumeur, après avoir sablé son épître avec une poudre de grès bleu à paillettes d’or, la relut plusieurs fois. Il en parut satisfait. La plume de madame de Sévigné, selon lui, n’avait jamais eu de plus belle inspiration épistolaire.
Il prit son chapeau et sortit. Il alla mettre lui-même la lettre à la poste, afin d’être seul dans le secret de sa démarche.
Pendant que M. Graffinard cheminait vers le bureau de poste, Aurore, son épouse chérie, était assise sur le fin gazon du bois de Vincennes à côté d’un jeune officier, au regard martial et à la moustache provocante.
Voici ce qui lui était arrivé:
Madame Graffinard, en entrant dans le bois, avait ordonné à son cocher de brûler le macadam.–Les chevaux, excités par le fouet, avaient pris une allure rapide.–Il faisait lourd, le soleil était brûlant, l’air pénétrait avec peine dans la poitrine.–La vitesse imprimée à la voiture produisait un léger courant d’air qui, en frappant au visage de la charmante promeneuse, lui faisait éprouver une certaine sensation de fraîcheur. Elle était heureuse, s’abandonnant avec indolence aux molles secousses de son véhicule. Rêveuse. les yeux à demi fermés, elle avait parfaitement oublié qu’il existait au monde un parfumeur du nom de Graffinard. Ses idées s’envolaient vers des régions plus éthérées que l’atmosphère banale d’un magasin de parfumerie... quand tout à coup les chevaux prirent le mors aux dents; un taon à l’aiguillon terrible venait de s’abattre sur eux. L’attelage, rendu furieux par les piqûres de l’insecte, dévorait l’espace. Le cocher, surpris par cette course vertigineuse, fut précipité de son siège. La voiture, au détour d’une allée, heurta un poteau; un des essieux se brisa, et madame Graffinard, à demi morte de peur, alla rouler à quelques mètres de là sur la pelouse. Sa chute fut amortie par deux bras vigoureux qui, au moment du danger, se tendirent vers elle. Ce secours inattendu lui venait d’un grand, bel et jeune officier, qui, avec un sang-froid tout militaire, avait paré aux funestes conséquences de ce dangereux accident. Elle en fut quitte pour une violente émotion.
Pour échapper aux regards curieux de la foule, le galant officier offrit son bras à Aurore, en lui disant:
––Il faut marcher un peu, madame, pour remettre vos sens dans leur état normal.
Madame Graffinard obéit machinalement, et son sauveur l’emmena dans une des sinueuses allées qui se perdent dans les taillis.
–Eh bien! comment vous trouvez-vous à présent? lui dit-il après quelques minutes de marche.
–Mieux, monsieur.
– Le mouvement est un remède souverain à laccident qui a failli vous faire perdre la vie. Dans un quart d’heure vous aurez retrouvé votre sérénité première, et je bénirai alors le ciel de m’a voir placé sur votre route.
–Je noublierai jamais l’important service que vous m’avez rendu; sans vous, je serais peut-être morte à cette heure.
Vous ne deviez pas mourir, madame, répondit en souriant l’officier; dans le bois de Vincennes, il y a un dieu pour les jolies femmes.
–Vous êtes alors un des anges de ce dieu, ajouta la parfumeuse en jetant timidement les yeux sur son sauveur, qu’elle n’avait pas encore regardé.
–Belle et spirituelle, madame, dit alors le jeune homme avec un doux sourire, vous avez toutes les perfections de la femme.
–Je pourrais répondre à votre compliment flatteur en parlant de votre courage, monsieur; mais permettez-moi de vous témoigner seulement toute ma reconnaissance pour vos soins empressés et votre dévouement.
–C’est inutile, madame. Je suis déjà assez récompensé par le plaisir que j’éprouve de vous avoir rendu service.
–Et je vous en garderai un éternel souvenir!..
–Vous paraissez fatiguée, dit alors l’officier en s’arrêtant et en changeant de ton.
–Oui, mon émotion est passée et la fatigue est venue.
–Si vous voulez vous reposer un instant.
Aurore se sentait brisée; elle s’assit sur un tertre de gazon qui bordait le chemin. Elle était encore pâle et portait fréquemment à ses narines fines et arquées un riche flacon de sels.
Le jeune officier se plaça près d’elle et put alors la contempler tout à son aise.
Après un long silence, madame Graffinard reprit la parole pour demander le nom de celui à qui elle devait la vie.
L’officier prit une carte dans un petit portefeuille et la lui présenta.
Aurore y lut les mots suivants:
«Anténor des Malhars.»
– Est-ce que par hasard, monsieur, demanda la belle parfumeuse, vous seriez parent de M. Philippe des Malhars dont l’immense propriété est située en Bretagne, non loin du château des Quatre-Vents?
– Philippe des Malhars, répondit Anténor, était mon grand-père.
–Serait-il possible?
–C’est l’exacte vérité, madame.
– Dans ma jeunesse, j’ai beaucoup entendu parler de votre honorable famille.
– Y aurait-il indiscrétion à vous demander?..
–Ne m’interrogez pas, monsieur, je vous en prie.
Madame Graffinard se leva brusquement et lit signe à une voiture qui passait au bout de l’allée.
Anténor n’était pas encore revenu de sa surprise qu’Aurore était installée dans le coupé.
–Rue Saint-Denis, dit-elle, vite!
Le jeune officier accourut trop tard pour saluer une dernière fois la charmante Parisienne,
–Quel est donc ce mystère? dit-il.
Madame Graffinard, blottie dans un coin de la voiture, faisait les réflexions suivantes:
» Grand Dieu!... quelle honte pour moi, si ce jeune homme avait osé me demander mon nom! Il aurait vu que la seule descendante en ligne directe de l’ancienne et honorable maison des Quatre-Vents est aujourd’hui la femme d’un parfumeur dans le quartier Saint-Denis. Quelle humiliation pour mes nobles aïeux! D’un château séculaire tomber dans une boutique d’essences et de pommades! quelle dégringolade! c’est affreux! Et puis, avoir troqué le nom nobiliaire des Quatre-Vents contre le nom plébéien de Graftinard-Pouah!..»
Et Aurore cacha sa figure dans ses deux mains en poussant un profond soupir. Elle resta absorbée dans ses pénibles pensées, jusqu’à ce que la voiture s’arrêtât devant la porte de son magasin. Elle ouvrit la portière, jeta une pièce de cinq francs au cocher et gagna rapidement sa chambre. En un clin d’œil elle eut changé de toilette, puis elle s assit devant sa glace, pour réparer tant bien que mal le désordre de sa coiffure.
M. Pythagore Graffinard, après avoir jeté sa lettre à la poste, revenait heureux et content à son domicile. En tournant la rue Saint-Denis, il se trouva face à face avec son vieil ami Stanislas Benjoin.
–C’est vous, Stanislas, s’écria-t-il.
–Moi-même, mon cher Pythagore.
–Par quel hasard êtes-vous dans la capitale?
–Je suis venu régler mon compte avec mon successeur.
– Depuis que vous êtes retiré des affaires, vous ne vous ennuyez pas?
–Non; je m’occupe d’histoire naturelle; J’herborise le jour et je lis M. de Buffon le soir.
–Et madame Benjoin?
–Ma femme s’occupe de ses poules et de ses rosiers.
–A propos, vous êtes grand-père?
–Oui, ma fille a accouché d’un gros garçon la semaine dernière.
–La mère et l’enfant se portent bien?
–Comme la porte Saint-Denis.
–Ah! vous avez été chançard de trouver un gendre et un successeur tout à la fois.
–Certes, mon gendre Bouricot n’a pas à se plaindre non plus. Il fait de bonnes affaires et de beaux enfants. Et puis, il faut vous dire: en épousant ma fille, il est tombé sur un véritable trésor; Cornélie a été élevée dans la perfection; elle est industrieuse comme le castor, bonne et douce comme la sarigue, prévoyante comme le lapin et économe comme le rat musqué... Vous voyez donc bien, mon cher Pythagore, que ma fille réunit toutes les qualités propres à faire le bonheur domestique de l’homme que je lui ai donné pour époux.
–Vous parlez comme feu Buffon.
–Le style c’est l’homme. Et madame Graffinard se porte bien?
–A merveille!
Je me sauve. Il faut que je sois à Maisons-Laffitte pour dîner. Venez nous voir un de ces jours.
Heureux homme! se dit le parfumeur en voyant s’éloigner son ami. Il a marié sa fille et il vit tranquille à la campagne, sous de grands arbres; il peut manger en plein air, et cueillir des fruits nouveaux dans son jardin.
Il ne connaît pas son bonheur. Espérons que ma fille sera aussi heureuse, car le fils de Fourcadin doit être probe, honnête, rangé; il ne doit avoir aucun vice de ces jeunes gens de Paris qui se font un plaisir de passer leur jeunesse à piétiner sur le cœur des demoiselles.