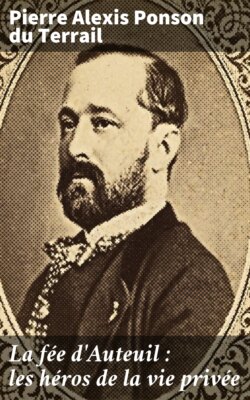Читать книгу La fée d'Auteuil : les héros de la vie privée - Pierre Alexis Ponson du Terrail - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE X
ОглавлениеTable des matières
Au bout de cinq jours de délire et de prostration, le baron Paul Morgan croyait encore entendre la voix de son oncle lui parlant de probité et d’honneur et l’engageant à restituer une fortune dont l’origine était souillée.
Il se rappela donc avec une netteté parfaite les paroles du défunt et il dit à son ami M. Léon de Courtenay dont la stupeur allait croissant:
— Ecoute-moi, tu vas voir que je n’ai pas le délire.
Et il lui répéta mot pour mot tout ce que le vieillard lui avait dit avant de mourir.
M. de Courtenay l’écouta jusqu’au bout sans l’interrompre:
Mais un sourire glissait sur ses lèvres.
— Mon ami, dit-il enfin, tout cela est absurde.
— Absurde! exclama le baron.
— Sans doute.
— Ce n’est plus moi qui suis fou, c’est toi, dit encore Paul Morgan.
— Oh! tu crois?
— Je te dis que la fortune que mon oncle me laisse est une fortune volée.
— Soit.
— Et tu me trouves absurde de vouloir la restituer?
— Parfaitement.
— Mais tu es un homme d’honneur, pourtant, et je ne comprends pas...
— Je suis un homme d’honneur et un homme de bon sens, dit M. de Courtenay avec calme.
— Oh!
—Et si tu veux bien mettre à m’écouter la patience dont je viens de te donner l’exemple, je te le prouverai aussi clairement que deux et deux font quatre.
Paul Morgan regardait son interlocuteur avec une sorte d’effarement.
— Parle, dit-il enfin.
— Voyons, mon ami, reprit M. de Courtenay, le meilleur moyen de voir clair, c’est de récapituler les événements et de procéder par ordre.
Je n’ai pas lu la lettre de ton oncle que nous n’avons pas ouverte encore, mais je puis te réciter ce qu’elle contient.
— Ah! fit le baron de plus en plus stupéfait.
— Sans doute. Suis bien mon raisonnement. Ton père était un honnête homme, ton oncle un honnête homme, toi aussi; mais ton grand-père était un gredin. Passons. Le gredin en question a volé une fortune, je te l’accorde. Comment? Cela m’est tout à fait indifférent. Lui a-t-on confié de l’argent qu’il n’a pas rendu? Peut-être. A-t-il assassiné quelque pauvre diable qui avait sur lui un portefeuille gonflé de billets de caisse? Rien ne s’y oppose.
Cependant, avant cette précieuse confidence que ton brave homme d’oncle t’a faite avant sa mort, il était de notoriété publique que ton grand-père avait gagné un ou deux millions dans les fournitures des armées.
— Je te l’accorde, dit le baron qui ne savait réellement pas où son ami en voulait venir.
M. de Courtenay continua:
— A la gredinerie près, l’histoire de ton grand-père est celle d’un juif devenu un banquier célèbre. La Révolution éclate; un émigré qui fuit la guillotine lu confie cent mille francs. Suis-tu mon raisonnement?
— Parfaitement.
— Le juif fait ses affaires; il est laborieux, intelligent, il est honnête. Avec les cent mille francs de l’émigré, il gagne un million, puis deux, puis trois. L’émigré revient et réclame son argent:
«Voilà quinze cent mille francs, dit le juif. — Non, répond l’émigré, je vous ai prêté cent mille francs seulement; rendez-les-moi, nous sommes quittes.»
Et l’émigré avait raison.
— Mais que prouve cette histoire? demanda le baron Paul Morgan.
— Ceci: ton grand-père était un gredin, soit; il a volé cent mille francs, très-bien; mais il a gagné trois millions. Donne cent mille francs aux pauvres, double et triple cette somme si bon te semble, mais ne va pas plus loin.
Le baron secoua la tête.
— Ton raisonnement, dit-il, est spécieux, et il satisferait même certaines consciences indépendantes, mais la mienne le repousse.
— Tu es fou!
— Soit; mais mon oncle m’a ordonné, en mourant, de restituer; je ne garderai pas un sou de cette fortune.
— Alors, mon cher, dit M. de Courtenay, il faut être logique jusqu’au bout.
— Plaît-il?
— La fortune que tu as mangée avait la même source.
— Hélas! oui.
— Et tu as un créancier inconnu auquel, si tu es un honnête homme, tu rendras ce qui te reste, c’est-à-dire tes six mille livres de rente.
— Je le ferai, dit simplement le baron.
— En outre, tu devras, pour être logique, travailler toute ta vie pour reconstituer cet héritage évanoui et le restituer pareillemen; tôt ou tard.
— Mon beau-père futur m’associera à ses affaires, répliqua Paul Morgan.
— Si tu n’étais idiot, tu serais sublime, dit alors M. de Courtenay avec un accent d’ironie. Voyons maintenant à qui tu dois cette restitution.
— Je l’ignore.
— Mais la lettre de ton bon oncle te l’indiquera.
— Oui.
— Eh bien, je vais la chercher, nous verrons bien.
M. de Courtenay fit deux pas vers la porte; mais au moment d’en franchir le seuil, il se retourna:
— Encore une question, cher ami, dit-il.
— Voyons.
— Nous avons supposé que ton grand-père avait simplement volé une somme plus ou moins importante qui était l’origine de sa fortune.
— Oui.
— Mais rien ne nous empêche de penser qu’il a, pour se procurer cet argent, assassiné un monsieur.
— Eh bien? fit le baron en baissant la tête.
— Supposons alors que le monsieur n’ait pas eu d’enfant et qu’il n’ait laissé aucun héritier.
— Après?
— C’est donc à l’Etat, qui est au besoin l’héritier de tout le monde, que tu restitueras.
— Oui.
— Ma foi, mon ami, dit M. de Courtenay, Bayard n’était qu’un homme de tiède vertu auprès de toi, et je t’admire.
Sur ces mots, M. de Courtenay partit d’un éclat de rire et se dirigea vers la chambre du défunt.
Les indications, données par le vieillard à son neveu étaient exactes.
M. de Courtenay trouva tout de suite la fameuse lettre. Elle était volumineuse et enfermée dans une large enveloppe grise qui portait cette suscription:
A mon neveu, Paul Morgan, avec prière d’ouvrir cette lettre quinze jours après ma mort.
— Donc, dit M. de Courtenay en souriant, mon ami Paul est plus riche qu’il ne croit. Il a quinze jours devant lui, et quand on a quinze jours de réflexion, on ne renonce pas à cent cinquante mille livres de rente, surtout quand je suis là, moi!...