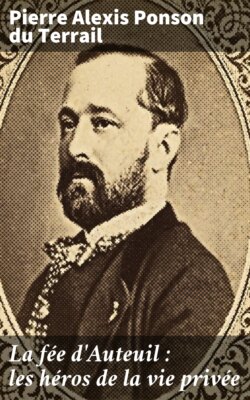Читать книгу La fée d'Auteuil : les héros de la vie privée - Pierre Alexis Ponson du Terrail - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE XI
ОглавлениеTable des matières
Quarante-huit heures après, à quatre heures du matin, l’express de Limoges à Paris entrait en gare avec M. le baron Paul Morgan et son ami Léon de Courtenay.
Le coupé de ce dernier les attendait.
— Mon bon ami, dit le viveur, jusqu’à présent j’ai un peu prêché dans le désert et je ne t’ai pas convaincu; mais j’espère que les huit jours qui nous restent te donneront le temps de réfléchir encore.
Le baron ne répondit pas.
— Sais-tu, poursuivit M. de Courtenay, que j’ai fait une singulière réflexion?
— Laquelle?
— Ton oncle s’est défié de toi et de lui.
— Comment cela?
— Il aurait fort bien pu écrire sur cette fameuse lettre: «A ouvrir aussitôt après ma mort.» Il ne l’a pas fait, il a voulu que tu eusses le temps de la réflexion. Il a pensé que la probité était peut-être par trop chevaleresque, et peut-être a-t-il pensé comme moi, qu’en restituant simplement la somme volée, tu aurais largement accompli ton devoir.
— Ce n’est pas mon opinion, dit froidement le baron qui, depuis deux jours, résistait aux paroles tentatrices de son ami.
— Voyons, cher, poursuivit M. de Courtenay, réfléchis à une chose encore.
— Laquelle?
— Nous vivons dans le siècle le plus positif, et, comme je te l’ai dit, l’amour sans argent est à peu près impraticable.
— Pauline est riche.
— Oui, mais son père qui est un brave homme de bourgeois ne s’est pas mis à pleurer, j’en suis sûr, en apprenant que tu partais pour enterrer ton oncle et recueillir trois millions.
— M. de Valserres est un honnête homme, dit le baron, et il pensera comme moi.
— Ou comme moi, dit Léon de Courtenay. Et puis, mon cher baron, songe que tu as huit jours devant toi; par conséquent, ne pensons plus à cette lettre jusqu’au moment où tu devras l’ouvrir.
— Soit, dit le baron.
— En outre, veux-tu un bon conseil?
— Parle.
— Attends huit jours pour dire un mot de tout cela, soit à ta fiancée, soit à son père.
— Pourquoi?
— Mais parce que, mon ami, il est toujours temps d’apprendre aux gens qui nous croient riche qu’on est pauvre.
Et comme M. Léon de Courtenay disait cela, son coupé qui était traîné par un trotteur très-vite s’arrêta à la porte de la maison que le baron Morgan habitait rue du Helder.
— J’ai ta parole, n’est-ce pas? dit-il en tendant la main.
— De ne rien dire à Pauline et à son père?
— Oui. Me la donnes-tu?
— Soit, répondit le baron.
Et il mit pied à terre et sonna, prenant à la main sa petite valise de voyage.
— Au revoir, dit M. de Courtenay; je viendrai te demander à déjeuner demain.
Et le coupé repartit.
Le baron monta chez lui.
Le vieil Antoine, qui attendait son maître depuis plusieurs jours, ne dormait que d’un œil, et il accourut à sa rencontre.
Paul Morgan était triste; mais sa douleur n’était plus bruyante comme au premier jour.
— Mon ami, dit-il à Antoine, je voudrais causer sérieusement avec toi.
Le vieillard, un peu étonné, suivit son jeune maître dans sa chambre à coucher, disant:
— Est-ce que monsieur le baron ne va pas se mettre au lit?
— Non, j’ai dormi en chemin de fer et je n’ai plus sommeil.
Antoine demeurait debout devant son maître et n’osait lui parler de son oncle défunt.
— Antoine, reprit le baron, depuis combien d’années es-tu au service de ma famille?
— Ma foi, monsieur, répondit le vieillard, j’ai soixante-dix ans bientôt et j’en avais quinze à peine lorsque votre grand-père me prit comme groom. Ça ne s’appelait pas comme ça, il est vrai, mais le métier était le même: je montais derrière le cabriolet, j’accompagnais M. le baron quand il sortait à cheval.
— Et mon grand père était riche alors?
— Oui, monsieur.
— Très riche?
— Oh! non pas comme il l’est devenu depuis.
— Vraiment!
— C’est surtout en 1814 que M. le baron a doublé sa fortune en échangeant des terrains considérables qu’il avait aux Champs-Elysées contre des maisons toutes bâties sur le boulevard de Gand.
— Mais enfin, quel chiffre de fortune pouvait-il avoir auparavant?
— Mon Dieu, monsieur le baron, dit Antoine, aujourd’hui on parle de cent mille francs de rente comme d’une aisance honnête; mais alors un homme qu’on qualifiait de millionnaire ne l’était pas toujours. Je suis bien sûr que M. le baron votre grand-père n’avait pas plus de sept ou huit cent mille francs quand 1814 arriva.
— C’est bien, Antoine, dit le baron; je te remercie. Va te coucher, mon ami. As-tu des lettres pour moi?
— Une seule, arrivée hier par la poste.
Antoine sortit et revint une minute après, un plateau à la main.
Le baron tressaillit en prenant la lettre qui se trouvait dessus. Il avait reconnu une mignonne écriture un peu allongée et qui trahissait une main de femme.
Antoine se retira discrètement, et le baron ouvrit la lettre avec empressement.
Quelle autre femme que Pauline de Valserres aurait pu lui écrire?
C’était elle, en effet; mais, dès les premières lignes, l’émotion joyeuse du baron fit place à un froncement de sourcils et à une légère pâleur.
Pauline écrivait:
«Mon ami,
M. Léon de Courtenay s’est chargé de nous apprendre la mort de votre excellent oncle et je partage toute votre douleur.
Mais j’espère que vous allez revenir à Paris, et je vous écris en hâte, en quelques mots, d’une main fiévreuse et tremblante, car votre Pauline est tourmentée depuis trois jours et livrée aux plus affreuses inquiétudes.
Mon père est parti précipitamment pour Londres lundi soir.
Nous étions à table, dans le jardin, causant de vous et de notre bonheur futur. Mon père paraissait être le plus heureux des hommes. Tout à coup on sonne; un domestique court à la grille et revient avec un homme que je reconnais pour l’employé du télégraphe.
Vous pensez bien qu’aujourd’hui que le télégramme est passé dans nos mœurs, la vue d’une dépêche ne saurait produire une grande émotion.
Eli bien, cependant, j’ai eu froid au cœur, et un pressentiment s’est emparé de moi.
La dépêche venait de Londres.
Mon père a pâli en la lisant.
— Mon enfant, m’a-t-il dit, il faut que je parte ce soir; il y va de sommes considérables. J’apprends que mes correspondants de Liverpool et de Dublin viennent de suspendre leurs payements.
J’ai vu mon père livrer souvent ce qu’il appelle des batailles financières et jouer ces parties hasardeuses avec un calme inouï.
Cette fois, il a paru comme terrassé. Voici trois jours qu’il est parti et je suis sans nouvelles.
Paul, mon ami, mon mari bientôt, aussitôt que vous serez arrivé, venez, je suis à demi folle de terreur et je me meurs d’inquiétude.
Votre Pauline désolée.»
Cette lettre échappa aux mains du baron, et une fois encore la figure grimaçante de Simon le mendiant traversa son cerveau épouvanté.