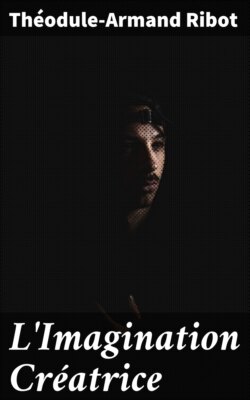Читать книгу L'Imagination Créatrice - Théodule-Armand Ribot - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеTable des matières
Je désigne sous ce nom — principalement non exclusivement — ce que le langage ordinaire appelle l’inspiration. Malgré son apparence mystérieuse et demi-mythologique, ce terme désigne un fait positif, mal connu dans son intimité, comme tout ce qui touche aux racines de la création. Cette conception a son histoire, et s’il est permis d’appliquer une formule très générale à un cas très particulier, on peut dire qu’elle s’est développée selon la loi des trois états admise par les positivistes.
À l’origine, l’inspiration est attribuée littéralement aux dieux : chez les Grecs, Apollon et les Muses ; de même, dans les diverses religions polythéistes. Puis, ce sont des esprits surnaturels, les anges, les saints, etc. D’une manière ou d’une autre, elle est toujours considérée comme extérieure et supérieure à l’homme. À l’origine de toutes les inventions : agriculture, navigation, médecine, commerce, législation, beaux-arts, il y a la croyance en une révélation : l’esprit humain se considère comme incapable d’avoir trouvé tout cela. La création a jailli, on ne sait comment, dans l’ignorance des procédés.
Plus tard, ces êtres supérieurs deviennent des formules vides, des survivances : il ne reste plus que les poètes qui les invoquent sans y croire, par tradition. Mais à côté de ces survivances de forme, il subsiste un fond mystérieux qu’on traduit par des expressions vagues et des métaphores : enthousiasme, délire poétique, être pris, possédé, « avoir le diable au corps », « l’esprit souffle quand il veut », etc. On est sorti du surnaturel, sans essayer toutefois une explication positive.
Enfin, dans une troisième phase, on cherche à sonder cet inconnu. La psychologie y voit une manifestation particulière de l’esprit, un état singulier, demi-inconscient, demi-conscient que nous devons étudier maintenant.
Tout d’abord, et considérée sous son aspect négatif, l’inspiration présente un caractère très net : elle ne dépend pas de la volonté individuelle ; comme pour le sommeil ou la digestion, on peut essayer des procédés qui la provoquent, la favorisent, la maintiennent ; mais on n’y réussit pas toujours. Les inventeurs, grands et petits, ne tarissent pas en plaintes sur les périodes de stérilité qu’ils subissent malgré eux : les plus sages attendent le moment ; les autres essaient de lutter contre leur mauvais sort et de créer contre nature.
Considérée sous son aspect positif, l’inspiration a deux marques essentielles : soudaineté, impersonnalité.
Elle fait dans la conscience une irruption brusque, mais qui suppose un travail latent, souvent très long. Elle a ses analogues dans d’autres états psychiques bien connus : par exemple, une passion qui s’ignore et qui, après une longue période d’incubation, se révèle par un acte ; ou bien une résolution soudaine, après des délibérations sans fin qui ne paraissaient pas devoir aboutir. Absence d’effort et en apparence de préparation. Beethoven frappait au hasard les touches d’un piano ou écoutait le chant des oiseaux. « Chez Chopin, dit G. Sand, la création était spontanée, miraculeuse ; il la trouvait sans la chercher, sans la prévoir : elle venait complète, soudaine, sublime. » On pourrait entasser des faits semblables à profusion. Quelquefois même l’inspiration surgit en plein sommeil et éveille le dormeur : et qu’on ne suppose pas que cette soudaineté est propre aux artistes ; elle se trouve dans toutes les formes d’invention. « Vous sentez un petit coup d’électricité qui vous frappe à la tête et vous saisit en même temps le cœur ; voilà le moment du génie (Buffon). » « J’ai eu dans ma vie quelques bonnes rencontres, dit Dubois-Reymond, et j’ai souvent remarqué qu’elles me venaient involontairement et lorsque je n’y pensais pas. » Cl. Bernard a fait plus d’une fois la même remarque.
L’impersonnalité est un caractère plus profond que le précédent. Elle révèle une puissance supérieure à l’individu conscient, étrangère à lui quoique agissant par lui : état que tant d’inventeurs ont exprimé en ces termes : Je n’y suis pour rien. Le meilleur moyen de la connaître serait de transcrire quelques observations empruntées aux inspirés eux-mêmes. Elles ne manquent pas et quelques-unes ont la valeur d’une bonne observation[14] ; mais cela nous entraînerait trop loin. Notons seulement que cette poussée de l’inconscient agit différemment suivant les individus. Les uns la subissent douloureusement, luttant contre elle à la manière de la pythonisse antique au moment de rendre son oracle. Les autres (surtout dans l’inspiration religieuse) s’abandonnent tout entiers, avec plaisir, ou subissent passivement. D’autres, plus analystes, ont observé la concentration de toutes leurs facultés et aptitudes sur un seul point. Mais, quelques caractères qu’elle revête, l’inspiration restant impersonnelle, dans son fond, ne pouvant venir de l’individu conscient, il faut (à moins de lui assigner une origine surnaturelle) admettre qu’elle dérive de l’activité inconsciente de l’esprit. Pour être fixé sur sa nature, il serait donc nécessaire d’être fixé d’abord sur la nature de l’inconscient, c’est-à-dire sur une des énigmes de la psychologie.
J’écarte comme oiseuses et inutiles à notre dessein toutes les discussions sur ce sujet. En définitive, elles se réduisent à deux thèses principales. Pour les uns, l’inconscient est une activité purement physiologique, une « cérébration ». Pour les autres, c’est une diminution graduelle de la conscience qui existe sans être reliée au moi, c’est-à-dire à la conscience principale. Les deux thèses sont pleines de difficultés et passibles d’objections presque insurmontables[15].
Prenons donc l’inconscient comme fait et bornons-nous, à titre d’éclaircissement, à rapprocher l’inspiration de quelques états mentaux qu’on a jugés propres à l’expliquer.
1º L’hypermnésie ou exaltation de la mémoire ne nous apprend rien, quoi qu’on en ait dit, sur la nature de l’inspiration ni de l’invention en général. Elle se produit dans l’hypnotisme, la manie, la période d’excitation de la folie circulaire, au début de la paralysie générale et surtout dans les épidémies religieuses sous la forme appelée « le don des langues ». On trouve, à la vérité, quelques observations (une de Régis entre autres où un marchand de journaux illettré compose des pièces de vers de son cru) qui montrent que l’exaltation de la mémoire s’accompagne quelquefois d’une certaine tendance à l’invention mais l’hypermnésie pure consiste en un afflux extraordinaire de souvenirs totalement dénué de la marque essentielle de la création : les combinaisons nouvelles. Il semble même que, entre les deux cas, il y a plutôt antagonisme ; l’exaltation de la mémoire se rapprochant de la loi idéale de réintégration complète qui est, nous le savons, un obstacle à l’invention. Ils ne se ressemblent que par la grande masse de matériaux disponibles ; mais là où le principe d’unité manque, il n’y a pas de création.
2º On a aussi rapproché l’inspiration de l’état d’excitation qui précède l’ivresse. C’est un fait bien connu que beaucoup d’inventeurs l’ont cherchée dans le vin, les liqueurs alcooliques, les substances toxiques (hachich, opium, éther, etc.) ; il est inutile de citer des noms. L’abondance des idées, la rapidité de leur cours, les saillies, boutades excentriques, aperçus nouveaux, l’exaltation du ton vital et émotionnel, bref cet état de verve dont les romanciers ont donné de bonnes descriptions, montrent au moins clairvoyant que l’imagination travaille bien au-dessus de l’ordinaire, sous l’influence naissante de l’ivresse. Cependant, combien cela est incolore comparé à l’action des poisons intellectuels précités, surtout du hachich ! Les « paradis artificiels » de Quincey, Moreau de Tours, Th. Gautier, Baudelaire et autres ont fait connaître à tous un prodigieux débridement de l’imagination lancée dans une course vertigineuse, sans limites quant au temps et à l’espace.
En définitive, ces faits ne représentent qu’une inspiration provoquée, factice, momentanée : ils ne nous font pas pénétrer dans sa nature vraie ; tout au plus ils nous instruisent sur quelques-unes de ses conditions physiologiques. Ce n’est même pas une inspiration au sens propre, mais plutôt un essai, un embryon, une ébauche, analogues aux créations qui se produisent dans les rêves et se trouvent fort incohérentes au réveil. Une des conditions essentielles de la création, un élément capital est absent : le principe directeur qui organise et impose l’unité. Sous l’influence des boissons alcooliques et des toxiques enivrants, l’attention et la volonté tombent toujours en défaillance.
3º Avec plus de raison, on a cherché à expliquer l’inspiration par analogie avec certaines formes de somnambulisme et l’on a dit « qu’elle n’est que le moindre degré d’un état second, le somnambulisme à l’état de veille. Dans l’inspiration, c’est comme un étranger qui dicte à l’auteur ; dans le somnambulisme, c’est cet étranger lui-même qui prend la parole ou la plume, parle, écrit, en un mot fait l’œuvre[16] ». Elle serait ainsi la forme mitigée d’un état qui est le triomphe de l’activité subconsciente et un cas de dédoublement de la personnalité. Comme l’on abuse singulièrement de ce dernier mode d’explication et qu’on l’invoque à tout propos, il est indispensable de préciser.
L’inspiré ressemble à un dormeur éveillé ; il vit dans son rêve. (On en donne des exemples qui paraissent authentiques : Shelley, Alfieri, etc.). Psychologiquement cela signifie qu’il y a chez lui une double interversion de l’état normal.
D’abord, la conscience monopolisée par le nombre et l’intensité des représentations est fermée aux actions du dehors ou ne les accepte qu’en les faisant entrer dans la trame de son rêve : la vie intérieure annihile la vie extérieure, ce qui est l’opposé de l’ordinaire.
De plus, l’activité inconsciente (ou subconsciente) passe au premier plan, joue le premier rôle, en conservant son caractère d’impersonnalité.
Ceci admis, si l’on veut aller plus loin, on se heurte à des difficultés croissantes. L’existence d’un travail inconscient est hors de doute : on pourrait donner des preuves de fait à profusion de cette élaboration obscure qui n’entre dans la conscience que quand tout est fini. Mais quelle est la nature de ce travail ? Est-il purement physiologique ? Est-il psychologique ? Nous revenons aux deux thèses adverses. Théoriquement, on peut dire que tout se passe dans l’inconscience comme dans la conscience, seulement sans message au moi, que dans la conscience claire le travail peut être suivi pas à pas, avec ses progrès et ses reculs ; que dans l’inconscient il procède de même, mais à notre insu. Il est clair que tout cela est une pure hypothèse.
L’inspiration ressemble à une dépêche chiffrée que l’activité inconsciente transmet à l’activité consciente, qui la traduit. Faut-il admettre que, dans les couches profondes de l’inconscient, il ne se forme que des combinaisons fragmentaires et qu’elles atteignent la systémation complète dans la conscience claire seulement ? ou bien le travail créateur est-il identique dans les deux cas ? Il est difficile de décider. Ce qui semble acquis, c’est que la génialité ou du moins la richesse dans l’invention dépend de l’imagination subliminale[17], non de l’autre, superficielle par nature et promptement épuisée. L’une est spontanée, vraie, l’autre factice, simulée. « Inspiration » signifie imagination inconsciente et n’en est même qu’un cas particulier. L’imagination consciente est un appareil de perfectionnement.
En somme, l’inspiration est le résultat d’un travail souterrain qui existe chez tous les hommes, à un très haut degré chez quelques-uns. La nature de ce travail étant inconnue, on ne peut rien conclure sur la nature dernière de l’inspiration. Par contre, on peut d’une manière positive fixer la valeur de ce phénomène dans l’invention ; d’autant plus qu’on est porté à la surfaire. Il faut bien remarquer en effet que l’inspiration n’est pas une cause, mais plutôt un effet — plus exactement un moment, une crise, un état aigu : c’est un indice. Elle marque ou bien la fin d’une élaboration inconsciente qui a pu être très courte ou très longue, ou bien le commencement d’une élaboration consciente qui sera très longue, ou très courte (ceci se rencontre surtout dans les cas de création suggérés par le hasard). D’une part, elle n’est jamais un commencement absolu ; d’autre part, elle ne livre jamais une œuvre achevée : l’histoire des inventions le prouve abondamment. Bien plus, on peut se passer d’elle : beaucoup de créations à incubation très longue paraissent exemptes de crise proprement dite : telles l’attraction de Newton, La Cène et La Joconde, de L. de Vinci. Enfin beaucoup se sont sentis réellement inspirés sans produire rien qui vaille[18].