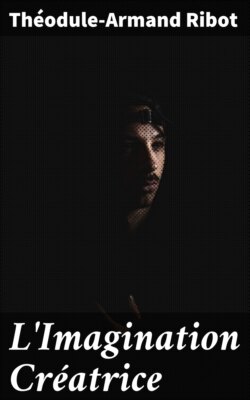Читать книгу L'Imagination Créatrice - Théodule-Armand Ribot - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеTable des matières
Reste un problème tellement obscur et énigmatique que j’ose à peine l’aborder. L’analogie que la plupart des langues — expression spontanée d’une pensée commune — établissent entre la création physiologique et la création psychique, n’est-elle qu’un rapprochement superficiel, un préjugé, une métaphore ou repose-t-elle sur quelque base positive ? Généralement, les diverses manifestations de l’activité mentale ont pour précurseur une forme inconsciente dont elles émergent. La sensibilité propre à la matière vivante connue sous les noms d’héliotropisme, chimiotropisme, etc., est comme une ébauche de la sensation et des réactions qui la suivent ; la mémoire organique est la base et la forme fruste de la mémoire consciente ; les réflexes préludent à l’activité volontaire ; les appétitions et tendances obscures sont les avant-courrières de la psychologie affective ; l’instinct, par quelques côtés, ressemble à un essai inconscient et spécifique de la raison : la puissance créatrice de l’esprit humain a-t-elle aussi des antécédents analogues, un équivalent physiologique ?
Un métaphysicien, Froschammer, qui a élevé l’imagination créatrice à la dignité de principe premier du monde, l’affirme hardiment. Pour lui, il y a une imagination objective ou cosmique qui travaille dans la nature, produit les innombrables variétés de formes végétales et animales ; puis, transformée en imagination subjective, devient dans le cerveau humain la source d’une forme nouvelle de création. « Le même principe fait apparaître les formes vivantes, sortes d’images objectives et les images subjectives, sorte de formes vivantes[24] ». Si ingénieuse et séduisante que soit cette théorie philosophique, évidemment, elle est sans aucune valeur positive pour la psychologie.
Restons dans l’expérience. La physiologie nous apprend que la génération est une « nutrition prolongée », un surplus, comme on le voit si clairement dans les formes inférieures de la génération agame (le bourgeonnement, la scissiparité). Elle aussi, la création imaginative, suppose une surabondance de vie psychique qui pourrait d’ailleurs se dépenser d’une autre manière. La génération dans l’ordre physique est une tendance spontanée, naturelle, bien qu’elle puisse recourir, avec succès ou non, à des procédés artificiels : on en peut dire autant de l’autre. Cette liste de ressemblances serait facile à étendre. Mais tout cela est insuffisant pour établir l’identité foncière des deux cas et trancher la question.
Il est possible de la limiter, de la poser en termes plus précis : Le développement de la fonction génératrice et celui de l’imagination sont-ils connexes ? Même sous cette forme, la question ne comporte guère que des réponses vagues. En faveur de la connexion on peut alléguer :
1º L’influence bien connue de la puberté sur l’imagination des deux sexes s’exprimant en rêveries, en aspirations vers un idéal insaisissable[25] : l’ingéniosité d’invention que l’amour donne aux moins doués. Rappelons aussi les troubles mentaux, les psychoses désignées sous le nom d’hébéphrénie. Avec l’adolescence coïncide la première floraison de la fantaisie qui, sortie des langes de l’enfance, ne s’est pas encore assagie et rationalisée.
Il n’est pas indifférent pour la thèse générale de cet ouvrage de noter que ce développement imaginatif dépend tout entier de l’effervescence première de la vie affective. Cette « influence des passions sur l’imagination » et « de l’imagination sur les passions » dont les moralistes et les anciens psychologues parlent si souvent, est une formule vague pour exprimer ce fait : que l’élément moteur inclus dans les images est renforcé.
2º Par contre, avec la vieillesse qui est, en résumé, une déchéance de la nutrition, une atrophie progressive, la décroissance de la faculté génératrice et celle de l’imagination constructive coïncident ; je néglige les exceptions. Il convient de ne pas omettre l’influence de la castration : d’après la théorie de Brown-Séquard, elle produirait un ralentissement des fonctions nutritives par suppression d’un stimulant interne ; et, quoique ses rapports avec l’imagination créatrice n’aient pas été étudiés spécialement, il n’est pas téméraire d’admettre qu’elle est plutôt une cause d’arrêt.
Toutefois, ce qui précède constate simplement, entre les deux fonctions comparées, une concomitance dans la marche générale de leur évolution et dans leurs périodes de crise : c’est insuffisant pour conclure. Il faudrait des observations nettes, authentiques et assez nombreuses, prouvant que des individus dépourvus d’imagination créatrice l’ont acquise brusquement par le seul fait des influences sexuelles ; inversement, que des imaginations brillantes se sont flétries dans des conditions contraires. On en trouve dans Cabanis[26], Moreau de Tours et divers aliénistes : elles seraient en faveur de l’affirmative ; mais quelques-unes me paraissent peu sûres, d’autres peu explicites. Malgré mes recherches sur ce point et une enquête auprès de gens compétents, je n’ose pas tirer une conclusion ferme. Je laisse donc la question ouverte ; elle tentera peut-être un autre qui sera plus heureux.
| [21] | Flechsig, Gehirn und Seele, 1896. |
| [22] | Pour des faits de ce genre, V. Oelzelt-Newin, Ouv. cité, 82-89. |
| [23] | Voir Deuxième partie, ch. iv. |
| [24] | Die Phantasie als Grundprincip der Weltprocesses, 1877. München. Pour quelques détails sur ce sujet, voir l’appendice C. |
| [25] | Un passage de Chateaubriand (cité par Paulhan, Rev. phil., mars 1898, p. 237), est une description typique de cette situation : « L’ardeur de mon imagination [d’adolescent], ma timidité, la solitude firent qu’au lieu de jeter au dehors, je me repliai sur moi-même ; faute d’un objet réel, j’évoquai par la puissance de mes vagues désirs un fantôme qui ne me quitta plus ; je me composai donc une femme de toutes les femmes que j’avais déjà vues. Cette charmeuse me suivait partout, invisible ; je m’entretenais avec elle comme avec un être réel ; elle variait au gré de ma folie ; Pygmalion fut moins amoureux de sa statue ». |
| [26] | Cabanis, Rapports du physique et du moral, édition Peisse, p. 248-249 : anecdote qu’il rapporte d’après Buffon. On trouvera aussi dans la Psychologie morbide de Moreau (de Tours) des faits analogues, mais moins nets. |