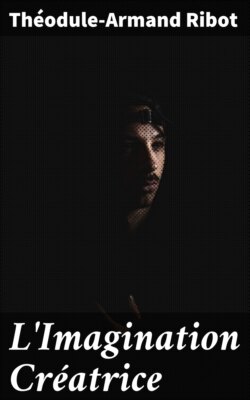Читать книгу L'Imagination Créatrice - Théodule-Armand Ribot - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеTable des matières
D’abord les conditions anatomiques. Existe-t-il un « siège » de l’imagination ? telle est la forme sous laquelle on eût posé la question, il y a vingt-cinq ans. À cette époque de localisations à outrance et étroitement circonscrites, on s’efforçait de rattacher chaque manifestation psychique à un point rigoureusement déterminé du cerveau. Aujourd’hui, le problème ne se présente plus de cette manière simpliste. Comme actuellement on incline vers des localisations disséminées, plutôt fonctionnelles que proprement anatomiques ; comme on entend souvent par « centre » l’action synergique de plusieurs centres différemment groupés suivant les cas, notre question équivaut à celle-ci : Y a-t-il certaines portions de l’encéphale qui ont un rôle exclusif ou prépondérant dans le travail de l’imagination créatrice ? Même sous cette forme, elle est à peine acceptable. En effet, l’imagination n’est pas une fonction primaire et relativement simple comme les sensations visuelles, auditives, etc. ; nous avons vu que c’est un état de formation tertiaire et très complexe. Il faudrait donc : 1º que les éléments constitutifs de l’imagination fussent déterminés d’une manière rigoureuse, or l’analyse qui précède n’a pas la prétention d’être définitive ; 2º que chacun de ces éléments constitutifs pût être rattaché rigoureusement à ses conditions anatomiques. Il est clair que nous sommes loin de posséder le secret d’un tel mécanisme.
On a essayé de poser le problème sous une forme plus précise et plus limitée, en étudiant le cerveau des hommes supérieurs à divers titres. Mais ce procédé, en tournant la difficulté, ne répond qu’indirectement à notre question : le plus souvent, les grands inventeurs possèdent d’autres qualités que l’imagination et qui leur sont indispensables pour réussir (Napoléon, J. Watt, etc.). Comment établir une division de manière à n’assigner à l’imagination que sa part légitime ? Par ailleurs, la détermination anatomique est pleine de difficultés.
Un procédé, très florissant vers le milieu du présent siècle, a consisté à peser minutieusement un grand nombre de cerveaux et à tirer de la comparaison des poids diverses conclusions sur la supériorité ou l’infériorité intellectuelle. On trouve sur ce point de nombreux documents dans les ouvrages spéciaux publiés à cette époque. Mais cette méthode des pesées a donné lieu à tant de surprises et d’explications difficiles qu’il a bien fallu se résigner à n’y voir qu’un des éléments du problème.
Actuellement, on accorde la plus grande importance à la morphologie du cerveau, à sa constitution histologique, au développement marqué de certaines régions, à la détermination non seulement des centres, mais des connexions et associations entre ces centres. Sur ce dernier point, les anatomistes contemporains se sont livrés à des recherches passionnées et bien que l’architecture cérébrale ne soit pas conçue par tous d’une manière identique, il convient pour la psychologie de noter que tous, avec leurs « centres » ou « systèmes d’association », essaient de traduire dans leur langue les conditions complexes de la vie mentale. Puisqu’il faut choisir entre ces diverses conceptions anatomiques, prenons celle de Flechsig : une des plus renommées et qui a aussi l’avantage de poser directement le problème des conditions organiques de l’imagination.
On sait que Flechsig s’appuie sur la méthode embryologique, c’est-à-dire sur le développement chronologique des nerfs et des centres. Pour lui, il existe d’une part, des sphères sensitives (sensori-motrices), qui occupent un tiers environ de la couche corticale ; d’autre part, des centres d’association occupant les deux autres tiers.
En ce qui concerne les centres sensoriels, le développement se fait dans l’ordre suivant : sensations organiques (milieu de l’écorce cérébrale), odorat (base du cerveau et partie des lobes frontaux), vision (lobe occipital), ouïe (première temporale). D’où il résulte qu’en une certaine partie du cerveau, le corps arrive à la conscience propre de ses impulsions, besoins, appétits, douleurs, mouvements, etc., et que cette partie se développant la première, « la connaissance du corps précède celle du monde extérieur ».
En ce qui concerne les centres d’association, Flechsig en admet trois : le grand centre d’association postérieure (pariéto-occipito-temporal) ; un autre beaucoup plus petit, antérieur ou frontal ; et un centre moyen, le plus petit de tous (Insula de Reil). L’anatomie comparée prouve que les centres d’association sont plus importants que les centres sensitifs. Seuls chez les mammifères inférieurs, ils se développent à mesure que l’on s’élève : « Ce qui fait l’homme psychique, ce sont les centres d’association qu’il possède. » Chez le nouveau-né, les centres sensitifs sont isolés et, faute de connexions entre eux (elles n’apparaissent que beaucoup plus tard), l’unité du moi ne peut se produire ; il y a pluralité de consciences.
Ceci admis, revenons à notre question particulière que Flechsig pose en ces termes : « Sur quoi repose le génie ? Tient-il à une structure particulière du cerveau ou bien à une irritabilité particulière, c’est-à-dire, d’après nos idées actuelles, à des facteurs chimiques ? Nous pouvons soutenir la première opinion avec toute l’énergie possible. Le génie est toujours uni à une structure particulière, à une organisation particulière du cerveau. » Toutes les parties de cet organe n’ont pas la même valeur. On a longtemps admis que la portion frontale peut servir de mesure pour la capacité intellectuelle ; mais il faut en outre admettre d’autres régions ; « principalement un centre placé sous la protubérance du sommet de la tête, qui est très développée chez tous les hommes de génie dont le cerveau a été étudié jusqu’à nos jours. Chez Beethoven et probablement aussi chez Bach, l’énorme développement de cette portion du cerveau est frappante. Chez de grands savants, comme Gauss, les centres de la partie postérieure du cerveau et ceux de la région frontale sont fortement développés. Le génie scientifique montre ainsi d’autres proportions dans la structure du cerveau que le génie artistique[21] ». Donc il y aurait, d’après notre auteur, prépondérance des régions frontales et pariétales ; celles-ci dominent surtout chez les artistes et les deux autres chez les savants. Déjà, vingt ans avant Flechsig, Rüdinger avait remarqué le développement extraordinaire des circonvolutions pariétales chez les hommes supérieurs, d’après l’étude de dix-huit cerveaux : toutes les circonvolutions et scissures étaient, dit-il, si développées que la région pariéto-occipitale présentait un caractère tout particulier.
En somme, sur les conditions anatomiques, même en puisant aux meilleures sources, il faut reconnaître que, pour le présent, on ne peut émettre que des vues fragmentaires, incomplètes, hypothétiques. Passons à la physiologie.