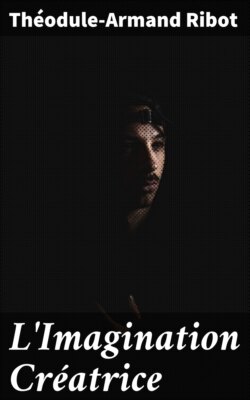Читать книгу L'Imagination Créatrice - Théodule-Armand Ribot - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеTable des matières
On a pu se demander à bon droit si les états physiologiques qui coexistent avec le travail de l’imagination créatrice sont la cause, l’effet ou simplement l’accompagnement de ce travail. Probablement les trois cas se rencontrent. D’abord la concomitance se constate en fait et on peut la considérer comme une manifestation de l’organisme, parallèle à celles de l’esprit. D’autre part, l’emploi de moyens artificiels pour provoquer et maintenir l’effervescence de l’imagination, assigne aux conditions physiologiques un rôle de cause ou d’antécédent. Enfin, le travail psychique peut être initial, produire des changements dans l’organisme ou, s’ils existent déjà, les augmenter et les prolonger.
Les cas les plus instructifs sont ceux qui se traduisent par des manifestations bien nettes et des modifications profondes dans l’état du corps. Tels sont les moments d’inspiration ou simplement d’ardeur au travail qui surgissent sous la forme de poussées brusques.
Le fait général et dominateur consiste en changements dans la circulation sanguine. L’accroissement d’activité intellectuelle suppose une augmentation de travail dans les cellules de l’écorce, qui dépend elle-même d’un état congestif, quelquefois d’une anémie passagère. L’hyperhémie paraît plutôt la règle ; mais on sait aussi qu’une anémie légère augmente l’excitabilité corticale. « Pouls petit, contracté, la peau pâle, froide, la tête bouillante, les yeux brillants, injectés, égarés » : telle est la description classique, souvent reproduite, de l’état physiologique pendant le travail de la création ; et ils sont nombreux les inventeurs qui, d’eux-mêmes, ont noté ces modifications : irrégularité du pouls chez Lagrange ; congestion de la tête chez Beethoven qui usait de douches froides pour y remédier, etc.[22] Cette élévation du ton vital, cette tension nerveuse se traduit aussi dans l’ordre moteur par des mouvements analogues aux réflexes, sans but propre, répétés machinalement et toujours les mêmes chez le même homme : agitation des pieds, des mains, des doigts ; tailler une table ou un bras de fauteuil comme Napoléon, quand il élaborait un projet, etc. C’est une dérivation pour le trop plein d’influx nerveux, et l’on admet que ce mode de dépense n’est pas inutile pour conserver à l’intelligence toute sa lucidité. En somme, augmentation de la circulation cérébrale aux dépens de la circulation locale : telle est la formule qui résume le plus grand nombre des observations sur ce point.
L’expérimentation proprement dite nous apprend-elle quelque chose sur ce point ? Des recherches physiologiques nombreuses et très connues (celles de Mosso principalement) nous apprennent que tout travail intellectuel et surtout émotionnel cause une congestion cérébrale ; que le volume du cerveau augmente et que celui des organes périphériques diminue ; mais cela ne nous révèle rien de spécial sur l’imagination, qui n’est qu’un cas particulier de la règle. À la vérité, dans ces derniers temps, on s’est proposé d’étudier les inventeurs par une méthode objective : (examen des divers appareils, circulatoire, respiratoire, digestif ; de la sensibilité générale et spéciale ; des modalités de la mémoire et des formes d’association, des procédés de travail intellectuel, etc.) ; mais, jusqu’ici, de ces descriptions individuelles aucune conclusion n’a été tirée qui comporte quelque généralité. Au reste, une expérience, dans le sens strict du mot, a-t-elle jamais été faite au moment psychologique ? Je n’en connais aucune ; et serait-elle possible ? Admettons que par un hasard heureux, l’expérimentateur disposant de tous ses moyens d’investigation, puisse tenir son sujet sous sa main à l’instant précis de l’inspiration, de la poussée brusque et féconde, bref de la création ; l’expérience ne serait-elle pas par elle-même une cause de perturbation, en sorte que le résultat serait vicié ipso facto, au moins peu probant ?
Il y a encore un ensemble de faits qui méritent d’être rappelés sommairement : les bizarreries des inventeurs. En recueillant uniquement celles qu’on peut tenir pour authentiques, on ferait un gros volume. Malgré leur apparence anecdotique et frivole, ces documents ne me paraissent pas tout à fait à dédaigner.
Il m’est impossible d’entrer ici dans une énumération qui serait sans fin. Après avoir rassemblé pour mon instruction personnelle un grand nombre de ces étrangetés, il m’a semblé qu’elles sont réductibles à deux catégories.
1º Les bizarreries inexplicables qui dépendent de la constitution de l’individu et plus encore probablement de quelques événements de la vie dont le souvenir s’est perdu : Schiller, par exemple, qui gardait des pommes pourries dans sa table de travail.
2º Les autres, bien plus nombreuses, sont aisées à expliquer, ce sont des moyens physiologiques, choisis consciemment ou inconsciemment pour faciliter le travail de la création ; ce sont des auxiliaires, des adjuvants de l’inspiration.
Le procédé le plus fréquent consiste à augmenter l’afflux du sang au cerveau par des moyens artificiels. Rousseau méditait la tête découverte en plein soleil, Bossuet travaillait dans une chambre froide, la tête enveloppée de fourrures ; d’autres plongeaient leurs pieds dans l’eau glacée (Grétry, Schiller). Très nombreux sont ceux qui méditent « horizontalement », c’est-à-dire étendus et quelquefois blottis sous leur couverture (Milton, Descartes, Leibniz, Rossini, etc.).
Quelques-uns ont besoin d’excitations motrices ; il ne trouvent qu’en marchant ou bien ils préludent au travail par l’exercice physique (Mozart). À titre de variante, rappelons ceux qui ont besoin du bruit des rues, des foules, des conversations, des fêtes, pour inventer. À d’autres, il faut la pompe extérieure et une mise en scène personnelle (Machiavel, Buffon, Guido Reni qui ne peignait que magnifiquement vêtu, ses élèves rangés autour de lui le servant en respectueux silence).
À l’opposé sont ceux qui ont besoin du recueillement, du silence, de la claustration et même des ténèbres comme Lamennais. Dans cette catégorie se rencontrent surtout les savants et penseurs : Tycho-Brahé qui pendant vingt et un ans sortit à peine de son observatoire, Leibniz qui pouvait rester trois jours dans un fauteuil presque sans remuer, etc.
Mais la plupart des procédés sont trop artificiels ou trop énergiques pour ne pas devenir rapidement nuisibles. Tout le monde les connaît : abus du vin, des alcooliques, des narcotiques, du tabac, du café, etc., — veilles prolongées, moins pour augmenter le temps du travail que pour provoquer un état d’hyperesthésie et de susceptibilité morbide (Goncourt).
En somme, les bases organiques de l’imagination créatrice, s’il en est qui lui soient propres, restent à déterminer ; car dans tout ce qui précède, il ne s’agit que des conditions du travail de l’esprit en général — assimilation aussi bien qu’invention. Les excentricités des inventeurs étudiées dans le détail et avec soin seraient peut-être finalement la matière la plus instructive ; parce qu’elle nous font pénétrer dans leur individualité intime. Ainsi la physiologie de l’imagination devient rapidement une pathologie. Je n’insiste pas, ayant volontairement éliminé l’étude morbide de notre sujet ; il sera pourtant nécessaire d’y revenir pour l’effleurer dans une autre partie de cet Essai[23].