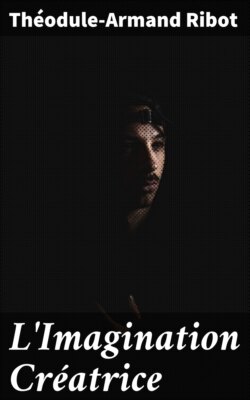Читать книгу L'Imagination Créatrice - Théodule-Armand Ribot - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеTable des matières
Ce qui précède n’épuise pas l’étude du facteur inconscient, comme source de combinaisons nouvelles. Son rôle peut être étudié sous une forme plus simple et plus restreinte ; pour cela il faut revenir une dernière fois à l’association des idées. La raison ultime de l’association (la contiguïté exclue, en partie du moins) doit être cherchée dans le tempérament, le caractère, l’individualité, souvent même dans le moment, c’est-à-dire dans une influence passagère, à peine saisissable parce qu’elle est inconsciente ou subconsciente. Ces dispositions momentanées à forme latente peuvent susciter des rapprochements nouveaux par deux procédés : les associations médiates et un mode particulier de groupement qui a reçu récemment le nom de « constellation ».
1º L’association médiate est bien connue depuis Hamilton qui, le premier, en a fixé la nature et en a donné un exemple personnel qui est devenu classique : (Le lac Ben Lomond lui rappelant le système prussien d’éducation, parce que, en visitant ce lac, il rencontra un officier prussien qui l’entretint de ce sujet.) Sa formule générale est celle-ci : A évoque C quoiqu’il n’y ait entre eux ni contiguïté ni ressemblance, mais parce qu’un moyen terme B, qui n’entre pas dans la conscience, sert de transition de A à C. Ce mode d’association paraissait universellement accepté, lorsque, dans ces derniers temps, il a été contesté par Münsterberg et quelques autres. On a recouru à l’expérimentation qui n’a donné que des résultats assez peu concordants[19]. Pour ma part, je me rallie aux contemporains qui l’admettent et c’est le plus grand nombre. Scripture, qui a fait de ce sujet une étude spéciale et qui a pu noter tous les intermédiaires depuis la conscience presque claire jusqu’à l’inconscient, « considère l’existence de l’association médiate comme prouvée ». Pour déclarer illusoire un fait qui se rencontre si fréquemment dans l’expérience journalière et qui a été étudié par tant d’excellents observateurs, il faudrait mieux que des recherches expérimentales, dont les conditions sont souvent factices et artificielles et dont quelques-unes d’ailleurs concluent pour l’affirmative.
Cette forme d’association se produit comme les autres tantôt par contiguïté, tantôt par ressemblance. L’exemple donné par Hamilton appartient au premier type. Dans les expériences de Scripture, il s’en trouve du second type : ainsi une lumière rouge rappelle par le souvenir vague de l’éclat du strontium une scène d’opéra.
Il est évident que, par sa nature, l’association médiate peut donner lieu à des combinaisons nouvelles. La contiguïté elle-même qui n’est à l’ordinaire qu’une répétition, devient la source de rapprochements imprévus, grâce à l’élimination du moyen terme. Rien ne prouve d’ailleurs qu’il n’y ait pas quelquefois plusieurs intermédiaires latents : il se peut que A suscite D par l’entremise de b et de c qui restent au-dessous de la conscience. Il semble même impossible de ne pas l’admettre dans l’hypothèse de la subconscience où nous ne voyons que les deux anneaux extrêmes de la chaîne, sans pouvoir admettre entre eux une solution de continuité.
2º Dans sa détermination des causes régulatrices de l’association des idées, Ziehen désigne l’une d’elles sous le nom de « constellation » qui a été adopté par quelques auteurs. Ce fait peut s’énoncer ainsi : L’évocation d’une image ou d’un groupe d’images est, dans quelques cas, le résultat d’une somme de tendances prédominantes.
Une idée peut être le point de départ d’une foule d’associations. Le mot Rome peut en susciter des centaines. Pourquoi l’une est-elle évoquée plutôt qu’une autre et à tel moment plutôt qu’à tel autre ? Il y a des associations fondées sur la contiguïté et la ressemblance que l’on peut prévoir, mais le reste ? Voici une idée A ; elle est le centre d’un réseau ; elle peut rayonner en tout sens B, C, D, E, F, etc. ; pourquoi évoque-t-elle maintenant B, plus tard F ?
C’est que chaque image est assimilable à une force de tension qui peut passer à l’état de force vive et, dans cette tendance, elle peut être renforcée ou entravée par d’autres images. Il y a des tendances stimulatrices et des tendances inhibitoires. B est à l’état de tension et C ne l’est pas, ou bien D exerce sur C une influence d’arrêt : par suite C ne peut prévaloir ; mais une heure plus tard les conditions sont changées et la victoire reste à C. Ce phénomène repose sur une base physiologique : l’existence de plusieurs courants à l’état de diffusion dans le cerveau et la possibilité de recevoir des excitations simultanées[20].
Quelques exemples feront mieux comprendre ce phénomène de renforcement, en suite duquel une association prévaut. Wahle rapporte que l’Hôtel de Ville gothique situé près de sa maison ne lui avait jamais suggéré l’idée du Palais des Doges à Venise, malgré certaines ressemblances architecturales, jusqu’à un certain jour où cette idée surgit avec beaucoup de clarté : alors, il se rappela que deux heures auparavant il avait remarqué une dame portant une belle broche en forme de gondole. J. Sully fait justement remarquer qu’il est bien plus facile de se rappeler les mots d’une langue étrangère quand nous revenons du pays où on la parle, que quand nous séjournons depuis longtemps dans le nôtre ; parce que la tendance au rappel est renforcée par l’expérience récente des mots entendus, parlés, lus et par tout un ensemble de dispositions latentes qui agissent dans le même sens.
À mon avis, on trouverait les plus beaux exemples de « constellation » considérée comme élément créateur, en étudiant la formation et le développement des mythes. Partout et toujours, l’homme n’a guère eu comme matière que les phénomènes de la nature (le ciel, la terre, l’eau, les astres, l’orage, le vent, les saisons, la vie et la mort, etc.). Sur chacun de ces thèmes, il fabrique des milliers d’histoires explicatives qui oscillent du grandiose à la plus ridicule puérilité. C’est que chaque mythe est l’œuvre d’un groupe humain qui a travaillé selon les tendances de son génie propre, sous l’influence des divers moments de sa culture intellectuelle. Nul procédé n’est plus riche en ressources, de plus libre allure ni plus apte à donner ce que tout inventeur promet : le nouveau et l’imprévu.
En somme, l’élément initial, externe ou interne, suscite des associations qu’on ne peut jamais prévoir, à cause des nombreuses orientations possibles : cas analogue à ce qui se passe dans l’ordre de la volonté, lorsqu’il y a en présence tant de raisons pour et contre, d’agir et de ne pas agir, dans tel sens ou tel autre, maintenant ou plus tard, que la résolution ne peut être prédite et dépend souvent de causes insaisissables.
En terminant, je préviens une question possible : Le facteur inconscient diffère-t-il en nature des deux autres ? La réponse dépend de l’hypothèse qu’on adopte sur la nature même de l’inconscient. D’après l’une, il serait surtout physiologique, par suite différent. D’après l’autre, la différence ne peut exister que dans les procédés : l’élaboration inconsciente est réductible à des processus intellectuels ou affectifs dont le travail préparatoire est ignoré et qui n’entre dans la conscience que tout fait ; par suite le facteur inconscient serait une forme particulière des deux autres plutôt qu’un élément distinct de l’invention.
| [14] | On en trouvera plusieurs dans l’appendice A. |
| [15] | Voir sur ce sujet, l’appendice B. |
| [16] | Dr Chabaneix, Le subconscient sur les Artistes, les Savants et les Écrivains, Paris, 1897, p. 87. |
| [17] | Le cas récent, étudié avec tant de sens par M. Flournoy, dans son livre : Des Indes à la planète Mars, 1900, est un exemple d’imagination créatrice subliminale et du travail dont elle est capable à elle seule. |
| [18] | Nous reviendrons sur ce point dans une autre partie de ce travail. Voir 2e partie, ch. iv. |
| [19] | Ainsi Howe (American Journal of Psychology, VI, 2) a publié des recherches dans le sens négatif. Une série de 557 expériences lui a donné huit associations d’apparence médiate ; après examen, il les réduit à une seule qui lui paraît douteuse. Une autre série de 961 expériences donne 72 cas pour lesquels il propose une autre explication que l’association médiate. D’autre part, Aschaffenburg les admet dans la proportion de 4% ; le temps d’association est plus long que pour les associations moyennes (Psychologische Arbeiten, I et II). Consulter particulièrement Scripture, The New Psychology, ch. xiii, avec expériences à l’appui de sa conclusion. |
| [20] | Ziehen, Leitfaden der physiologischen Psychologie, 4e édit., 1898, p. 164, 174. J. Sully, Human Mind, I, 343. |