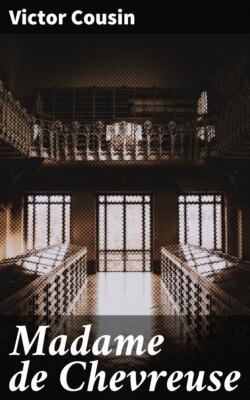Читать книгу Madame de Chevreuse - Victor Cousin - Страница 6
CHAPITRE DEUXIÈME
1623-1626
ОглавлениеLA DUCHESSE DE CHEVREUSE BIEN DIFFÉRENTE DE LA DUCHESSE DE LUYNES.—FAUTE DE POUVOIR AIMER SON NOUVEAU MARI, ELLE SE DONNE A LA REINE ANNE, DONT L'INTÉRÊT, BIEN OU MAL ENTENDU, DEVIENT SON PRINCIPAL ET CONSTANT OBJET.—ANNE D'AUTRICHE OPPRIMÉE PAR MARIE DE MÉDICIS, MME DE CHEVREUSE LA CONSOLE ET AUSSI LA COMPROMET.—ELLE AIME LE COMTE DE HOLLAND, AMBASSADEUR D'ANGLETERRE, ET ELLE TACHE D'ENGAGER LA REINE AVEC BUCKINGHAM.—ELLE ACCOMPAGNE AVEC SON MARI LA NOUVELLE REINE D'ANGLETERRE A LONDRES. SES SUCCÈS A LA COUR DE CHARLES IER.—HOLLAND ET BUCKINGHAM LA METTENT DANS LEURS INTRIGUES CONTRE RICHELIEU.—QUE BUCKINGHAM N'A JAMAIS ÉTÉ SON AMANT.—LA RÉSISTANCE DE LA REINE ANNE AU MARIAGE DE MONSIEUR AVEC MLLE DE MONTPENSIER, SUSCITE UNE CONSPIRATION A LAQUELLE MME DE CHEVREUSE PREND UNE GRANDE PART.—HENRI DE TALLEYRAND, COMTE DE CHALAIS.—ODIEUSE CONDUITE DU DUC D'ORLÉANS QUI TRAHIT TOUS SES COMPLICES.—FAIBLESSE DE CHALAIS EN PRISON POUSSÉE JUSQU'A LA BASSESSE. TROMPÉ PAR RICHELIEU, IL S'EMPORTE CONTRE MME De CHEVREUSE ET LA DÉNONCE, PUIS SE RÉTRACTE, ET MEURT AVEC COURAGE.—PREMIER EXIL DE MME DE CHEVREUSE.
Luynes au tombeau, la reine mère, Marie de Médicis, reprit son ascendant sur le faible Louis XIII, qui céda à la nécessité, et auquel on donna, pour l'amuser, un nouveau favori sans conséquence, le jeune, aimable et insignifiant Baradat. Elle s'empressa aussi de faire part de sa nouvelle puissance à celui qui l'avait si bien servie dans ses prospérités à la fois et dans ses disgrâces. En 1622, l'évêque de Luçon obtint enfin ce chapeau de cardinal dont le désir passionné lui avait fait rechercher dans les derniers temps la faveur et l'alliance [35] de Luynes qui, tout aussi fin que lui, et discernant bien l'usage que l'ambitieux évêque pourrait faire de cette haute dignité, la lui promit, mais sans se presser de la lui donner. Puis, en avril 1624, le nouveau cardinal rentra en triomphateur dans le cabinet, et commença ce second et glorieux ministère qui dura près de vingt années, et qui diffère essentiellement du premier. Il n'y porta pas en effet la politique du maréchal d'Ancre, mais celle-là même qu'il avait tant combattue dans Luynes. Comme lui, il ne se hâta point de rompre la paix avec l'Espagne, et parce que la reine mère, sa protectrice, était tout Espagnole, et parce qu'il lui importait avant tout de raffermir au dedans l'ordre ébranlé par tant de secousses [36]. Il acheva la complète incorporation du Béarn et de la Navarre à la France, et repoussa fermement les prétentions usurpatrices des protestants, en attendant que le moment fût venu de renouveler la campagne de 1621, de refaire le siége de Montauban et de soumettre La Rochelle. Il avait vu de près à Angers autour de la reine mère, dans les tristes affaires de 1620, l'égoïsme des grands, leur peu de foi, leur ambition déréglée, leur avidité insatiable; et forcé de les ménager d'abord, il se proposait bien de ne pas subir longtemps leur joug et de ne leur livrer ni la royauté ni la France. Ceux-ci à leur tour ne tardèrent pas à reconnaître que sur le cadavre de Luynes il s'était élevé un second Luynes, bien plus redoutable que le premier; et, selon leur habitude, après s'être empressés autour du nouveau favori de Marie de Médicis, comme ils l'avaient fait en 1617 autour du favori de Louis XIII, dès qu'ils désespérèrent de le gouverner au profit de leur vanité et de leur fortune, ils se mirent à recommencer leurs vieilles intrigues, et Richelieu vit bientôt s'agiter contre lui ses anciens complices d'Angers, couvrant habilement leurs vues personnelles d'un apparent dévouement à Monsieur, le jeune duc d'Anjou, qui sera bientôt le duc d'Orléans, et, bien entendu, s'appuyant sur l'étranger, sur la catholique Espagne ou sur la protestante Angleterre, sur le remuant duc de Lorraine, et particulièrement sur l'ambitieuse Savoie, impatiente de s'agrandir à tout prix et aux dépens de qui que ce soit, l'Italie, l'Autriche ou la France. C'est ainsi que Richelieu fut amené peu à peu à rompre avec son ancien parti, et plus tard avec le chef de ce parti, Marie de Médicis elle-même. Mais n'anticipons pas sur les événements, et bornons-nous à bien marquer ce point essentiel, qu'au début même de son second ministère, au lieu de continuer le conspirateur de 1620, Richelieu se montra le vrai successeur de Luynes et reprit tous ses desseins, mais avec le génie qui a rendu son nom immortel.
Pendant que s'accomplissait dans la pensée ou plutôt dans la situation du grand cardinal, cet important et heureux changement, un autre en sens contraire se faisait aussi dans la duchesse de Luynes, devenue la duchesse de Chevreuse. Comme elle ne choisissait pas son but elle-même, mais le recevait des mains de la personne qui l'intéressait, après avoir servi avec fidélité et dévouement Luynes, qu'elle aimait, n'ayant pas retrouvé dans M. de Chevreuse un mari fait pour la captiver, elle se donna tout entière à la reine Anne, sa maîtresse et son amie; et l'intérêt, bien ou mal entendu, de la reine la jeta dans une tout autre voie que celle qu'elle avait jusqu'alors suivie. En sorte que le même caractère, dans des circonstances diverses, lui dicta tour à tour les conduites les plus opposées.
Du temps de Luynes, et grâce à ses soins, le jeune roi avait fini par aimer tendrement sa femme; il s'était complu à l'entourer d'honneur et de considération, et lorsqu'il était parti pour la grande et brillante campagne de 1620, il l'avait laissée à Paris à la tête du gouvernement. Mais l'orgueilleuse Marie de Médicis, en reprenant possession de son pouvoir, relégua dans l'ombre la jeune reine; on dit même qu'elle s'appliqua et réussit à éloigner d'elle Louis XIII, afin de régner sur lui sans partage. Anne d'Autriche, Espagnole et fière, et en même temps belle, jeune, ayant besoin d'aimer et d'être aimée, ressentit amèrement les nouvelles froideurs de son mari, qu'elle croyait avoir vaincues; toute sa consolation était la compagnie de sa vive et hardie surintendante. Nous avons ici le témoignage de la véridique et si bien informée Mme de Motteville.
«La reine Marie de Médicis s'étant raccommodée avec le roi, la paix entre la mère et le fils brouilla le mari et la femme; et la reine mère étant persuadée que pour être absolue sur ce jeune prince, il falloit que cette jeune princesse ne fût pas bien avec lui, elle travailla avec tant d'application et de succès à entretenir leur mésintelligence, que la reine, sa belle-fille, n'eut aucun crédit ni aucune douceur depuis ce temps-là. Toute sa consolation étoit la part que la duchesse de Luynes, qui étoit remariée avec le duc de Chevreuse, prince de la maison de Lorraine, prenoit à ses chagrins, qu'elle tâchoit d'adoucir par tous les divertissements qu'elle proposoit, lui communiquant, autant qu'elle pouvoit, son humeur galante et enjouée pour faire servir les choses les plus sérieuses et de la plus grande conséquence de matière à leur gaieté et à leur plaisanterie: A giovine cuor tutto è gioco [37].»
La cour de France était alors très-brillante, et la galanterie à l'ordre du jour. C'était le temps où la marquise de Sablé soutenait et accréditait de son esprit et de sa beauté les maximes chevaleresques que les Espagnols avaient empruntées des Mores. Elle prétendait «que les hommes pouvoient sans crime avoir des sentiments tendres pour les femmes, que le désir de leur plaire leur donnoit de l'esprit et leur inspiroit de la libéralité et toutes sortes de vertus; et que, d'un autre côté, les femmes, qui étoient l'ornement du monde et faites pour être servies et adorées, ne devoient souffrir des hommes que leurs respects [38].» Anne, dans son pays, avait été de bonne heure accoutumée à ces maximes, et elle était fort portée à les mettre en pratique. Belle et sensible, elle aimait à plaire, et dans l'injuste abandon où la laissait Louis XIII, elle ne s'interdisait point de recevoir des hommages. La Rochefoucauld, qui l'a bien connue, dit «qu'avec beaucoup de vertu, elle ne s'offensoit pas d'être aimée [39].» Elle le fut, et Mme de Motteville ne fait pas difficulté de nous apprendre que le beau et vaillant duc Henri de Montmorenci conçut de tendres sentiments pour elle, et que même le héros de l'ancienne galanterie, le grand écuyer de Bellegarde, déjà un peu sur le retour de l'âge, lui fit une cour assez publique, sans que la réputation de la reine en eût éprouvé la moindre atteinte. Mais les choses ne se passèrent pas toujours ainsi. Mme de Chevreuse, qui n'avait pas la piété et la sagesse d'Anne d'Autriche, ne se retint pas longtemps sur la pente glissante de l'amour platonique; elle céda aux séductions de la jeunesse et du plaisir, et elle manqua d'y entraîner sa maîtresse. De là bien des fautes, dont nous détournerions les yeux si elles ne se liaient à d'importants événements, et n'exprimaient de la façon la plus frappante ce mélange de la galanterie et de la politique, qui est l'un des traits particuliers des mœurs de l'aristocratie et de la haute société au XVIIe siècle.
En l'année 1624, le cardinal de Richelieu avait repris une des meilleures pensées de Luynes, et renoué la négociation autrefois commencée pour faire épouser au prince de Galles, fils du roi d'Angleterre, la troisième fille d'Henri IV, la dernière sœur de Louis XIII. D'abord, ce mariage empêchait celui du prince anglais avec une infante d'Espagne, dont il était question depuis assez longtemps, et qui eût été un accroissement redoutable de la puissance espagnole en Europe. L'alliance anglaise nous était aussi fort précieuse, parce qu'elle promettait d'enlever à la faction protestante de France l'appui de l'Angleterre, et ce n'est pas la faute des plus sages desseins si quelquefois des circonstances imprévues les renversent. L'amour vint ici, contre sa coutume, seconder la politique. Le prince de Galles, en traversant la France, avait vu la belle et aimable Henriette-Marie, et il en était devenu éperdument épris; il pressa donc son père de demander pour lui la main de la princesse, et Jacques Ier envoya à Paris, outre son ministre accoutumé, deux ambassadeurs extraordinaires pour traiter cette grande affaire, qui fut conclue le 10 novembre 1624. L'un des deux ambassadeurs, et le principal, était Henri Rich, lord Kensington, de la maison de Warwick, premier comte de Holland, celui qui joua un rôle dans la révolution d'Angleterre, commanda un moment l'armée royale, et monta, en 1649, sur le même échafaud que lord Capel et lord Hamilton. Il devint amoureux de Mme de Chevreuse. Il était jeune et bien fait [40]; il lui plut. Voilà, selon nous, le vrai début de Mme de Chevreuse dans l'amour coupable et dans les intrigues de toute espèce où elle a consumé sa vie.
A la mort de Jacques Ier, le prince de Galles, devenu roi d'Angleterre sous le nom de Charles Ier, au mois de mars 1625, ordonna à ses ambassadeurs d'abréger tous les délais et de hâter la cérémonie des fiançailles. Grâce au crédit de Holland et de son ami Buckingham, favori du nouveau roi comme il l'avait été du précédent, Charles Ier choisit le duc de Chevreuse, grand chambellan de France, pour épouser Madame en son nom et pour la conduire en Angleterre: en même temps, on obtint de Louis XIII que le duc emmènerait avec lui sa femme qui devait être une des parures du cortége. Cet arrangement donnait aux deux amants le moyen de se voir souvent et l'espoir de ne pas se séparer trop vite.
Holland était un homme de plaisir et d'intrigue. Il exerça une mauvaise influence sur Mme de Chevreuse. Il prit sur elle un tel empire, qu'il lui persuada d'engager sa royale maîtresse dans quelque belle passion semblable à la leur, et il lui désigna son ami, le premier ministre d'Angleterre, le beau, le brillant, le magnifique Buckingham, comme le seul homme qui pût être agréé de la reine de France. Anne d'Autriche et Buckingham ne s'étaient jamais vus. Il fallait leur ménager l'occasion de se voir et de s'entendre. Les deux galants conspirateurs «trouvèrent toutes les facilités qu'ils désiroient auprès de la reine et du duc de Buckingham [41]». Celui-ci, qui était tout aussi léger que Holland et aimait passionnément les aventures extraordinaires, se fit envoyer par Charles Ier en France pour l'y représenter particulièrement et faire plus d'honneur à la nouvelle reine. Il partit de Londres en toute hâte, arriva à Paris le 24 mai, et descendit dans ce bel hôtel de Luynes de la rue Saint-Thomas-du-Louvre qui s'appelait alors l'hôtel de Chevreuse [42]. Il se montra à la cour «avec plus d'éclat [43], de grandeur et de magnificence que s'il eût été roi. La reine lui parut encore plus aimable que son imagination ne la lui avoit pu représenter, et il parut à la reine l'homme du monde le plus digne de l'aimer. Ils employèrent la première audience de cérémonie à parler d'affaires qui les touchoient plus vivement que celles des deux couronnes, et ils ne furent occupés que des intérêts de leur passion [44].» Le duc de Buckingham resta sept jours à Paris [45], «retardant son départ le plus qu'il lui étoit possible, et se servant de sa qualité d'ambassadeur pour voir la reine [46].» Le 2 juin, la nouvelle reine d'Angleterre quitta Paris et s'achemina à petites journées vers Calais. Marie de Médicis et la reine Anne accompagnèrent leur fille et leur belle-sœur jusqu'à Amiens. Le duc de Chaulnes, gouverneur de la ville, leur fit une réception magnifique, et c'est là que se passa la scène fameuse où Anne d'Autriche apprit à ses dépens que le jeu qu'elle jouait était mal sûr. Buckingham était entreprenant, Mme de Chevreuse fort complaisante, et la reine ne se sauva qu'à grand'peine. «Un soir, dit La Rochefoucauld [47], que la reine se promenoit assez seule dans un jardin, le duc de Buckingham y entra avec le comte de Holland, dans le temps que la reine se reposoit dans un cabinet. Ils se trouvèrent seuls; le duc étoit hardi, l'occasion favorable, et il essaya d'en profiter avec si peu de respect, que la reine fut contrainte d'appeler ses femmes et de leur laisser voir une partie du trouble et du désordre où elle étoit.» Quand, quelques jours après, Buckingham vint officiellement prendre congé d'elle, il la trouva en voiture avec la princesse de Conti; en s'inclinant à la portière pour baiser le bout de sa robe, il lui fallut se couvrir un peu du rideau pour cacher les larmes qui lui échappaient. Anne d'Autriche fut si émue que la princesse de Conti, qui était à côté d'elle, lui dit en badinant qu'elle pouvait répondre au roi de sa vertu, mais non pas de sa cruauté, et que les larmes de cet amant avaient dû attendrir son cœur, puisque ses yeux l'avaient du moins regardé avec quelque pitié [48]. Le duc de Buckingham partit «passionnément amoureux de la reine et tendrement aimé d'elle [49].» Arrivé à Boulogne et près de passer la mer, «par un emportement que l'amour seul rend excusable,» il feignit d'avoir reçu du roi Charles une lettre qui l'obligeait de retourner sur ses pas pour avoir une nouvelle conférence avec la reine mère; et en revenant à Amiens, après avoir entretenu Marie de Médicis de l'affaire simulée qui lui avait servi de prétexte, il s'en alla bien vite saluer une dernière fois la reine Anne. «Elle était au lit [50]; il entra dans sa chambre, se jetta à genoux devant elle, et fondant en larmes, il lui tenoit les mains. La reine n'étoit pas moins touchée, lorsque la comtesse de Lannoi, sa dame d'honneur, s'approcha du duc et lui fit approcher un siége en lui disant qu'on ne parloit point à genoux à la reine. Le duc de Buckingham remonta à cheval en sortant et reprit le chemin d'Angleterre.» Ajoutez que la reine s'était fort bien prêtée à cette visite, ou que du moins elle la connaissait; car à Boulogne, Buckingham avait fait part à Mme de Chevreuse de la démarche où l'entraînait sa passion, et celle-ci s'était empressée de l'écrire à la reine [51].
Telles sont les romanesques et téméraires aventures dans lesquelles Mme de Chevreuse et lord Holland embarquèrent la reine de France. Grâce à Dieu, elles se sont arrêtées là: Anne et Buckingham ne se sont jamais revus.
Sur la fin de juin, Mme de Chevreuse arriva à Londres avec le cortége royal. Elle effaça toutes les beautés de la cour d'Angleterre [52]. Pour reconnaître l'hospitalité qu'il avait reçue à l'hôtel de Chevreuse, le duc de Buckingham «fit paroître toute sa magnificence et celle d'un royaume dont il étoit le maître: il reçut l'amie de la reine avec tous les honneurs qu'il auroit pu rendre à la reine elle-même [53].» Déjà Mme de Chevreuse était fort liée avec la reine Henriette-Marie, et elle plut infiniment à Charles Ier. Elle fit la conquête de plus d'un seigneur anglais, par exemple lord Montaigu, et le comte Guillaume de Craft, page de la nouvelle reine, jeunes cavaliers brillants et frivoles, mais dont plus tard le dévouement ne lui fit jamais défaut. Elle fut aussi très-vivement frappée de la puissance maritime de la Grande-Bretagne; elle admira la flotte [54] qu'on équipait alors et qui bientôt devait se tourner contre nous. Comme on le pense bien, Holland la dirigea pendant tout ce voyage, et ne négligea rien pour faire valoir les brillantes et solides qualités de celle qu'il aimait. Il en parlait sans cesse au roi Charles et aux ministres, la présentant comme une personne que l'Angleterre devait attacher à ses intérêts; en même temps il écrivait à Richelieu des merveilles de la conduite habile de Mme de Chevreuse, des services qu'elle rendait, de son crédit sur le roi et sur la reine, et en leur nom il appelait sur elle les grâces de la cour de France [55]. En vain le cardinal, instruit des menées secrètes de Mme de Chevreuse avec Buckingham et avec le cabinet anglais, pressait le retour du grand chambellan et de sa femme: l'adroite duchesse affectait en public de vouloir revenir en France, et sous main, à l'aide de Buckingham et de Holland, elle se faisait inviter par Charles Ier à rester quelque temps encore. Elle en avait une bien bonne raison, et qui n'était pas feinte: elle était dans un état de grossesse avancée, et c'est à Londres qu'elle mit au jour la première fille qu'elle ait eue du duc de Chevreuse, et dont la reine d'Angleterre a été la marraine, la future abbesse du Pont-aux-Dames [56].
Quoi qu'en dise Retz, nous sommes persuadé que Buckingham n'a jamais été autre chose à Mme de Chevreuse que l'intime ami de son amant, le chef du parti dans lequel Holland l'entraîna. Nous ne saurions où placer les amours de Buckingham avec Mme de Chevreuse. Elle le vit pour la première fois en France, en mai 1625, et alors Buckingham était dans toute l'ivresse de sa passion pour la reine Anne; elle le revit bientôt après à Londres, mais avec Holland, qui la conduisait, et, Retz le dit lui-même, quand elle aimait, c'était fidèlement et uniquement. Ce n'est pas à vingt-quatre ans qu'on se moque à ce point d'un premier attachement, et le rôle de la pauvre femme n'est déjà pas assez beau dans cette affaire pour se complaire à l'enlaidir encore. Elle se trouva mal, il est vrai, en apprenant la nouvelle de l'assassinat de Buckingham. Rien de plus naturel: elle perdait en lui un ami éprouvé, le confident de ses premières amours, son plus solide appui dans les luttes où elle était engagée. Aux propos hasardés de Retz, nous opposons le récit bien lié de La Rochefoucauld, et le silence de Tallemant, qui n'aurait pas manqué d'ajouter ce trait à sa chronique scandaleuse, s'il en avait jamais entendu parler. Ainsi, sans avoir la prétention de voir bien clair en pareilles choses, surtout après deux siècles, mais en suivant notre habitude de ne rien admettre que sur des témoignages certains, nous estimons qu'on doit rayer Buckingham de la liste, encore trop nombreuse, des amants de Mme de Chevreuse.
Mais il est difficile de n'y pas mettre le beau, le léger et malheureux Chalais.
C'est encore son dévouement à la reine Anne qui jeta Mme de Chevreuse dans cette conspiration «la plus effroyable, dit Richelieu, dont jamais les histoires aient fait mention,» et où, dit-il encore, «Mme de Chevreuse fit plus de mal que personne [57].» En voici le fond et les principales circonstances.
Ainsi que nous l'avons dit, Anne d'Autriche souffrait de l'orgueil et de la domination de Marie de Médicis; mais le chemin qu'elle avait pris pour relever ou adoucir sa situation l'avait empirée. La reine mère n'avait pas manqué de se faire une arme contre elle auprès du roi des imprudences que nous avons racontées. Déjà, sous un spécieux prétexte, on lui avait ôté Mme de Chevreuse comme surintendante de sa maison [58]; mais leur commune disgrâce n'avait fait que resserrer leurs liens. A son retour d'Angleterre, encore toute pleine des magnificences de Buckingham et des vives marques de sa passion pour la reine [59], Mme de Chevreuse ne cessait d'en entretenir Anne d'Autriche, de réveiller et d'animer ses souvenirs [60]. De son côté Buckingham brûlait du désir de revoir la reine, et il fit toute sorte d'efforts pour retourner en France, sous divers prétextes politiques [61]. Mais Richelieu et le roi n'étaient pas tentés de lui ouvrir les portes du Louvre. D'ailleurs les espérances d'intime union entre la France et l'Angleterre que le mariage de madame Henriette avait fait naître, s'étaient rapidement évanouies, et se tournaient en menaces d'une prochaine rupture. Le contrat de mariage de Madame lui garantissait, de la façon la plus positive, la plus grande liberté religieuse, une chapelle, un père de l'Oratoire pour confesseur, d'abord le père de Bérulle, puis le père de Sanci, et un évêque pour grand aumônier, avec un clergé convenable. Mais l'ombrageux calvinisme de l'Angleterre se souleva contre le spectacle du culte catholique à Londres, au sein du palais du roi, et Buckingham persuada au roi Charles qu'il n'était pas obligé d'observer scrupuleusement des stipulations qui blessaient l'opinion publique de son pays et compromettaient son gouvernement. On renvoya donc la plus grande partie des officiers et des dames que la reine avait amenés avec elle [62], et on lui composa une maison tout anglaise. On la gêna de toutes les manières dans l'exercice de sa religion, on tourmenta les prêtres français et leur chef, l'évêque de Mende; on alla jusqu'à dire ouvertement à la reine que l'intérêt du roi son mari exigeait qu'elle se fît protestante [63]. Voilà comme on entendait alors en Angleterre la liberté religieuse. Charles Ier aimait la belle Henriette, qui joignait aux grâces de sa personne un esprit insinuant et le cœur de la fille d'Henri IV. Buckingham craignit qu'elle ne prît de l'ascendant sur le roi et ne diminuât cette absolue autorité qui le faisait maître de la cour et de tout le royaume. Le jaloux et ambitieux favori s'appliqua donc, par toute sorte de manœuvres déplorables, à mettre assez mal ensemble le roi et la jeune reine; et celle-ci, malgré sa douceur et sa patience, fut bientôt réduite à faire connaître à sa mère, Marie de Médicis, et à son frère, Louis XIII, l'oppression dans laquelle elle gémissait: elle demandait même à revenir en France. Enfin l'amiral des Rochelois, l'obstiné et audacieux Soubise, le frère du duc de Rohan, s'était emparé de plusieurs vaisseaux français: pour ne pas les rendre après l'accommodement passager qu'on avait fait avec les protestants de La Rochelle, il les avait menés dans un port anglais, et au mépris de la foi publique on faisait difficulté de les restituer. Mais Richelieu n'était pas homme à supporter de pareils affronts, et il adressait à Londres d'énergiques réclamations [64]. Les deux gouvernements s'aigrissaient de jour en jour davantage. Buckingham et Richelieu se regardaient d'un œil ennemi; ils voyaient bien qu'ils ne s'entendraient jamais, et travaillèrent à se détruire. Richelieu comptait sur l'opposition toujours croissante du parlement qui venait de mettre en accusation l'incapable et présomptueux ministre de Charles; Buckingham comptait sur nos éternelles divisions, sur cette faction protestante vaincue mais non pas soumise, dont il tenait un des chefs dans sa main à Londres, prêt à le lancer contre la France, sur le mécontentement peu dissimulé des grands, qui n'admettaient point qu'un ministre prétendît gouverner dans l'intérêt général et non dans leur intérêt particulier, et s'apprêtaient à tirer l'épée contre Richelieu, comme ils l'avaient fait contre Luynes et contre le maréchal d'Ancre. Il y avait dans l'air un bruit sourd de conspirations et de révoltes [65].
C'est sur ces entrefaites que la reine mère et le roi songèrent à établir Monsieur, qui atteignait sa dix-huitième année. Ils lui destinèrent Marie de Bourbon, la fille unique du dernier duc de Bourbon Montpensier, princesse aimable et la plus riche héritière du royaume. Ce projet réunissait toutes sortes d'avantages, mais il blessait Anne d'Autriche qui, n'ayant pas d'enfants, redoutait une belle-sœur qui pouvait en avoir, et deviendrait alors toute-puissante par l'ombre seule du trône qui l'attendait après la mort du roi. Ce mariage lui semblait le comble de la disgrâce, le dernier coup porté à toutes ses espérances. Elle se décida à «tout faire pour empêcher ce mariage,» comme elle le dit elle-même à Mme de Motteville: aveu bien grave qu'il importe de recueillir [66]. Mme de Chevreuse embrassa la cause de la reine avec son ardeur accoutumée et cet énergique dévouement qui ne recule devant aucun danger, ni aussi devant aucun scrupule.
Il s'agissait d'amener Monsieur à refuser le mariage qu'on lui proposait. Mais on ne pouvait arriver à Monsieur que par un homme qui était en possession de sa confiance et presque de sa personne, son gouverneur, le surintendant général de sa maison et le chef de ses conseils, Ornano, le fils du célèbre colonel corse et maréchal de ce nom, lui-même longtemps colonel général des Corses et fait tout récemment maréchal; personnage très-considérable, à la fois politique et militaire. La reine s'adressa donc au maréchal [67]. Ainsi c'est elle qui a donné le branle à cette affaire; tout le reste n'a été qu'une suite de moyens jugés successivement nécessaires pour atteindre le but marqué. Or, marcher à un but quel qu'il fût par tous les moyens quels qu'ils fussent, pourvu qu'ils promissent d'y conduire, c'était là précisément le génie de Mme de Chevreuse.
Elle connaissait depuis longtemps Ornano: il avait été l'un des complices les plus résolus de Luynes dans l'entreprise contre le maréchal d'Ancre, et c'est à Luynes qu'il devait sa charge auprès de Monsieur. Il avait rassemblé autour de lui et tenait dans sa main la plupart des anciens amis du connétable, Modène, Déagent, Marsillac et d'autres, tous gens de tête et de cœur, impatients de n'être plus rien et capables de tout oser. Lui-même était aussi hardi qu'ambitieux. Maître du frère du roi, il le poussait sans cesse à prendre dans l'État la place que lui donnait sa naissance, afin que la sienne s'en élevât d'autant. Lorsque le jeune prince avait obtenu de faire partie du conseil, Ornano avait demandé à l'accompagner et à y siéger avec le rang et le titre de secrétaire d'État. Le refus qu'il avait essuyé l'avait irrité contre Richelieu, et son inquiète ambition commençait à chercher d'autres voies. Mme de Chevreuse n'eut donc pas grand'peine à le gagner à la cause de la reine. Elle lui envoya d'ailleurs la belle princesse de Condé à qui le maréchal faisait une sorte de cour, et qui acheva de le décider. La princesse agissait dans l'intérêt des Condé, naturellement opposés à un mariage qui plaçait au-dessus d'eux dans la maison royale les Montpensier leurs cadets, et Mr le Prince, après avoir autrefois engagé sa fille, la future duchesse de Longueville, au prince de Joinville, le fils aîné du duc de Guise, rêvait de la faire épouser au duc d'Orléans, afin de confondre les deux familles et d'approcher toujours un peu plus du trône. Les Soissons pensaient en cela comme les Condé, et le jeune comte désirait pour lui-même Mlle de Montpensier. Sa mère, Mme la Comtesse, avait un grand ascendant sur Alexandre de Vendôme, grand prieur de France, personnage aussi redoutable par son audace que par ses artifices, et qui, lui aussi, comme Ornano, croyait avoir à se plaindre du cardinal, auprès duquel il avait en vain sollicité de pouvoir traiter avec le duc de Montmorency de la charge de grand amiral. Il avait aisément entraîné son frère aîné, César de Vendôme, gouverneur de Bretagne, qui, portant très-haut le nom de fils de Henri IV, trouvait toujours qu'on ne lui rendait pas ce qui lui était dû à lui et aux siens, et depuis la mort de son père s'était jeté dans tous les complots des grands. Tous ensemble avaient fait effort auprès de Monsieur, et ils avaient réussi à le détourner du mariage qui portait atteinte à leurs intérêts et contrariait tant la reine. Quelles raisons lui donnèrent-ils? Leur suffit-il de présenter à son goût du plaisir l'attrait d'une indépendance prolongée, ou de faire rougir sa vanité d'une docilité qui lui donnerait l'air d'un enfant entre les mains de sa mère, de son frère et du cardinal, et lui ôterait toute importance en France et en Europe? Ou firent-ils briller à ses yeux la perspective d'une autre alliance, par exemple, celle d'une princesse étrangère qui le mettrait hors de la dépendance du roi de France et lui permettrait de jouer un plus grand rôle? Ou enfin osèrent-ils lui laisser entrevoir la main même de la jeune et belle Anne d'Autriche, après la mort du roi, que faisaient paraître imminente et sa mauvaise santé et des prédictions d'astrologues? Le bruit de ce dernier projet s'est au moins fort répandu, et il a passé dans les mémoires du temps. La reine a toujours protesté qu'elle n'avait jamais trempé dans une aussi coupable pensée, si elle était venue à l'esprit de personne, et nous l'en croyons; mais nous connaissons assez Mme de Chevreuse pour être assuré qu'elle ne se serait pas fait le moindre scrupule de compromettre la reine pour la mieux servir, et que, comme l'en accuse Richelieu [68], elle n'hésita pas, sans en parler à la reine, à bercer d'une semblable espérance les oreilles crédules du jeune prince, si elle jugea qu'elle pouvait par là le décider et arriver à ses fins. Elle fit bien davantage.
«Mme de Chevreuse, dit La Rochefoucauld [69], avoit beaucoup d'esprit, d'ambition et de beauté; elle étoit galante, vive, hardie, entreprenante. Elle se servoit de tous ses charmes pour réussir dans ses desseins.» Or, il y avait alors dans la maison même du roi, et tout près de sa personne, comme maître de la garde-robe, un jeune et brillant gentilhomme qui avait été nourri et élevé avec Louis XIII, et qu'il aimait beaucoup: Henri de Talleyrand, comte de Chalais, d'une ancienne maison souveraine du Périgord, et de plus, par sa mère, petit-fils du maréchal de Montluc. Quoiqu'il ne fût que le cadet de sa maison, il en était le représentant le plus en vue. Il avait vingt-huit ans [70]; il était bien fait, et à des manières agréables [71] il joignait cette bravoure téméraire qui ne déplaît pas aux dames. Il avait fait avec honneur la terrible campagne de 1621 contre les protestants, et s'était distingué aux siéges de Montpellier et de Montauban. Il sortait d'un duel qui avait fait beaucoup de bruit et où il avait tué le comte de Pongibault, de la maison de Lude. Maître de la garde-robe, il se plaignait d'un emploi qui le condamnait à l'oisiveté, et demandait instamment celui de maître général de la cavalerie légère. Il était entré fort avant dans la société et la confiance du duc d'Orléans, à ce point que les domestiques du prince ne croyaient pas lui faire mieux leur cour qu'en témoignant à Chalais une grande déférence. Il se prit d'une passion extraordinaire pour Mme de Chevreuse [72]; elle l'encouragea, et le précipita au plus épais de la ligue déjà toute formée autour de Monsieur pour empêcher son mariage avec Mlle de Montpensier.
Ornano était, avec Mme de Chevreuse, l'âme de cette ligue. Quoi qu'en dise Richelieu, il ne fut jamais question de porter la main sur le roi, nul n'y pensa, et ce n'est là qu'un sinistre épouvantail jeté par le cardinal sur toute cette affaire: c'est bien assez qu'on n'y puisse méconnaître un de ces crimes d'État que le succès seul peut absoudre, comme quelques années auparavant il avait absous le complot de Luynes: fatal souvenir, trompeuse analogie qui égara Ornano et Mme de Chevreuse: elle était trop jeune encore pour savoir ce qu'une longue expérience lui fit si bien comprendre à la fin de la Fronde, quelle différence c'est en France d'avoir le roi pour soi ou contre soi.
Averti des menées du maréchal au dedans et au dehors, sûr de la reine mère et sûr aussi du roi qui lui déclara qu'il voulait lui servir de second dans cette rencontre, Richelieu, le 4 mai 1626, fit arrêter Ornano à Fontainebleau même, et l'envoya à Vincennes avec la ferme intention de lui faire son procès. Cette arrestation inattendue tomba comme la foudre sur la tête des conspirateurs. C'en était fait, non pas seulement de leurs desseins, mais de leurs personnes, si on instruisait le procès d'Ornano, et il n'y eut parmi eux qu'une seule pensée et un seul cri: délivrer le maréchal. Ils s'adressèrent donc à Monsieur, et le pressèrent d'obtenir du cardinal la liberté de son gouverneur, et, s'il n'y parvenait pas, comme ils s'y attendaient bien, de recourir à l'un de ces deux moyens: ou sortir de la cour, protester hautement, et se retirer dans quelque lieu sûr, ou s'en prendre au cardinal et se défaire de celui qui leur faisait obstacle. Pendant tout le mois de mai ils ne cessèrent de représenter avec force cette alternative au jeune prince; ils agitèrent avec lui les deux partis à prendre, et tour à tour le poussèrent à l'un et à l'autre. Il est établi:
1o Qu'une fois l'un des deux partis, et le plus violent, celui de se défaire du cardinal, fut arrêté; qu'en conséquence Monsieur, avec les conjurés les plus résolus, devait aller trouver le cardinal à sa maison de campagne de Fleury, et là le poignarder, s'il refusait de mettre en liberté le maréchal; qu'il y eut en effet une tentative d'exécution, que le jeune duc, bien accompagné, se rendit à Fleury, mais que le cœur lui manqua, et que le cardinal, averti, se tira d'affaire;
2o Que le comte de Soissons offrit 400,000 écus à Monsieur pour quitter la cour et commencer la guerre;
3o Que Monsieur envoya un de ses aumôniers, l'abbé d'Obasine, au duc d'Épernon, en Guyenne, pour l'inviter à se déclarer en sa faveur; et Chalais, un de ses gentilshommes, en Lorraine, à Metz, au marquis de La Valette, pour lui demander de les recevoir dans cette place;
4o Que Monsieur avait écrit en Piémont à sa sœur et à son beau-frère, Victor-Amédée, et qu'il entretenait une correspondance avec l'Angleterre; que le duc de Savoie, qui conspirait la perte de Richelieu comme il avait fait celle de Luynes et auparavant celle de Henri IV, avait promis un secours de dix mille hommes, et Buckingham une puissante diversion, et en désespoir de cause un inviolable asile.
La plus grande partie du mois de mai se perdit en conversations et en tentatives infructueuses. Cependant Monsieur était allé trouver Richelieu et s'était plaint de l'arrestation de son gouverneur, disant qu'autant il eût valu l'arrêter lui-même, car il était coupable si le maréchal l'était. Il le prit d'abord assez haut, mais Richelieu le prit plus haut encore; il répondit au prince qu'il s'agissait de crimes effroyables, et finit par l'intimider, ce qui n'était pas difficile. Le roi et la reine mère se mirent de la partie, et, moitié en le caressant, moitié en lui montrant un visage sévère, le 31 mai, ils lui firent jurer sur les saints évangiles de ne jamais se séparer du roi et de porter loyalement à sa connaissance tout ce qu'il apprendrait qui pût être contraire à son service. On lui fit signer un écrit, évidemment dressé par Richelieu, et qu'il a inséré dans ses Mémoires, par lequel le duc prenait l'engagement solennel de n'être qu'un cœur et qu'une âme avec sa mère et son frère. Le faible jeune homme jura et signa tout ce qu'on voulut, mais sans se croire engagé à rien, et en faisant ses réserves mentales [73]. En effet, au milieu des pathétiques effusions du 31 mai, et tout en jurant à son frère de l'instruire de tout ce qu'il apprendrait contre son service, il ne lui dit pas un mot de la conspiration qui se tramait, et de retour parmi ses amis, sans leur rien dire aussi de ce qui venait de se passer, il leur renouvela toutes les promesses qu'il leur avait faites, et reprit avec eux les délibérations commencées.
Le duc de Vendôme se préparait à lui offrir une retraite assurée dans son gouvernement de Bretagne. Il armait en secret, mettait ses places fortes en ordre, nouait des intelligences avec La Rochelle, et engageait le duc Henri de Montmorenci, grand amiral de France, à ménager la flotte des protestants qui ne périraient pas, disait-il, sans un immense dommage de l'aristocratie française, laquelle avait besoin d'eux pour s'y appuyer dans l'occasion. Richelieu s'aperçut des mouvements du duc de Vendôme, et, sentant de quelle importance il était d'étouffer l'insurrection à sa naissance dans une grande province voisine de La Rochelle et ouverte à l'Angleterre, il persuada au roi de s'y porter de sa personne pour y rétablir son autorité menacée. Il s'avança donc vers Nantes, et le duc de Vendôme et le grand-prieur n'ayant pu se dispenser, sans afficher la révolte, de venir présenter leurs hommages au roi, le cardinal, le 12 juin, se saisit des deux frères et les envoya dans la citadelle d'Amboise. Il connaissait alors si peu la portée et les chefs de la conspiration, qu'en partant pour Nantes il avait laissé derrière lui, à Paris, le comte de Soissons pour y commander au nom du roi. Monsieur y était aussi. Plus que jamais on le pressa de se déclarer et de se joindre au comte de Soissons. Le duc promettait toujours, parlait beaucoup et ne faisait rien. Un ordre du roi l'appela près de lui à Nantes; il s'y achemina à petites journées.
Privée d'Ornano et du grand-prieur, à demi vaincue, mais ne désespérant pas d'elle-même, Mme de Chevreuse n'avait plus qu'une ressource, mais qui, bien employée, pouvait tout rétablir ou tout remettre en question, l'influence de Chalais sur Monsieur, et elle s'en servit jusqu'au dernier moment avec la constance, l'audace et l'adresse qui déjà la distinguaient. Chalais restait le dernier sur la scène. Sans cesse aiguillonné par Mme de Chevreuse, enflammé et soutenu par l'espoir de plaire à la belle duchesse, de conquérir son cœur et sa personne, il ne perdit pas une occasion de pousser Monsieur du côté par où il penchait, fuir et se jeter dans quelque place forte, Metz ou La Rochelle. Il s'était ménagé d'utiles auxiliaires dans les deux jeunes favoris du jeune duc, Puylaurens et Bois-d'Annemetz, tous deux hardis et résolus; il avait avec eux de secrètes conférences, et ils réussirent ensemble à persuader au prince de quitter la cour. A Blois, il paraissait décidé: il voulait se retirer à La Rochelle; ses deux favoris l'en dissuadèrent par motif de religion. Il envoya son aumônier au duc d'Épernon avec un billet qu'il écrivit de sa main et que lui dicta Bois-d'Annemetz [74]. Il reçut là un courrier du comte de Soissons, lui offrant de l'argent et des troupes [75]. Chalais se chargea de préparer sa retraite et de lui ménager partout de libres passages; il se chargea aussi d'envoyer un messager à La Valette, et disait à Bois-d'Annemetz et à Puylaurens: «Vous voyez comme je me confie en vous; s'il se savoit quelque chose de notre dessein, vous feriez La Mole et Coconas, et moi quelque chose de par-dessus [76].» A Nantes même, le plan de la fuite de Monsieur fut arrêté: ce devait être pendant une grande chasse, et la chose sembla moins manquer par la volonté du duc que par de fortuites circonstances.
Tandis que Chalais travaillait ainsi à satisfaire Mme de Chevreuse, pour tromper et endormir Richelieu il lui faisait une cour assidue, et lui donnait même quelquefois des renseignements utiles [77]. Mais il n'était pas de force à jouer longtemps un semblable jeu avec le vigilant, soupçonneux et pénétrant cardinal. Plus d'une fois, étonné et incertain devant des apparences et des allures si contraires, Richelieu se demandait et demandait autour de lui: Qu'est-ce que Chalais [78]? La plus lâche trahison le lui apprit. Chalais avait confié une partie de ses secrets à un de ses amis, Roger de Gramont, comte de Louvigni, le dernier des enfants du comte de Gramont, gouverneur de Bayonne, l'indigne cadet du futur duc et maréchal de Gramont. On prétend que Louvigni, étant devenu amoureux de Mme de Chevreuse, s'irrita de la préférence qu'obtenait le maître de la garde-robe [79]. D'autres disent qu'ayant demandé à Chalais de lui servir de second dans un duel contre le comte de Candale, frère du marquis de La Valette et le fils aîné du duc d'Épernon, Chalais, qui avait de puissants motifs de ménager les d'Épernon, avait prié Louvigni de l'excuser, et que celui-ci furieux s'était écrié: «Je vois ce que c'est, vous voulez rompre d'amitié avec moi; je changerai aussi d'ami et de parti [80].» Et il alla dire au cardinal tout ce qu'il savait [81]. Sur-le-champ, le 8 juillet, Richelieu fit arrêter Chalais à Nantes, et en même temps faisant comparaître Monsieur devant le roi et devant la reine mère, il lui imprima un tel effroi que le malheureux prince, perdant la tête, renouvela et surpassa la triste scène du 31 mai. Non-seulement il consentit au mariage contre lequel il s'était tant révolté, mais il découvrit le plus intime de la conspiration dont il était le chef, il livra sans pitié son gouverneur pour lequel il avait montré un si grand zèle, et révéla les intelligences du maréchal avec les grands et avec l'étranger, quand l'infortuné était à Vincennes sous la main de Richelieu, menacé de porter sa tête sur un échafaud. Il trahit également le grand-prieur de Vendôme; il apprit au cardinal que c'était le grand-prieur qui lui avait donné le conseil d'aller à Fleury le poignarder s'il ne délivrait Ornano. Il dénonça le comte de Soissons, Longueville, Soubise et bien d'autres. Et quant à Chalais, avec lequel la veille encore il méditait les moyens de s'enfuir, il lui rendit toute défense impossible par les aveux les plus circonstanciés. Enfin il avoua que la reine Anne l'avait plusieurs fois supplié de ne consentir du moins au mariage proposé qu'à la condition qu'on mît d'abord le maréchal en liberté [82], et il déclara que depuis plus de deux ans Mme de Chevreuse disait qu'il ne fallait pas qu'il se mariât, et qu'il épouserait la reine après la mort du roi. Encore on pourrait comprendre une pareille faiblesse, si le jeune prince eût craint pour sa vie; mais un tel danger était bien loin de lui, et, dès qu'il épousait Mlle de Montpensier, il ne s'agissait pour lui que d'un apanage plus ou moins considérable. C'était là aussi tout ce qui l'occupait; il réclama avec force un grand apanage: il ne lui échappa pas un mot de tendresse, de commisération, d'intérêt véritable pour ses malheureux complices. Il demanda grâce, il est vrai, pour Ornano, mais le maréchal fit bien de mourir vite en prison, car Monsieur ne l'aurait pas plus sauvé qu'il ne sauva Chalais, qu'il ne sauva Montmorenci, qu'il ne sauva Cinq-Mars. Il intercéda aussi en faveur de Chalais, mais seulement par ce motif bien digne de son égoïsme, que si on faisait mourir Chalais, il ne trouverait plus personne pour le servir. Déjà Richelieu nous avait donné quelque idée des aveux du prince, mais nous les avons aujourd'hui tels qu'ils sortirent de sa bouche, consignés jour par jour dans des procès-verbaux officiels, car il comparut devant une sorte de tribunal; il subit des interrogatoires, un secrétaire d'État écrivit ses réponses, et toutes ces ignominies sont maintenant sous nos yeux, revêtues du caractère le plus authentique; nous les avons trouvées dans les papiers de Richelieu, et les mettons au jour pour la première fois [83].
Mais voici un autre spectacle presque aussi honteux. Il semble que Chalais ait entrepris de lutter de bassesse avec Monsieur. Lui qui avait souvent bravé la mort dans les combats particuliers et sur les champs de bataille en a peur tout à coup, et recule jusqu'aux dernières extrémités de la lâcheté devant l'échafaud qu'il ne pouvait éviter. Les dépositions du prince l'accablaient, et lui-même confessa sans réserve tout ce qu'il avait fait. Il n'eut pas même à se défendre d'avoir voulu assassiner le roi, cette odieuse accusation n'ayant pas été suivie. Il n'était pas de ceux qui avaient conçu et formé la grande conspiration qui du pied du trône s'étendait à travers tout le royaume jusque chez l'étranger, mais il s'y était associé. S'il avait peu connu les trames du maréchal Ornano, il n'avait ignoré aucune de celles du grand-prieur de Vendôme; il y avait pris part, et comme lui et avec lui il avait pressé Monsieur de ne pas abandonner son gouverneur, et de recourir pour le sauver à l'un des moyens que le grand-prieur proposait. Il était évidemment le complice du comte de Soissons, puisque, après l'arrestation des Vendôme, il lui avait écrit de ne pas venir à la cour parce qu'il y aurait le même sort qu'eux. Et, ce qui suffisait à constituer un crime d'État au premier chef, il avait à plusieurs reprises engagé le frère du roi à se retirer dans quelque place d'où il pût soulever le royaume: il avait même envoyé un messager au commandant de la forteresse de Metz pour lui demander d'y recevoir le prince et ses amis. Ce messager à son retour était tombé entre les mains de Richelieu, et son interrogatoire, que nous avons retrouvé [84], ne laisse aucun doute sur ce point capital. Ajoutez qu'il y avait contre Chalais bien des circonstances aggravantes: il était maître de la garde-robe; il faisait partie de cette haute domesticité qui lui imposait plus particulièrement une loyauté à toute épreuve; et c'est lui, l'un des premiers serviteurs du roi, qui avait mis la main dans un complot entrepris pour renverser le gouvernement du roi. Il s'était introduit dans la maison et dans la confiance du cardinal; il avait affecté le plus grand zèle pour ses intérêts; il lui avait rendu même plus d'un important service pour mieux couvrir ses desseins. Une conspiration qui avait pensé ébranler tout l'État ne pouvait passer impunie: il fallait un solennel et exemplaire châtiment pour bien avertir les grands du royaume qu'il y allait de leur tête à lutter contre la couronne. On ne pouvait s'en prendre à un prince du sang tel que le comte de Soissons, qui d'ailleurs était en fuite et hors de France, ni à des fils d'Henri IV tels que les Vendôme. Le maréchal Ornano se mourait à Vincennes. Chalais était donc la victime désignée pour cette juste et nécessaire expiation. Aussi on le livra à une commission composée de conseillers d'État, de maîtres des requêtes et de membres du parlement de Bretagne, parmi lesquels on rencontre le père de Descartes qui fit l'office de rapporteur. Cette commission s'assembla à Nantes, présidée par le nouveau garde des sceaux, Michel de Marillac. Le procès s'instruisit selon les formes accoutumées et dura quarante jours. Chalais ne comprit pas que tout cet appareil judiciaire n'était pas déployé en vain, et que rien ne pouvait le sauver. Il crut se tirer d'affaire par des aveux aussi étendus qu'on le souhaita. Non-seulement il fit connaître tous ses complices, mais il indiqua comme favorables en secret à leur cause et opposés au cardinal plusieurs grands seigneurs, ainsi que l'avait fait Monsieur; il grossit même cette liste de suspects en nommant sans nécessité le duc de Bouillon, Senneterre, l'ami du comte de Soissons, le père du futur maréchal, et ce fameux commandeur de Jars, de la maison de Rochechouart [85], qui plus tard, jeté aussi en prison, y garda un si courageux silence et monta sans pâlir sur l'échafaud où, à la place du coup mortel, il reçut inopinément sa grâce sans l'avoir jamais demandée. Chalais la demanda dès le premier jour; il la demanda sans cesse au roi, à la reine mère, à Richelieu. Il ne se contenta pas de descendre aux supplications les plus humbles, et de faire valoir en sa faveur les renseignements que plus d'une fois il avait donnés au cardinal et qui lui avaient été fort utiles, prétendant que si le cardinal n'avait pas été poignardé à Fleury, il le lui devait; il alla jusqu'à dire, et en cela il se calomniait lui-même, que s'il avait plusieurs fois écrit au comte de Soissons, c'était «pour entretenir créance et avoir moyen de découvrir ce qui se passoit, afin de servir le roi et le cardinal [86].» Il s'offrit même à les servir encore; il promit, si on voulait lui faire grâce, de donner avis de tout ce qui se ferait chez Monsieur, particulièrement pendant le procès du maréchal Ornano. «Encore [87] qu'il ne faille point douter, dit-il, que le maréchal ne soit coupable, et que le roi n'ait assez de lumière de sa faute, néantmoins lui répondant y servira beaucoup, tant à découvrir ses anciennes cabales qu'à faire connoître ceux qui solliciteroient pour lui... Il ne doute point que Monsieur étant à Paris, plusieurs grands et quantité de gentilshommes ne l'excitent à faire quelques remuements et des violences au cardinal: il les découvrira tous jusqu'au dernier conseiller.» «Il vous est nécessaire, écrit-il à Richelieu [88], d'avoir quelqu'un auprès de Monsieur... Il y a bien des grands prieurs en France [89], et Monsieur verra bien des fois le jour des personnes qui ne vous aiment guère... Si [90] le maréchal a été assez ingrat pour méconnoître les bons offices que vous lui avez faits, et qu'au bout de seize mois il vous ait trompé, assurez-vous, Monseigneur, que je ne suis pas Corse, et qu'en seize siècles cela ne m'entrera pas dans l'esprit... Je donnerai les apparences [91] à Monsieur et les services effectifs à qui je les dois.»
Du moins, pendant quelque temps et jusqu'à la fin de juillet, en trahissant tout le monde, Chalais avait gardé sa foi à Mme de Chevreuse. Ni dans ses dépositions officielles, ni dans ses conversations avec Richelieu, il n'avait prononcé ce nom. Mais emporté par la passion qui déjà lui avait fait faire tant de fautes, il céda au besoin de se rappeler à celle qu'il aimait toujours, et de lui faire hommage de ses souffrances. Il lui adressa des lettres remplies de l'adoration et du dévouement le plus chevaleresque, et écrites dans le jargon alors à la mode qui convenait bien mieux dans la bouche des mourants de l'hôtel de Rambouillet, que dans celle d'un homme aussi sérieusement menacé. En les lisant, on se demande si Mme de Chevreuse s'était rendue à l'amour de Chalais, ou si elle ne l'avait pas laissé sur ces espérances enivrantes et enflammées, qui transforment leur objet encore peu connu en une divinité dont on achèterait la possession au prix de tous les sacrifices [92]. A ces lettres imprudentes, qui évidemment ne lui arrivaient qu'après avoir passé par les mains de Richelieu, Mme de Chevreuse pouvait-elle répondre autrement qu'elle ne fit? Le domestique de Chalais écrit à son maître [93], le 4 août: «J'ai baillé la lettre à Madame; elle m'a dit qu'elle ne fait point de réponse, que sa vie et son honneur dépendent de cela véritablement; elle m'a dit sur sa vie qu'elle le servira sans écrire; elle lui baille cent mille baisemains.» Le 7 août: «Mme de Chevreuse a été bien aise; elle servira plus qu'on ne demande, mais elle ne peut écrire.» Il paraît que ce silence si naturel blessa Chalais, qui peut-être même ne reçut pas les lettres de son domestique et ne connut pas les réponses de Mme de Chevreuse. L'habile Richelieu partit de là pour jeter des soupçons dans l'âme du prisonnier, et l'aigrir contre la duchesse. Il la lui représenta [94] comme l'ayant fort oublié, occupée d'autres amours, et s'étant sauvée elle-même à ses dépens; manœuvre accoutumée d'une police déloyale qui s'étudie à tromper les accusés les uns sur les autres, et, en faisant accroire à chacun d'eux qu'il est trahi par son complice, le pousse à le trahir à son tour. Nous pouvons assurer que dans tous les papiers qui ont passé sous nos yeux, nous n'avons pas découvert l'ombre même d'une faiblesse de la part de Mme de Chevreuse. Mais le pauvre Chalais tomba dans le piége qu'on lui tendait, et le dépit de l'amour et du dévouement trompé ôtant tout frein à son ardent désir de complaire au cardinal et d'en obtenir sa grâce par des révélations importantes et inattendues, peu à peu il commença, ce qu'il n'avait pas fait jusque-là, à parler des dames, particulièrement de Mme de Chevreuse, et, passant sur elle de l'adoration à l'injure, il finit par la charger des accusations les plus graves. Il déclara que c'était elle qui l'avait engagé dans ce complot auquel auparavant il était resté entièrement étranger, «qu'elle avoit grande affection et liaison avec le maréchal d'Ornano sur l'affaire de Monsieur [95], qu'elle travaille à unir ensemble M. le Prince, M. le Comte et M. de Montmorenci, ainsi que les Huguenots par le moyen de Mme de Rohan [96], qu'elle l'avoit exhorté [97] à faire tout ce qu'il pourroit pour délivrer le grand-prieur, et qu'il n'y avoit rien qu'elle ne voulût faire pour cela, et qu'à toute occasion elle disoit à Monsieur: Ne voulez point faire sortir de prison le maréchal? qu'elle excitoit le grand-prieur à conseiller à Monsieur de quitter la cour et de faire violence à M. le cardinal, et qu'elle disoit continuellement au grand-prieur: Monsieur n'aura-t-il pas de ressentiment pour le maréchal [98]? que par ces mots: Monsieur ne se souviendra-t-il pas du maréchal? on entendoit: Monsieur ne fera-t-il pas violence au cardinal? qu'il le sait parce que le grand-prieur et Mme de Chevreuse le lui ont dit, et que Mme de Chevreuse étoit dans la confidence du dessein qui se devoit exécuter à Fleury [99],» c'est-à-dire du dessein d'assassiner le cardinal. Enfin, pour bien montrer à Richelieu qu'il n'y a pas de sacrifices qu'il ne soit prêt à lui faire, après celui de la personne qu'il avait tant aimée et à laquelle, la veille encore, il prodiguait les plus ardents hommages, il compromet jusqu'à la reine elle-même, et répète le bruit injurieux «qu'il a ouï dire que si Dieu rappeloit le roi, Monsieur pourroit épouser la reine [100].» Chalais ne pouvait descendre plus bas encore qu'en s'engageant à se faire l'espion de la reine et de Mme de Chevreuse, comme il avait promis d'être celui de Monsieur. Il croit nuire à Mme de Chevreuse, il la relève au contraire en la peignant obstinément attachée à la reine et à ses amis. «C'est elle, dit-il, qui a embarqué le maréchal d'Ornano, et elle lui conserve plus inviolablement que jamais l'amitié promise [101].» «Si elle vouloit, s'écrie-t-il, je jure qu'elle pourroit dire de belles choses,» excitant ainsi à la faire arrêter. Il la surveillera, il la démasquera, il lui ôtera toute influence, «il ne veut plus vivre que pour la damner [102].» Et sans cesse il rappelle au cardinal «les grandes choses qu'il feroit parmi les dames [103].»
On souffre en vérité d'avoir à transcrire de pareilles bassesses, et on voudrait les pouvoir imputer à un accès de fureur jalouse qui aurait troublé l'esprit de l'infortuné dans la sombre solitude d'un cachot. D'ailleurs elles furent inutiles. Dès que Richelieu sentit qu'il avait tiré de Chalais tout ce qu'il en pouvait espérer, le procès marcha vite, et l'inévitable sentence fut rendue le 18 août. Le lendemain on la lut au prisonnier. Elle rendit Chalais à lui-même. Il se souvint qu'il était gentilhomme et Talleyrand, il rougit de sa conduite envers Mme de Chevreuse, et sur la sellette il rétracta tout ce qu'il avait dit sur elle, déclarant particulièrement «qu'elle ne l'avoit jamais détourné du service qu'il devoit au roi [104].» Il chargea son confesseur d'aller demander pardon à la reine d'avoir mêlé son nom dans une pareille affaire [105], et quelques heures après, soutenu par les prières de sa vieille mère, la digne fille du maréchal de Montluc, agenouillée dans une église voisine [106], le 19 août 1626, il présentait avec fermeté sa tête à la hache du bourreau sur le premier échafaud dressé par Richelieu.
Ainsi finit Chalais, et la première conspiration à laquelle prit part Mme de Chevreuse. Le mois d'août était à peine écoulé, que le maréchal Ornano succombait à Vincennes sous la menace du procès qui l'attendait. Le grand prieur le suivit à quelques années de distance, en février 1629. Le duc César de Vendôme ne sortit de prison qu'en 1630, et perdit pour toujours son gouvernement de Bretagne. Le comte de Soissons s'exila quelque temps lui-même en Suisse et en Italie. Pour Monsieur, il en fut quitte pour épouser une des princesses les plus aimables de France, avec une dot immense, et l'opulent apanage [107] que lui méritait bien cette première trahison qui devait être suivie de tant d'autres. Mais un an après, la nouvelle duchesse d'Orléans mourait en donnant le jour à une fille qui fut la grande Mademoiselle. Déjà le roi avait été fort mécontent des coquetteries de la reine avec Buckingham: cette fois il lui ôta à jamais sa confiance et son cœur. Sa jalouse et soupçonneuse nature lui persuada aisément qu'il y avait eu quelque intrigue entre elle et son frère, non pas peut-être pour se défaire de lui, mais pour s'unir ensemble un jour; toute sa vie il garda cette amère conviction, et quand à son lit de mort la reine lui jura avec larmes qu'elle était innocente, il répondit que dans son état il était obligé de lui pardonner, mais non de la croire. Dans les premiers transports de sa colère, il la fit comparaître devant un conseil, où elle fut traitée en criminelle; on ne lui donna qu'un pliant au lieu d'un fauteuil, comme si elle eût été sur la sellette, et le roi l'accusa d'être entrée dans un complot pour avoir un autre mari. La reine indignée s'écria qu'elle aurait trop peu gagné au change, et elle reprocha avec énergie à sa belle-mère et au cardinal de travailler à lui nuire dans l'esprit du roi [108]. Puis elle courba un peu plus la tête, renferma dans son sein la haine qu'elle portait à Richelieu, et se résigna, pour quelque temps du moins, à passer sa triste jeunesse dans la solitude de son palais, de toutes parts surveillée, et n'ayant plus un cœur ami pour y verser ses ennuis et ses souffrances. Mme de Chevreuse apprit à ses dépens ce qu'il en coûte de trop aimer une reine. Elle courut grand risque d'être enveloppée dans le funeste procès. Sur les dépositions de Chalais, le tribunal avait ordonné [109] qu'elle serait arrêtée pour être interrogée sur les charges qui s'élevaient contre elle. Le décret de prise de corps fut rédigé, signé par les juges, et remis au roi qui, dans un conseil tenu chez la reine mère, le montra au duc de Chevreuse. Celui-ci obtint à grand'peine qu'on se contenterait de la menace [110]. Elle quitta Nantes quelques jours avant la terrible exécution [111], et alla s'enfermer à Dampierre, espérant qu'elle y pourrait laisser passer la tempête. Mais on la trouva encore trop près de la reine, et elle reçut l'ordre de sortir de France [112]. Il lui fallut donc renoncer à toutes les douceurs de la vie, aux magnificences de son hôtel de la rue Saint-Thomas-du-Louvre, à sa belle retraite de Dampierre, et aller, à vingt-cinq ans, chercher un asile sur une terre étrangère. Aussi, dit Richelieu, «elle fut transportée de fureur; elle s'emporta jusqu'à dire qu'on ne la connoissoit pas, qu'on pensoit qu'elle n'avoit l'esprit qu'à des coquetteries, qu'elle feroit bien voir, avec le temps, qu'elle étoit bonne à autre chose, qu'il n'y avoit rien qu'elle ne fît pour se venger, et qu'elle s'abandonneroit à un soldat des gardes plutôt que de ne pas tirer raison de ses ennemis [113].» Elle aurait bien souhaité aller en Angleterre, où elle était sûre de l'appui de Holland, de Buckingham et de Charles Ier lui-même: cette permission ne lui fut pas accordée, et elle prit le chemin de la Lorraine.