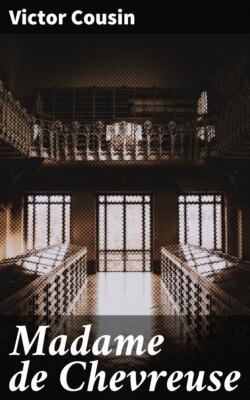Читать книгу Madame de Chevreuse - Victor Cousin - Страница 7
CHAPITRE TROISIÈME
1627-1637
ОглавлениеMME DE CHEVREUSE EN LORRAINE. LE DUC CHARLES IV. NOUVELLE LIGUE CONTRE RICHELIEU. VICTOIRE DU CARDINAL. MME DE CHEVREUSE RENTRE EN FRANCE.—ELLE EST D'ABORD ASSEZ BIEN AVEC RICHELIEU.—SA LIAISON AVEC LE GARDE DES SCEAUX CHATEAUNEUF.—LETTRES D'AMOUR ET D'INTRIGUE.—NOUVELLE DISGRACE.—MME DE CHEVREUSE RELÉGUÉE EN TOURAINE. CRAFT, MONTAIGU, LA ROCHEFOUCAULD.—AFFAIRES DE 1637. INTELLIGENCE DE LA REINE ANNE AVEC M. DE MIRABEL, A BRUXELLES, ET AVEC SON FRÈRE LE CARDINAL-INFANT, PENDANT QUE LA FRANCE ET L'ESPAGNE SONT EN GUERRE. ELLE CORRESPOND AUSSI AVEC MME DE CHEVREUSE, QUI ELLE-MÊME CORRESPOND AVEC LE DUC DE LORRAINE ET L'ENGAGE AVEC L'ESPAGNE.—DÉCOUVERTE DE CES INTRIGUES. LA REINE ANNE PLUS QUE JAMAIS MALTRAITEE.—MME DE CHEVREUSE CRAINT D'ÊTRE ARRÊTÉE ET PREND LE PARTI DE SE SAUVER EN ESPAGNE.—AVENTURES DE SA FUITE DEPUIS TOURS JUSQU'A LA FRONTIÈRE ESPAGNOLE.
Mme de Chevreuse arriva en Lorraine dans l'automne de 1626. On sait qu'au lieu d'un refuge, elle y trouva le plus éclatant triomphe. Sa beauté éblouit le nouveau duc de Lorraine Charles IV, qui, se déclarant ouvertement son adorateur, en fit la reine de ces brillants tournois à la barrière de Nancy, illustrés par le burin de Callot. Elle n'a pas été, comme le dit La Rochefoucauld et comme on l'a tant répété, la première cause des malheurs de ce prince; non: la vraie cause des malheurs de Charles IV [114] était dans son caractère, dans son ambition présomptueuse, ouverte à toutes les chimères, et qui rencontrait devant elle, en France, un politique tel que Richelieu. N'oublions pas qu'ils étaient déjà brouillés bien avant que Mme de Chevreuse ne mît le pied à Nancy. Richelieu revendiquait plusieurs parties des États du duc, et celui-ci, placé entre l'Autriche et la France, commençait à se déclarer pour la première contre la seconde. C'était l'homme le plus fait pour entrer dans les sentiments de Mme de Chevreuse, comme elle était admirablement faite pour seconder ses desseins. Elle trouva Charles IV déjà uni à l'Empire; elle l'unit aussi à l'Angleterre, dont Buckingham disposait; elle renoua ses anciennes intelligences avec les ennemis de Richelieu, particulièrement avec la Savoie, et renouvela ainsi la ligue formée sous le maréchal Ornano, en lui donnant, comme toujours, à l'intérieur l'appui du parti protestant, que gouvernaient ses parents, Rohan et Soubise. Le plan était sérieux: une flotte anglaise, conduite par Buckingham lui-même, devait débarquer à l'île de Ré et se joindre aux protestants de La Rochelle; le duc de Savoie, avec le comte de Soissons, qui était venu chercher un asile auprès de lui, devait descendre à la fois dans le Dauphiné et dans la Provence, le duc de Rohan, à la tête des protestants du midi, soulever le Languedoc, enfin le duc de Lorraine marcher sur Paris par la Champagne. L'agent principal de ce plan, chargé de porter des paroles à tous les intéressés, était mylord Montaigu, personnage d'une activité et d'un courage à toute épreuve, qui passa la moitié de sa vie dans des intrigues galantes et politiques, et la finit dans une ardente dévotion. Il était alors ami particulier de Holland et de Buckingham. Il allait sans cesse de Londres à Turin et à Nancy [115]. Richelieu épiait toutes ses démarches, et en novembre 1627 il le fit arrêter jusque sur le territoire lorrain, pour s'emparer des papiers dont il était porteur, qui lui découvrirent toute la conspiration. La reine Anne y était si fort mêlée qu'elle trembla à la nouvelle de l'arrestation de Montaigu, et n'eut de repos qu'après s'être bien assurée qu'elle n'était pas nommée dans les papiers du prisonnier, et qu'elle ne le serait pas dans ses interrogatoires [116]. Renfermé assez longtemps à la Bastille, Montaigu montra qu'il était un serviteur des dames d'une autre trempe que Chalais: il garda un généreux silence sur la reine et sur Mme de Chevreuse. Mais le cardinal ne s'y trompa pas; il vit parfaitement que cette vaste machination était l'ouvrage de la duchesse, et que celle-ci n'avait agi qu'avec le consentement de la reine [117]. Il se hâta de faire face au péril qui le menaçait avec sa promptitude et sa vigueur accoutumées. L'Angleterre, poussée par l'impétueux Buckingham, était entrée la première en campagne: elle rencontra une résistance sur laquelle elle n'avait pas compté. L'attaque sur l'île de Ré échoua; Buckingham battu fut forcé à une retraite honteuse, et à peine avait-il remis le pied sur le sol anglais que le poignard d'un assassin terminait sa vie, le 2 septembre 1628. Le mois suivant, La Rochelle, le foyer et le boulevard de tous les complots protestants, La Rochelle, qui passait pour imprenable, cédait à la constance et à l'habileté du cardinal. Étonnés de pareils succès, le duc de Lorraine et le duc de Savoie demeurèrent immobiles; la coalition était dissoute, et l'Angleterre demandait la paix, en mettant parmi ses conditions les plus pressantes le retour en France de Mme de Chevreuse, devenue une puissance politique pour laquelle on fait la paix et la guerre. «C'étoit une princesse aimée en Angleterre, à laquelle le roi portoit une particulière affection, et il la voudroit assurément comprendre en la paix, s'il n'avoit honte d'y faire mention d'une femme; mais il se sentiroit très-obligé si Sa Majesté ne lui faisoit point de déplaisir. Elle avoit l'esprit fort, une beauté puissante dont elle savoit bien user, ne s'amollissant par aucune disgrâce, et demeurant toujours en une même assiette d'esprit [118]:» portrait moins brillant, mais tout autrement sérieux et fidèle que celui de Retz, et qui pourrait bien être de la main même de Richelieu, étant assez vraisemblable que le cardinal, selon sa coutume, aura ici plutôt résumé à sa manière que reproduit textuellement la dépêche du négociateur anglais. Quoi qu'il en soit, Richelieu, qui désirait vivement, La Rochelle une fois soumise, n'avoir plus sur les bras les Rohan, les protestants et l'Angleterre, afin de porter toutes ses forces contre l'Espagne, accepta la condition demandée, et à la fin de l'année 1628 Mme de Chevreuse eut la permission de revenir à Dampierre.
Il y eut là quelques années de repos dans cette vie agitée. Du fond de sa retraite, Mme de Chevreuse vit plus d'une fois changer la face des affaires et de la cour. Elle vit Marie de Médicis revêtue de nouveau, en 1629, du titre et des fonctions de régente, de nouveau aussi dépouillée de son pouvoir en 1630, après la célèbre journée des dupes, et, plus maltraitée par son ancien favori qu'elle ne l'avait jamais été par Luynes, s'enfuir en 1631 à Bruxelles, se mettre sous la protection de l'Espagne et à la tête des ennemis de Richelieu. Elle vit le duc d'Orléans, après avoir voulu épouser la belle Marie de Gonzague, une des filles du duc de Mantoue, devenu amoureux de Marguerite de Lorraine, sœur de Charles IV, l'épouser contre la volonté du roi, et s'en aller à Bruxelles grossir et fortifier le parti de la reine mère. Anne d'Autriche et Mme de Chevreuse étaient naturellement de ce parti, et le secondaient de tous leurs vœux, mais en ayant grand soin de les cacher sous des démonstrations contraires, devant le cardinal tout-puissant et irrité, prodiguant sans pitié les destitutions, les emprisonnements, les exils, et faisant monter tour à tour, en 1632, sur l'échafaud de Chalais, son ancien ami le maréchal de Marillac, coupable surtout d'être resté fidèle à leur commune maîtresse, et le dernier descendant des deux grands connétables de Montmorency, le vainqueur de Veillane, qui s'était laissé engager dans la révolte la plus insensée par les conseils de sa femme, dévouée à la reine mère, et sur la parole du duc d'Orléans. Mme de Chevreuse avait appris à mettre un voile sur ses plus chers sentiments: peu à peu elle reparut à la cour en ayant l'air de ne chercher que le plaisir. Elle avait à peine trente-deux ans, et il était difficile encore de la voir impunément. On dit que Richelieu ne fut pas insensible à sa beauté. Pourquoi s'en étonner? D'autres grands politiques, Henri IV, Charlemagne, César, ont aussi aimé la beauté, et le XVIIe siècle est particulièrement le siècle de la galanterie. C'est une tradition accréditée que le cardinal fit quelque temps une cour inutile mais fort pressante à la reine Anne. Nous écartons les propos grossiers de Tallemant [119]; nous n'ajoutons pas foi à l'incroyable récit du jeune Brienne [120], mais son père [121], mais La Rochefoucauld [122], mais Retz [123], parlent de l'inclination que le cardinal a ressentie pour la reine; et celle-ci a conté elle-même à Mme de Motteville «qu'un jour il lui parla d'un air très-galant et lui fit un discours fort passionné [124].» C'est encore Mme de Motteville qui nous apprend que Richelieu, «malgré la rigueur qu'il avait eue pour Mme de Chevreuse, ne l'avoit jamais haïe, et que sa beauté avoit eu des charmes pour lui [125].» Il essaya de lui plaire, et un moment l'entoura d'attentions et d'hommages [126]. L'habile duchesse se garda bien de les repousser, sans les trop accueillir. Le cardinal s'efforça de lui persuader de rompre avec le duc de Lorraine [127]. Tantôt elle résistait, tantôt elle donnait des espérances [128], et mettait même son influence sur le duc de Lorraine au service des desseins de Richelieu [129]. Mais au fond son âme demeurait inébranlablement attachée à sa cause et à ses amis, et au tout-puissant cardinal elle préféra un de ses ministres, celui sur lequel il avait le plus droit de compter: elle le lui enleva d'un regard, et le conquit au parti des mécontents.
Charles de l'Aubépine, marquis de Châteauneuf, d'une vieille famille de conseillers et de secrétaires d'État, avait succédé en 1630 à Michel de Marillac dans le poste de garde des sceaux; il le devait à la faveur de Richelieu et au dévouement qu'il lui avait montré. Il avait poussé ce dévouement bien loin, car il présida à Toulouse la commission qui jugea Henri de Montmorenci, et par là il mit à jamais contre lui les Montmorenci et les Condé. Châteauneuf avait donné des gages sanglants à Richelieu, et ils semblaient inséparablement unis. Le cardinal l'avait comblé, comme il faisait tous les siens. Châteauneuf avait été successivement nommé ambassadeur, chancelier des ordres du roi, gouverneur de Touraine. C'était un homme consommé dans les affaires, laborieux, actif, et doué de la qualité qui plaisait le plus au cardinal, la résolution; mais il avait une ambition démesurée qu'il conserva jusqu'à la fin de sa vie; l'amour s'y joignant la rendit aveugle [130]. On ne se peut empêcher de sourire quand on se rappelle ce que dit Retz, que Châteauneuf amusa Mme de Chevreuse avec les affaires; cet amusement-là était d'une espèce toute particulière: on y jouait sa fortune et quelquefois sa tête, et l'intrigue où l'un et l'autre s'engagèrent était si téméraire, que pour cette fois nous admettons que ce ne fut pas Châteauneuf qui y jeta Mme de Chevreuse, et que c'est elle bien plutôt qui y poussa l'amoureux garde des sceaux.
Châteauneuf avait alors cinquante ans [131], et le sentiment qu'il avait conçu pour Mme de Chevreuse devait être une de ces passions fatales qui précèdent et qui marquent la fuite suprême de la jeunesse. Pour Mme de Chevreuse, elle partagea dans toute leur étendue les dangers et les malheurs de Châteauneuf, et jamais plus tard elle ne consentit à séparer sa fortune de la sienne. Elle portait au moins dans ses égarements ce reste d'honnêteté que, lorsqu'elle aimait quelqu'un, elle l'aimait avec une fidélité sans bornes, et que l'amour passé il lui en demeurait une amitié inviolable. Déjà, depuis quelque temps, Richelieu s'était aperçu que son garde des sceaux n'était plus le même. Son génie soupçonneux, secondé par sa pénétration et une incomparable police, l'avait mis sur la trace des manœuvres les plus secrètes de Châteauneuf, et lui-même s'est complu à rassembler tous les indices de la trahison de son ancien ami dans des pages jusqu'ici restées inédites et qui nous semblent un chapitre égaré de ses Mémoires [132]. Au mois de novembre 1632, à Bordeaux, pendant une assez grave maladie du cardinal, tandis que le cardinal La Valette, le P. Joseph et Bouthillier veillaient avec anxiété autour de son lit, le garde des sceaux, subjugué par Mme de Chevreuse et séduit par elle à la cause de la reine Anne, partagea tous les divertissements des deux jeunes femmes, et les accompagna dans un voyage de plaisir à La Rochelle. Cette conduite avait éclairé et irrité Richelieu; et à son retour à Paris, le 25 février 1633, Châteauneuf fut arrêté, et tous ses papiers saisis. On y trouva cinquante-deux lettres de la main de Mme de Chevreuse où, sous des chiffres faciles à pénétrer et à travers un jargon transparent, on reconnaissait les sentiments de Châteauneuf et de la duchesse. Il y avait aussi beaucoup de lettres du commandeur de Jars, du comte de Holland, de Montaigu, de Puylaurens, du comte de Brion, du duc de Vendôme et de la reine d'Angleterre elle-même. Ces papiers furent apportés au cardinal, qui les garda selon sa coutume; après sa mort on les trouva dans sa cassette, et ils arrivèrent ainsi, avec bien d'autres, en la possession du maréchal de Richelieu, qui les communiqua au père Griffet pour son Histoire du règne de Louis XIII [133]. Une copie assez ancienne est aujourd'hui entre les mains de M. le duc de Luynes, dont l'esprit est trop élevé pour songer à dérober à l'histoire les fautes, d'ailleurs bien connues, de son illustre aïeule, surtout quand ces fautes portent encore la marque d'un noble cœur et d'un grand caractère. Nous avons pu examiner ces curieux manuscrits [134], et particulièrement les lettres de Mme de Chevreuse. Elles confirment ce que nous dit Mme de Motteville de l'impression que la beauté de Mme de Chevreuse avait faite sur le cardinal: on y voit qu'il lui rendait des soins, qu'il était jaloux [135] de Châteauneuf, et que celui-ci s'alarmait des ménagements qu'elle gardait envers le premier ministre pour mieux cacher leur commerce. On ne lira pas sans intérêt divers passages de ces lettres encore inédites où se montre l'esprit délié à la fois et audacieux de la duchesse, son empire sur le garde des sceaux, et la haine intrépide qu'elle portait au cardinal parmi les déférences qu'elle lui prodiguait.
«Mme de Chevreuse [136] se plaint à M. de Châteauneuf de son serviteur qui a si peu d'assurance en la générosité et amitié de son maître, et fait bien pis quand il demande si Mme de Chevreuse le néglige pour l'avoir promis au cardinal. Vous avez tort d'avoir eu cette pensée, et l'âme de Mme de Chevreuse est trop noble pour qu'il y entre jamais de lâches sentiments. C'est pourquoi je ne considère non plus la faveur du cardinal que sa puissance, et je ne ferai jamais rien d'indigne de moi pour le bien que je pourrois tirer de l'une ni pour le mal que pourroit me faire l'autre. Croyez cela si vous voulez me faire justice. Je vous la rendrai toute ma vie, et souhaite que vous y ayez de l'avantage, car je prendrai grand plaisir à vous contenter et j'aurai grand'peine à vous déplaire. Voilà, en conscience, mes sentiments, et vous n'en avez point si vous manquez jamais à votre maître.
«Mme de Chevreuse a vu le cardinal, qui a demeuré deux heures chez la Reine. Il lui a fait des compliments inimaginables et dit des louanges extraordinaires devant Mme de Chevreuse, à qui il a parlé fort froidement, affectant une grande négligence et indifférence pour elle qui l'a traité à son accoutumé sans faire semblant de s'apercevoir de son humeur. Sur une picoterie qu'il lui a voulu faire, Mme de Chevreuse l'a raillé jusqu'à en venir au mépris de sa puissance. Cela l'a plus étonné que mis en colère, car alors il a changé de langage et s'est mis dans des civilités et humilités grandes. Je ne sais si ç'a été qu'en la présence de la reine il n'a pas voulu montrer de mauvaise humeur, ou bien pour ne vouloir pas se brouiller avec Mme de Chevreuse. Demain je dois le voir à deux heures. Je vous manderai ce qui se passera. Soyez assuré que Mme de Chevreuse ne sera plus au monde lorsqu'elle ne sera plus à vous.»
«Je crois que je suis destinée pour l'objet de la folie des extravagants. Le cardinal me le témoigne bien; mais quelque peine que nous donne sa mauvaise humeur, je n'en suis pas si affligée que de celle de 37 [137], qui, sans s'arrêter à ma prière ni aux considérations que je lui ai représentées, veut aller où est Mme de Chevreuse, et dit qu'il n'y a rien qui l'en puisse empêcher, encore même que Mme de Chevreuse ne le veuille pas de peur de fâcher le cardinal s'il le découvroit. Je vous avoue que le discours de 37 m'a très affligée, car je ne le saurois souffrir. Je suis bien marrie que 37 m'ait donné tant de sujets de le fâcher après m'en avoir tant donné de me louer de lui. Je suis résolue de ne pas le voir s'il vient contre ma volonté, et même de ne pas recevoir ses lettres s'il ne se repent pas de la façon dont il parle à Mme de Chevreuse, qui ne peut souffrir ce langage d'âme du monde que de vous.»
«Mme de Chevreuse n'a point eu de nouvelles du cardinal. S'il est aussi aise de n'ouïr point parler de moi comme je le suis de n'ouïr plus parler de lui, il est bien content, et moi hors de la persécution dont le temps et notre bon esprit nous délivreront.
«La tyrannie du cardinal s'augmente de moments en moments. Il peste et enrage de ce que Mme de Chevreuse ne va pas le voir. Je lui avois écrit deux fois avec des compliments dont il est indigne, ce que je ne lui eusse jamais rendu sans la persécution que M. de Chevreuse m'a faite pour cela, me disant que c'étoit acheter le repos. Je crois que les faveurs du roi ont mis au dernier point sa présomption. Il croit épouvanter Mme de Chevreuse de sa colère, et se persuade, à mon opinion, qu'il n'y a rien qu'elle ne fît pour l'apaiser; mais elle aime mieux se résoudre à périr qu'à faire des soumissions au cardinal. Sa gloire m'est odieuse. Il a dit à mon mari que mon humeur étoit insupportable à un homme de cœur comme lui, et qu'il étoit résolu de ne me plus rendre aucun devoir particulier, puisque je n'étois pas capable de donner à lui seul mon amitié et ma confiance. C'est vous seul que je veux qui sache ceci. Ne faites pas semblant à M. de Chevreuse de le savoir. Il a eu une petite brouillerie avec moi à cause qu'il a été si intimidé par l'insolence du cardinal qu'il m'a voulu persécuter pour que je l'endure bassement. J'estime tant votre courage et votre affection que je veux que vous sachiez tous les intérêts de Mme de Chevreuse. Elle se fie si entièrement en vous qu'elle tient ses intérêts aussi chers entre vos mains qu'aux siennes. Aimez fidèlement votre maître, et quelque persécution qu'on puisse lui faire, croyez qu'il se montrera toujours digne de l'être par toutes ses actions.
«Je ne vous fais point d'excuse de ne vous avoir pas écrit aujourd'hui, mais je veux que vous croyiez que je n'ai pas laissé de songer souvent à vous, quoique mes lettres ne vous l'aient pas témoigné. Je ne vous saurois bien représenter l'entrevue du cardinal et de Mme de Chevreuse qu'en vous disant qu'il témoigne à votre maître autant de passion que Mme de Chevreuse en a cru autrefois dans le cœur de 33 [138]; mais comme Mme de Chevreuse l'a toujours estimée véritable là, elle la croit fausse en celui du cardinal, qui dit n'avoir plus de réserve pour elle, voulant faire absolument tout ce qu'elle ordonnera, pourvu qu'elle vive en sorte avec lui qu'il se puisse assurer d'être en son estime et confiance par-dessus tout ce qui est sur la terre... Celui qui m'avoit promis de me dire des nouvelles fut hier ici, mais fort triste, et deux ou trois fois il me sembla qu'il me vouloit parler, dont je lui donnai assez moyen; mais il fut muet, et à moins de deviner, je ne saurois rien connoître de ses sentiments. Dès que j'en saurai la vérité, vous ne l'ignorerez pas, et j'en userai avec lui et avec tout autre comme je vous ai promis, soyez-en sûr, et que jamais les promesses du cardinal ne m'ébranleront. Est-il besoin que je vous assure de cela? Seroit-il possible que vous en eussiez seulement soupçon? Je serois au désespoir si je le croyois; mais j'ai trop bonne opinion de vous pour ne vivre pas certaine que vous ne l'avez pas mauvaise de moi.
«Je suis désespérée de ce que le cardinal a mandé à Mme de Chevreuse ce soir. Il lui a envoyé un exprès pour la conjurer de deux choses: la première, de ne point parler à Brion (François Christophe de Levis, comte de Brion, un des favoris du duc d'Orléans, le futur duc de Damville); la seconde de ne point voir M. de Châteauneuf; en ce dernier seul est ma peine. Toutefois, ma résolution de témoigner mon affection à M. de Châteauneuf est plus forte que toute la considération du cardinal. C'est pourquoi j'ai mandé au cardinal que je ne me pouvois pas défendre des prières que M. de Chevreuse me fait de voir M. de Châteauneuf pour mille affaires qu'il a. La plus grande que j'aye est de me revenger des obligations que j'ai à M. de Châteauneuf, à qui je suis plus véritablement que toutes les personnes du monde.
«Il n'y a pas de divertissement ni de lassitude capable de m'empêcher de penser à vous et de vous en donner des marques. Ces trois lignes sont une preuve de cette vérité, et je veux qu'elles vous servent d'assurance d'une autre, qui est que si M. de Châteauneuf est aussi parfait serviteur en effets qu'en paroles, Mme de Chevreuse sera plus reconnaissant maître en ses actions qu'en ses discours.
«Je ne doute pas de la peine où vous êtes, et vous proteste que Mme de Chevreuse la partage bien s'en croyant la cause. Mandez-moi comment je vous pourrai voir sans que le cardinal le sache, car je ferai tout ce que vous jugerez à propos pour cela, souhaitant passionnément de vous entretenir, et ayant bien des choses à vous dire qui ne se peuvent pas bien expliquer par écrit, surtout touchant 37 [139] et le cardinal, mais du dernier beaucoup davantage, l'ayant vu ce soir et trouvé plus résolu à persécuter Mme de Chevreuse que jamais. Il est sorti bien d'avec elle; mais jamais elle ne l'a trouvé comme aujourd'hui, si inquiet, et des inégalités telles en ses discours que souvent il se désespéroit de colère, et en un moment s'apaisoit et étoit dans des humilités extrêmes. Il ne peut souffrir que Mme de Chevreuse estime M. de Châteauneuf, et ne sauroit l'empêcher, je vous le promets, mon fidèle serviteur, que j'appelle ainsi parce que je le crois tel. Adieu, il faut que je vous voye à quelque prix que ce soit. Faites-moi réponse et prenez garde au cardinal, car il épie Mme de Chevreuse et M. de Châteauneuf, en qui Mme de Chevreuse se fie comme à elle-même.
«Il est vrai que je voudrois avoir donné de ma vie et vous avoir vu hier. Je sortis le soir et faillis aller pour cela chez votre sœur (Élisabeth de L'Aubespine, qui avait épousé André de Cochefilet, comte de Vaucellas). Si le cardinal vous parle de la visite de Mme de Chevreuse, dites que ce fut pour l'affaire de la princesse de Guymené (belle-sœur de Mme de Chevreuse); mais je veux que vous lui témoigniez être mal satisfait de votre maître et le mépriser. Je sais que vous aurez de la peine en cela. Toutefois vous m'obéirez parce qu'il est absolument nécessaire. C'est pourquoi je vous le recommande. Prenez-y occasion bien adroitement, et n'envoyez pas chez moi. Vous aurez souvent de mes nouvelles, et toute ma vie des preuves de mon affection. Je serai aujourd'hui où vous allez.
«Encore que je me porte mal, je ne veux pas laisser de vous dire comme s'est passée la visite de Mme de Chevreuse au cardinal. Il lui a parlé de sa passion qu'il dit être au point de lui avoir causé son mal par le déplaisir du procédé [140] de Mme de Chevreuse avec lui. Il s'est étendu en de longs discours de plainte de la conduite de Mme de Chevreuse, surtout touchant M. de Châteauneuf, concluant qu'il ne pouvoit plus vivre dans les sentiments où il est pour Mme de Chevreuse, si elle ne lui témoignoit d'être en d'autres pour lui que par le passé; à quoi Mme de Chevreuse a répondu qu'elle avoit toujours essayé de donner sujet au cardinal d'être satisfait d'elle, et qu'elle vouloit lui en donner plus que jamais. Le cardinal a pressé au dernier point Mme de Chevreuse pour savoir comment M. de Châteauneuf étoit avec elle, disant que tout le monde l'y croyoit en une intelligence extrême, ce que j'ai absolument désavoué. Je ne vous en veux dire davantage à cette heure, mais croyez que je vous estime autant que je le méprise, et que je n'aurai jamais de secret pour M. de Châteauneuf ni de confiance pour le cardinal.
«Je vous confirme la promesse que je vous fis de la dernière religion. Si j'en ai fait quelque difficulté, ce n'est pas que j'aye changé de volonté depuis, mais ç'a été pour voir si vous étiez bien ferme dans la vôtre. Il est vrai en cette occasion que vous me priez de ce que je désire pour vous rendre plus coupable si vous y manquez, et moi plus excusable en ce que j'aurai fait.
«Pourvu que votre affection soit aussi parfaite que la bague que vous m'envoyez, vous n'aurez jamais sujet de rougir pour avoir fait un mauvais présent à votre maître, ni de l'avoir reçu.
«Je veux partager avec vous le regret que vous avez de vous éloigner sans me voir. J'ai plus de haine de la tyrannie du cardinal que vous, mais je la veux surmonter et non pas m'en plaindre, puisque le premier sera un effet de courage et le dernier seroit un acte de foiblesse. Jamais je n'eus tant d'envie de vous entretenir qu'à cette heure. Le cardinal jure que Mme de Chevreuse sera mal avec vous dans peu, que M. de Châteauneuf n'aime pas Mme de Chevreuse et en fait des railleries avec 47 (dame inconnue, peut-être Mme de Puisieux, que Châteauneuf avait longtemps aimée). Pour ce qui la regarde, je me moque de cela; je crois M. de Châteauneuf fidèle et affectionné pour moi et le serai toute ma vie pour lui, pourvu que, comme il a mérité que j'aye pris cette bonne opinion de lui, il ne se rende pas digne que je la perde. Je suis au désespoir de ne pouvoir vous envoyer aujourd'hui la peinture de Mme de Chevreuse, que je vous ai promise.
«Vous vous obligez à beaucoup; mais il faut que vous sachiez que la moindre faute est capable de me fâcher extrêmement. C'est pourquoi prenez garde à ce que vous promettez. Cela seroit déshonorant [141] pour vous si vos actions n'étoient conformes à vos paroles et honteux à moi de le souffrir. Je vous dis encore un coup que vous ne vous engagiez pas tant, si vous n'êtes bien assuré de ne manquer jamais à rien. Je m'obligerai de peu tant que je ne me serai pas attendue à tout; mais quand vous me l'aurez promis, et que je l'aurai reçu, je ne serai plus satisfaite de vous si j'y remarque la moindre réserve.
«Je vous conseille, ne pouvant pas encore dire que je vous commande et ne voulant plus dire que je vous prie, de porter le diamant que je vous envoye, afin que voyant cette pierre, qui a deux qualités, l'une d'être ferme, l'autre si brillante qu'elle paroît de loin et fait voir les moindres défauts, vous vous souveniez qu'il faut être ferme dans vos promesses pour qu'elles me plaisent, et ne point faire de fautes pour que je n'en remarque point.
«Le cardinal est en meilleure humeur qu'il n'avoit été depuis son retour pour Mme de Chevreuse. Il m'a écrit ce soir qu'il étoit en des peines extrêmes de mon mal, que toutes les faveurs du roi ne le touchoient point en l'état où j'étois, et que la gayeté que M. de Châteauneuf avoit aujourd'hui a ôté l'opinion qu'il aime Mme de Chevreuse, à qui il a dit sa maladie sans que cela l'ait touché, et que si Mme de Chevreuse avoit vu sa mine, elle le croiroit le plus dissimulé ou le moins affectionné homme du monde, ce qui l'obligeroit à ne l'aimer jamais ou à ne jamais le croire. Sur cela, Mme de Chevreuse promet à M. de Châteauneuf que, ne se gouvernant pas par les avis du cardinal, elle fera les deux, l'aimant et le croyant toujours.
«Je crois que M. de Châteauneuf est absolument à Mme de Chevreuse, et je vous promets qu'éternellement Mme de Chevreuse traitera M. de Châteauneuf comme sien. Quand toute la terre négligeroit M. de Châteauneuf, Mme de Chevreuse le saura toute sa vie si dignement estimer que, s'il l'aime véritablement comme il dit, il aura sujet d'être content de sa fortune, car toutes les puissances de la terre ne sauroient me faire changer de résolution. Je vous le jure, et je vous commande de le croire et de m'aimer fidèlement.
«Hier au soir le cardinal envoya savoir des nouvelles de Mme de Chevreuse et lui écrivit qu'il mouroit d'envie de la voir, qu'il avoit bien des choses à lui dire, étant plus que jamais à Mme de Chevreuse, qui fait peu de cas de cette protestation et beaucoup de celle que M. de Châteauneuf lui a faite d'être absolument à elle. Demain, je vous en dirai davantage. Aimez toujours votre maître, il se porte mal et n'est sorti ces deux jours que par contrainte; mais en quelque état qu'il puisse être et quoi qu'il lui puisse jamais arriver, il mourra plutôt que de manquer à ce qu'il vous a promis.
«Hier, à six heures du soir, le cardinal de La Valette vint voir Mme de Chevreuse de la part du cardinal de Richelieu. Il lui parla avec douleur et soumission en faveur de son maître. Ensuite de cela il fit force admirations de Mme de Chevreuse et mille galanteries à sa mode qui sont des sottises à la mienne. J'ai répondu fort civilement et froidement. 37 est au désespoir; il dit qu'il veut se perdre puisque Mme de Chevreuse ne le veut pas voir, qu'il lui seroit à charge toute sa vie qu'il n'a jamais chérie que pour ce qu'il croyoit qu'elle pourroit un jour être agréable et utile à Mme de Chevreuse, qu'en ayant perdu l'espérance à cette heure il avoit perdu l'envie de vivre, et que ce sera la dernière importunité que j'aurai de lui. J'espère que votre affection est à l'épreuve de tout. Je vous demande cette grâce et vous promets que tant que Mme de Chevreuse vivra, vous en recevrez d'elle. Cette lettre est écrite dès hier. Depuis, le cardinal de La Vallette m'a fait écrire mille compliments de la part du cardinal de Richelieu.
«Il n'y a plus moyen de dire autre chose pour le diamant; mais quoique le cardinal soupçonne Mme de Chevreuse, ou elle lui en ôtera l'opinion, ou elle lui en donnera une autre, qui est que toutes ses prospérités ne sont pas capables d'assujettir Mme de Chevreuse jusqu'au point de dépendre de ses humeurs s'il en prend d'extravagantes pour elle. Ne vous inquiétez pas de cette affaire, mais bien de la santé de votre maître qui est fort mauvaise et l'arrête au lit, puisque, si vous le perdiez, vous n'en trouverez jamais un pareil en fidélité et affection.
«Je n'ai pas moins d'envie de vous voir que vous de m'entretenir, mais je suis en peine comment en trouver les moyens, car il ne faut pas que le cardinal sache que nous nous sommes vus, si on ne le veut mettre hors des gonds. Mandez-moi donc comment il faut faire pour que je vous voye sans que le cardinal le puisse savoir.
«Je vous commanderai toujours, hors cette fois que je vous demande une grâce qui est la plus grande que vous me puissiez faire, c'est que M. de Châteauneuf ne doute jamais de Mme de Chevreuse et s'assure qu'il ne perdra jamais les bonnes grâces de son maître que Mme de Chevreuse ne perde la vie, ce qu'elle auroit regret qui arrivât avant d'avoir prouvé à M. de Châteauneuf combien il est estimé de Mme de Chevreuse, encore que ce soit plus qu'elle ne lui a promis. Mais un bon maître ne sauroit craindre de faillir en obligeant son serviteur, quand il se témoigne plein de fidélité et d'affection. Le cardinal veut persuader à Mme de Chevreuse qu'il a le cœur rempli de tous les deux pour elle qui ne croit pas ses paroles. Je donnerois de ma vie pour vous entretenir, mais je ne sais comment faire, car il ne faut pas que le cardinal puisse le savoir. Parlez-en avec le porteur pour en trouver les moyens, et croyez qu'il n'y a que la mort qui me puisse ôter les sentiments où je suis pour vous.
«Jamais il n'y eut rien de pareil à l'extravagance du cardinal. Il a envoyé à Mme de Chevreuse et lui a écrit des plaintes étranges. Il dit qu'elle a perpétuellement raillé avec Germain (lord Jermin, agent et ami très-particulier de la reine d'Angleterre), afin qu'il dît en son pays le mépris qu'elle faisoit de lui, qu'il sait assurément que Mme de Chevreuse et M. de Châteauneuf sont en intelligence, et que vos gens ne bougent de chez moi, que je reçois Brion à cause qu'il est son ennemi pour lui faire dépit, que tout le monde dit qu'il est amoureux de moi, qu'il ne sauroit plus souffrir mon procédé. Voilà l'état où est le cardinal. Mandez-moi ce que vous apprendrez de cela, et ne faites semblant d'en rien savoir. Je verrai le cardinal ici et vous ferai savoir ce qui se passera. Croyez que, quoi qu'il puisse arriver à votre maître, il ne fera rien d'indigne de lui ni qui vous doive faire honte d'être à lui. Je me porte un peu mieux, et plus résolue que jamais d'estimer M. de Châteauneuf jusqu'à la mort comme je vous l'ai promis.»
Et ce n'était pas là un pur commerce de galanterie: il y avait dessous une intrigue politique très-compliquée. Le duc d'Orléans venait de nouveau de quitter la France, et on s'agitait autour de lui pour lui persuader de ne pas rester en Lorraine et à Bruxelles, et d'aller chercher, avec la reine sa mère, un asile auprès de sa sœur en Angleterre. Pour cela, il fallait changer le ministère anglais et renverser le grand trésorier attentif à maintenir la paix avec la France et à éviter tout motif de querelle et de guerre entre les deux pays. Une cabale puissante conspirait sa perte, et à la tête de cette cabale était ou passait pour être la reine Henriette, et à la suite de la reine lord Holland, ennemi personnel du grand trésorier, lord Montaigu et le commandeur de Jars, serviteurs dévoués et chevaleresques de la belle Henriette. On a peine à comprendre aujourd'hui comment un homme d'État tel que Châteauneuf a pu s'engager dans une entreprise aussi contraire à ses intérêts qu'à ses devoirs; mais Mme de Chevreuse avait réussi à faire passer dans l'esprit du garde des sceaux cette opinion alors très-spécieuse, qui plus tard a entraîné le politique et réfléchi duc de Bouillon, et qui était à Mme de Chevreuse le fond de ses espérances et le ressort de toute sa conduite: Louis XIII et Richelieu ont un pied dans la tombe; le premier des deux qui mourra emportera l'autre; l'avenir appartient donc au duc d'Orléans, qui déjà est presque roi, à la reine Anne, à la reine mère, qui ont pour eux l'Empire, l'Angleterre et l'Espagne; attendons et préparons cet infaillible avenir, et gardons-nous de nous donner à un homme dont la destinée est si précaire.
Quel ne fut pas le courroux du superbe et impérieux cardinal lorsqu'il apprit qu'il avait été ainsi joué par une femme et trahi par un ami! Sa vengeance s'appesantit sur l'infidèle garde des sceaux. Il le tint enfermé dans le château fort d'Angoulême pendant dix longues années. Le frère de Châteauneuf, le marquis d'Hauterive, put à peine se sauver à la faveur de la nuit et se réfugier en Hollande. On s'empara de son neveu, le marquis de Leuville, qu'on garda longtemps en prison; on jeta à la Bastille le commandeur de Jars, ami particulier du garde des sceaux, et dont on avait saisi des lettres fort équivoques; on lui fit son procès à Troyes; il fut condamné à avoir la tête tranchée pour crime de correspondance avec l'étranger, et, comme nous l'avons dit, il ne reçut sa grâce que sur l'échafaud.
Par un étrange contraste, Mme de Chevreuse, ménagée par Richelieu dans un reste d'espérance, n'eut pas d'autre punition que de se retirer à Dampierre, avec l'ordre de ne point revenir à Paris sans la permission du roi. Le cardinal croyait avoir besoin d'elle pour les affaires de Lorraine, où déjà son influence sur le duc Charles avait été fort utile, et pouvait l'être encore dans les nouvelles et difficiles négociations qui aboutirent au traité du 6 septembre 1633. Charles IV était alors plus engagé que jamais contre Richelieu: en favorisant le mariage du duc d'Orléans avec sa sœur Marguerite, il s'était comme enchaîné à la cause du duc et de la reine mère, et poussé par eux il avait rassemblé des troupes et fait des mouvements qui avaient contraint le cardinal, pour l'occuper chez lui et l'empêcher de se joindre à l'armée impériale, de lui jeter les Suédois sur les bras. Mais Charles IV avait les qualités de ses défauts: il soutenait ses téméraires entreprises de la plus brillante valeur et d'une vraie capacité militaire; il avait fait essuyer plus d'un échec aux Suédois, et il pouvait sortir de là des complications redoutables. Il importait à la France d'être tranquille du côté de la Lorraine, pour disposer librement de ses forces en Allemagne au service de ses alliés et en Flandre contre les Espagnols. Il s'agissait d'amener le duc Charles à désarmer en même temps que les Suédois, en donnant des sûretés bien plus grandes qu'aux précédents traités, en remettant même Nancy en dépôt provisoire entre nos mains. Pour persuader Charles IV, Richelieu avait, ce semble, une raison bien suffisante, l'impossibilité de toute résistance, une puissante armée française étant déjà dans le cœur de la Lorraine et maîtresse de toutes les places fortes. Le cardinal donna-t-il à Mme de Chevreuse la tâche ingrate de seconder et d'adoucir la nécessité [142]? Du moins il est certain que, grâce à une protection qui ne pouvait être désintéressée, Mme de Chevreuse put demeurer quelque temps à Dampierre avec son mari et ses enfants. Mais elle ne s'y amusait guère. La reine aussi ne s'amusait pas davantage dans sa prison du Louvre. Les deux nobles amies avaient besoin de se voir pour soulager leurs peines en s'en entretenant, et vraisemblablement aussi pour aviser aux moyens de les faire cesser. Plus d'une fois le soir, à l'ombre naissante, Mme de Chevreuse vint à Paris, s'introduisit furtivement au Val-de-Grâce, saint monastère dans le faubourg Saint-Jacques où se retirait souvent Anne d'Autriche; elle y voyait quelques moments la reine, et au milieu de la nuit s'en retournait à Dampierre. Bientôt on découvrit ou on soupçonna ces visites clandestines, et on exila de nouveau Mme de Chevreuse, non pas comme la première fois hors de France, où son activité et son influence eussent été bien plus redoutables, mais à cent lieues de la cour et de la reine, en Touraine, dans une terre de son premier mari.
Qu'on juge du mortel ennui qui dut accabler la belle et vive duchesse, ensevelie jeune encore dans le fond d'une province, loin de toutes les émotions qui lui étaient devenues nécessaires, loin de toute intrigue de politique et d'amour. Elle resta en Touraine près de quatre années, depuis la fin de 1633 jusqu'au milieu de 1637. C'était pour elle un divertissement fort médiocre de tourner la vieille tête de l'archevêque de Tours, Bertrand d'Eschaux [143]; et, pour se soutenir, elle avait grand besoin des visites de plus jeunes adorateurs: il ne manqua pas de s'en présenter.
Lord Montaigu et le comte de Craft, envoyés en France par le roi et la reine d'Angleterre, passèrent à Paris la fin de l'année 1634. Les plaisirs de la cour, dans l'épuisement du trésor, et avec la guerre qui tenait éloignée la fleur de la noblesse française, n'étaient point assez vifs pour faire oublier aux deux gentilshommes anglais celle qu'ils avaient vue autrefois à Londres dans tout l'éclat de la beauté et de la puissance, et ils vinrent l'un après l'autre en Touraine consoler la belle exilée.
Mme de Chevreuse coquetta beaucoup avec Craft, et peut-être parce que le jeune comte lui était agréable dans sa solitude, et aussi parce qu'elle mettait du prix à s'attacher un gentilhomme qui avait toute la confiance de la reine Henriette et une assez grande importance à la cour d'Angleterre. Elle y réussit parfaitement, et Craft ne la quitta, en février 1635, qu'avec le plus ardent enthousiasme pour sa beauté, son esprit et son courage. Il épanche sa jeune admiration dans les lettres passionnées qu'il lui adresse de Calais et de Londres [144]. Il lui sacrifie toutes les femmes qu'il rencontre. Il ne voit plus autour de lui que faiblesse et bassesse en comparaison des nobles sentiments et de la grandeur d'âme dont il emporte avec lui l'image. Il est résolu à tout braver pour conserver l'estime de sa belle amie; cette estime lui est le premier de tous les biens, et il ne demande à être traité que selon ce qu'elle lui verra faire. Était-ce un second Chalais que venait d'acquérir Mme de Chevreuse? Grâce à Dieu, celui-là ne fut pas mis aux mêmes épreuves que le premier.
Lord Montaigu était un tout autre homme que Guillaume de Craft; la politique l'occupait plus que la galanterie, bien qu'il les mêlât ensemble, selon le goût et les habitudes du temps. Ennemi de Richelieu, son grand objet était d'unir contre lui le duc de Lorraine, le duc de Savoie, l'Angleterre et l'Espagne. Le coup de main dont il avait été la victime en 1627, au lieu de l'intimider, n'avait fait que l'animer davantage, et il persévérait dans tous ses desseins. Il était parvenu à entretenir en secret au Val-de-Grâce Anne d'Autriche, pour laquelle, ainsi que pour la reine Henriette, il professait le dévouement le plus désintéressé. Il s'était aussi rendu en Touraine auprès de Mme de Chevreuse. La reine lui avait donné une lettre pour son amie, où elle lui disait qu'elle portait bien envie à Montaigu de pouvoir passer une heure avec elle, et plaisantait un peu le fidèle et courageux gentilhomme sur le sentiment qui l'entraînait vers les bords de la Loire. Voici la réponse qu'elle reçut [145]:
«Cet excès de bonté qui vous fait désirer d'être une heure en ce lieu pour rendre heureux ceux qui y sont, me donne la liberté de répondre à la raillerie que vous faites à M. de Montaigu sur son séjour ici. J'avoue que c'est avec sujet que vous croyez que ce lui est un avantage d'être quelque temps à Tours, mais pour une raison bien différente de celle que vous en donnez: il est certain qu'il avoit besoin de n'être plus auprès de vous pour lui faire voir qu'il étoit encore mortel puisqu'il ne demeuroit pas toujours avec les anges. Si j'ai du crédit auprès d'eux, il sera bientôt en cette félicité; c'est à mon avis le plus grand bien qu'il sçauroit avoir, et non pas le moindre qui vous peut arriver [146]. Je ne m'ose flatter de l'espérance d'un tel bonheur pour moi, ni ne me lasse point de le souhaiter, mais je m'afflige bien de vous dire tant de fois, sans vous le témoigner une seule, que je suis parfaitement votre très humble et très obéissante servante, «M. de Rohan.»
C'est aussi vers ce temps-là que Mme de Chevreuse fit la connaissance de La Rochefoucauld. Il entrait alors dans le monde, et en vrai jeune homme il se jeta d'abord dans le parti des dames qui était celui de l'opposition [147]; il se prit d'un grand attachement pour la belle reine persécutée, et surtout pour sa charmante dame d'atours, Mme de Hautefort. Demeurant à Verteuil, près d'Angoulême, il n'était pas fort loin de Tours. La reine Anne, touchée, comme le sera plus tard Mme de Longueville, des apparences chevaleresques du jeune et brillant gentilhomme, lui donna toute sa confiance, et désira que Mme de Chevreuse et lui se connussent. «Nous fûmes bientôt, dit La Rochefoucauld [148], dans une très grande liaison... En allant et revenant j'étois souvent chargé par l'une ou par l'autre de commissions périlleuses.» Il ne s'agissait donc pas seulement entre la reine Anne et son ancienne surintendante d'un échange de compliments et de nouvelles de leur santé. Non: Mme de Chevreuse employait mieux son activité et ses loisirs; elle était le centre et le lien d'une correspondance mystérieuse entre la reine de France, le duc de Lorraine et le roi d'Espagne.
La reine se servait pour ce commerce secret de La Porte, un de ses valets de chambre en qui elle avait une absolue confiance qu'il justifia bien, comme on va le voir. Quelquefois la reine écrivait la nuit dans l'intérieur de ses appartements du Louvre; quelquefois elle se rendait au Val-de-Grâce, en apparence pour y faire ses dévotions, et elle y écrivait des lettres que la supérieure, Louise de Milley, la mère de Saint-Étienne, doublement dévouée à Anne d'Autriche et comme catholique et comme Espagnole [149], se chargeait de faire arriver à leur adresse. La reine croyait agir dans une ombre impénétrable, mais la police du soupçonneux cardinal était aux aguets. Un billet d'Anne à Mme de Chevreuse, confié par La Porte à un homme dont il se croyait sûr et qui le trahit, fut intercepté, La Porte arrêté, jeté dans un cachot de la Bastille, interrogé tour à tour par les suppôts les plus habiles du cardinal, Laffemas et La Poterie, par le chancelier Pierre Séguier et par Richelieu lui-même. En même temps le chancelier, accompagné de l'archevêque de Paris, se fit ouvrir les portes du Val-de-Grâce, pénétra dans la cellule de la reine, fouilla tous ses papiers, et interrogea la supérieure, la mère de Saint-Étienne, après lui avoir fait commander par l'archevêque de dire la vérité au nom de l'obéissance qu'il lui devait et sous peine d'excommunication. La reine en cette affaire eut beaucoup à souffrir, et courut les plus grands dangers.
Écoutons La Rochefoucauld, qui, ce semble, devait être parfaitement informé, puisqu'il était alors, avec Mme de Hautefort et Mme de Chevreuse, le confident le plus intime d'Anne d'Autriche: «On accusoit la reine d'avoir des intelligences avec le marquis de Mirabel, ministre d'Espagne... On lui en fit un crime d'État... Plusieurs de ses domestiques furent arrêtés, ses cassettes furent prises; M. le chancelier l'interrogea comme une criminelle; on proposa de la renfermer au Havre, de rompre son mariage et de la répudier. Dans cette extrémité, abandonnée de tout le monde, manquant de toutes sortes de secours et n'osant se confier qu'à Mme de Hautefort et à moi, elle me proposa de les enlever toutes deux et de les emmener à Bruxelles. Quelques difficultés et quelques périls qui parussent dans un tel projet, je puis dire qu'il me donna plus de joie que je n'en avois eu de ma vie. J'étois dans un âge où l'on aime à faire des choses extraordinaires et éclatantes, et je ne trouvois pas que rien le fût davantage que d'enlever en même temps la reine au roi son mari et au cardinal de Richelieu qui en étoit jaloux, et d'ôter Mme de Hautefort au roi qui en étoit amoureux. Heureusement les choses changèrent; la reine ne se trouva pas coupable, l'interrogatoire du chancelier la justifia, et Mme d'Aiguillon adoucit le cardinal de Richelieu [150].» Tout ce récit nous est un peu suspect. Nous ne pouvons croire que la reine ait eu la folle idée que lui prête La Rochefoucauld; il aura pris une plaisanterie pour une proposition sérieuse, et il la rapporte pour se donner, selon sa coutume, un air d'importance. Il n'était pas d'ailleurs, quoi qu'il en dise, assez hardi pour se charger d'une entreprise aussi téméraire, et nous le verrons très-circonspect en des occasions bien moins périlleuses. D'autre part l'interrogatoire du chancelier n'a point justifié la reine, et la reine ne s'est point trouvée innocente; loin de là, elle a été trouvée et elle-même s'est reconnue coupable, et c'est à ses aveux qu'elle dut le pardon qui lui fut accordé. Mme de Motteville le déclare formellement, bien entendu en défendant, comme à son ordinaire, l'innocence de sa maîtresse: «La reine, dit-elle [151], avoit été réduite à ce point de ne pouvoir obtenir de pardon qu'en signant de sa propre main qu'elle étoit coupable de toutes les choses dont elle étoit accusée, et elle le demanda au roi en des termes fort humbles et fort soumis... Chacun étoit dans cette croyance qu'elle étoit innocente. Elle l'étoit en effet autant qu'on le croyoit à l'égard du roi; mais elle étoit coupable, si c'étoit un crime d'avoir écrit au roi d'Espagne, son frère, et à Mme de Chevreuse. La Porte, domestique de la reine, m'a conté lui-même toutes les particularités de cette histoire. Il me les a apprises dans un temps où il étoit disgracié et mal satisfait de cette princesse, et ce qu'il m'en a dit doit être cru. Il fut arrêté prisonnier comme étant le porteur de toutes les lettres de la reine, tant pour l'Espagne que pour Mme de Chevreuse. Il fut interrogé trois fois dans la Bastille par La Poterie. Le cardinal de Richelieu le voulut interroger lui-même en présence du chancelier. Il le fit venir chez lui dans sa chambre, là où il fut questionné et pressé sur tous les articles sur quoi on désiroit de pouvoir confondre la reine. Il demeura toujours ferme sans rien avouer... refusant les biens et les récompenses qu'on lui promettoit, et acceptant plutôt la mort que d'accuser la reine de choses dont il disoit qu'elle étoit innocente. Le cardinal de Richelieu, admirant sa fidélité, et persuadé qu'il ne disoit pas vrai, souhaita d'être assez heureux pour avoir à lui un homme aussi fidèle que celui-là. On avoit surpris aussi une lettre en chiffres de la reine qu'on montra à cette princesse. Elle ne put qu'elle ne l'avouât, et, pour ne pas montrer de dissemblance, il fallut faire avertir La Porte de ce que la reine avoit dit, afin qu'il en fît autant. Ce fut en cette occasion que Mme de Hautefort, qui étoit encore à la cour, voulant généreusement se sacrifier pour la reine, se déguisa en demoiselle suivante pour aller à la Bastille faire donner une lettre à La Porte, ce qui se fit avec beaucoup de peine et de danger pour elle par l'habileté du commandeur de Jars, qui étoit encore prisonnier. Comme il étoit créature de la reine et qu'il avoit gagné beaucoup de gens en ce lieu-là, ils firent tomber la lettre entre les mains de La Porte. Elle lui apprenoit ce que cette princesse avoit confessé, si bien qu'étant tout de nouveau interrogé par Laffemas et menacé de la question ordinaire et extraordinaire même, il fit semblant de s'en épouvanter, et dit que si on lui faisoit venir quelque officier de la reine, homme de créance, il avoueroit tout ce qu'il savoit. Laffemas croyant l'avoir gagné, lui dit qu'il pouvoit nommer celui qu'il voudroit, et que sans doute on le lui feroit venir. La Porte demanda un nommé Larivière, officier de la reine, qu'il savoit être des amis de Laffemas, et dont il n'avoit pas bonne opinion, ce que cet homme accepta avec grande joie. Le roi et le cardinal firent venir ce Larivière. On lui commanda d'aller voir La Porte sans voir la reine, et gagné par les promesses qu'on lui fit, il s'engagea de faire tout ce qu'on voudroit. Il fut mené à la Bastille, et il commanda de la part de la reine à La Porte de dire tout ce qu'il savoit de ses affaires. La Porte fit semblant de croire que c'étoit la reine qui l'envoyoit, et lui dit, après bien des façons, ce que la reine avoit déjà avancé, et protesta n'en pas savoir davantage. Le cardinal de Richelieu fut alors confondu, et le roi demeura satisfait. La Porte, homme de bien et sincère, m'a assuré qu'ayant vu les lettres dont il était question et sachant ce qu'elles contenoient, il y avoit lieu de s'étonner qu'on pût former des accusations contre la reine, qu'il y avoit seulement des railleries contre le cardinal de Richelieu, et qu'assurément elles ne parloient de rien qui fût contre le roi ni contre l'État.» La Porte, dans ses Mémoires, confirme ce récit de Mme de Motteville: «La reine [152], dit-il, se voyant sans enfants et ses ennemis dans une puissance absolue, elle avoit sujet de craindre qu'ils ne prissent cette occasion pour la perdre en la faisant répudier et renvoyer en Espagne, et faire épouser Mme d'Aiguillon au roi. Ces réflexions lui donnèrent de grandes inquiétudes, et n'ayant aucun sujet de consolation, elle en voulut chercher dans ses proches et dans les autres personnes qui lui étoient affectionnées et qui avoient les mêmes ennemis. Pour y parvenir elle tâcha d'entretenir correspondance avec le roi d'Espagne et le cardinal infant son frère, avec l'archiduchesse gouvernante des Pays-Bas sa tante, avec le duc de Lorraine et avec Mme de Chevreuse. Comme elle avoit peu de domestiques qui ne fussent pensionnaires du cardinal, et qu'elle avoit assez de preuves de ma fidélité, elle jeta les yeux sur moi pour ses correspondances: elle me donna les clefs de ses chiffres et de ses cachets; en sorte qu'étant au Val-de-Grâce et les soirs au Louvre, quand tout le monde étoit retiré, après avoir fait tout ce qu'elle pouvoit pour tromper ses espions, elle écrivoit ses lettres en espagnol qu'elle me donnoit après pour les mettre en chiffre, et lorsque je recevois les réponses, je les déchiffrois en les mettant en espagnol pour les lui donner. Je lui faisois signe de l'œil, en sorte qu'elle prenoit son temps pour me parler, et je les lui donnois sans qu'on s'en apperçût. Pour faire tenir ces lettres en Flandre et en Espagne, nous avions un secrétaire d'ambassade [153] en Flandre, qui les donnoit au marquis de Mirabel, qui étoit ambassadeur d'Espagne pour l'archiduchesse, après l'avoir été en France. Cet ambassadeur faisoit tenir tous nos paquets à leurs adresses, et nous recevions les réponses par les mêmes voies. Pour la Lorraine, nous avions l'abbesse de Jouarre, de la maison de Guise, que j'allois voir fort souvent; et pour les lettres de Mme de Chevreuse, je les lui envoyois à Tours par la poste, et je recevois ses réponses par la même voie; outre que la reine et elle s'écrivoient encore par le moyen de ceux qui alloient ou qui passoient à Tours. Nos lettres étoient écrites avec une eau en l'entreligne d'un discours indifférent, et en lavant le papier d'une autre eau l'écriture paroissoit. Ainsi la reine avoit des nouvelles de toutes parts sans qu'on s'en apperçût... Notre correspondance dura jusqu'au mois d'août 1637.» Le fidèle La Porte n'hésite pas à affirmer qu'il n'y avait pas de finesse dans les lettres de la reine et de Mme de Chevreuse, et «qu'on [154] embarqua Mme de Chevreuse dans cette affaire pour faire croire au public que c'étoit une grande cabale contre l'État; car il étoit de la coutume de son Éminence de faire passer des choses de rien pour de grandes conspirations.»
Reste à savoir si en effet il n'y avait là que des choses de rien, comme dit La Porte. Nous venons d'entendre les amis de la reine, mais il faut entendre aussi Richelieu [155]; il faut entendre surtout des témoins bien autrement sûrs que tous les mémoires, c'est-à-dire les documents originaux et authentiques d'après lesquels Richelieu a écrit. Ces documents irrécusables sont les lettres mêmes de la reine Anne que La Porte a représentées à Mme de Motteville comme si parfaitement innocentes, ou du moins un certain nombre de ces lettres que la police du cardinal intercepta et qui de ses mains sont tombées entre les nôtres [156]. Beaucoup d'autres sans doute ont échappé à Richelieu et sont parvenues à leur adresse, mais celles-là suffisent à établir que pendant les années 1635 et 1636 et plusieurs mois de l'année 1637, tandis que la France et l'Espagne se faisaient une guerre à outrance sur la frontière de Flandre, la reine entretenait une correspondance suivie avec le marquis de Mirabel, naguère ambassadeur d'Espagne en France, et depuis résidant à Bruxelles, ainsi qu'avec le cardinal infant lui-même, le général en chef de l'armée espagnole qui avait franchi la frontière et après avoir pris Corbie menaçait Amiens. Cette correspondance passait en grande partie par les mains d'une personne que ne nomment pas même ni La Rochefoucauld ni Mme de Motteville ni La Porte, à savoir Mme du Fargis, la femme du comte du Fargis, ancien ambassadeur de France en Espagne, le négociateur du célèbre traité de Monçon, elle-même ancienne dame d'atours de la reine Anne avant Mme de Hautefort, qu'on avait éloignée de la cour en 1630 à cause des mauvais conseils qu'on l'accusait de donner à sa maîtresse, et qui, dès 1634, réfugiée en Flandre, y servait d'agent secret à Anne d'Autriche [157]. Sans doute, la plupart de ces lettres ne contiennent guère que des marques d'intérêt accordées par la reine à une femme qui s'était perdue pour elle, et qu'elle se faisait un devoir de recommander à la générosité de l'Espagne, avec des témoignages bien naturels de politesse et d'affection envers un ancien serviteur tel que Mirabel et envers son frère, le cardinal infant; mais, n'en déplaise à La Rochefoucauld, à Mme de Motteville et à La Porte, il y a aussi bien autre chose encore dans les lettres qui sont sous nos yeux. D'abord la reine laisse exprimer à Mme Du Fargis et au marquis de Mirabel des vœux et des espérances qu'une reine de France aurait dû repousser; ensuite elle-même se permet quelquefois un langage plus digne d'une Espagnole que d'une Française; enfin elle reçoit d'importantes nouvelles d'Angleterre, de Lorraine, de la reine mère, de Monsieur, de la jeune duchesse d'Orléans, du comte de Soissons et du duc de Bouillon, qu'elle se garde bien de communiquer au gouvernement du roi, et elle transmet à un gouvernement ennemi des renseignements qui pouvaient être fort préjudiciables à l'État. Par exemple, en 1637, la France s'efforçait d'acquérir le duc de Lorraine dont les talents militaires et la petite mais solide armée pouvaient être d'un grand poids dans la balance des événements. L'Espagne, de son côté, disputait le duc à la France, et Mme de Chevreuse ne négligeait rien pour engager Charles IV dans la cause espagnole. Mais ce qu'on ne savait pas, et ce qu'on voit clairement ici, c'est que Mme de Chevreuse ne fut guère que l'instrument de la reine Anne, et que, dans un moment décisif, lorsque Richelieu espérait entraîner le duc de Lorraine, la reine, instruite d'un pareil secret, se hâte de le communiquer à son frère le cardinal infant, et lui adresse une lettre qu'elle le prie d'envoyer au comte-duc Olivarès, dans laquelle elle fait vivement sentir la nécessité de maintenir la vaillante épée de Charles IV au service de Sa Majesté catholique, c'est-à-dire contre la France, et annonce qu'elle emploie à cet effet Mme de Chevreuse [158]. En sorte qu'en vérité, sans être Laffemas ou La Potherie, il est bien difficile de ne pas avouer que la reine Anne avait sacrifié son devoir à sa passion.
Mais nous possédons un témoignage plus péremptoire, s'il est possible, celui d'Anne d'Autriche elle-même qui, voyant saisies ses lettres de Flandre et celles qu'elle avait écrites à Mme de Chevreuse, et se croyant menacée des derniers malheurs, pour les conjurer et apaiser le roi et son ministre, finit par dire toute la vérité. Ces aveux précis et détaillés, que le P. Griffet avait connus et qu'on vient de retrouver tout récemment [159], portent le dernier coup aux apologies intéressées de ses défenseurs, et justifient pleinement la conduite et le récit de Richelieu. La reine confessa: 1o en ce qui concernait Mme de Chevreuse, que, lorsqu'elle était reléguée à Dampierre, en 1633, avant d'être exilée en Touraine, la duchesse était venue deux fois en secret au Val-de-Grâce; que depuis elle lui avait écrit plusieurs fois à ce même Val-de-Grâce et y avait même adressé un messager; que de Touraine elle lui avait proposé de rompre son ban et de venir déguisée la trouver à Paris; qu'elle correspondait avec le duc de Lorraine, et qu'elle avait reçu un envoyé du duc; 2o pour elle-même, qu'en effet elle a écrit toutes les lettres interceptées, qu'elle les écrivait de sa main, les donnait à La Porte qui les donnait à Auger, secrétaire de l'ambassade d'Angleterre à Paris, et que celui-ci les faisait passer à Gerbier, résident d'Angleterre à Bruxelles, lequel les remettait à leur adresse; que souvent elle s'était plaint dans ses lettres de l'état où elle était en des termes qui devaient déplaire au roi; qu'elle avait signalé à la cour de Madrid le voyage d'un religieux envoyé en Espagne avec une mission secrète; qu'elle avait aussi averti qu'il y avait lieu de craindre que l'Angleterre, au lieu de demeurer unie à l'Espagne, ne s'en détachât et ne s'entendît avec la France; qu'enfin elle avait fait savoir que la France travaillait à s'accommoder avec le duc de Lorraine, afin que le cabinet de Madrid prît ses mesures pour empêcher cet accommodement.
Comme on le pense bien, on n'avait amené Anne d'Autriche à faire de pareils aveux qu'avec des peines infinies. D'abord elle avait tout nié, et dit que si elle avait plusieurs fois écrit à Mme de Chevreuse, ç'avait toujours été sur des choses indifférentes. Au mois d'août 1637, le jour de l'Assomption, après avoir communié, elle avait fait venir son secrétaire des commandements, Le Gras, et elle lui avait juré sur le saint sacrement, qu'elle venait de recevoir, qu'il était faux qu'elle eût une correspondance en pays étranger, et elle lui avait commandé d'aller dire au cardinal le serment qu'elle faisait. Elle fit venir aussi le P. Caussin, jésuite, confesseur du roi, et lui renouvela le même serment. Puis, deux jours après, voyant qu'il n'y avait pas moyen de s'en tenir à une dénégation aussi absolue, elle commença par avouer à Richelieu qu'à la vérité elle avait écrit en Flandre à son frère, le cardinal infant, mais pour savoir des nouvelles de sa santé, et autres choses d'aussi peu de conséquence. Richelieu lui ayant montré qu'on en savait davantage, elle fit retirer sa dame d'honneur, Mme de Sénecé, Chavigny et de Noyers, qui étaient présents, et, restée seule avec le cardinal, sur l'assurance qu'il lui donna du plein et absolu pardon du roi si elle disait la vérité, elle avoua tout, en témoignant une extrême confusion d'avoir fait des serments contraires. Pendant cette triste confession, appelant à son secours les grâces et les ruses de la femme, et couvrant ses vrais sentiments de démonstrations affectueuses, elle s'écria plusieurs fois: «Quelle bonté faut-il que vous ayez, monsieur le cardinal!» Et protestant d'une reconnaissance éternelle, elle lui dit: «Donnez-moi la main,» et lui présenta la sienne comme un gage de sa fidélité; mais le cardinal s'y refusa par respect, se retirant au lieu de s'approcher [160]. L'abbesse du Val-de-Grâce fit comme la reine; après avoir tout nié, elle avoua ce qu'elle savait. Le roi et Richelieu pardonnèrent, mais en faisant signer à la reine une sorte de formulaire de conduite auquel elle devait se conformer religieusement. On lui interdit provisoirement l'entrée du Val-de-Grâce et de tout couvent jusqu'à ce que le roi lui en donnât de nouveau la permission; on lui défendit d'écrire jamais qu'en présence de sa première dame d'honneur et de sa première femme de chambre, qui devaient en rendre compte au roi, ni d'adresser une seule lettre en pays étranger par aucune voie directe ou indirecte, sous peine de se reconnaître elle-même déchue du pardon qu'on lui accordait. La première à la fois et la dernière de ces prescriptions se rapportaient à Mme de Chevreuse: le roi commandait à sa femme de ne jamais écrire à Mme de Chevreuse, «parce que ce prétexte, disait-il, a été la couverture de toutes les écritures que la reine a faites ailleurs.» Il lui commande aussi de ne plus voir ni Craft, qu'on avait trouvé mêlé à toutes les intrigues de Flandres [161], ni «les autres entremetteurs de Mme de Chevreuse.» On le voit, c'est toujours Mme de Chevreuse que Louis XIII et Richelieu considèrent comme le principe de tout mal, et ils ne se croient bien sûrs de la reine qu'après l'avoir séparée de sa dangereuse amie.
Mais que fallait-il faire de celle-ci? Fallait-il la laisser à Tours, ou l'arrêter, ou lui faire quitter la France? Il est curieux de voir quelles furent à cet égard les délibérations du cardinal avec lui-même et avec le roi. Il rend involontairement un bien grand hommage à la puissance de Mme de Chevreuse en établissant par une suite de raisons, un peu scolastiquement déduites à sa manière, que le pire des partis serait de la laisser sortir de France: «Cet esprit est si dangereux, qu'étant dehors il peut porter les affaires à de nouveaux ébranlements qu'on ne peut prévoir [162].» C'est elle qui, disposant absolument du duc Charles, lui a persuadé de donner asile en Lorraine à Monsieur, duc d'Orléans; c'est elle aussi qui a poussé l'Angleterre à la guerre; si on la jette hors du royaume, elle empêchera le duc de Lorraine de s'accommoder; «elle donnera grand branle aux Anglois à ce à quoi elle les voudra porter;» elle remuera de nouveau pour le commandeur de Jars et pour Châteauneuf, elle suscitera mille difficultés intérieures et extérieures, et le cardinal conclut à la retenir en France.
Pour cela, il y avait deux voies à prendre, la violence ou la douceur. Le cardinal fait voir beaucoup d'inconvénients à la violence, qui serait infailliblement suivie de tant de sollicitations importunes de la part de toute la famille de Mme de Chevreuse et de toutes les puissances de l'Europe, qu'il serait fort difficile d'y résister avec le temps. Il propose donc de la gagner par la douceur et de la traiter comme on avait traité la reine, mais à la condition qu'elle serait aussi sincère et répondrait aux questions qui lui seraient adressées. Connaissant Mme de Chevreuse, il prévoit qu'elle ne fera aucun aveu, et il oublie de nous dire ce qu'alors il aurait fait. On avait pardonné à la reine humiliée et repentante; mais quelle conduite aurait-on tenue envers la fière et habile duchesse persévérant dans d'absolues dénégations? Content de l'avoir séparée d'Anne d'Autriche, Richelieu l'aurait-il laissée libre et tranquille en Touraine? Est-il bien sincère quand il l'assure? ou l'ancien charme agissait-il encore, et ce cœur de fer, cette âme impitoyable ne pouvait-elle se défendre d'une faiblesse involontaire pour une femme qui rassemblait en sa personne et portait au plus haut degré ces deux grands dons si rarement unis, la beauté et le courage?
Il lui fit parler comme étant toujours son ami; il lui rappela quels ménagements il avait eus pour elle dans l'affaire de Châteauneuf, et, la sachant en ce moment assez dépourvue, il lui envoya de l'argent. La duchesse fit beaucoup de cérémonies pour le recevoir; quelque temps elle le refusa [163], et, lorsque la nécessité finit par la contraindre à l'accepter, elle ne le prit pas comme un don, mais comme un prêt, et demanda pour toute grâce au cardinal de l'assister dans le juste procès qu'elle poursuivait pour être séparée de biens d'avec son mari, procès qu'elle gagna quelque temps après. Sur les questions qui lui furent adressées, elle répondit sans s'étonner et avec sa fermeté accoutumée. Ne pouvant nier qu'elle eût proposé à la reine de se rendre à Paris déguisée, puisqu'on avait saisi la lettre où la reine rejetait cette proposition, elle déclara qu'en cela elle n'avait eu d'autre désir que d'avoir l'honneur de saluer sa souveraine, et qu'aussi le besoin de ses affaires l'appelait à Paris; que, loin de songer à animer la reine contre le cardinal, son intention était d'employer le crédit qu'elle pouvait avoir sur elle à la bien disposer en faveur du premier ministre. Et, payant Richelieu de la même monnaie, elle lui rendit avec usure ses démonstrations d'amitié; mais au fond du cœur elle s'en défiait. En vain les envoyés de Richelieu, le maréchal La Meilleraie, l'évêque d'Auxerre, et surtout l'abbé Du Dorat, ancien serviteur de la maison de Lorraine et trésorier de la Sainte-Chapelle, avec qui elle était assez liée, lui dit-il tout ce qu'il put imaginer pour lui persuader la bonne foi du cardinal; elle ne vit dans cette bienveillance empressée qu'un leurre habile pour endormir sa vigilance et lui inspirer une fausse sécurité. Elle pensa à ses amis le commandeur de Jars et Châteauneuf, tous deux languissant encore dans les cachots de Richelieu, et elle résolut de tout entreprendre plutôt que de partager leur sort.