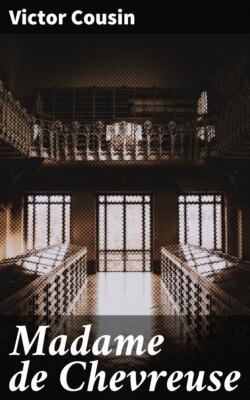Читать книгу Madame de Chevreuse - Victor Cousin - Страница 9
CHAPITRE QUATRIEME
1637-1643
ОглавлениеMME DE CHEVREUSE EN ESPAGNE, PUIS EN ANGLETERRE.—LONGUE NÉGOCIATION AVEC RICHELIEU POUR RENTRER EN FRANCE. COMMENT CETTE NÉGOCIATION ÉCHOUE.—LE PARTI DES ÉMIGRÉS A LONDRES. MARIE DE MÉDICIS, LE DUC DE LA VALETTE, LA VIEUVILLE, SOUBISE.—MME DE CHEVREUSE S'EN VA EN FLANDRES.—ELLE PREND PART A LA CONSPIRATION DU COMTE DE SOISSONS.—AFFAIRE DE CINQ-MARS.—MORT DE RICHELIEU. DÉCLARATION ROYALE DE LOUIS XIII MOURANT, DU 20 AVRIL 1643, QUI CONDAMNE MME DE CHEVREUSE A UN EXIL PERPÉTUEL. LA RÉGENTE LA RAPPELLE.
On comprend l'accueil que fit le roi d'Espagne à l'intrépide amie de sa sœur. Il avait envoyé au-devant d'elle plusieurs carrosses à six chevaux, et à Madrid il la combla de toutes sortes de marques d'honneur. Mme de Chevreuse avait alors trente-sept ans. A tous ses moyens de plaire elle joignait le prestige des aventures romanesques qu'elle venait de traverser, et l'on dit que Philippe IV grossit le nombre de ses conquêtes [171]. Elle était déjà tout Anglaise et toute Lorraine; elle devint Espagnole. Elle se lia avec le comte-duc Olivarès, et prit un grand ascendant sur les conseils du cabinet de Madrid. Elle le dut sans doute à son esprit et à ses lumières, mais particulièrement à la noble fierté qu'elle déploya en refusant les pensions et l'argent qu'on lui offrait, et en parlant toujours de la France comme il appartenait à l'ancienne connétable de Luynes [172].
Néanmoins, quelque agrément que lui donnât en Espagne la faveur déclarée du roi, de la reine et du premier ministre, elle n'y demeura pas longtemps. La guerre des deux pays rendait sa situation trop délicate; ses lettres pénétraient difficilement en France; on n'osait lui écrire, tant la police de Richelieu était redoutée, tant on craignait d'être accusé de correspondre avec l'ennemi et avec Mme de Chevreuse. L'intendant même de sa maison, Boispille, recevant d'elle une lettre, dit au messager qui lui demandait une réponse: Nous ne faisons pas de réponse en Espagne. Aussi, pour avoir plus de liberté et pour être plus près de la France, elle prit le parti de passer dans un pays neutre et même ami, et au commencement de l'année 1638 elle arriva en Angleterre.
Mme de Chevreuse fut reçue et traitée à Londres comme elle l'avait été à Madrid. Elle y retrouva le premier de ses adorateurs, le comte de Holland, encore très-puissant auprès du roi, lord Montaigu, son ami de tous les temps, Craft, toujours passionné pour elle, et bien d'autres gentilshommes anglais et français, qui s'empressèrent de lui faire cortége. Elle avait toujours beaucoup plu à Charles Ier, et l'aimable Henriette, en revoyant celle qui autrefois l'avait conduite à son royal époux, l'embrassa et voulut qu'elle s'assît devant elle, distinction tout à fait inusitée dans la cour d'Angleterre. Le roi et la reine écrivirent en sa faveur au roi Louis XIII, à la reine Anne et au cardinal de Richelieu. Mme de Chevreuse réclamait la pleine et entière jouissance de son bien, qui lui avait été naguère accordée, et ensuite retirée depuis sa fuite en Espagne. Au printemps de 1638, la grossesse de la reine Anne, étant devenue publique, avait rempli la France d'allégresse et ouvert tous les cœurs à la bienveillance et à l'espérance. Mme de Chevreuse profita de cet événement pour adresser à la reine la lettre suivante qu'Anne d'Autriche pouvait très-bien montrer à Louis XIII, et qui pourtant, sous sa réserve et sa circonspection diplomatique, laisse paraître la réciproque et intime affection de la reine et de l'exilée [173]:
«A LA REINE, MA SOUVERAINE DAME,
«Madame, je ne serois pas digne de pardon si j'avois pu et manqué de rendre compte à Votre Majesté du voyage que mon malheur m'a obligée d'entreprendre. Mais la nécessité m'ayant contrainte d'entrer en Espagne, où le respect de Votre Majesté m'a fait recevoir et traiter mieux que je ne méritois, celui que je vous porte m'a fait taire jusqu'à ce que je fusse en un royaume qui, étant en bonne intelligence avec la France, ne me donne pas sujet d'appréhender que vous ne trouviez pas bon d'en recevoir des lettres. Celle-ci parlera devant toute chose de la joie particulière que j'ai ressentie de la grossesse de Votre Majesté. Dieu récompense et console tous ceux qui sont à elle par ce bonheur, que je lui demande de tout mon cœur d'achever par l'heureux accouchement d'un dauphin. Encore que ma mauvaise fortune m'empêche d'être des premières à le voir, croyez que mon affection au service de Votre Majesté ne me laissera pas des dernières à m'en réjouir. Le souvenir que je ne saurois douter que Votre Majesté n'ait de ce que je lui dois et celui que j'ai de ce que je lui veux rendre, lui persuaderont assez le déplaisir que ce m'a été de me voir réduite à m'éloigner d'elle pour éviter les peines où j'appréhendois que des soupçons injustes ne me missent. Il m'a fallu priver de la consolation de soulager mes maux en les disant à Votre Majesté, jusqu'à cette heure que je puis me plaindre à elle de ma mauvaise fortune, espérant que sa protection me garantira de la colère du roi et des mauvaises grâces de M. le cardinal. Je n'ose le dire moi-même à Sa Majesté et ne le fais pas à M. le cardinal, m'assurant que votre générosité le fera, et rendra agréable ce qui pourroit être importun de ma part. La vertu de Votre Majesté m'assure qu'elle l'exercera volontiers en cette occasion, et qu'elle emploiera sa charité pour me dire, ce que je sais, qu'elle est toujours elle-même. Votre Majesté saura, par les lettres du roi et de la reine de la Grande-Bretagne l'honneur qu'ils me font. Je ne le saurois mieux exprimer qu'en disant à Votre Majesté qu'il mérite sa reconnoissance. Je crois que vous approuverez ma demeure en leur cour, que cela ne me rendra pas digne d'un mauvais traitement, et que l'on ne me refusera point les choses que l'autorité de Votre Majesté et le soin de M. le cardinal m'avoient procurées avant mon départ, et que je demande à monsieur mon mari. En quoi je supplie Votre Majesté de me protéger, afin que j'en aie bientôt les effets si justes que j'en attends.»
En même temps qu'elle réclamait son bien, Mme de Chevreuse songeait à acquitter une dette qui pesait à sa fierté. A Tours, elle avait bien été forcée d'accepter l'argent que lui avait envoyé Richelieu; mais, ainsi que nous l'avons dit [174] elle l'avait accepté comme un simple prêt, et sous le couvert de la lettre officielle à la reine Anne qu'on vient de lire, était un petit billet confidentiel et réservé à la reine seule, où nous voyons que la reine de France avait elle-même autrefois emprunté de l'argent à son ancienne surintendante. Celle-ci, en effet, la conjure de payer M. le cardinal sur ce qu'elle lui doit, et, si elle le peut, «d'achever le surplus de la dette [175].»
Ces derniers mots, et bien d'autres de lettres subséquentes, nous apprennent que depuis sa sortie de France, n'ayant rien voulu recevoir de l'étranger, Mme de Chevreuse avait épuisé toutes ses ressources, et que, n'ayant pas la disposition de son bien, elle en était réduite à Londres à faire des dettes toujours croissantes, et auxquelles elle ne savait comment satisfaire. Pendant ce temps-là M. de Chevreuse, qui avait mis sa maison dans le plus triste état, et pour la rétablir n'espérait que dans la raison et le crédit de sa femme, ne cessait d'intercéder auprès du roi et du premier ministre pour qu'on la laissât revenir en France. Le cardinal en était resté avec elle à l'offre de pardon et d'abolition, comme on disait alors, que le président Vignier avait été lui porter jusqu'à la frontière d'Espagne. Outre les raisons générales de souhaiter son retour, que lui-même a développées, Richelieu en avait une toute particulière en ce moment: il traitait avec le duc de Lorraine; plus que jamais il s'efforçait de l'attirer à un accommodement qui lui permît de rassembler toutes les forces de la France contre l'Autriche et contre l'Espagne. Il avait donc le plus grand intérêt à ménager Mme de Chevreuse, toute-puissante sur l'esprit du duc, qui tour à tour avait nui et servi, qui déjà, à ce qu'il croyait, avait, en 1637, empêché l'accommodement désiré, et pouvait l'empêcher encore. De son côté, Mme de Chevreuse était lasse de l'exil; elle soupirait après son bel hôtel de la rue Saint-Thomas-du-Louvre et son beau château de Dampierre, après ses enfants, après sa fille, l'aimable Charlotte, qui grandissait loin de sa mère, sans être, comme ses sœurs, destinée à la carrière ecclésiastique. Elle frémissait à la pensée de la douloureuse alternative qui chaque jour la pressait davantage, ou d'être forcée de recourir à l'Angleterre et à l'Espagne, ou d'engager ses pierreries qu'elle avait fait redemander à La Rochefoucauld [176]. Elle tenait à cette riche parure, souvenir d'un temps plus heureux; car Mme de Chevreuse était femme, elle en avait les faiblesses comme les grâces, et quand la passion et l'honneur ne la jetaient pas au milieu des périls, elle se complaisait dans toutes les élégances de la vie [177]. C'est ce mélange de mollesse féminine et de virile énergie qui est le trait particulier de son caractère, et qui la rendait propre à toutes les situations, aux douceurs et à l'abandon de l'amour, comme à l'agitation des intrigues et des aventures. C'est avec ces divers sentiments qu'elle se décida à reprendre avec Richelieu une négociation qui n'avait jamais été entièrement abandonnée, et dont le succès paraissait assez facile, puisque des deux parts on le souhaitait presque également.
Cette négociation dura plus d'une année. Le cardinal autorisa l'intendant de la maison de Chevreuse, Boispille, et l'abbé Du Dorat, à se rendre en Angleterre pour mener à bien cette affaire délicate. Ils y mirent bien du temps, y prirent bien des peines; plus d'une fois il leur fallut retourner de Londres à Paris et de Paris à Londres pour aplanir les difficultés qui s'élevaient. Le fil souvent rompu se renouait pour se rompre encore. Le cardinal et la duchesse désiraient fort sincèrement s'accommoder; mais, se connaissant bien, ils voulaient prendre l'un envers l'autre des sûretés presque inconciliables. Quand on a sous les yeux les pièces diverses auxquelles a donné lieu cette longue négociation [178], on y reconnaît tout l'esprit et le caractère de Richelieu et de Mme de Chevreuse, les artifices habituels du cardinal avec sa hauteur mal dissimulée, la souplesse de la belle dame, son apparente soumission et ses précautions inflexibles. Successivement, Richelieu se relâche davantage de sa rigueur accoutumée; mais ses prétentions, perçant toujours sous la courtoisie la plus recherchée, avertissent Mme de Chevreuse de prendre garde à elle et de ne faire aucune faute devant un homme qui n'oubliait rien et qui pouvait tout. C'est un curieux spectacle de les voir, pendant plus d'une année, employer toutes les manœuvres de la plus fine diplomatie et épuiser les ressources d'une habileté consommée pour se persuader l'un l'autre et s'attirer vers le but commun qu'ils désiraient tous les deux, sans y parvenir et se pouvoir guérir de leurs réciproques et incurables défiances. Faisons connaître les traits principaux, les commencements, le progrès, les péripéties et la fin inévitable de cette singulière correspondance.
Elle s'ouvre le 1er juin 1638 par une lettre de Mme de Chevreuse. La duchesse remercie le cardinal des assurances de bienveillance qu'on lui a données de sa part; elle lui avoue que si l'année précédente elle s'est résolue à quitter la France, ç'a été par appréhension des soupçons qu'il paraissait nourrir envers elle; elle a voulu laisser au temps le soin de les dissiper: «J'espère, lui dit-elle, que le malheur qui m'a contraint de sortir de France s'est lassé de me poursuivre... Je serois très-aise d'être tout à fait guérie des craintes que j'ai eues en reconnoissant que mes ennemis ne sont pas plus puissants que mon innocence [179].» La lettre, en feignant de la confiance et de l'abandon, est fort calculée et réservée. Mme de Chevreuse se garde bien d'engager une polémique sur le passé, mais elle y revient un peu pour sonder Richelieu, ne voulant pas s'exposer à rentrer en France pour y être recherchée sur sa conduite antérieure; aussi a-t-elle soin de placer habilement et sans déclamation le mot d'innocence. Dès cette première lettre, on comprend le jeu de Mme de Chevreuse, qui consiste à prendre doucement ses sûretés. Cesser de se dire innocente, c'eût été se remettre entre les mains de Richelieu, qui, au premier mécontentement feint ou réel, pouvait s'armer de ses aveux et l'en accabler. La réponse du cardinal découvre aussi, et selon nous, découvre un peu trop sa secrète pensée: elle est, comme en général toute sa politique, captieuse à la fois et impérieuse. Au milieu des démonstrations d'une politesse un peu maniérée, il lui dit: «Ce que vous me mandez est conçu en tels termes que, n'y pouvant consentir sans agir contre vous-même par excès de complaisance, je ne veux pas répondre de peur de vous déplaire en voulant vous servir. En un mot, Madame, si vous êtes innocente, votre sûreté dépend de vous-même, et si la légèreté de l'esprit humain, pour ne pas dire celle du sexe, vous a fait relâcher quelque chose dont Sa Majesté ait sujet de se plaindre, vous trouverez en sa bonté tout ce que vous pouvez en attendre.» Mme de Chevreuse comprend aisément la finesse du cardinal; mais, pour ne laisser subsister aucune équivoque, elle lui adresse un mémoire où elle lui rend compte de toute sa conduite et des motifs qui l'ont déterminée à sortir de France. Elle a fui, parce que, tout en lui prodiguant les bonnes paroles, on essayait de lui faire avouer qu'elle avait écrit au duc de Lorraine pour l'empêcher de rompre avec l'Espagne et de s'entendre avec la France, et que, ne pouvant avouer une faute qu'elle n'avait pas commise, et voyant qu'on en était persuadé et qu'on alléguait même des lettres interceptées, elle avait mieux aimé quitter son pays que d'y rester soupçonnée et en un perpétuel danger. Richelieu s'empresse de la rassurer, mais au contraire il l'épouvante en paraissant convaincu qu'elle a fait ce qu'elle est bien décidée à ne jamais avouer. Était-ce une bien heureuse manière de lui inspirer de la confiance que de lui rappeler l'affaire de Châteauneuf, et de lui insinuer assez clairement qu'on a en main des preuves qui dispensaient de tout aveu de sa part? «Quand le sieur de Boispille vous alla trouver, je lui dis ce que j'estimois pour votre service et votre sûreté, qui consistoit à mon avis à ne tenir rien de caché; ce à quoi j'estimois que vous vous dussiez porter d'autant plus facilement, que l'expérience vous a fait connoître, par ce qui s'est passé au fait de M. de Châteauneuf, qu'en ce qui vous intéresse, ce dont vos amis ont la preuve en main est plus secret que s'ils ne l'avoient point. Tant s'en faut qu'on ait voulu vous faire avouer une chose qu'on ne sût pas, qu'on voudroit ne savoir pas ce qu'on sait, pour ne pas vous obliger à le dire [180].» Peut-on s'étonner, après cela, que Mme de Chevreuse recule, ou du moins qu'elle soit fort embarrassée? Elle écrit le 8 septembre au cardinal pour lui exprimer sa reconnaissance des bontés qu'il lui témoigne, et en même temps le trouble où la jette la conviction manifestement arrêtée dans son esprit, qu'elle est réellement coupable. Sa lettre peint à merveille ses perplexités: «Considérez l'état où je suis, très-satisfaite d'un côté des assurances que vous me donnez de la continuation de votre amitié, et de l'autre fort affligée des soupçons ou pour mieux dire des certitudes que vous dites avoir d'une faute que je n'ai jamais commise, laquelle, j'avoue, seroit accompagnée d'une autre si, l'ayant faite, je la niois, après les grâces que vous me procurez du roi en l'avouant. Je confesse que ceci me met en un tel embarras, que je ne vois aucun repos pour moi dans ce rencontre. Si vous ne vous étiez pas persuadé si certainement de savoir cette faute, ou que je la pusse avouer, ce seroit un moyen d'accommodement; mais vous laissant emporter à une créance si ferme contre moi qu'elle n'admet point de justification, et ne me pouvant faire coupable sans l'être, j'ai recours à vous-même, vous suppliant, par la qualité d'ami que votre générosité me promet, d'aviser un expédient par lequel Sa Majesté puisse être satisfaite, et moi retourner en France avec sûreté, n'en pouvant imaginer aucun, et me trouvant dans de grandes peines.»
Or, voici l'expédient qu'inventa Richelieu pour délivrer Mme de Chevreuse des inquiétudes qui la tourmentaient: il lui envoya une déclaration royale par laquelle elle était autorisée à rentrer en France avec un pardon absolu pour sa conduite passée, et notamment pour ses négociations avec le duc de Lorraine contre le service du roi. En recevant cette grâce fort inattendue, Mme de Chevreuse protesta contre le pardon d'une faute qu'à aucun prix elle ne voulait reconnaître, ne s'avouant coupable que de sa sortie précipitée du royaume. Ses ombrages s'accroissant par le moyen même qu'on avait pris pour les dissiper, elle se mit à examiner, à la lumière d'une attention défiante, tous les termes de cette déclaration, et elle trouva bien du louche dans ce qui se rapportait à son retour à Dampierre. Il n'était pas dit nettement qu'elle y pourrait demeurer en liberté. La seule privation à laquelle elle se condamnait était celle de ne plus voir la reine et de n'entretenir aucune correspondance étrangère. Hormis cela, elle demandait une entière liberté; elle demandait surtout que, sous un air de pardon, on ne la noircît pas d'une faute qu'elle prétendait n'avoir pas commise. Elle refuse donc, le 23 février 1639, l'abolition qui lui est envoyée, et demande des explications sur la manière dont il lui sera permis de vivre en France. Le cardinal, irrité de voir découvertes et éludées toutes ses feintes, s'emporte et laisse paraître le fond de sa pensée dans une lettre du 14 mars à l'abbé Du Dorat, où il se plaint que Mme de Chevreuse ne veuille pas reconnaître ses négociations avec les étrangers, comme si, dit-il, «on avoit jamais vu de malade guérir d'un mal dont il ne veut pas qu'on le croye malade [181].» Il n'entend pas non plus laisser Mme de Chevreuse séjourner à Dampierre plus de huit ou dix jours, et elle devra se retirer dans quelqu'une de ses terres éloignées de Paris. Il consent toutefois à modifier l'abolition royale qui avait déplu à Mme de Chevreuse, et il lui en envoie une autre un peu adoucie, comme une preuve extrême de sa condescendance et de la bonté du roi.
Cette déclaration nouvelle était encore bien loin d'être celle que désirait Mme de Chevreuse; elle n'y était pas seulement absoute de sa sortie de France, mais «des autres fautes et crimes qu'elle avoit pu commettre contre la fidélité qu'elle devoit au roi,» et Richelieu revenait par un détour à son but, imposer indirectement au moins à la malheureuse exilée une sorte de confession de crimes qu'elle soutenait n'avoir pas commis, confession à la fois humiliante et dangereuse, et qui la mettait à sa merci. Cependant, tel était le désir de la pauvre femme de revoir sa patrie et sa famille, qu'après avoir réclamé de nouveau et inutilement, elle se résigna à cette grâce suspecte. Elle fit plus; Richelieu s'étant empressé de remettre à l'abbé Du Dorat et à Boispille l'argent nécessaire pour acquitter les dettes qu'elle avait contractées en Angleterre, et lui permettre de sortir de cette cour comme il convenait à sa dignité et à son rang, elle consentit à laisser signer en son nom, aux deux agents intermédiaires, un écrit destiné à satisfaire Richelieu sans trop la compromettre, où, en termes très-généraux, elle parlait humblement de sa mauvaise conduite passée [182], et s'engageait, pourvu qu'on la laissât vivre en toute liberté à Dampierre, à ne jamais venir secrètement à Paris. Elle avait dû vaincre bien des scrupules, étouffer bien des défiances, et faire céder ses secrets instincts aux sollicitations de sa famille, aux instances de l'abbé Du Dorat et de Boispille, et à la parole solennelle que lui renouvela Richelieu dans une dernière lettre du 13 avril 1639.
Les choses en étaient là: la fière duchesse avait courbé la tête sous le poids de l'exil et du malheur; elle allait partir, déjà elle avait fait ses adieux à la reine d'Angleterre; un vaisseau était prêt qui devait la conduire à Dieppe, où un carrosse l'attendait, quand tout à coup à la fin du mois d'avril, elle reçut la lettre suivante, ni datée ni signée, que nous transcrivons fidèlement:
«Il ne faudroit pas vous être ce que je vous suis pour manquer de vous dire que si vous aimez Mme de Chevreuse, vous empêchiez sa perte, qui est indubitable en France, où on la veut pour sa ruine. Ceci n'est pas une opinion; il n'y a autre remède qu'à suivre cet avis pour garantir Mme de Chevreuse, dont le cardinal a dit affirmativement trop de mal, touchant l'Espagne et M. de Lorraine, pour n'en plus rien dire à l'avenir. Enfin, il n'y a que patience pour Mme de Chevreuse à cette heure, ou perdition sûre, et regret éternel pour celui qui écrit.»
De quelque part que vînt ce billet, on peut juger s'il troubla Mme de Chevreuse. Il répondait à tous les instincts de son cœur et à la connaissance que, de longue main, elle avait acquise des implacables ressentiments du cardinal. Elle suspendit ou prolongea ses préparatifs de départ, et, aussi loyale que prudente, elle montra à Boispille ce qu'elle venait de recevoir, l'autorisant à le communiquer à Richelieu.
Un mois à peine écoulé, elle reçut une autre lettre du même genre, non plus anonyme, mais signée de l'homme au monde qui lui était le plus dévoué:
«Je suis certain du dessein qu'a fait M. le cardinal de Richelieu de vous offrir toutes choses imaginables pour vous obliger de retourner en France, et aussitôt vous faire périr malheureusement. Le marquis de Ville, qui a parlé à lui et à M. de Chavigny, vous en pourra rendre plus savante, comme l'ayant ouï lui-même. Je l'attends à toute heure, et si je croyois pouvoir assez sur votre esprit pour vous divertir de prendre cette résolution, je m'en irois me jeter à vos pieds pour vous faire connoître votre perte absolue, et vous conjurer, par tout ce qui vous peut être au monde de plus cher, d'éviter ce malheur, trop cruel à toute la terre, mais à moi plus insupportable qu'à tout le reste du monde, vous protestant que si ma perte pouvoit procurer votre repos, j'estimerois cette occasion très-heureuse qui me la procureroit, et que rien autre chose ne me fait vous servir que votre seule considération, étant pour jamais, Madame, votre très-affectionné serviteur,
«Charles de Lorraine.
«Cirk, le 26 mai 1639.»
Ce nouvel avis porta à son comble l'anxiété de Mme de Chevreuse. Elle fit passer à Richelieu cette seconde lettre, comme elle avait fait la première, pour lui montrer qu'elle n'était pas retenue par de médiocres motifs, et le faire juge de ses incertitudes. Elle déclara aussi qu'elle ne partirait point avant d'avoir vu et entendu le marquis de Ville, que lui annonçait le duc de Lorraine.
Henri de Livron, marquis de Ville, était un gentilhomme lorrain, plein d'esprit et de valeur, attaché à son pays et à son prince, qui, fait prisonnier, mis à la Bastille, puis relâché par Richelieu, avait été rejoindre le duc Charles dans les Pays-Bas. Il vint à Londres dans les premiers jours du mois d'août 1639, et fit tous ses efforts pour persuader à Mme de Chevreuse de rompre avec le cardinal. La duchesse voulut qu'il s'expliquât devant Boispille, et que celui-ci rendît compte à Richelieu de cette conférence. Le marquis de Ville demeura inébranlable dans son opinion, et il ne demanda pas mieux que de rédiger et signer cette déposition: «Un nommé Lange, m'ayant accompagné l'hiver dernier depuis Paris jusqu'à Charenton, me dit qu'il savoit l'affection que j'avois au service de Mme de Chevreuse, qui l'obligeoit de s'adresser à moi pour me dire qu'elle étoit perdue si elle retournoit à cette heure en France. Le pressant de me dire ce qu'il savoit particulièrement sur ce sujet, après avoir tiré parole de moi que je ne le dirois qu'à son altesse de Lorraine ou à Mme de Chevreuse, il me dit qu'il n'y avoit que deux jours que M. le cardinal, en parlant à M. de Chavigny de Mme de Chevreuse, témoignoit d'être fort mal satisfait de ce qu'elle persistoit à nier d'avoir conseillé à M. de Lorraine de ne s'accommoder pas avec la France. De quoi M. de Chavigny faisoit aussi fort l'étonné, disant tous deux que cette affaire est bien éclaircie, et que, Mme de Chevreuse étant en France, on la feroit bien parler françois avec ses lettres qu'ils avoient, qu'elle ne croit pas, et que si elle les pensoit tromper, elle se trompoit elle-même. Disant savoir ceci comme l'ayant ouï lui-même. A Londres, ce 8 août 1639. Henri de Livron, marquis de Ville.» Cet écrit fut loyalement envoyé à Richelieu comme les précédents.
Nous le demandons: tout cela ne devait-il pas faire la plus forte impression sur l'esprit de Mme de Chevreuse? Pouvait-elle se rappeler sans terreur les sollicitations obstinées du cardinal pour lui arracher, par diverses voies directes et indirectes, un aveu bien indifférent, s'il n'avait l'intention de s'en servir contre elle? Ne connaissait-elle pas son humeur altière, la passion qu'il avait de tenir tout le monde à ses pieds, et d'avoir toujours de quoi perdre ses ennemis? Quiconque a ressenti les amertumes et les misères de l'exil ne s'étonnera pas que l'infortunée duchesse fût descendue jusqu'à subir des conditions pénibles et mal sûres, dans l'ardent désir de retrouver la patrie et le foyer domestique. Qui pourrait aussi la blâmer d'avoir hésité, sur des avis tels que ceux que nous venons de rapporter, à franchir le pas après lequel, si par malheur elle s'était trompée, il n'y avait plus pour elle que des regrets éternels et un désespoir sans ressource?
Bientôt un autre conseil, qui lui était un ordre, l'enchaîna sur la terre étrangère. Celle pour qui, depuis dix années, elle avait tout souffert et tout bravé, son auguste amie, sa royale complice, Anne d'Autriche, lui fit dire de ne pas se fier aux apparences. Un jour, à Saint-Germain, la reine, rencontrant M. de Chevreuse, lui demanda des nouvelles de la duchesse. Celui-ci répondit qu'il avait fort à se plaindre de Sa Majesté qui seule empêchait sa femme de revenir. La reine lui dit qu'il avait grand tort de se plaindre d'elle, qu'elle aimait bien Mme de Chevreuse, qu'elle souhaitait bien de la revoir, mais qu'elle ne lui conseillerait jamais de rentrer en France [183]. Il parut à Mme de Chevreuse qu'Anne d'Autriche devait être bien informée, et elle se décida à suivre un avis parti de si haut. Elle ne toucha point à l'argent de Richelieu, et lui écrivit une dernière fois le 16 septembre, lui représentant ses incertitudes et ses embarras, et lui demandant du temps pour apaiser les inquiétudes qui travaillaient son esprit. Le même jour elle annonce à son mari, à Du Dorat et à Boispille, sa résolution définitive. «Je désire bien vivement, dit-elle à son mari, me voir en France en état de remédier à nos affaires et de vivre doucement avec vous et mes enfants; mais je connois tant de périls dans le parti d'y aller, comme je sais les choses, que je ne le puis prendre encore, sachant que je n'y puis servir à votre avantage ni au leur, si j'y suis dans la peine. Ainsi il me faut chercher avec patience quelque bon chemin qui enfin me mène là, avec le repos d'esprit que je ne puis encore trouver... J'ai appris des particularités très-importantes dont je suis absolument innocente, ainsi que peut-être on le reconnoît à cette heure, et dont toutes les apparences montrent qu'on me vouloit accuser. Je ne puis pas m'expliquer plus clairement sur cela.»—A l'abbé Du Dorat: «Je m'étonne comme on me peut accuser de feindre des appréhensions imaginaires pour n'aller pas jouir des biens véritables, au lieu de me plaindre des peines où ma mauvaise fortune me réduit.»—A Boispille: «Depuis votre départ, j'ai eu tant de nouvelles connoissances de la continuation de mon malheur dans les soupçons qu'il donne de moi, qu'il m'est impossible de me résoudre à m'aller exposer à tout ce qu'il peut produire... Croyez que je souhaite si passionnément mon retour, que je passe par-dessus beaucoup de choses, mais il y en a qui m'arrêtent avec tant de raison qu'il faut nécessairement que je demeure encore où je suis. Je sens et sens trop les incommodités de cet éloignement, pour ne le pas faire finir aussitôt que j'y verrai jour. En attendant, il vaut mieux souffrir que périr [184].»
Ainsi s'évanouirent les dernières espérances d'un rapprochement sincère entre deux personnes qu'attiraient l'une vers l'autre et que séparaient avec la même force d'insurmontables instincts, qui se connaissaient trop pour ne pas se craindre, et pour se fier à des paroles dont elles n'étaient point avares, sans exiger de sérieuses garanties qu'elles ne pouvaient ni ne voulaient donner. A Tours, deux ans auparavant, Mme de Chevreuse avait mieux aimé reprendre une seconde fois le chemin de l'exil que de risquer sa liberté; à Londres aussi elle préféra supporter les douleurs de l'exil, consumer ses derniers beaux jours dans les privations et les fatigues, pour demeurer libre, avec l'espoir de lasser la fortune à force de courage, et de faire payer cher ses souffrances à leur auteur.
Au milieu de l'année 1639, Marie de Médicis, fatiguée de la vie errante qu'elle menait dans les Pays-Bas, à la merci du gouvernement espagnol, qui lui avait prodigué les promesses dans l'espoir d'en tirer parti, et qui la délaissait la voyant impuissante à le servir, résolut de venir demander un asile à sa fille, la reine d'Angleterre. Celle-ci pouvait-elle donc repousser sa vieille mère, malade et réduite aux dernières extrémités? L'impitoyable Richelieu accuse Mme de Chevreuse [185] d'avoir soutenu et secondé la résolution de la reine Henriette; il lui fait un crime d'avoir été, elle-même exilée et malheureuse, mêler ses respectueux hommages à ceux de la cour d'Angleterre envers la veuve d'Henri IV, la mère de Louis XIII et de trois grandes princesses, qui venait d'essuyer sur l'Océan une tempête de sept jours, et arrivait dénuée, abattue, mourante, triste objet de la compassion universelle. Richelieu trouve dans ces hommages et dans les visites que fit Mme de Chevreuse à Marie de Médicis, des intrigues et des complots. Ce sont là vraisemblablement les accusations dont se plaint à mots couverts Mme de Chevreuse dans ses dernières lettres. Elle les repousse avec assez de vraisemblance; il paraît bien qu'elle se tint tranquille et même fort circonspecte aussi longtemps qu'elle conserva l'espoir d'une sincère réconciliation avec Richelieu; mais lorsqu'elle se crut bien sûre qu'il la trompait, l'attirait en France pour l'avoir en sa dépendance et au besoin la faire enfermer, ayant à peu près rompu avec lui, elle se considéra comme délivrée de tout scrupule, elle ne songea plus qu'à lui rendre guerre pour guerre, et resserra ses engagements avec l'Espagne.
Quelque temps après Marie de Médicis, vint encore à Londres chercher un refuge une autre victime du cardinal, un autre proscrit, intéressant au moins par l'incroyable iniquité des formes du jugement rendu contre lui: l'ancien gouverneur de Metz, le marquis, devenu duc de La Valette, un des fils du vieux duc d'Épernon, le propre frère du cardinal de La Valette, l'un des généraux et des confidents de Richelieu, qui peut-être l'avait sauvé par ses conseils à la journée des dupes, et dont l'épée l'avait tant de fois fort bien servi dans les Pays-Bas et en Italie. Le duc de La Valette avait commis une grande faute. Au siége de Fontarabie, placé sous les ordres de M. le Prince, il avait fait échouer cette importante entreprise en ne secondant pas son général comme il le devait. Sans doute, ainsi que son père, il n'aimait pas Richelieu, il ne servait qu'à contre-cœur, il avait été indirectement mêlé à l'affaire de Chalais; mais avait-il trahi à Fontarabie et s'entendait-il déjà avec l'Espagne? Rien ne le prouve, et tout porte à croire que la seule jalousie envers le prince de Condé l'avait fait manquer à son devoir. Une juste punition eût satisfait l'armée; l'excès de la condamnation et le scandale du procès révoltèrent tous les honnêtes gens. Au lieu d'être traduit devant le parlement en sa qualité de duc et pair, selon les règles de la justice du temps, Bernard de La Valette fut livré à une commission, comme l'avait été le maréchal de Marillac. Le duc, voyant qu'on en voulait à sa vie, s'enfuit, et on le jugea par contumace de la façon la plus inouïe. Le roi assembla dans sa chambre un certain nombre de membres du parlement, le premier président, les présidents à mortier, quelques conseillers d'État, quelques ducs et pairs bien choisis; il en forma une sorte de tribunal, se mit à sa tête, présida lui-même, et, malgré la résistance généreuse de la plupart des membres du parlement, qui demandaient que l'affaire leur fût renvoyée selon toutes les ordonnances, il força ces prétendus juges de délibérer [186], d'adopter les tristes conclusions du procureur général, et on déclara le duc de La Valette criminel de lèse-majesté, coupable de perfidie, trahison, lâcheté et désobéissance; il fut condamné à être décapité, ses biens confisqués, et ses terres mouvant de la couronne réunies au domaine du roi. Le procureur général, Mathieu Molé eut grand'peine à se faire décharger du soin de mettre à exécution cette odieuse sentence, et l'illustre contumace fut décapité en effigie, sur la place de Grève, le 8 juin 1639. Une telle façon de procéder en matière criminelle, était le renversement de toutes les lois du royaume. Puisqu'elle consterna des magistrats attachés au roi et qui certes n'étaient pas des factieux, tels que les présidents Lejay, Novion, Bailleul, de Mesmes, Bellièvre, est-il surprenant qu'elle ait révolté l'âme d'une femme, et que Mme de Chevreuse ait conjuré Charles Ier de recevoir dans ses États le noble fugitif? Remarquez bien que le duc de La Valette n'arriva en Angleterre qu'à la fin d'octobre 1639, lorsque Mme de Chevreuse n'avait plus aucun ménagement à garder envers Richelieu. Elle intercéda si vivement auprès de Charles Ier que, malgré l'opinion contraire du conseil des ministres, grâce à l'intervention de la reine, elle obtint pour le duc la permission de venir résider à Londres, et même d'être présenté au roi, mais en particulier et en secret, pour ne pas trop blesser la France [187]: vaine précaution, qui ne sauva pas le roi Charles des rancunes vindicatives de Richelieu. Le cardinal, voyant que Mme de Chevreuse l'emportait sur lui auprès du roi d'Angleterre, et qu'elle le poussait vers ses ennemis, travailla plus que jamais à susciter au malheureux roi des embarras domestiques qui le missent hors d'état de nuire à la France; il poursuivit dans l'ombre ses pratiques artificieuses auprès des parlementaires, et surtout auprès des puritains d'Écosse [188].
De son côté, Mme de Chevreuse ne s'endormit pas. Une fois son ancien duel avec Richelieu renouvelé, elle forma à Londres, avec la reine mère, avec le duc de La Valette, avec l'habile et infatigable Soubise, avec le marquis de La Vieuville, ancien surintendant général des finances que le cardinal avait accusé et fait déclarer coupable de concussion, une petite mais puissante faction d'émigrés qui, s'appuyant en secret sur la reine Henriette, secondés par lord Montaigu, devenu ardent catholique et le conseiller intime de la reine, par le chevalier d'Igby et par d'autres grands seigneurs, entretenant aussi d'étroites intelligences avec la cour de Rome par son envoyé en Angleterre, Rosetti [189], surtout avec le cabinet de Madrid, encourageant et enflammant en France les espérances de tous les mécontents, semaient de toutes parts des obstacles sur la route de Richelieu et amassaient des périls sur sa tête.
En 1640, Mme de Chevreuse était, à Londres, le chef avoué des ennemis du cardinal, et en commerce public avec l'Espagne et avec le duc de Lorraine, réfugié dans les Pays-Bas et à peu près passé au service de l'Autriche. Le marquis de Ville ayant été envoyé par le duc en Angleterre pour obtenir la permission de faire des recrues [190], avait amené avec lui six beaux chevaux dont son maître faisait cadeau à Mme de Chevreuse; il était descendu à son hôtel et avait pris logement chez elle. Le marquis de Velada, grand d'Espagne, gouverneur de Dunkerque, ambassadeur extraordinaire à Londres, avant même de voir le roi, avait été faire visite à Mme de Chevreuse, et s'était servi de son carrosse pour aller à sa première audience [191]. Elle protégeait et dirigeait à Londres les émissaires du prince Thomas de Savoie, tout à fait devenu un général espagnol, qui nous faisait la guerre en Flandre, et menaçait le trône de sa belle-sœur, la duchesse de Savoie, veuve de Victor-Amédée, Madame Royale, la sœur de Louis XIII [192]. Rencontrant de tous côtés la main de Mme de Chevreuse, Richelieu sentit mieux que jamais qu'elle lui faisait plus de mal partout ailleurs qu'en France, et il s'avisa d'un dernier moyen pour la contraindre à y revenir. Il mit en avant le duc de Chevreuse [193]. Celui-ci, poussé à la fois par l'intérêt et par l'honneur, écrivit au roi et à la reine d'Angleterre, dans les premiers mois de l'année 1640, les lettres les plus pressantes où il les suppliait de ne pas encourager la désobéissance de sa femme aux ordres du roi et aux siens; et puisque ni Boispille ni Du Dorat n'avaient pu réussir auprès d'elle, il annonça hautement sa résolution de venir lui-même la chercher. Cette résolution épouvanta Mme de Chevreuse [194]. Elle connaissait son mari: elle savait qu'après tout il était Guise, et qu'à une assez grande faiblesse de caractère il joignait une intrépidité, une audace qui ne reculerait devant aucune extrémité, et qu'évidemment couvert et soutenu par le cardinal, il était homme à l'enlever l'épée à la main, en plein jour, à Londres, au milieu de tous ses amis. En vain le roi Charles Ier et la reine Henriette lui promirent leur protection; elle reconnut qu'il n'y avait d'asile assuré pour elle que sur le sol espagnol, et elle céda aux instances du duc de Lorraine qui la faisait inviter par M. de Ville à se rendre auprès de lui en Flandre. Elle reçut de la reine Henriette un riche présent d'adieu, et apprenant que M. de Chevreuse faisait ses préparatifs pour passer la mer, elle le prévint, remit à Craft le soin de ses affaires en Angleterre, et, le 1er mai [195], partit de Londres accompagnée d'une brillante escorte, du marquis de Velada et du résident d'Espagne, du duc de La Valette, du marquis de La Vieuville et de son fils, du marquis de Ville, de lord Montaigu et de Craft, et d'un officier du roi, le comte de Niewport chargé par Sa Majesté Britannique de la couvrir de sa protection si on rencontrait M. de Chevreuse sur la route, et de la conduire avec les plus grands honneurs jusqu'aux limites de ses États. Le 5 mai, elle s'embarqua à Rochester pour Dunkerque [196], suivie du fidèle comte de Craft, qui ne voulut la quitter que le plus tard possible, et elle alla s'établir à Bruxelles. Là, n'ayant plus de mesure à garder, elle se donna tout entière et ouvertement à l'Espagne, y attacha de plus en plus le duc Charles, ainsi que les principaux émigrés français de Londres, La Valette et Soubise [197]. Elle se lia étroitement avec don Antonio Sarmiento, le plus influent ministre d'Espagne dans les Pays-Bas. On ne sait pas communément, mais nous pouvons établir qu'en 1641 elle prit une assez grande part à l'affaire du comte de Soissons, c'est-à-dire à la conspiration la plus formidable qui ait été tramée contre Richelieu.
Louis de Bourbon, comte de Soissons, prince du sang, avait été nourri, par sa mère, l'orgueilleuse Anne de Montafié, dans des prétentions dont aucune n'avait été satisfaite. En 1616, voyant le prince de Condé jeté en prison et menacé d'y mourir sans enfants, Mme la Comtesse avait conçu l'espoir que le titre de premier prince du sang retomberait bientôt sur la tête de son fils. Mais en 1619 M. le Prince était sorti de Vincennes et avait repris son rang au-dessus des cadets de sa maison. Sous le ministère de Luynes, le jeune comte avait osé prétendre à la main de Madame Henriette-Marie; elle lui avait échappé, et avait été donnée un peu plus tard à Charles Ier. M. le Comte et sa mère s'étaient alors tournés contre Luynes, et ils avaient été, en 1620, à Angers grossir le parti de Marie de Médicis. Sous Richelieu, convoitant pour lui-même la riche héritière des Montpensier, le comte de Soissons avait vu de très-mauvais œil le projet de la marier au duc d'Orléans, et pour faire échouer ce projet il n'avait point hésité à se jeter au milieu de la conspiration qui avait si tristement fini dans les cachots de Vincennes et sur la place publique de Nantes. Afin d'éviter le sort du grand prieur de Vendôme, il avait pris la fuite et s'était retiré d'abord en Suisse, puis en Piémont, auprès de son beau-frère, le prince Thomas de Savoie. Plus tard, il avait fait sa paix avec le roi et Richelieu par l'intermédiaire de son autre beau-frère, le duc de Longueville, et en 1636 on lui confia, sous le duc d'Orléans, le commandement de l'armée de Flandre; il y avait montré une valeur brillante et même des talents militaires, sans remporter toutefois de grands avantages. C'est vers ce temps-là, et lorsqu'ils étaient encore à l'armée, que le duc d'Orléans et le comte de Soissons formèrent cette mystérieuse conspiration d'Amiens que Richelieu a toujours ignorée, où les deux princes tinrent un moment entre leurs mains l'ennemi qu'ils devaient frapper, et le laissèrent échapper par un soudain retour de conscience ou par défaut de résolution. Les conjurés eurent peur d'eux-mêmes: le duc d'Orléans se retira bien vite à Blois, et le comte de Soissons à Sedan, auprès du duc de Bouillon. Frédéric-Maurice, le frère aîné de Turenne, était un homme de guerre et un politique, encore plus ambitieux, tout aussi capable, et moins prudent que son père. Sa place forte de Sedan, placée sur la frontière de la France et de la Belgique, lui semblait un asile d'où il pouvait braver toutes les menaces du cardinal. Le duc de Bouillon et le comte de Soissons se connaissaient depuis longtemps. Ils formèrent une ligue nouvelle, mieux concertée et plus puissante que celle de Montmorenci. Les circonstances étaient aussi bien plus favorables. Richelieu, en tendant tous les ressorts du gouvernement, en perpétuant la guerre, en aggravant les charges publiques, en opprimant les corps, en frappant aussi les particuliers, avait soulevé bien des haines, et il ne gouvernait guère plus que par la terreur. Son génie imposait; la grandeur de ses desseins parlait à quelques esprits d'élite; mais cette dureté continue et tant de sacrifices sans cesse renaissants fatiguaient le plus grand nombre, à commencer par le roi. Le favori du jour, le grand écuyer Cinq-Mars minait et noircissait le plus qu'il pouvait le cardinal dans l'esprit de Louis XIII. Il connaissait la conspiration du comte de Soissons, et sans en faire partie, il la favorisait. On pouvait compter sur lui pour le lendemain. La reine Anne, toujours en disgrâce malgré les deux fils qu'elle venait de donner à la France, faisait au moins des vœux pour la fin d'un pouvoir qui l'opprimait. Monsieur avait engagé sa parole, il est vrai bien peu sûre. On s'était ménagé de vastes intelligences dans toutes les parties du royaume, dans le clergé, dans le parlement. On conspirait jusque dans la Bastille, où le maréchal de Vitry et le comte de Cramail, tout prisonniers qu'ils étaient, avaient préparé un coup de main avec un secret admirablement gardé. L'abbé de Retz, qui avait alors vingt-cinq ans, préludait à sa carrière aventureuse par cet essai de guerre civile, qu'il avait même songé à inaugurer par un assassinat [198]. Le duc de Guise, échappé de l'archevêché de Reims et réfugié dans les Pays-Bas [199], allait sans cesse de Bruxelles à Sedan et de Sedan à Bruxelles; il devait, quand le moment serait venu, se joindre aux conjurés et combattre avec eux. Mais le plus grand, le plus solide espoir du comte de Soissons reposait sur l'Espagne: elle seule pouvait le mettre en état de sortir de Sedan, de marcher sur Paris et de briser le pouvoir de Richelieu; aussi envoya-t-il à Bruxelles un de ses gentilshommes les plus braves et les plus intelligents pour négocier avec les ministres espagnols et en obtenir de l'argent et des soldats. Ce gentilhomme s'appelait Alexandre de Campion. Il rencontra à Bruxelles Mme de Chevreuse, et lui fit part de la mission dont il était chargé. Elle s'empressa de le seconder de tout son crédit. Comme nous verrons reparaître plus d'une fois ce personnage dans la vie de Mme de Chevreuse, et au milieu des plus tragiques aventures, il nous faut bien nous y arrêter quelques moments et le faire un peu connaître.
Lui-même au reste a pris soin de se peindre dans un ouvrage intitulé Recueil de Lettres qui peuvent servir à l'histoire, et diverses Poésies, à Rouen, aux dépens de l'auteur, 1657. Cet écrit, destiné seulement à quelques personnes, fort peu remarqué dans le temps, et depuis aussi peu connu que s'il n'avait jamais été, n'en est pas moins, quoique le titre le dise, très précieux pour l'histoire. Il est dédié à cette célèbre Gillonne d'Harcourt, comtesse de Fiesque, un des aides de camp de Mademoiselle pendant la guerre de la Fronde, femme d'esprit, intrigante et galante. Le livre est à l'avenant. Alexandre de Campion s'y montre plein de prétentions au bel esprit et à la galanterie; il recueille avec soin tous les petits vers qu'il fit dans sa jeunesse pour les belles d'alors, et donne sans façon les lettres qu'autrefois il écrivit, dans les circonstances les plus délicates, au comte de Soissons, au duc de Vendôme, au duc de Beaufort, au comte de Beaupuis, à de Thou, au duc de Bouillon, au duc de Guise, à Mme de Montbazon et à Mme de Chevreuse. On voit dans ces lettres qu'Alexandre de Campion, né, en 1610, d'une très bonne famille de Normandie, entré à vingt-quatre ans, en 1634, au service du jeune comte de Soissons, en qualité de gentilhomme, le suivit dans ses diverses campagnes, s'y distingua, et partagea peu à peu sa confiance avec Bardouville, Beauregard, Saint-Ibar, Varicarville, braves officiers et gens d'honneur, mais inquiets et un peu brouillons, qui flattaient l'ambition de leur maître, et le poussaient à jouer un grand rôle en France en renversant le cardinal de Richelieu. Alexandre de Campion nous apprend que, dès l'année 1636, le comte de Soissons méditait déjà ce qu'il exécuta un peu plus tard, qu'il s'entendait parfaitement avec le duc de Bouillon, et que l'un et l'autre s'efforcèrent d'attirer à Sedan le duc d'Orléans, afin de lever de là l'étendard de la révolte et de contraindre le roi à sacrifier son ministre. Campion alla à Blois pour décider le duc d'Orléans et lui indiquer les moyens les plus sûrs de se rendre à Sedan. En même temps il négociait avec Richelieu par le moyen du père Joseph. La fin de l'année 1636 et toute l'année 1637 se passèrent en ces intrigues, qui échouèrent par la peur qu'au moment d'agir éprouvèrent les conjurés à s'embarquer dans une pareille entreprise. Pendant que le comte de Soissons était réfugié à Sedan, son confident, resté à Paris, travaillait à lui faire des partisans par tous les moyens. Il se lia avec Cinq-Mars, et tandis que le comte avait un engagement secret avec une personne qu'il aimait et qui n'est pas ici nommée, Alexandre de Campion ne laissait pas de faire espérer sa main à diverses princesses et à leurs familles. En 1640, le complot, qui n'avait jamais été entièrement abandonné, se ranime et s'achève entre le duc de Bouillon et le comte de Soissons. Le grand écuyer, sans y entrer directement, promet son appui [200]. Emmanuel de Gondi, autrefois général des galeres, maintenant prêtre de l'Oratoire, père du duc de Retz et du futur cardinal, les présidents de Mesmes et Bailleul, sont consultés, non comme complices, mais comme amis. Richelieu les devine, et les éloigne de la cour et de Paris [201]. Après être resté quelque temps sur ce théâtre périlleux où il vit souvent l'abbé de Retz [202], Campion est bientôt réduit à fuir lui-même à Sedan. On l'envoie à Bruxelles négocier avec l'Espagne. C'est alors qu'il connut Mme de Chevreuse. La politique fit-elle seule les frais de cette liaison? Nous l'ignorons; mais lorsque Alexandre de Campion raconte au comte de Soissons tout ce qu'il doit à Mme de Chevreuse, le comte, jeune et galant, plaisante un peu son jeune et galant gentilhomme sur ses succès auprès de la belle duchesse, et celui-ci lui répond avec une apparente modestie, mêlée d'assez de fatuité: «3 juin 1641. M. de Châtillon (qui commandait l'armée envoyée par Richelieu contre les rebelles) ne vous fait guère de peur, puisque vous songez à me railler dans votre lettre, et c'est me savoir peu de gré des services que je vous rends en réunissant une illustre personne avec vous, et en vous procurant une amie qui ne l'avoit jamais été. Elle est persuadée de votre amitié par les compliments que vous lui faites dans votre lettre; mais si elle avoit vu celle que vous m'écrivez, peut-être n'agiroit-elle pas avec tant de chaleur, vos railleries n'étant pas trop obligeantes pour elle. Elle a écrit au comte-duc, de sorte que son assistance ne vous sera pas inutile; même, comme elle a tout pouvoir sur don Antonio Sarmiento, elle l'a fait écrire de la même manière, et elle a un très grand zèle pour vous. Je ne sais si vous en seriez quitte à si bon marché que vous pensez, si l'état de vos affaires vous obligeoit à faire un tour ici, ou si les siennes lui faisoient prendre le chemin de Sedan; mais si vous m'en croyez, vous n'aurez pas si bonne opinion de moi, puisqu'il est constant que j'envisage ces sortes de déités qui sont au-dessus de moi avec respect et vénération, et que comme elles n'ont garde de s'abaisser jusqu'à moi, je m'empêche bien d'élever mes prétentions jusqu'à elles. Après avoir parlé sincèrement, j'ose espérer que vous m'épargnerez à l'avenir, et elle aussi, qui se charge de solliciter vos affaires comme les siennes propres.» En effet, Mme de Chevreuse, sans qu'il soit besoin de lui prêter des raisons plus particulières, servit avec chaleur une entreprise dirigée contre l'ennemi commun. Elle écrivit au comte-duc Olivarès, et appuya vivement auprès de lui les demandes du comte de Soissons et du duc de Bouillon. A Bruxelles, elle entraîna don Antonio Sarmiento, et elle donna à Campion, ainsi qu'à l'abbé de Merci, agent d'intrigues au service de l'Espagne, des lettres pour le duc de Lorraine, où elle le pressait de ne pas manquer cette occasion suprême de réparer ses malheurs passés et de porter un coup mortel à Richelieu. Charles IV, sollicité à la fois par Mme de Chevreuse, par son parent le duc de Guise, par le ministre espagnol, surtout par son inquiète et aventureuse ambition, rompit l'alliance solennelle qu'il venait de contracter tout récemment avec la France, entra dans le traité de l'Espagne et du comte de Soissons, et fit diligence pour aller au secours de Sedan. Le général Lamboy et le colonel de Metternic accoururent de Flandre avec six mille impériaux. En même temps Mme de Chevreuse et les émigrés firent jouer tous les ressorts qui étaient entre leurs mains. La France et l'Europe étaient dans l'attente. Jamais Richelieu ne courut un plus grand danger, et la perte de la bataille de la Marfée lui serait peut-être devenue funeste, si le comte de Soissons n'eût trouvé la mort dans son triomphe.
Mme de Chevreuse est-elle restée étrangère en 1642 à la nouvelle conspiration de Monsieur, de Cinq-Mars et du duc de Bouillon? Ce serait donc la seule à laquelle elle n'ait pas pris part. Il est bien douteux qu'elle ne fût pas dans le secret, ainsi que la reine Anne, dont l'intelligence avec Cinq-Mars et Monsieur ne peut pas être contestée. Tout en se ménageant très soigneusement avec Louis XIII et avec son ministre, Anne d'Autriche n'avait pas abandonné ses anciens sentiments ni même ses desseins, et elle eût pu être compromise dans l'affaire du comte de Soissons, si nous en croyons ces mots d'un billet d'Alexandre de Campion à Mme de Chevreuse, du 15 août 1641: «N'ayez point de peur des lettres qui parlent de la personne du monde pour qui vous avez le plus de dévouement; M. de Bouillon et moi nous avons brûlé toutes celles qui étoient dans la cassette du comte.» Quant au complot de Cinq-Mars, la reine le connaissait certainement, et elle y donna les mains. La Rochefoucauld l'affirme plusieurs fois comme une chose où il a été mêlé: «L'éclat du crédit de M. Le Grand, dit-il, réveilla les espérances des mécontents; la reine et Monsieur s'unirent à lui; le duc de Bouillon et plusieurs personnes de qualité firent la même chose. M. de Thou vint me trouver de la part de la reine pour m'apprendre sa liaison avec M. le Grand, et qu'elle lui avoit promis que je serois de ses amis [203].» Le duc de Bouillon déclare aussi que la reine s'entendait avec Monsieur et avec le grand écuyer, et qu'elle-même lui avait demandé son concours: «La reine [204], que le cardinal avoit persécutée en tant de manières, ne douta point que si le roi venoit à mourir, ce ministre ne voulût lui ôter ses enfants pour se faire donner la régence [205]. Elle fit rechercher le duc de Bouillon par de Thou secrètement et avec beaucoup d'instances. Elle lui fit demander que, le roi venant à mourir, il voulût lui promettre de la recevoir dans Sedan avec ses deux enfants, ne croyant pas, tant elle étoit persuadée des mauvaises intentions du cardinal et de son pouvoir, qu'il y eût aucun lieu de sûreté pour eux dans toute la France. De Thou dit encore au duc de Bouillon que, depuis la maladie du roi, la reine et Monsieur s'étoient liés étroitement ensemble, et que c'étoit par Cinq-Mars que leur liaison avoit été faite. Deux jours après, de Thou souhaita que la reine témoignât au duc de Bouillon la satisfaction qu'elle avoit de la manière dont il avoit répondu aux choses qui lui avoient été dites de sa part; ce qu'elle ne put faire qu'en peu de paroles et en passant pour aller à la messe, se remettant du reste à de Thou comme ayant en lui une confiance entière.» Turenne écrivant un an après à sa sœur, Mlle de Bouillon, lui dit: «Vous pouvez juger combien il doit être sensible à mon frère de voir la reine et Monsieur tout-puissants, et d'avoir perdu Sedan pour l'amour d'elle [206].» Or, où la reine Anne s'était si fort engagée, Mme de Chevreuse n'avait guère dû s'abstenir. Ajoutez qu'elle était depuis longtemps très-liée avec de Thou, qui s'était compromis pour elle dans une affaire qu'il nous est impossible de déterminer, mais où nous savons qu'il eut grand'peine à obtenir son pardon du cardinal, comme il le reconnaît lui-même dans le tragique procès qui le conduisit à l'échafaud [207]. Un ami de Richelieu, qui ne se nomme pas, mais qui paraît bien informé, n'hésite point à mettre Mme de Chevreuse, ainsi que la reine, parmi ceux qui alors ont voulu le renverser: «M. le Grand, écrit-il au cardinal [208], a été poussé à son mauvais dessein par la reine mère, par sa fille (la reine d'Angleterre) qui est en Hollande, par la reine de France, par Mme de Chevreuse, par Montaigu et autres papistes du parti malin d'Angleterre.» Enfin le cardinal lui-même, dans les premiers jours de juin 1642, retiré à Tarascon pour sa santé sans doute, mais aussi pour sa sûreté, avec ses deux confidents les plus dévoués, Mazarin et Chavigni, et les fidèles régiments de ses gardes, se sentant environné de périls sans savoir encore d'où ils viennent, et faisant représenter à Louis XIII la gravité de la situation, cite ce qu'on lui écrit des mouvements que se donne Mme de Chevreuse parmi les indices les plus alarmants [209].
Mais bientôt l'œil de Richelieu perce la nuit qui l'enveloppe; il voit clair dans les menées du grand écuyer que depuis longtemps il surveillait: une trahison, dont le secret est demeuré impénétrable à toutes les recherches depuis deux siècles, fait tomber entre ses mains le traité conclu avec l'Espagne, par l'intermédiaire de Fontrailles, au nom de Monsieur, de Cinq-Mars et du duc de Bouillon. Dès lors, le cardinal se tient assuré de la victoire. Il connaissait Louis XIII; il savait qu'il avait pu, dans quelque accès de son humeur mobile et bizarre, se plaindre de son ministre auprès de son favori, souhaiter même d'en être délivré, et prêter l'oreille à d'étranges propos [210]; mais il savait aussi à quel point il était roi et Français, et dévoué à leur commun système. Il se hâta donc d'envoyer Chavigni à Narbonne avec les preuves authentiques du traité d'Espagne. A la vue de ces preuves [211], Louis se trouble; il a peine à en croire ses yeux, il tombe dans une sombre mélancolie, et il n'en sort qu'avec des éclats d'indignation contre celui qui a pu abuser ainsi de sa confiance et conspirer avec l'étranger. On n'a pas besoin de l'enflammer; il est le premier à demander une punition exemplaire; pas un jour, pas une heure il ne s'attendrit sur la jeunesse d'un coupable qui lui a été si cher; il ne pense qu'à son crime, et signe sans hésiter l'arrêt de sa mort. S'il épargne le duc de Bouillon, c'est pour acquérir Sedan. Il fait grâce à son frère, le duc d'Orléans, mais en le déshonorant et en lui ôtant tout pouvoir dans l'État. Sur un bruit parti d'un domestique de Fontrailles, et que les mémoires de Fontrailles confirment pleinement [212], ses soupçons se portent sur la reine [213], et on ne parvint jamais à lui arracher de l'esprit qu'ici, comme dans l'affaire de Chalais, Anne d'Autriche ne s'entendît avec Monsieur. Qu'eût-il dit s'il avait lu la relation de Fontrailles, les mémoires du duc de Bouillon, le billet de Turenne et la déclaration de La Rochefoucauld? A nos yeux, l'accord de ces témoignages est décisif. Les paroles du duc de Bouillon et de La Rochefoucauld sont telles qu'on n'en peut révoquer en doute l'autorité qu'en imputant à l'un et à l'autre non pas une erreur, mais un mensonge, et un mensonge à la fois gratuit et odieux. La reine fit tout au monde pour conjurer ce nouvel orage et persuader son innocence au roi et à Richelieu. Nous avons vu qu'en 1637 les protestations les plus solennelles, les serments les plus saints ne lui avaient pas coûté pour démentir d'abord ce qu'ensuite il lui avait bien fallu confesser. En 1642, elle eut recours aux mêmes moyens. Elle descendit à des humilités aussi incompatibles avec une bonne conscience qu'avec sa dignité et son rang. Elle fit paraître «une grande horreur pour l'ingratitude du grand écuyer;» elle déclara qu'elle se remettait sans réserve entre les mains du cardinal, qu'elle ne voulait plus se gouverner que par ses conseils, et qu'elle chercherait désormais tout son bonheur en ses enfants, dont elle abandonnait l'éducation à Richelieu. Elle lui écrivit elle-même pour lui demander avec tendresse des nouvelles de sa santé, comme autrefois elle lui avait demandé sa main et offert la sienne en signe d'éternelle alliance, ajoutant très-humblement qu'il ne se donnât pas la fatigue de lui répondre [214].
Anne fit bien plus, elle ne se borna pas à la dissimulation et au mensonge: dans ce péril extrême, elle alla jusqu'à se tourner contre la courageuse amie qui se dévouait pour elle. Elle l'eût embrassée comme une libératrice, si la fortune se fût déclarée en sa faveur; vaincue et désarmée, elle l'abandonna. Comme elle avait protesté de son horreur pour la conspiration qui avait échoué et pour ses deux imprudents et infortunés complices qui montèrent, sans la nommer, sur l'échafaud, ainsi, voyant le roi et Richelieu déchaînés contre Mme de Chevreuse et bien décidés à repousser les nouvelles instances que faisait sa famille pour obtenir son rappel, la reine, loin d'intercéder pour son ancienne favorite, se joignit à ses ennemis; et, afin de donner le change sur ses propres sentiments et de paraître applaudir à ce qu'elle ne pouvait empêcher, elle demanda comme une grâce toute particulière qu'on tînt la duchesse éloignée de sa personne et même de la France. «La reine, écrit à Richelieu son ministre des affaires étrangères, Chavigny [215], la reine m'a demandé avec soin s'il étoit vrai que Mme de Chevreuse revînt; et, sans attendre ce que je lui repondrois, elle m'a témoigné qu'elle seroit marrie de la voir présentement en France, qu'elle la connoissoit pour ce qu'elle étoit, et elle m'a ordonné de prier Son Éminence de sa part, si elle avoit quelque envie de faire quelque chose pour Mme de Chevreuse, que ce fût sans lui permettre son retour en France. J'ai assuré Sa Majesté qu'elle auroit satisfaction sur ce point.»—«Je n'ai jamais vu une plus véritable et plus sincère satisfaction que celle qu'a eue la reine d'apprendre ce que je lui ai dit de la part de Monseigneur. Elle proteste que non-seulement elle ne veut point que Mme de Chevreuse l'approche, mais qu'elle est résolue, comme à son propre salut, de ne plus souffrir que personne lui parle contre la moindre chose de son devoir [216].»
Voilà donc Mme de Chevreuse tombée, ce semble, au dernier degré du malheur. Sa situation était affreuse; elle souffrait dans toutes les parties de son cœur; plus d'espoir de revoir sa patrie, ses enfants, sa fille Charlotte. Ne tirant presque rien de France, elle était à bout de ressources, d'emprunts et de dettes. Elle apprenait combien il est dur de monter et de descendre l'escalier de l'étranger [217], d'avoir à subir tour à tour la vanité de ses promesses et la hauteur de ses dédains. Et pour qu'aucune amertume ne lui fût épargnée, celle qui lui devait au moins une fidélité silencieuse se rangeait ouvertement du côté de la fortune et de Richelieu. Elle passa ainsi quelques mois bien douloureux, sans nul autre soutien que son courage. Tout à coup, le 4 décembre 1642, le redouté cardinal, victorieux de tous ses ennemis au dehors et au dedans, maître absolu du roi et de la reine, succombe au faîte de la puissance. Louis XIII ne tarda pas à le suivre; mais, forcé bien malgré lui de confier la régence à la reine et de nommer son frère lieutenant général du royaume, il leur imposa un conseil sans lequel ils ne pouvaient rien, et où dominait, en qualité de premier ministre, l'homme le plus dévoué au système de Richelieu, son ami particulier, son confident et sa créature, le cardinal Jules Mazarin. Ce n'était point assez de cette mesure bizarre qui, par défiance de la future régente, mettait en quelque sorte la royauté en commission; Louis XIII ne crut avoir assuré après lui le repos de ses États qu'en confirmant et en perpétuant, autant qu'il était en lui, l'exil de Mme de Chevreuse. Dans sa pieuse aversion pour la vive et entreprenante duchesse, il avait coutume de l'appeler le Diable. Il n'aimait guère plus, il craignait presque autant, l'ancien garde des sceaux Châteauneuf, enfermé dans la citadelle d'Angoulême. Comme si l'ombre du cardinal le gouvernait encore à son lit de mort, avant d'expirer il inscrivit dans son testament, dans la déclaration royale du 21 avril [218] contre Châteauneuf et Mme de Chevreuse, cette clause extraordinaire: «D'autant, dit le roi, que pour de grandes raisons, importantes au bien de notre service, nous avons été obligé de priver le sieur de Châteauneuf de la charge de garde des sceaux de France, et de le faire conduire au château d'Angoulême, où il a demeuré jusqu'à présent par nos ordres, nous voulons et entendons que ledit sieur de Châteauneuf demeure au même état qu'il est de présent audit château d'Angoulême jusques après la paix conclue et exécutée, à la charge néanmoins qu'il ne pourra lors être mis en liberté que par l'ordre de la dame régente, avec l'avis du conseil qui ordonnera d'un lieu pour sa retraite dans le royaume ou hors du royaume, ainsi qu'il sera jugé pour le mieux. Et comme notre dessein est de prévoir tous les sujets qui pourroient en quelque sorte troubler l'établissement que nous avons fait pour conserver le repos et la tranquillité de notre État, la connoissance que nous avons de la mauvaise conduite de la dame duchesse de Chevreuse, des artifices dont elle s'est servie jusques ici pour mettre la division dans notre royaume, les factions et les intelligences qu'elle entretient au dehors avec nos ennemis nous font juger à propos de lui défendre, comme nous lui défendons, l'entrée de notre royaume pendant la guerre, voulons même qu'après la paix conclue et exécutée elle ne puisse retourner dans notre royaume que par les ordres de ladite dame reine régente, avec l'avis dudit conseil, à la charge néanmoins qu'elle ne pourra faire sa demeure ni être en aucun lieu proche de la cour et de ladite dame reine.» Ces solennelles paroles désignaient Mme de Chevreuse et Châteauneuf comme les deux plus illustres victimes du règne qui allait finir, mais aussi comme les chefs de la politique nouvelle qui semblait appelée à remplacer celle de Richelieu. Louis XIII rendit le dernier soupir le 14 mai 1643. Quelques jours après, le même parlement qui avait enregistré son testament, le réformait; la nouvelle régente était délivrée de toute entrave et mise en possession de l'absolue souveraineté; Châteauneuf sortait de prison, et Mme de Chevreuse quittait Bruxelles en triomphe pour revenir en France et à la cour.