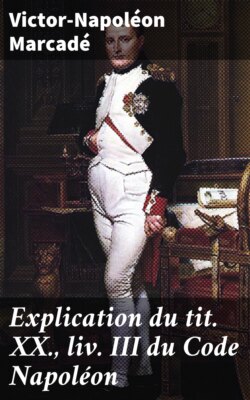Читать книгу Explication du tit. XX., liv. III du Code Napoléon - Victor-Napoléon Marcadé - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES § 1er. — Nature de la Prescription; ses effets; ses diverses espèces.
ОглавлениеTable des matières
2219. — La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi.
SOMMAIRE.
I. Étymologie et sens actuel du mot prescription.
II. La prescription est un mode légal d’acquisition ou de libération. Réfutation de l’idée contraire.
III. Critique exagérée que M. Troplong adresse à notre article.
IV. La prescription a son principe dans le droit naturel et peut dès lors être invoquée par l’étranger et par le mort civilement: erreur de Pothier. Mais elle appartient pour le reste au droit civil et elle n’éteint les actions que civilement: erreur et contradiction de M. Troplong.
V. La prescription n’opère d’ailleurs que quand elle est opposée par le défendeur: inadvertance de M. Troplong.
VI. Dans le conflit des lois de différents pays, la prescription se règle, en matière réelle, par la loi de la situation du bien; et en matière personnelle par celle du domicile du débiteur. Réfutation des deux systèmes contraires de Pothier et de M. Troplong.
VII. Observation sur la règle précédente. Quid si le passage d’un pays à un autre a soumis successivement la chose à plusieurs lois différentes.
VIII. Indication générale et sommaire des différentes espèces de prescriptions.
I. — Le mot prescription, détourné comme tant d’autres de son acception première, est loin d’avoir ici le sens qu’il présente naturellement. Prescription, en effet, præ-scriptio (substantif du verbe præscribere), signifie tout simplement, par lui-même, une écriture mise en avant, tandis que, dans notre titre, il exprime un mode particulier d’acquisition et de libération qui s’accomplit sans qu’aucune écriture ait besoin d’y figurer.
On sait, au surplus, d’où vient ici ce mot de prescription. Cette qualification (si bizarre aujourd’hui pour la chose à désigner) d’écriture mise en avant est un reste de la procédure formulaire des Romains. A Rome, sous le système des formules, lorsque le prêteur avait accordé une formule d’action ordonnant au juge de condamner à restitution le possesseur d’un bien qui serait démontré appartenir à l’adversaire d’après les règles du droit civil, le possesseur, défendeur à l’action, pouvait échapper à cette condamnation en prouvant que, s’il n’était pas, à la vérité, propriétaire du bien ex jure quiritium, du moins il le possédait depuis le temps voulu pour être à l’abri de toute attaque d’après la jurisprudence prétorienne; et quand il opposait ce moyen de défense, le préteur ajoutait à la formule portant l’ordre de condamner, cette restriction: nisi de eâ re agatur cujus longa possessio sit. Or comme cette phrase protectrice de la longue possession du défendeur, quoiqu’elle fût ainsi mise après coup, s’écrivait cependant en tête de la formule, c’était bien au moyen d’une præ-scriptio que le défendeur était garanti; et quoique depuis bien des siècles il n’y ait plus ici ni de formule, ni dès lors d’écriture à mettre en tête, le mot prescription s’est perpétué jusqu’à nous, comme tant d’autres que la routine a fait survivre aux choses qu’ils désignaient, et qui ne sont plus maintenant que des non-sens ou même des contre-sens .
II. — Nous venons de dire que la prescription est, en droit, un mode particulier d’acquisition ou de libération. Or quelques jurisconsultes nient aujourd’hui cette idée.
«La prescription, disent-ils, n’est pas une cause d’acquisition ou de
«libération; c’est la preuve légale d’une acquisition ou libération antérieure;
« c’est la présomption et la constatation, admise par la loi,
«soit d’une vente ou d’une donation du bien, soit d’un payement ou
«d’une remise de la créance. S’il en était autrement, si c’était la
«prescription qui fût légalement la cause d’acquisition du bien ou
«d’extinction de la créance, le défendeur serait tenu, dans le cas où sa
«possession a été de mauvaise foi, de restituer les fruits de ce bien ou
«les intérêts de cette créance antérieurs à l’échéance du délai; or
«tout le monde reconnaît qu’il ne les doit jamais, ce qui suppose bien
«qu’il est réputé être devenu propriétaire ou avoir cessé d’être débiteur
« le jour même où la prescription a commencé à courir.» — Cette théorie, qui paraît être enseignée par certains professeurs de la faculté de Paris , n’est pas exacte et ne résulte que d’un malentendu. Sans doute la prescription repose pour partie sur la présomption dont il s’agit, mais elle n’est pas cette présomption; la supposition d’un fait de vente ou de donation, de payement ou de remise, est une des bases de la prescription, un des motifs qui l’ont fait admettre, mais elle ne constitue pas la prescription; et la vérité est que cette institution fondée tout à la fois, et sur la présomption dont on parle, et aussi sur un autre motif tout différent, constitue véritablement, dans la théorie de la loi, une cause particulière et l’un des modes légaux d’acquisition de la propriété et d’extinction des obligations.
La prescription, disons-nous, repose pour partie sur la présomption de fait d’un droit antérieurement acquis; c’est surtout parce que la longue possession du défendeur ou la longue inaction de son prétendu créancier ne sont souvent que la conséquence d’un droit que ce défendeur n’est pas en mesure de prouver, que les législateurs ont protégé celui-ci au moyen de la prescription. Mais cette raison d’être de la prescription n’est pas la prescription; et on a confondu deux choses distinctes, quand en lisant dans les travaux préparatoires du Code, et dans nos auteurs anciens et modernes, le développement de cette idée, on a pris ce pourquoi de l’institution pour l’institution elle-même.
Et non-seulement ce n’est là que le motif de la prescription; mais ce n’est pas d’ailleurs son motif unique, et quand on considère sa seconde raison d’être et les effets qu’elle lui a fait attribuer, il est bien impossible de dire qu’elle est seulement une preuve, et non pas une cause d’acquisition ou de libération. On sait, en effet, que les plus hautes considérations d’intérêt social, et l’impérieuse nécessité des choses, ont déterminé tous les législateurs, celui de 1804 comme ses devanciers, à consacrer, quand l’état des choses a duré très-longtemps, jusqu’aux usurpations les plus flagrantes. Ainsi, supposons que le possesseur du champ que je viens revendiquer eût l’impudence de me répondre: «Il est très-vrai que je n’ai jamais eu de juste titre pour
«posséder ce bien, que je m’en suis emparé de mauvaise foi et sachant
« parfaitement qu’il appartenait à un autre; mais voici 40, 50,
«60 ans que je le cultive et le traite en propriétaire; or par cela seul
«il m’appartient; il y a prescription.» Ce langage, si révoltant qu’il puisse paraître, sera cependant couronné de succès, et l’usurpateur sera déclaré propriétaire, malgré son aveu, par cela seul qu’il possède en maître depuis plus de 30 ans. On sanctionnera de même la prétention du défendeur qui dirait: «Je sais parfaitement que je vous devais «50,000 fr. et que ma dette n’a jamais été ni payée par moi, ni remise
«par vous; mais voici plus de 30 ans qu’elle est échue sans que vous
«m’ayez jamais poursuivi ni fait aucun acte interruptif de la prescription,
et par conséquent votre créance est éteinte, je ne vous dois
«plus rien.» Sans doute il est triste d’être forcé d’accueillir de tels moyens de défense; mais il fallait bien qu’il en fût ainsi. On ne pouvait pas, quand un droit est resté non exercé pendant 50, 60, 100 années et plus, lui donner encore effet en jetant partout la perturbation, et il fallait bien qu’après un temps assez long les positions les plus vicieuses finissent par devenir légitimes. On l’a compris dans tous les temps et dans tous les lieux, pour le droit international et le droit public aussi bien que pour le droit privé, et c’est précisément à cause de cet effet héroïque et absolu, que la prescription a mérité d’être appelée patrona generis humani. Or puisqu’il en est ainsi, puisque après un certain délai (que le Code fixe à 30 ans) la loi transfère le droit elle-même, malgré l’absence constante et avouée de toute autre cause juridique, il est donc manifeste que la prescription est bien ici la cause d’acquisition ou d’extinction, et non pas simplement la présomption ou preuve légale d’une cause préexistante et d’un droit antérieurement acquis. C’est donc en termes très-propres, et non par simple manière de parler, que la prescription s’appelle, selon les cas, ou acquisitive ou libératoire.
Et cette preuve, que nous tenions à tirer avant tout de la nature même de l’institution, n’est-elle pas d’ailleurs écrite partout? A Rome, la prescription acquisitive s’appelait du nom énergique d’usu-capion, c’est-à-dire ACQUISITION par l’usage, et l’usu-capion était, dans la rigueur même du droit quiritaire, un des cinq modes d’acquérir la propriété . Dans notre ancien droit français, tous nos auteurs sont d’accord pour admettre la même idée, ils nous disent, celui-ci, que «la prescription est une manière d’acquérir ou de perdre par l’effet du
«temps;» celui-là, qu’elle est «un moyen d’acquérir le domaine des
«choses en les possédant, et de s’affranchir des droits, actions et obligations
« quand le créancier néglige de les exercer;» l’autre, que des deux espèces de prescriptions la première peut se définir «l’acquisition
« de la propriété par la possession» et que la seconde, «la
«prescription à l’effet de se libérer, n’est pas seulement établie sur la
«présomption de payement, mais aussi comme une peine contre la négligence
« du créancier .» Le Code civil, enfin, non content de définir la prescription, dans notre article, un moyen d’acquérir ou de se libérer, a déjà pris soin, en énumérant d’une part les manières d’acquérir la propriété, dans les art. 711,712, et d’autre part les causes d’extinction des obligations dans l’art. 1234, de ranger la prescription parmi les unes et parmi les autres .
C’est donc une fausse théorie que celle qui présente la prescription comme n’étant, en droit, que la présomption ou la preuve soit de l’acquisition, soit de la libération, tandis qu’elle en est la cause efficiente; et l’on a mauvaise grâce à présenter les rédacteurs du Code, ainsi que le fait M. Mourlon (p. 5), comme des praticiens vulgaires qui ont ici confondu l’acquisition du droit avec l’acquisition de sa preuve et n’ont pas su se dégager du fait pour remonter aux principes, alors qu’ils n’ont fait, au contraire, que suivre non-seulement l’ancien droit français, mais même le droit romain, qui lui aussi posait la prescription comme cause légale d’acquisition. Mais ceci, bien entendu, n’empêche pas la prescription d’avoir un effet rétroactif au jour où elle a commencé à courir, comme tout le monde le reconnaît, puisque l’idée contraire serait en opposition directe avec le but même de l’institution. En brisant le droit de l’ancien propriétaire ou créancier, la loi le brise nécessairement pour le tout, pour l’accessoire aussi bien que pour le principal: quand, par raison d’ordre public, on lui interdit toute action pour le bien ou le capital, on ne pouvait pas lui permettre d’agir encore pour les simples intérêts ou fruits de ce capital ou de ce bien.
III. — M. Troplong (n° 24) adresse à notre article, en tant qu’il définit la prescription «un moyen d’acquérir ou de se libérer par un «certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi», une critique qui serait parfaitement fondée si les derniers mots du texte n’existaient pas, mais qui nous paraît exagérée en présence de ce texte entier. Sans doute le temps ne saurait être en lui-même et par lui seul une cause d’acquisition ou de libération; ce n’est pas seulement par l’effet du temps, c’est aussi et surtout par l’effet de la possession du bien ou de l’inaction du créancier, que la prescription s’accomplit; en sorte que le reproche de fausseté que M. Troplong fait à la définition du Code serait mérité, si la loi disait seulement que le droit s’opère par un certain laps de temps, sans rien ajouter, et en présentant ainsi le temps comme la condition unique. Mais du moment que le Code ajoute et sous les conditions déterminées par la loi, en sorte que sa définition se trouve ainsi complétée par ce renvoi aux autres articles de notre titre, il n’est pas exact de dire, comme le fait M. Troplong, que le Code présente le temps comme étant par lui seul le moyen d’acquérir ou de se libérer. Le seul tort qu’on peut ici reprocher aux rédacteurs, c’est, non pas d’avoir omis, comme le dit M. Troplong, le premier élément de la prescription, mais de ne l’avoir indiqué que vaguement, par simple renvoi et en le reléguant au second rang, quand il était si facile de définir la prescription: «un
«moyen d’acquérir ou de se libérer par la possession du bien ou par
«l’inaction du créancier continuées pendant un certain temps.»
IV. — C’est une question qui a été très-controversée, que celle de savoir si la prescription est du droit naturel ou seulement du droit civil; et cette question, pour des esprits qui ne veulent se placer qu’à un point de vue absolu, aurait pu se perpétuer indéfiniment sans jamais se résoudre; car la vérité est qu’on avait tort et raison de part et d’autre, attendu que la prescription est tout à la fois et du droit civil et du droit naturel. Elle est du droit naturel quant à son principe fondamental, puisque c’est la raison elle-même et la force des choses, comme on l’a vu au n° II, qui commandent impérieusement de l’admettre; mais elle est du droit civil pour la plupart des règles de détail qui en organisent l’application, en précisant les diverses conditions sous lesquelles elle s’accomplira: c’est bien manifeste, puisqu’on voit ces conditions varier d’un pays à un autre pays, d’une époque à une autre époque, et que le droit naturel ne saurait changer ainsi selon les temps et les lieux. La prescription, si elle a son principe dans le droit naturel, participe donc aussi, et pour une large part, au droit purement positif; et tandis que Pothier méconnaissait autrefois certaines conséquences du premier fait, M. Troplong méconnaît à son tour aujourd’hui une conséquence non moins certaine du second.
Pothier (n° 20) enseignait que la prescription ne pourrait pas être invoquée en France par des étrangers. Or cette doctrine, repoussée par Vattel (liv. 2, ch., 2, n° 141), par Denizart (v° Prescript.) et par un arrêt rendu au Parlement de Paris sur les conclusions de l’avocat général Gilbert, le 25 juin 1728, était en effet inadmissible autrefois déjà, et elle l’est bien mieux encore aujourd’hui, depuis que la loi de 1819 permet aux étrangers de recueillir et transmettre en France non-seulement par succession, mais même par donation et testament: certes la matière des donations et testaments est bien autrement du droit civil que la prescription... On ne doit pas douter non plus que la prescription ne puisse être invoquée par le mort civilement lui-même, quoiqu’il ait moins de droits qu’un étranger. Puisque la prescription, en général et dans son principe, est du droit naturel, le mort civilement peut donc s’en prévaloir, et comme on ne pourrait lui refuser le système particulier de prescription organisé par notre droit (sous prétexte que ce système, dans son ensemble, appartient au droit civil) qu’en lui refusant par là même toute espèce de prescription (la loi n’en connaissant pas d’autre que celle qu’elle a organisée), force est bien de lui en accorder pleinement le bénéfice. Il va sans dire, au surplus, que le mort civilement ne peut user de la prescription acquisitive que dans les limites que la loi pose à sa faculté d’acquérir. Ainsi, un acte de donation ne lui suffirait pas pour acquérir par dix ou vingt ans, puisqu’il faut pour cela un juste titre, et que cette donation, qui serait un juste titre pour un autre, ne l’est pas pour lui, à qui la loi interdit ce mode d’acquisition: il lui faudrait dans ce cas une possession de trente ans.
Mais d’un autre côté, puisque la prescription, bien qu’elle ait son principe dans le droit naturel, ne tire que du droit civil les conditions sous lesquelles elle s’accomplit, il faut donc se bien garder d’admettre avec M. Troplong (nos 29-32) qu’elle opère dans l’ordre naturel en même temps que dans l’ordre civil, et que, quand elle éteint une dette civilement, elle l’éteint par là même naturellement, en sorte que cette dette serait complètement anéantie, absolument comme si elle avait été payée. C’est une grave erreur sur laquelle M. Troplong lui-même arrive bientôt à se contredire et à se condamner (nos 33, 34). L’extinction d’une dette par la prescription laisse intacte la question d’existence ou d’inexistence de l’obligation naturelle, et il est de toute évidence que le débiteur, dans ce cas, quoique libéré aux yeux de la loi, pourra continuer d’être tenu en conscience.
En vain M. Troplong argumente de ce que la loi met sur la même ligne, comme causes d’extinction, la prescription et le payement (art. 1234), puisque la loi ne parle nécessairement que de l’extinction civile, à ce point qu’elle met aussi sur le même rang l’extinction par nullité ou rescision! Aussi, voyez dans quelle contradiction tombe bientôt, et sur deux points consécutifs, le savant magistrat... Si la prescription était ici, même aux yeux de l’équité naturelle, sur la même ligne que le payement, et que comme lui elle éteignit la dette naturellement en même temps que civilement, de sorte qu’une fois la prescription opposée, il ne resterait absolument rien de cette dette, il s’ensuivrait que le payement que viendrait ensuite faire l’ex-débiteur serait sujet à répétition d’après l’art. 1235; car cet article déclare nettement, et avec raison, qu’un payement n’est inattaquable comme tel que quand il existait une dette (au moins naturelle), que ce qu’on a payé sans être dû (au moins naturellement) peut toujours être répété, et que c’est seulement quand il y avait une obligation naturelle (sinon civile), que la répétition n’est pas admise. Or M. Troplong reconnaît (n° 33) que si le débiteur, après avoir opposé la prescription, vient néanmoins payer, la répétition ne sera possible, et qu’elle ne le serait que pour celui qui aurait payé par erreur et dans l’ignorance où il était de l’état des choses; encore fait-il remarquer qu’il lui faudrait donner des preuves bien manifestes, attendu qu’on supposera toujours qu’il a payé volontairement et pour décharger sa conscience! Mais s’il en est ainsi, c’est donc que la prescription n’éteint la dette que civilement et la laisse subsister comme dette naturelle, comme obligation de conscience... M. Troplong nous offre encore au numéro suivant (34, 2e alin.) une contradiction non moins tlagrante, et une nouvelle condamnation de son faux principe, en proclamant, contrairement à la doctrine de Dunod, que l’obligation éteinte par prescription est encore susceptible de novation! Comment, en vérité, s’expliquer l’accouplement de pareilles idées? Après la prescription, la dette, dites-vous, est radicalement anéantie, elle n’existe pas plus comme dette naturelle que comme dette civile, il n’y a plus rien; et cependant, cette dette est susceptible de se nover! Que signifie un tel non-sens? Est-ce que, pour être susceptible de n’importe quoi, pour avoir telle ou telle qualité ou propriété, il ne faut pas avant tout exister? est-ce qu’il n’est pas élémentaire que nihili nullæ sunt proprietates vel qualitates et que prius est esse quàm esse tale? La novation étant la transformation d’une dette en une autre, la substitution d’une seconde dette à une première, il est clair que quand aucune dette n’existe, il n’y a pas de novation possible; et puisque après la prescription la dette peut encore se nover, c’est évidemment qu’elle existe encore et que, brisée civilement, elle subsiste toujours naturellement .
V. — Remarquons, au surplus, que dans ce qui précède, nous avons encore atténué la profonde inexactitude des doctrines professées ici par M. Troplong, en n’attribuant qu’à la prescription opposée par le débiteur l’effet d’éteindre civilement l’obligation. Le savant magistrat, lui, va ici, même pour l’extinction naturelle et civile tout ensemble, plus loin que ne le fait la loi pour l’extinction civile seulement. Non content de donner à la prescription l’effet d’éteindre la dette, non-seulement quant au lien civil, mais même quant au lien naturel, il va ici jusqu’à présenter ce double effet comme se produisant de plein droit, et par le seul fait de l’échéance du délai, au lieu d’attendre, comme le veut le Code, que le moyen tiré de la prescription soit invoqué par le débiteur. Au n° 32, pour combattre un passage de Dugald-Stewart (dont les idées philosophiques, nous devons le dire en passant, sont autrement exactes que celles de M. Troplong), le savant magistrat nous dit: «Le droit positif veut que le délai de trente ans épure le droit
«vicieux, que l’obligation originaire ne puisse plus (une fois ce délai
«passé) reparaître parmi les droits reconnus;» et il ajoute qu’après ce délai TOUT est éteint et fini, parce que la loi écrite force le droit naturel à abdiquer. Ainsi, c’est par le seul fait de l’échéance des trente ans que l’obligation serait totalement anéantie, et civilement, et naturellement aussi; et par cela seul que le terme serait passé, l’obligation originaire aurait cessé d’être une obligation, elle ne pourrait plus reparaître parmi les droits reconnus! Quelle doctrine! Ce n’est pas seulement une grave erreur que ce passage contient, il en contient deux; car non-seulement la prescription ne brise que le lien civil de l’obligation, et non le lien naturel, mais elle n’opère d’ailleurs son effet que quand elle est opposée au demandeur par le défendeur: malgré l’échéance de trente années, ou même de quarante années et plus, l’obligation originaire, tant que le défendeur n’aura pas soin de déclarer qu’il se retranche derrière la prescription, pourra toujours, et à toute époque, reparaître parmi les droits reconnus, et elle y reparaîtra dans toute sa force et sa pleine efficacité. M. Troplong, que nous avons vu au numéro précédent oublier les art. 1235 et 1271, comme nous l’avions vu au n° II oublier l’art. 712, oublie ici l’art. 2223, qui défend au magistrat de jamais appliquer d’office, et tant qu’il n’est pas opposé par le défendeur, le moyen résultant de la prescription.
Il est vrai que M. Troplong, quand il arrive au commentaire de cet art. 2223, en critique vivement la disposition, qui ne cadre guère, en effet, avec ses idées sur la prescription. Mais comme cette disposition, quand on la supposerait aussi mauvaise que nous la croyons bonne, n’en est pas moins écrite dans le Code, et qu’il s’agit ici d’appliquer la loi, non de la refaire, cette nouvelle erreur de M. Troplong est donc aussi manifeste que la précédente. Aussi cette fausse idée est-elle rejetée ailleurs par M. Troplong lui-même. Le savant magistrat, qui, après avoir déjà dit au n° 30 que la prescription éteint l’obligation (même naturelle, selon lui) dès l’instant qu’elle est acquise et opposée, déclare nettement encore au n° 80 que «tant que le moyen de prescription «n’est pas opposé, l’obligation CIVILE continue à subsister.» Ce n’est donc que par inadvertance et en se laissant entraîner au delà de sa véritable pensée, que M. Troplong nous dit ici que par l’expiration du délai de trente ans tout est fini et la créance si bien anéantie qu’elle ne saurait désormais reparaître parmi les droits reconnus.
VI. — C’est une question dont la seconde partie est assez délicate et traitée d’une manière peu satisfaisante par les interprètes du Code, que celle de savoir, en cas de conflit des lois de différents pays, quelle est celle qui doit régler, soit la prescription acquisitive, soit la prescription libératoire.
Pour la prescription acquisitive des choses, comme aussi pour la prescription, soit acquisitive, soit extinctive de droits réels sur ces choses, il n’y a pas de doute possible, et on doit évidemment suivre, comme le décident M. Troplong (n° 39) et M. Duranton (XXI-113), d’après nos anciens auteurs, la loi du pays où se trouve la chose. Il est évident, en effet, que la loi de la prescription n’est pas alors un statut personnel, mais un statut réel, puisqu’il s’agit de savoir comment, par quel temps et d’après quelles autres conditions telle chose se prescrira. Cette chose dès lors, selon qu’elle sera française, anglaise ou espagnole, c’est-à-dire située en France, en Angleterre ou en Espagne, se prescrira d’après la loi française, anglaise ou espagnole, de quelque pays que soit d’ailleurs la personne à laquelle elle appartient, d’après les principes par nous expliqués sous l’art. 3, nos III et V.
Et ce n’est pas seulement aux immeubles que nous appliquons cette règle; les meubles, pour lesquels Pothier (n° 251) croyait devoir y faire exception en les soumettant à la loi du domicile de leur propriétaire, et pour lesquels M. Duranton (loc. cit.) se contente de signaler la difficulté sans oser la résoudre, suivent selon nous le même principe, par les raisons que nous avons indiquées sous ce même art. 3, n° VI. Et telle était aussi, pour ce cas, l’opinion de Dumoulin, qui déclare formellement la règle applicable à toute prescription, rerum corporalium, SIVE MOBILIUM, sive immobilium, en ajoutant inspicitur INDISTINCTE locus ubi res est.
Mais que faut-il décider pour la prescription extinctive d’obligations personnelles! Nos anciens auteurs, à l’exception de Pothier, voulaient qu’on appliquât la loi du domicile du débiteur . Pothier, dans un passage où, tout en ne paraissant traiter qu’une question de prescription acquisitive, il traite aussi la nôtre en réalité, tient pour la loi du domicile du créancier . M. Troplong, enfin (n° 38), tient pour celle du lieu où devait se faire le payement. Et quant à M. Duranton (n° 113, dern. alin.), il prend le change sur le point en litige, et se contente d’examiner deux questions de suspension de la prescription pour minorité, au lieu de rechercher d’après quelle loi seront fixés le temps et les autres conditions nécessaires pour prescrire. Or, en présence des trois solutions contraires de M. Troplong, de Pothier et de tous nos anciens auteurs, nous n’hésitons pas à dire que cette dernière est seule exacte.
En effet, on peut d’abord dire, avec Merlin, que puisque la prescription n’anéantit pas le droit du créancier par elle-même et ipso facto, mais procure seulement au débiteur une exception qu’il lui sera facultatif d’opposer à l’action, c’est donc par la loi du lieu où ce débiteur doit être actionné, c’est-à-dire du lieu de son domicile, que la prescription doit tout naturellement se régler. Il n’importe pas qu’un autre lieu soit désigné pour le payement ou ait été celui de la passation du contrat; car, selon la pensée d’Huberus, la chose capitale à considérer ici, la chose à laquelle la prescription se rattache intimement, puisqu’elle vient en opérer l’extinction, c’est l’action, et non pas telle ou telle circonstance de la convention: jus AD ACTIONEM pertinet, non ad negotium gestum... D’un autre côté, et si l’on veut pénétrer plus avant en comparant avec soin cette prescription extinctive des obligations personnelles avec la prescription acquisitive des choses corporelles, on pourra remarquer entre elles un rapport plus profond qu’on ne le croit communément, et qui va nous conduire encore à la même solution. Lorsque Pierre d’une part et Paul de l’autre ont prescrit contre moi, le premier la ferme qui m’appartenait en Normandie, le second une créance de 50,000 fr. que j’avais sur lui, il y a en définitive plus d’analogie entre les deux cas qu’il ne le semble tout d’abord. Qu’est-ce que Pierre, en effet, a prescrit contre moi? on répond: ma ferme. Mais c’est aller trop vite, et arriver tout de suite à une seconde idée en sautant sur une première à laquelle il faut ici s’arrêter. Pierre a prescrit, Pierre a éteint et brisé chez moi, pour le faire naître chez lui, le dominium de la ferme, la propriété de l’immeuble, c’est-à-dire un pur droit, une chose incorporelle, absolument comme Paul a éteint et brisé mon droit de créance, ma propriété de cette créance, laquelle m’appartenait tout aussi bien que m’appartenait la ferme. Des deux côtés, la prescription a brisé un droit; et la seule différence, c’est que d’une part ce droit avait pour sujet passif une chose, c’est-à-dire la ferme, tandis que de l’autre il avait pour sujet passif une personne, c’est-à-dire le débiteur; l’un était jus in re, et l’autre jus in personam. Cela étant, on voit donc que les raisons qui font admettre pour règlement de la prescription, en matière réelle, la loi de la chose soumise au droit prescrit, celle de la situation de cette chose, commandent d’admettre de même en matière personnelle la loi de la personne soumise à ce même droit, celle du domicile de cette personne. La règle est en définitive la même dans les deux cas; on applique, dans les deux cas, la loi DE LA SITUATION. Qu’on n’objecte pas, en effet, qu’une créance étant un pur droit, elle n’a pas de situation. Sans doute, rigoureusement, elle n’en a pas; mais, rigoureusement, le dominium de la ferme, qui est de même un pur droit, n’en a pas davantage, ce qui n’empêche pas cependant de lui en assigner une. Or le procédé est absolument identique des deux côtés. De même que c’est en identifiant le droit réel avec la chose sur laquelle il frappe et s’exerce, qu’on dit: J’ai un domaine ou une propriété en Normandie, j’ai un usufruit à Paris, j’ai une hypothèque à Bordeaux (quoique la propriété, l’usufruit et l’hypothèque soient de purs droits, sans aucune existence matérielle et ne pouvant dès lors occuper aucune place nulle part); de même c’est en identifiant le droit personnel avec la personne sur laquelle il frappe et s’exerce, qu’on dit aussi, et ni plus ni moins exactement: J’ai des créances en Angleterre, j’ai des rentes en Amérique. Encore une fois, la règle est partout la même, on suit partout la loi du pays de la situation.
C’est donc la loi du domicile du débiteur qu’il faut suivre; et l’examen des motifs présentés par Pothier d’une part, et par M. Troplong de l’autre, à l’appui des deux systèmes contraires, en donne une nouvelle preuve.
Pothier, pour s’arrêter, dans son hypothèse d’une rente, à la loi du domicile du créancier, ou comme il dit, du propriétaire de cette rente, s’appuie sur cette raison, qu’un propriétaire ne peut être dépouillé de la chose qui lui appartient que par une loi à laquelle il soit soumis. Or de deux choses l’une. Ou bien Pothier entend une loi à laquelle le créancier ou propriétaire soit soumis d’une manière quelconque, et sinon quant à sa personne, du moins quant au droit à prescrire; et alors on lui répondra que le crédirentier, tout Français qu’il est, se trouve en effet soumis, quant à la rente qu’il possède en Angleterre, à l’empire de la loi anglaise, puisque c’est devant les tribunaux anglais et d’après les règles anglaises qu’il lui faut actionner et poursuivre son débirentier domicilié en Angleterre. Ou bien Pothier entend, et telle paraît être son idée, que le propriétaire ne peut être dépouillé de sa chose que par une loi à laquelle il serait soumis personnellement; mais alors l’idée est fausse et se trouve réfutée d’avance par les explications qu’il vient de donner lui-même (n° 247), puisqu’il en résulte que le propriétaire français peut très-bien se voir dépouiller des immeubles qui lui appartiennent en pays étranger, par une prescription accomplie d’après la loi de ce pays, quoiqu’il ne soit pas soumis personnellement à cette loi.
M. Troplong, qui tient pour la loi du pays où le payement devait se faire, en donne cet incroyable motif, que la prescription extinctive des obligations-étant la peine de la négligence du créancier, c’est la peine établie dans le lieu convenu pour le payement que ce créancier doit subir, puisque c’est dans ce lieu qu’il a été négligent (n° 38). Ainsi, soit une dette contractée par un Piémontais domicilié à Turin envers un Français domicilié à Paris, mais avec convention que le remboursement sera fait à Rome (où d’ailleurs il faut supposer qu’il n’est pas fait élection de domicile par le débiteur, puisque alors la question n’existerait plus, Rome devenant ainsi le lieu du domicile); c’est d’après la loi de Rome, quoique le débiteur n’y eût pas de domicile, que la dette se prescrira; et LA RAISON EN EST SIMPLE, dit M. Troplong, puisque c’est à Rome que le créancier a été négligent! Nous avouerons que, loin de trouver une pareille raison fort simple, nous la trouvons au contraire fort bizarre, et aussi fausse que bizarre, fausse deux fois pour une, comme on va le voir bientôt. Comment! cet homme qui n’a jamais quitté Paris, vous me dites que pendant 15 ans, 20 ans ou plus il a été négligent A ROME! c’est à Rome qu’il est resté dans cette longue inaction, à Rome qu’il s’est endormi dans cette insouciance prolongée, à Rome, lui qui n’y a jamais mis le pied!... Il faut donc, ici encore, comme dans notre n° IV, rappeler à M. Troplong que priùs est esse quàm esse tale, et que pour avoir été n’importe quoi à Rome, pour y avoir été négligent ou soigneux, insouciant ou vigilant, pour y avoir été tout ce qu’on voudra, il faut tout d’abord AVOIR ÉTÉ A ROME... Qu’on nous dise que ce créancier a négligé son affaire de Rome, à la bonne heure; mais cette affaire de Rome, où l’a-t-il négligée? c’est à Paris. Or, puisque c’est à Paris que la négligence a été commise, le prétendu principe d’après lequel on devrait appliquer la peine établie dansée lieu où s’est commise la négligence, conduirait donc à la solution toute contraire à celle de M. Troplong; elle conduirait à suivre la loi du domicile du créancier, c’est-à-dire qu’elle ramènerait à la fausse décision de Pothier, que M. Troplong vient pourtant de combattre... La vérité est qu’il ne faut considérer ni le domicile du créancier, ni le lieu du payement (quand il est autre que le domicile du débiteur). C’est qu’en effet (et c’est là que se trouve la seconde erreur de l’argument de M. Troplong), si l’on veut entrer dans l’ordre d’idées si peut logiquement présenté par le savant magistrat, voici ce que dira la raison. Ce n’est pas du topt, comme le dit le célèbre auteur, par la loi du pays où l’on a commis une faute, que cette faute doit être punie; c’est par la loi à laquelle cette faute a fait infraction, par la loi qui rendait le fait fautif, par la loi qui prohibait le fait qu’on a accompli ou prescrivait le fait qu’on a omis. Quand, par exemple, une loi française enjoint, sous telle peine, aux Français qui se trouvent en Angleterre, d’en sortir dans tel délai, ceux qui resteront passé ce délai ne seront certainement pas punissables par la loi anglaise, quoique leur faute ait été commise en Angleterre, mais bien par la loi française à laquelle ils ont négligé d’obéir. Or quelle est la loi à laquelle le créancier, dans notre question, a négligé d’obéir? Pour le dire, il faut voir d’abord en quoi a consisté sa négligence. Or quels sont les faits dont l’omission a constitué la négligence fautive du créancier et entraîné la prescription, en d’autres termes, les faits dont l’accomplissement eût empêché la prescription de se réaliser? Ces faits, ce ne sont pas du tout des voyages ou des envois à Rome pour y recevoir ou faire recevoir un payement que le débiteur n’y faisait pas, quoique tenu de le faire; c’étaient des actes de nature à le contraindre à ce payement, des sommations, des demandes, des poursuites régulièrement dirigées contre le débiteur récalcitrant. Or quelle est la loi d’après laquelle ces poursuites eussent pu et dû se faire? c’est la loi piémontaise, puisque, le débiteur ayant son domicile en Piémont, il ne pouvait être poursuivi que par les officiers et d’après les règles de ce pays. Donc, la loi dont le créancier a négligé d’user et dont le non-usage lui a fait encourir la prescription, peine de sa négligence, c’est la loi piémontaise; et c’est, par conséquent, d’après les diverses conditions, de temps et autres, fixées par cette loi, que la prescription se règle dans ce cas.
Ainsi, de quelque côté qu’on se tourne et quelque ordre d’idées qu’on prenne pour point de départ, on se trouve toujours ramené à cette conclusion, conforme à la doctrine des anciens docteurs, que c’est uniquement le domicile du débiteur qu’il faut considérer ici .
VII. — Quand on dit que la prescription se règle par la loi de la situation du bien en matière réelle, et par celle du domicile du débiteur en matière personnelle, cela s’entend, on le conçoit, des éléments constitutifs de la prescription, de ses conditions intrinsèques, et non des questions de capacité des personnes, questions qui se décident toujours par la loi du pays auquel la personne appartient, qu’elle y soit ou non domiciliée et sans distinction entre les matières personnelles et les matières réelles.
Ainsi, c’est bien par la situation de la chose ou par le domicile du débiteur, selon les cas, que l’on déterminera la durée du temps nécessaire pour prescrire, les qualités que la possession doit avoir, les causes d’interruption de la prescription, et aussi le point de savoir si cette prescription court ou non contre un propriétaire ou créancier mineur, interdit ou autrement incapable; mais ce n’est plus ainsi que se décidera le point de savoir si ce propriétaire ou créancier est ou n’est pas incapable. C’est par la loi de la situation ou du domicile, selon les cas, que l’on saura si l’incapacité empêche ou non la prescription; mais ce n’est pas par elle qu’on saura s’il y a ou non incapacité.
Nous devons insister sur ces idées, parce que M. Duranton (113, alin. dern.) donne à cet égard une explication dont le vague et l’indécision pourraient induire en erreur. Ainsi, soit un bien situé en Russie ou une créance dont le débiteur est domicilié dans le même pays; c’est bien la loi russe qui nous dira si la prescription court ou non contre un mineur; mais ce n’est pas nécessairement elle qui nous dira si le propriétaire ou créancier est ou n’est pas mineur, c’est-à-dire à quel âge a commencé ou commencera sa majorité. Cette dernière question se décidera par la loi allemande si l’individu est Allemand, par la loi française s’il est Français, etc., et ce alors même que cet individu serait domicilié en Russie... Il faut, en un mot, bien saisir ici cette idée, qui paraît n’avoir été qu’entrevue confusément par M. Duranton, que tandis que le point de savoir si la prescription court ou non contre les mineurs est une question de prescription, le point de savoir si telle personne est mineure ou majeure, n’est pas une question de prescription, et reste complètement indépendant pour sa solution, soit de la situation des biens de cette personne, soit du domicile de ses débiteurs.
Un point, au contraire, qui tient intimement à notre question, ou qui plutôt est encore la question elle-même, et dont cependant M. Duranton ne dit rien (pas plus que M. Troplong), c’est de savoir comment le délai de la prescription se réglera, quand pendant son cours le domicile du débiteur ou (si c’est en matière réelle) la situation du bien meuble auront changé de pays et se seront trouvés soumis successivement à des lois différentes. Faut-il s’en tenir alors, soit à la première loi, soit à la dernière, ou bien doit-on les combiner toutes deux pour les appliquer simultanément?
C’est à ce dernier parti qu’il faut s’arrêter. Ainsi, supposons que la loi allemande admette une prescription de douze ans pour telle créance qui ne se prescrit en France que par trente ans, et que le débiteur ait été domicilié huit ans à Vienne et neuf ans à Paris: on ne pourra pas dire, en appliquant seulement la loi française, que la prescription étant de trente années, et l’inaction du créancier n’ayant duré que dix-sept ans, treize années seraient encore nécessaires; mais on ne pourra pas dire non plus, en appliquant seulement la loi allemande, que le temps exigé n’étant que douze années, la prescription est dès lors accomplie depuis cinq ans. On ne peut pas, en effet, traiter comme n’ayant été soumise qu’à telle ou telle des deux lois, une chose qui a été soumise successivement à toutes deux, et il faut bien les appliquer l’une et l’autre en proportion de la durée qu’a eue l’empire de chacune comparée au délai total qu’elle exigeait. On dira donc que la prescription ayant couru huit ans sous l’empire d’une loi qui en exigeait douze, la prescription était aux deux tiers de son cours quand la loi allemande a été remplacée par la loi française, et que dès lors le délai différent exigé par celle-ci n’a eu à courir que pour un tiers, c’est-à-dire pour dix ans sur trente. Donc la prescription, au lieu d’avoir encore treize ans à courir, ou d’être accomplie depuis cinq ans, courra encore pendant un an.
Il va sans dire qu’on appliquerait le même principe si, au lieu d’avoir seulement deux lois différentes, on en avait eu successivement trois ou davantage.
VIII. — Nous croyons utile de terminer ce premier paragraphe par un aperçu général et sommaire des diverses espèces de prescriptions admises par notre Code.
Dans la prescription acquisitive, on distingue trois espèces: 1° la prescription de trente ans; 2° la prescription de dix à vingt ans ; 3° pour les meubles corporels, la prescription instantanée. — La prescription trentenaire n’exige que trois conditions: la possession, revêtue des qualités requises par la loi; le laps de temps; et enfin, l’invocation positive et publique, par le possesseur, de ce moyen d’acquisition que lui offre la loi. — La prescription de dix à vingt ans présente cinq éléments: la possession; le laps de temps; la bonne foi du possesseur; un juste titre; et l’invocation publique. — La prescription instantanée des meubles en présente quatre: la possession; la bonne foi; le juste titre; et l’invocation du possesseur (art. 2262,2265,2279).
La prescription libératoire, quant au délai, varie beaucoup plus. Ce délai est, en principe, de trente années; mais il est quelquefois aussi de dix ans, de cinq ans, de trois ans, de deux ans, d’un an, de six mois, de trois mois, de deux mois, de quarante jours, d’un mois, de quinze jours et de huit jours (art. 2262, 1304, 2276, 2277, 809, 2273, 1676, 2272, 2274, 316, 2102). — Du reste trois conditions seulement sont ici requises en général: l’inaction du créancier; le laps de temps; l’invocation du moyen de libération par le débiteur. Mais quelquefois la loi exige en plus la prestation de serment de ce même débiteur (art. 2275).
On appelle longues prescriptions, celles de trente ans, de dix ans et de dix à vingt ans; et petites prescriptions, celles de cinq ans et au-dessous. Les premières sont suspendues pendant la minorité ou l’interdiction du propriétaire ou créancier; les secondes courent contre les mineurs et les interdits aussi bien que contre les personnes capables (art. 2252, 2278).
2223. — Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
SOMMAIRE.
I. Réponse à la critique adressée à cet article par M. Troplong.
II. L’article s’applique à toutes personnes et pour toutes prescriptions. Mais il ne s’applique qu’en matière civile.
III. La prescription n’a pas besoin d’être opposée explicitement; mais il faut que le moyen existe réellement dans les conclusions.
I. — Nous plaçons immédiatement ici cet art. 2223, parce que sa disposition, comme on a pu le remarquer, fait partie intégrante des idées qui viennent d’être expliquées et s’y trouve déjà commentée sommairement.
Cette disposition, d’après laquelle la prescription n’est un des moyens légaux d’acquérir et de se libérer qu’autant qu’elle est positivement opposée à l’adversaire par celui qui doit en profiter, ne pouvait pas être approuvée par M. Troplong, lui qui regarde la prescription comme une cause d’acquisition ou de libération aussi respectable et aussi complète en elle-même que peut l’être toute autre. La prescription, dans les idées du savant magistrat, vaut une donation ou un achat en fait d’acquisition, elle vaut le payement lui-même en fait d’extinction d’une créance; et de même, dès lors, que le juge qui voit, quoique je ne le dise pas (parce que je fais défaut ou que je ne sais pas me défendre), que je vous ai bien et dûment acheté la chose que vous prétendez être à vous, ou que je vous ai payé la créance que vous me réclamez, doit repousser votre injuste demande, en constatant d’office, c’est-à-dire spontanément et malgré mon silence à cet égard, mon acquisition ou ma libération; de même, selon M. Troplong, le juge qui, malgré mon silence, découvre la preuve de l’existence des conditions requises pour l’accomplissement de la prescription, devrait être tenu de me déclarer propriétaire du bien ou libéré de la dette... Notre article, qui décide positivement le contraire et défend nettement au magistrat de jamais appliquer d’office la prescription, n’est, suivant M. Troplong, que le résultat d’anciens préjugés, qu’un emprunt maladroit à la législation romaine; et quand on lui fait remarquer que la prescription répugne dans bien des cas à la délicatesse et à la probité, que dès lors on doit toujours espérer et désirer que le plaideur ne se réfugiera pas dans ce retranchement extrême qui n’est souvent que l’asile des fripons, le célèbre jurisconsulte répond que l’objection serait bonne si le défendeur gardait un silence absolu (ce dont nous prenons acte, pour y revenir plus loin), mais que quand on le voit se débattre et employer, pour échapper à l’action, tous les moyens imaginables, même les plus puérils, il est bien impossible de croire alors à dçs scrupules de conscience, et force est bien de reconnaître que, s’il n’allègue pas la prescription, c’est par inexpérience ou erreur, d’où la conséquence que le juge devrait l’appliquer d’office.
L’art. 2223 n’est donc, à en croire M. Troplong (nos 84-87), qu’une règle manifestement mauvaise, et qui ne trouve pas plus sa raison d’être dans la considération morale invoquée par ses partisans, que dans les traditions du droit romain.
N’est-ce pas là une nouvelle et fâcheuse erreur du savant écrivain? Sans doute ce n’est pas dans les idées romaines qu’il faut aller chercher la justification de notre article: l’antagonisme qui existait à Rome entre le droit civil et le droit prétorien n’existant plus chez nous, il serait ridicule de vouloir expliquer cet article par une prétendue différence, aujourd’hui impossible, entre les défenses tirées du droit civil ou l’ipsum jus, et d’autres défenses qui sous le nom d’exceptions viendraient d’une autre source; il n’existe plus aujourd’hui qu’un seul et unique droit auquel appartiennent toutes les règles admises par la législation; du moment qu’un principe quelconque, soit d’action, soit de défense ou d’exception, existe quelque part, c’est qu’il est reconnu par le droit civil, et la prescription dès lors appartient chez nous à l’ipsum jus dans tous les cas possibles, aussi bien que tout autre moyen d’acquérir ou de se libérer. Aussi ne faut-il pas, pour parler exactement, dire que la prescription existe comme cause légale d’acquisition ou de libération dès l’instant que le délai requis est expiré (car si elle existait, elle devrait opérer immédiatement); il faut dire, comme nous venons de le faire, et comme nous l’avions déjà dit au n° VIII de l’article précédent, que la prescription ne devient mode d’acquisition ou de libération que par l’invocation qu’en fait celui au profit duquel elle existe, en présentant ainsi cette invocation comme l’un de ses éléments constitutifs.
Ce n’est donc pas, encore une fois, dans les principes du droit romain, qu’on peut trouver la raison d’être de notre art. 2223; et nous sommes, sur ce point, parfaitement d’accord avec M. Troplong. Mais cette raison se trouve, quoi que dise le savant magistrat, dans l’observation que nous avons présentée plus haut; et les principes de morale et d’équité qui ont présidé à notre législation de 1804 faisaient un devoir de défendre au juge d’admettre jamais d’office la prescription.
Et d’abord, M. Troplong lui-même avoue que la règle est bonne alors que ceux qui pourraient invoquer la prescription gardent un silence absolu; en sorte qu’il se met en contradiction avec sa conclusion, qui tendrait à supprimer cette règle dans tous les cas. Mais la vérité est que la règle est également juste, morale et nécessaire, alors même que le plaideur emploie pour repousser la demande tous les moyens imaginables, hormis toutefois celui de la prescription. M. Troplong nous dit qu’il est alors bien impossible de croire à des scrupules de conscience. C’est très-vrai, et ce n’est pas non plus par ce mobile de l’homme vraiment honnête, que nous expliquons le silence, quant à la prescription, de celui qu’on voit s’épuiser en efforts de toute espèce, et quelquefois même ridicules, pour ne pas céder. Mais à défaut de ce mobile du véritable honnête homme, n’y a-t-il pas aussi le mobile de ceux qui, fripons au fond, tiennent néanmoins à ne pas paraître tels; à défaut de la crainte de Dieu, ne reste-t-il pas souvent la crainte des hommes, le respect humain; et ne sera-ce pas, le plus souvent, par cette salutaire frayeur de l’opinion publique, que ce plaideur de mauvaise foi, qui ne demanderait pas mieux au fond que de faire valoir la prescription, n’osera cependant pas en parler? Or, ce respect humain, cette conscience de ceux qui n’ont pas de conscience, le devoir du législateur était évidemment d’en tirer parti; faire appliquer d’office la prescription à leur profit, c’eût été combler leurs vœux, en leur offrant le facile moyen d’obtenir le bénéfice de leur mauvaise foi sans même en avoir le courage. Certes, le législateur ne devait pas le faire; et c’est bien le moins, en vérité, que celui qui entend user de la prescription, soit tenu de le déclarer hautement.
II. — Notre article portant sa disposition d’une manière absolue et sans aucune exception ni restriction, il devra donc s’appliquer à toute espèce de prescriptions, et aussi bien pour le délai des actions en nullité ou rescision que pour tous autres cas. Que des auteurs aient enseigné le contraire autrefois par la raison ou le prétexte que, des ordonnances formelles ayant rigoureusement limité ce délai de l’action, le juge n’aurait pu recevoir l’action après l’expiration du délai qu’en contrevenant à l’ordonnance, cela se conçoit jusqu’à un certain point. Mais aujourd’hui qu’on ne peut plus distinguer des prescriptions provenant celles-ci du droit civil et celles-là du droit prétorien, comme à Rome, ou bien celles-ci des ordonnances et celles-là de la coutume seulement, comme dans notre ancienne France; aujourd’hui que toutes découlent d’une seule et même source, toutes dès lors sont soumises au même principe .
Par cette même raison de la portée absolue de notre article, il faut dire qu’il s’applique pour les mineurs, les interdits, les communes, etc., aussi bien que pour les personnes capables. Il est vrai que M. Troplong qui, du reste, partage aussi ce sentiment (n° 89), pense qu’on ne peut pas expliquer alors l’application de la règle par le même motif que dans les autres cas, c’est-à-dire par la nécessité de laisser chacun user ou ne pas user de la prescription suivant l’inspiration de sa conscience, parce que, selon lui, cette inspiration de la conscience n’est plus à consulter et n’a aucun rôle à jouer, quand il s’agit d’incapables (n° 80). Mais on verra plus bas (art. 2222, n° VIII) que cette idée du savant magistrat n’est pas admissible, d’où la conséquence que, si notre article s’applique aux incapables comme aux autres, il s’applique à eux par le même motif qu’aux autres.
Cela étant, on doit donc dire aussi comme M. Troplong (n° 90), et contrairement à la doctrine de M. Vazeille (n° 335) et de M. Dalloz, (Presc., art. 2, n° 3), que le ministère public n’aurait pas qualité, dans les conclusions qu’il doit donner pour les affaires des mineurs, interdits, etc., pour suppléer le moyen de prescription que la partie n’a pas opposé ; car il n’appartient pas plus à ce magistrat qu’à ceux qui doivent rendre la sentence de trancher une question que la loi n’entend laisser qu’à la conscience du plaideur.
Du reste, si absolue que soit notre disposition, on comprend que, puisqu’elle n’est écrite que dans le Code civil et comme règle de droit civil, elle ne saurait être étendue aux matières criminelles. La vie et la liberté des hommes ne leur appartiennent pas, ils n’ont pas le droit d’en disposer; et de même que le juge devrait ici appliquer la prescription, alors même que le prévenu déclarerait y renoncer, de même et à plus forte raison devra-t-il l’appliquer malgré son silence .
III. — La prescription, en matière civile, a donc besoin d’être opposée dans tous les cas; mais la loi n’exige nulle part qu’elle le soit en termes exprès; il suffit que le moyen soit réellement proposé au juge, peu importe de quelle manière, pour qu’il soit vrai de dire que celui-ci ne l’a pas suppléé d’office. Seulement, il faut que dans le fait et en réalité le moyen soit en effet proposé dans les conclusions du plaideur.
Ainsi, quand un individu, poursuivi en payement d’un capital et de ses intérêts, oppose la prescription pour ce capital, il est clair qu’il l’oppose par là même pour les intérêts aussi, puisque la prescription du capital n’a pu courir précisément que par le non-payement des intérêts; en sorte que, si les juges condamnent au payement du capital, parce qu’ils trouvent que le défaut de payement ne remonte pas assez loin, ils n’en devront pas moins admettre la prescription pour tous les intérêts dont l’échéance se trouvera remonter à plus de cinq ans. Au contraire, si une partie, après avoir opposé la prescription devant le bureau de conciliation, ne vient pas l’opposer de nouveau devant le tribunal qui doit juger, il est clair que ce tribunal ne pourra pas l’admettre, puisque ce moyen ne lui est pas proposé, quoiqu’il en ait été question précédemment: rien ne prouve au tribunal que la partie persiste dans ce moyen; son silence indique bien plutôt le contraire; et c’est avec grande raison que la cour d’Aix l’a ainsi jugé par arrêt du 22 messidor an XIII.