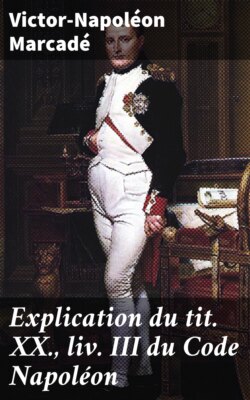Читать книгу Explication du tit. XX., liv. III du Code Napoléon - Victor-Napoléon Marcadé - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
§ 4. — Des choses imprescriptibles.
ОглавлениеTable des matières
2226. — On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.
2227. — L’État, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer.
SOMMAIRE.
I. Les choses hors du commerce sont généralement imprescriptibles, mais elles ne sont pas les seules, et la règle: Alienabile, ergò prescriptibile, n’est pas exacte aujourd’hui. Erreur de M. Mourlon.
II. Sont imprescriptibles les facultés naturelles et légales de l’homme. Différence entre une faculté et un droit. La faculté, qui devient prescriptible quand elle est transformée en simple droit, ne le devient pas par cela seul qu’un tiers s’imagine de signifier une défense de l’exercer. Erreur de M. Troplong.
III. Sont également imprescriptibles les grandes rivières et les rivages de la mer, lesquels sont insusceplibles de propriété privée et par là même de servitudes. Dissentiment avec Toullier. — Il en est autrement des relais de la mer.
IV. Sont de même imprescriptibles toutes les autres choses publiques, notamment les places de guerre et les chemins. Les places de guerre étant toutes classées officiellement, elles ne cessent d’être telles et ne deviennent prescriptibles que par un acte de l’autorité. Il en est de même de ceux des chemins qui sont aussi classés. Quant aux chemins non classés, ils perdent leur qualité par la cessation de l’usage qui la leur donnait, et peuvent dès lors se prescrire immédiatement. — Les diverses choses publiques, et notamment les églises, ne sont pas susceptibles de servitudes. Critique des doctrines de M. Troplong sur ces trois derniers points.
V. Sont au contraire prescriptibles, et d’après les règles ordinaires, à la différence de l’ancien droit, tous les biens ordinaires des établissements publics quelconques, des communes et même de l’État.
I. — Il est diverses classes de choses que leur nature ou la disposition expresse de la loi rend imprescriptibles, c’est-à-dire hors d’état de pouvoir s’acquérir ou de pouvoir se perdre par la prescription; et au premier rang se trouvent en général celles qui sont hors du commerce.
Nous disons que les choses hors du commerce sont au premier rang des choses imprescriptibles: c’est assez dire qu’elles ne sont pas les seules. Il existe, en effet, des choses imprescriptibles quoiqu’elles soient dans le commerce; il n’y a point corrélation, comme on le croit quelquefois, entre le caractère d’aliénabilité ou d’inaliénabilité et celui de prescriptibilité ou d’imprescriptibilité : telles choses qui sont inaliénables peuvent être prescriptibles, et réciproquement celles qui sont aliénables peuvent être imprescriptibles. M. Mourlon se trompe donc gravement, quand, après avoir dit que l’inaliénabilité d’un bien n’a pas pour corrélatif son imprescriptibilité (ce qui est très-vrai), il ajoute que «l’aliénabilité des biens, au contraire, a toujours pour corrélatif nécessaire leur prescriptibilité, de sorte que tout bien qui est aliénable est prescriptible (p. 9).» C’est une erreur: si l’inaliénabilité n’entraîne pas forcément l’imprescriptibilité, comme on le voit pour les immeubles dotaux, qui sont prescriptibles après la séparation de biens, quoiqu’ils soient toujours inaliénables tant que le mariage dure (art. 1561), l’aliénabilité réciproquement n’entraîne pas non plus la prescriptibilité ; car, sans parler des biens des mineurs et des interdits qui sont imprescriptibles tant que dure l’interdiction ou la minorité (art. 2252), quoique pendant tout ce temps ils soient dans le commerce et parfaitement aliénables (en sorte qu’ils sont précisément, ce que n’a pas remarqué M. Mourlon, dans le cas inverse des biens dotaux), on sait d’ailleurs que les servitudes qui ne sont point en même temps continues et apparentes ne peuvent pas non plus s’acquérir par prescription (art. 691), quoiqu’elles ne soient nullement aliénables et hors du commerce. Ainsi, non-seulement la seconde proposition, celle que nie si explicitement M. Mourlon, est tout aussi exacte que la première avec laquelle il la met en opposition, mais il est même vrai de dire qu’elle est d’une exactitude plus profonde. Car si l’on voit coexister la prescriptibilité avec l’inaliénabilité (pour les biens dotaux), ce n’est du moins que momentanément en considération de la personne à qui les choses appartiennent, non pour ces choses elles-mêmes, et on peut encore dire que le caractère d’inaliénabilité et de mise hors du commerce n’est d’ailleurs pas complet, puisqu’on peut encore dans bien des cas aliéner un immeuble dotal (art. 1555, 1556 et 1558), tandis que la coexistence de l’aliénabilité avec l’imprescriptibilité, si elle se rencontre de même dans des cas où elle n’est admise que momentanément et en considération de l’état des personnes, se rencontre en outre dans d’autres où elle est perpétuelle et inhérente aux choses elles-mêmes! On pourrait, en ne tenant pas compte de ce qui n’est qu’accidentel, écarter la première proposition et dire avec vérité que les choses qui sont complètement hors du commerce (en elles-mêmes et pour elles-mêmes) sont dès lors imprescriptibles (et telle est précisément la disposition de notre article); mais on ne peut pas écarter la seconde, et l’ancienne règle: Alienabile, ergò prescriptible, est devenue absolument fausse depuis que le Code a restreint la prescriptibilité des servitudes.
II. — Au-premier rang des choses qui sont hors du commerce et imprescriptibles, se trouve la liberté de l’homme, et on reconnaît imprescriptibles aussi (sinon inaliénables, car elles n’ont pas toutes ce dernier caractère) les diverses facultés par lesquelles cette liberté s’exerce. Ainsi, je suis bien libre de planter ou de bâtir sur mon terrain ou de le laisser en culture, comme je suis libre de me marier ou de rester célibataire, et si je laisse ce terrain nu pendant trente années et plus, cette circonstance ne fera pas naître au profit de mes voisins le droit de s’opposer aux constructions ou plantations que j’y voudrais faire plus tard. Quand il ne s’agit que d’un droit proprement dit, droit de servitude de créance ou autre, ce droit peut s’éteindre, soit par le simple non-usage, soit par l’exercice qu’un autre en fait à ma place; mais ici, pour répéter, après M. Troplong, un mot fameux de M. Royer-Collard, c’est plus qu’un droit, c’est une faculté ; c’est un pouvoir qui d’une part ne saurait se perdre par le non-usage, parce qu’il est précisément de sa nature de rester en réserve pour s’exercer à l’occasion selon les éventualités de la vie, et qui d’autre part ne peut pas davantage, par la force même des choses, être exercé par un tiers à ma place; c’est un pouvoir plus grand et plus élevé que le droit, qui n’a jamais besoin, comme lui, du secours d’une action pour fonctionner, et qui s’exerce immédiatement et directement par un fait de l’agent, ce qui a fait dire que la faculté est de fait et non de droit, facti non juris, en ce sens qu’elle ne suppose pas un droit et une action propre et particulière qui préexistent (Dunod, p. 86). Je pourrai donc laisser sommeiller ma faculté tant et aussi longtemps qu’il me plaira, sans jamais avoir à craindre qu’on la prétende éteinte par la prescription; car elle est imprescriptible.
M. Troplong, qui développe parfaitement et longuement cette idée si juste (nos 112 et suiv.), y ajoute bientôt une précision, ou plutôt une contradiction, qu’on s’étonne de trouver là. Le savant, magistrat enseigne (n° 113) que si mon voisin, dont la maison de campagne jouit d’une belle vue par-dessus mes terres, s’imagine un beau matin de me signifier une défense de ne jamais bâtir sur ces mêmes terres, parce qu’une construction gênerait son point de vue; à partir de ce moment, ma faculté de bâtir sera prescriptible et se prescrira, de sorte que si, au lieu de résister à la défense par des actes contraires, je reste trente années sans bâtir, je n’aurai plus le droit de bâtir ensuite! Il invoque à l’appui de cette solution (mais bien à tort, hâtons-nous de le dire) Despeisses, Dunod et M. Pardessus.
Qui ne voit combien cette doctrine est inacceptable? qui ne voit que la défense du voisin m’étant faite sans aucun fondement, ni réel ni même prétendu, sans l’ombre d’un droit de sa part, j’ai dès lors pu et dû la regarder comme une mauvaise plaisanterie ou un acte de folie dont je n’avais aucun compte à tenir; que cet acte étant souverainement ridicule et insignifiant, les choses sont restées après lui ce qu’elles étaient avant, en sorte que trente, quarante, cinquante années d’inaction ne m’empêcheront pas d’user de ma faculté de bâtir quand il me conviendra de le faire? Sans doute il en serait autrement si (parce que la prohibition du voisin serait basée sur un droit au moins apparent, ou à raison de quelque autre circonstance particulière) le silence du propriétaire qui a reçu la défense constituait un acquiescement à la prohibition. C’est ce que suppose Despeisses, quand il nous parle d’un propriétaire qui, «déférant à cette prohibition, ne s’est pas servi de la faculté durant trente ans.» Mais quand on suppose purement et simplement, comme M. Troplong, un fou qui me défend de bâtir sur ma terre uniquement parce qu’il lui plaît de me le défendre, il est en vérité bien clair que je ne suis pas tenu de perdre mon temps à lui répondre, et qu’il n’y a rien dès lors à induire de mon silence. C’est précisément ce qu’enseigne M. Pardessus, que M. Troplong n’a pu invoquer ici que pour l’avoir mal lu, et qui, quoique présentant une hypothèse beaucoup plus favorable que celle du savant magistrat, nous dit que le silence de trente années ne peut néanmoins faire présumer la volonté, parce que «celui qui a reçu la signification dont il s’agit a pu n’en tenir aucun compte (t. II, n° 276).» Dunod, à son tour, n’est pas plus favorable; car il explique seulement, à l’endroit cité par M. Troplong, «que la faculté, qui est imprescriptible, tandis qu’elle
«conserve sa nature, devient prescriptible quand on l’assujettit à une
«convention, parce qu’alors elle est dénaturée et changée en un droit
«formé et particulier (p. 89-90).» Or où est ici la convention qui transforme ma faculté de bâtir en un simple droit de bâtir, désormais prescriptible par trente ans? Il est bien clair qu’il n’y en a pas, puisque, d’une part, aucune convention n’a eu lieu entre mon voisin et moi, et que si, d’autre part, on s’imaginait, par impossible, de voir une convention dans les faits indiqués, cette convention, bien loin de m’attribuer le droit de bâtir, consisterait au contraire en une promesse à moi demandée et par moi consentie de ne pas bâtir, d’où la conséquence qu’il ne serait besoin ni de trente années ni de dix années, ni d’une année pour que le voisin pût s’opposer à toute construction que je voudrais faire: il pourrait, du moment qu’une telle convention serait reconnue exister, s’y opposer aussi bien après quelques mois ou quelques jours qu’après trente ans. La solution de M. Troplong est donc bien une doctrine, et disons franchement une erreur, à lui personnelle; et nous sommes convaincu que le savant magistrat lui-même, si jamais il recevait une signification de ce genre, oublierait ce qu’il a écrit sur ce point et n’aurait pas d’autre idée que de rire d’une pareille pièce, sans songer à la prendre au sérieux.
III. — Sont hors du commerce et imprescriptibles comme n’étant pas susceptibles de propriété privée et ne pouvant apparteuir qu’à la nation, au domaine public de l’État, les fleuves et autres rivières navigables, ainsi que les rivages de la mer. (Quant à la mer elle-même, elle n’est pas même susceptible d’appartenir à un peuple, sa nature résiste à toute appropriation même publique, et elle reste nécessairement chose nullius et commune à tous les hommes.)
Toullier (III-479) enseigne que si les rivages de la mer et autres choses publiques ne peuvent pas s’acquérir par prescription, elles peuvent du moins, par ce moyen, être grevées de servitudes, et que dès lors une possession suffisante pourrait faire acquérir à des individus le droit d’avoir des moulins sur une rivière navigable, ou des pêcheries et prises d’eau sur les rivages de la mer. Nous pensons comme M. Troplong (n° 150) que cette idée n’est pas exacte. Du moment qu’une chose est hors du commerce, elle n’est susceptible d’aucun droit privé ; et puisqu’elle répugne par sa nature à subir le droit de propriété, elle répugne donc par cela même à subir tout droit qui serait un démembrement de cette propriété : toute chose insusceptible du droit de propriété est par là même insusceptible des droits réels d’usufruit, d’usage et de servitudes quelconques qui sont de la même nature et du même ordre que le premier. Que ceci n’ait pas été compris autrefois, c’est tout simple: dans un ordre de choses où l’on ne savait pas même distinguer le droit public et le droit privé, où l’un et l’autre étaient tellement confondus et identifiés que le droit de propriété embrassait tout, à ce point que le propriétaire territorial d’une localité (dominus, le seigneur) avait à ce titre sur les hommes et les choses de cette localité, tous les droits possibles, le droit de justice, par exemple, et partant celui d’avoir ses greffiers à lui, ses huissiers à lui, ses notaires à lui; dans un système où l’idée du pouvoir public, conçu rationnellement et comme indépendant de la puissance privée qui convient seule aux particuliers, a mis huit cents ans à se dégager lentement et péniblement ; dans un tel système on ne pouvait pas trouver étrange de reconnaître un droit de servitude à un particulier sur une chose publique. Mais aujourd’hui, sous les principes rationnels de notre législation moderne, il en est autrement; par là même, encore une fois, qu’une chose est insusceptible du droit de propriété, elle est par là même insusceptible d’un droit de servitude; et les possessions du genre de celles qui nous occupent ne peuvent plus être regardées que comme maintenues par tolérance, non comme reposant sur un droit positif et vigoureux.
L’art. 538, en mettant les grandes rivières et les rivages de la mer au rang des choses qui font partie du domaine public et ne sont pas susceptibles de propriété privée, y met aussi les lais ou relais de la mer; mais c’est à tort. Ces lais ou relais, en effet, c’est-à-dire les terrains que la mer laisse définitivement à découvert après les avoir occupés plus ou moins longtemps, sont, comme tous autres terrains, susceptibles de propriété privée; ils tombent dans le domaine privé de l’Etat, avec les prés, bois, forêts et autres biens ordinaires qui le composent, et la preuve s’en trouve dans l’art. 41 de la loi du 16 septembre 1807, qui permet de les aliéner sans loi spéciale. Ces terrains, qui n’ont aucune destination publique, et ne servent à l’État que par les revenus qu’ils lui donnent, sont donc des biens ordinaires, susceptibles dès lors de se prescrire conformément à l’art. 2227 .
IV. — Sont également hors du commerce et imprescriptibles: 1° toutes les voies publiques, routes, rues, places et promenades, appartenant soit à l’État, soit aux départements, soit aux communes; 2° les havres, rades et ports; 3° les forteresses, remparts, fossés et autres parties des fortifications des places de guerre; 4° les églises, cimetières et monuments publics quelconques, même ceux qui ne sont qu’un objet de pure curiosité, comme la tour Saint-Jacques, de Paris, et la maison carrée, de Nîmes. On sait, en effet, que les départements et les communes ont, comme l’État, un domaine public avec leur domaine privé, qu’ils ont, comme l’État, des choses publiques, et du moment qu’un objet est chose publique, il est par cela même imprescriptible, peu importe à qui il appartient, puisque ce caractère le rend insusceptible de propriété privée.
Les différentes choses dont nous parlons en ce moment ont ceci de particulier, qu’elles peuvent cesser d’être choses publiques et devenir choses privées, biens ordinaires: une église peut cesser d’être destinée à l’exercice du culte et devenir un magasin ou un atelier; une place de guerre peut être démantelée et voir ses fortifications démolies ou abandonnées; un chemin public peut être abandonné et devenir un terrain ordinaire. Dans ce cas, il est clair que ces choses deviennent susceptibles de prescription, comme le reconnaît la fin de l’art. 541.
Mais que faut-il pour que la chose publique cesse d’être telle? suffit-il qu’en fait elle soit depuis longtemps détournée de sa destination, ou faut-il qu’un acte de l’autorité soit intervenu à cet égard? La généralité des auteurs a fait à cette question une réponse qui, malgré la contradiction de M. Troplong, nous paraît parfaitement juridique. Si c’est par un acte de l’autorité que l’objet a été mis au rang des choses publiques, il n’en peut sortir que par l’acte usité dans ce but; mais si, au contraire, il n’a été chose publique que par l’usage que le public en a fait, sans aucune consécration officielle, le simple usage contraire, c’est-à-dire le fait même de l’abandon peut lui enlever cette qualité. Ainsi, comme une place de guerre ne peut jamais être telle que par une déclaration de l’autorité, et que toutes les places de guerre, sans exception, sont officiellement classées, l’une d’elles ne pourra perdre ce caractère que quand une décision du’ gouvernement le lui enlèvera (L. des 8-10 juill. 1791, art. 1 et 4). Pour les chemins publics, au contraire, comme il en est qui n’ont jamais été classés (il y en avait beaucoup autrefois et il y en a peu aujourd’hui; mais il en existe certainement encore), ceux qui l’ont été ne pourront perdre leur caractère que par un acte de déclassement, les autres le perdront par le seul fait d’un non-usage suffisamment prolongé.
M. Troplong, qui reconnaît la justesse de cette doctrine quant aux places de guerre (n° 174), la repousse pour les chemins (n° 163) et veut que tout chemin, sans distinction et qu’il soit ou non classé, puisse se dénaturer et devenir prescriptible par le simple non-usage. Or n’est-ce pas là une erreur et une contradiction? si le classement officiel doit produire son effet quant aux places de guerre, pourquoi ne le produirait-il pas quant aux chemins? M. Troplong nous dit que cette différence tient à ce que les places de guerre sont toutes classées, tandis que les chemins ne le sont pas tous. Mais qu’importe ceci? De ce que les chemins ne sont pas tous classés, il s’ensuit très-bien que tous n’auront pas besoin d’être déclassés; niais pour ceux qui le sont, la circonstance que certains autres ne le sont pas ne saurait certes empêcher les premiers de recevoir l’effet du classement dont ils ont été l’objet. En un mot, quand un chemin n’est pas classé, il n’est chemin que par l’usage que le public en fait, et du moment que cet usage cesse absolument, sa nature de chemin cesse par là même; mais quand le chemin est tel par déclaration de l’autorité, le non-usage ne saurait changer sa nature, c’est alors un chemin dont on n’use pas, mais c’est toujours un chemin, et il ne peut perdre sa qualité que par une déclaration contraire à celle qui la lui a donnée .
Du moment qu’un chemin, classé ou non, a été l’objet d’un arrêté de déclassement, il devient à l’instant un terrain ordinaire, prescriptible comme tout autre, et trente années de possession le feront acquérir. Mais quand il n’y a eu ni classement ni déclassement du chemin, combien faudra-t-il d’années de non-usage par le public et de possession par le particulier pour le faire acquérir à celui-ci? M. Troplong, qui, bien entendu, applique ici à tous les chemins, même à ceux qui sont classés, la question que nous posons seulement pour les non-classés (puisque pour lui le classement d’un chemin est une chose qui ne signifie rien), enseigne (n° 163) qu’il faudra toujours, et nécessairement, deux délais successifs: un premier, qui selon les cas pourrait n’être que de vingt ans, mais qui pourrait aussi s’étendre à quarante ou cinquante, pour transformer la chose publique en chose privée, par le non-usage du public; puis un second, qui ne peut commencer que quand le premier est accompli et qui sera invariablement de trente ans, pour faire acquérir le terrain au particulier au moyen de la possession de celui-ci. D’après le savant magistrat, il est impossible que la même période serve tout à la fois à transformer la chose publique en chose privée et à la faire acquérir au possesseur: c’est impossible, puisque la chose étant imprescriptible tant qu’elle n’a pas cessé d’être publique, c’est inutilement qu’elle est alors possédée par le particulier, dont la possession ne commence à être utile que quand la chose a cessé d’être publique... Nous ne saurions adopter cette idée, et nous pensons avec M. Vazeille que la possession privative, pendant trente ans, d’un chemin non classé, suffit pour produire le double effet de transformer ce chemin en chose privée et de l’attribuer en propriété au possesseur; nous pensons que les deux effets se produisent simultanément et cumulativement sous l’influence de cette possession trentenaire. Lorsqu’un chemin, en effet, n’est pas classé comme tel, il n’est chemin, il n’est une chose publique, que par l’usage même que le public en fait, que par le fait du passage des habitants; en sorte que, du moment que cesse complètement et rigoureusement cet usage du public, ce passage des habitants, à l’instant même le terrain cesse d’être chemin. Sans doute la cessation du fait de passer, et dès lors la cessation de la nature de chemin public, peut, selon les cas, n’être que provisoire et momentanée, ou devenir définitive par sa prolongation, en sorte que, dans les premiers temps, on ne sait pas encore quel sera le résultat; mais quand, en fin de compte, cette cessation absolue et rigoureuse de tout passage aura duré trente années consécutives, il sera bien manifeste que ce terrain, qui encore une fois n’était chemin que par le fait du passage, et qui a cessé de l’être par l’absence de ce fait, a cessé de l’être dès le commencement des trente années, puisque c’est dès ce commencement qu’on a complètement et définitivement cessé d’y passer. Lors donc qu’un particulier s’empare d’un chemin non classé, qu’il le possède rigoureusement comme chose sienne (par exemple en le fermant par des clôtures qui le réunissent à son terrain et ne laissent plus passer personne), et que cet état de choses se continue paisiblement pendant trente ans, ce particulier devient propriétaire de cet ancien chemin. D’une part, en effet, cet ancien chemin, d’après ce qui vient d’être dit, a cessé d’être chemin depuis trente ans et se trouve, par le résultat définitif, avoir été prescriptible depuis lors; et, d’autre part, il a été depuis ce temps possédé avec toutes les conditions voulues pour prescrire... Il en serait autrement, d’après l’explication donnée ci-dessus, si ce chemin était classé et qu’il n’y eût pas eu déclassement.
Disons en terminant que pour les choses publiques dont nous venons de parler dans ce n° IV, comme pour celles du n° III, l’acquisition d’un droit de servitude n’est pas possible. Sans doute les particuliers pourront exercer des droits sur ces choses, et ceux, par exemple, qui ont leurs propriétés sur des routes, rues, places ou promenades publiques pourront percer sur elles des sorties ou y prendre des vues; car ce n’est pas là s’attribuer une servitude sur la chose, c’est, au contraire, s’en servir précisément selon sa destination. Mais quant à des servitudes véritables, comme serait celle oneris ferendi qu’un propriétaire voisin s’arrogerait sur une église ou autre édifice public, elles ne sauraient s’acquérir par la possession, si prolongée qu’elle fût. M. Troplong (n° 173) en croit l’acquisition possible quand il s’agit d’une église qui n’est pas un édifice monumental, une œuvre d’art; mais cette idée ne saurait être, admise, car le Code ne fait pas cette distinction pour déclarer les choses publiques imprescriptibles. Sans doute les droits de cette sorte qui ont pu être acquis avant le Code devraient être respectés et on ne. pourrait en dégrever un monument que par expropriation pour cause d’utilité publique et moyennant indemnité. Mais depuis que les choses publiques sont nettement reconnues imprescriptibles par la législation, de pareilles servitudes ne peuvent plus s’acquérir, parce que, comme nous l’avons dit au n° III, une chose insusceptible de propriété privée est insusceptible de tout droit de servitude parlà même, et que dire qu’une chose est imprescriptible, c’est dire que la prescription ne peut avoir aucune action sur elle .
V. — Si toutes les choses publiques, soit de l’État, soit des communes elles-mêmes, sont imprescriptibles, nous avons dit qu’elles ne le sont pas seules, et nous aurons notamment à nous occuper plus loin de l’imprescriptibilité des biens des mineurs, des interdits et des femmes dotales. Mais réciproquement il ne faut pas croire que toutes les choses appartenant à l’État ou aux communes soient imprescriptibles: ce sont seulement celles qui composent leur domaine public; et quant à celles qui constituent leur domaine privé, lesquelles ne sont que des biens ordinaires, bois, prés, vignes, terres arables, etc., elles sont prescriptibles d’après les mêmes règles que les biens des particuliers; et vice versâ, l’État et les communes peuvent également invoquer ces mêmes règles, établies à leur profit comme contre eux. Il en est de même de tous établissements publics.
Il n’en était pas ainsi dans notre ancien droit. L’État, les communes et les établissements publics, soit laïcs, soit religieux surtout, y jouissaient de priviléges que le droit intermédiaire est venu amoindrir et que notre Code supprime complétement.
Autrefois les biens formant le domaine de l’État étaient inaliénables et imprescriptibles, en vertu de diverses lois dont la principale était la fameuse ordonnance de Moulins de février 1566. Ce caractère d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, si étrange qu’il puisse paraître aujourd’ hui, était parfaitement raisonnable alors; il était même une véritable nécessité, dans l’intérêt des peuples, en présence de la puissance absolue des rois et de l’avidité des courtisans; èt sur ce point comme sur beaucoup d’autres du régime féodal (si décrié, mais si peu étudié, ainsi qu’il en a été depuis de l’époque révolutionnaire), ce serait fort mal juger, que de juger d’après nos idées et nos mœurs modernes. — Lors de la révolution et après la suppression de l’état de choses qui rendait désormais inutiles ces anciennes précautions, la loi du 22 novembre 1790, en laissant subsister l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité de ceux des biens domaniaux que les rois avaient précédemment concédés nonobstant la prohibition, disposa qu’à l’avenir les biens de l’État pourraient être aliénés en vertu d’une loi (art. 8) et qu’ils seraient prescriptibles par quarante ans; plus tard, une loi du 14 ventôse an VII (14 mars 1799) permit aux détenteurs de biens domaniaux d’en devenir propriétaires en payant le quart de leur valeur; puis le Code, allant plus loin, mit tous les biens de l’État, par notre art. 2227, sur la même ligne, quant à la prescription, que les biens des propriétaires; et comme cette disposition ne devait mettre à l’abri ceux de ces détenteurs qui n’avaient pas juste titre et bonne foi (de manière à pouvoir prescrire par dix à vingt ans) qu’au bout de trente années de la publication du Code, c’est-à-dire en 1834, la restauration crut utile d’abréger ce délai de quelques années encore, et une dernière loi, du 20 mars 1820, déclara que la prescription serait acquise et les détenteurs mis à l’abri de toute recherche du Trésor, après trente ans de la promulgation de la loi de l’an VII, c’est-à-dire le 14 mars 1829. — La combinaison de ces lois de l’an VII et de 1820 avec notre art. 2227 a fait naître une difficulté que la jurisprudence a sagement résolue. L’administration des domaines prétendait que l’art. 2227 ne concernait nullement les domaines qui avaient été engagés autrefois sous l’empire de l’inaliénabilité des biens de l’État, que ces domaines n’étaient régis que par les lois de l’an VII et de 1820, et que par conséquent il n’y avait pas lieu, par un possesseur (pour échapper aux recherches plus tôt encore que par le bénéfice de la loi de 1820) d’invoquer d’après le droit commun la prescription de dix ou vingt ans, en se fondant sur le juste titre et la bonne foi qui avaient pu accompagner l’acquisition par lui faite d’un précédent engagiste (art. 2227 et 2265). Mais cette prétention, admise d’abord par la cour de Colmar (18 mars 1830), a bientôt été condamnée par tous les arrêts, et avec raison, puisque l’art. 2227 porte une règle générale et absolue qui, non-seulement par ses termes, mais aussi et surtout par la nature même de la loi dont il fait partie, place tous les biens privés de l’État, complètement et sans distinction, au même rang que les biens des particuliers. Remarquons, en effet, qu’il ne s’agit pas ici d’une loi ordinaire spéciale, comme celle de 1790, mais de la loi générale, de notre système complet de législation civile, du Code enfin, qui dès lors ne s’applique pas seulement à tels biens de l’État, mais à tous les biens de l’État sans exception ni restriction, et par conséquent aux domaines engagés comme aux autres .
Quant aux communes et aux divers établissements publics, leurs biens étaient aliénables, mais ils jouissaient presque partout d’avantages privilégiés pour la prescription. Au lieu de trente ans, leur prescription (sauf quelques provinces dans lesquelles on leur appliquait le droit commun) ne s’accomplissait que par quarante. Quelques-unes même des corporations religieuses ne subissaient que la prescription centenaire. Bien plus, le fameux ordre de Malte prétendait à l’imprescriptibilité, et si quelques parlements la lui refusaient, pour le restreindre à la prescription de cent ans, elle lui était reconnue par d’autres, notamment par ceux de Paris et de Toulouse, ainsi que par le grand conseil du roi ( Voir Merlin, Rép., v° Prescript.).
Aujourd’hui la règle est la même pour tous les biens privés, sans aucune exception ni distinction, quel que soit leur propriétaire. Qu’ils appartiennent à des particuliers, à des communes, à des hospices, à des fabriques, à des établissements publics quelconques, soit laïcs, soit religieux, ou enfin à l’État lui-même, les règles seront toujours celles qui vont être exposées ci-dessous, et la prescription la plus longue (et toujours applicable à défaut d’une plus courte) ne sera jamais que celle de trente ans.