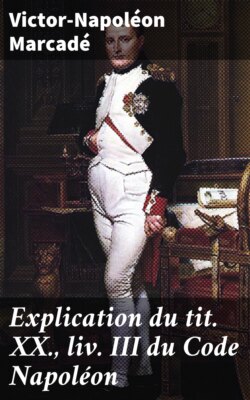Читать книгу Explication du tit. XX., liv. III du Code Napoléon - Victor-Napoléon Marcadé - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
§ 2. — Des renonciations à la Prescription.
ОглавлениеTable des matières
2220. — On ne peut d’avance renoncer à la prescription; on peut renoncer à la prescription acquise.
2221. — La renonciation à la prescription est expresse ou tacite; la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis.
2222. — Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.
SOMMAIRE.
I. Pourquoi les renonciations anticipées sont-elles nulles? Erreur de M. Vazeille. — Quid de celles qui portent sur une prescription accomplie ou en voie de s’accomplir. — La nullité ne concerne pas les prescriptions purement conventionnelles.
II. Au cas de prescription acquisitive, les renonciations anticipées, nulles comme telles, n’en sont pas moins efficaces généralement, en ce que, contenant la reconnaissance du droit actuel et futur du propriétaire, elles entachent de précarité la possession ultérieure du renonçant. Réfutation de la doctrine contraire.
III. Il en peut être autrement à raison de circonstances particulières. Exemple. — Mais, dans ce cas même, la renonciation rend impossible pour la possession ultérieure le caractère de bonne foi. Observation importante.
IV. On peut renoncer à la péremption d’instance comme à toute autre prescription. — On peut renoncer de même à toute espèce de déchéances; mais la renonciation ne peut avoir effet que quant à l’intérêt privé ; elle ne saurait notamment rendre possible un appel que la loi déclare non recevable. Erreur de Merlin; langage inexact de M. Troplong.
V. La renonciation est expresse ou tacite. — La reconciation expresse peut être écrite ou verbale: inexactitude de MM. Duranton, Troplong et Taulier. — La renonciation tacite résulte de circonstances dont l’appréciation appartient aux juges du fait: critique d’arrêts de la cour de cassation et de la doctrine de M. Troplong.
VI. Des protestations. La théorie s’y réduit toujours à une simple appréciation de fait. Vice et danger de la transformation de questions de fait en questions de principes. Critique d’une doctrine de M. Troplong.
VII. La renonciation à la prescription échue n’opère, par elle-même, aucun changement dans le droit. Il en serait autrement de la renonciation à la prescription déjà consommée.
VIII. Il faut être capable d’aliéner pour pouvoir renoncer à la prescription. Les tuteurs peuvent renoncer pour les mineurs ou interdits au moyen des formalités requises pour l’aliénation. Critique de la doctrine contraire de M. Troplong.
I. — Il n’est pas permis de renoncer d’avance à une prescription future; mais on peut très-bien renoncer, soit expressément, soit tacitement, à une prescription actuellement acquise.
Toute renonciation à une prescription qui n’est pas accomplie est nulle et non avenue. Ce n’est pas, comme l’a dit à tort M. Vazeille (I, n° 332), parce qu’il est défendu de renoncer à un droit non encore ouvert; car, au contraire, tous droits non encore ouverts, et plus généralement toutes choses futures, peuvent, aux termes de l’art. 1130, être l’objet de toutes conventions et stipulations. Le motif de cette prohibition est, comme l’avait très-bien expliqué Bartole et comme le dit d’après lui M. Troplong: «qu’il y a dans la renonciation anticipée à la prescription quelque chose qui trouble le bien public, qui encourage la faute ou l’incurie, et déroge à une loi d’utilité générale.» Si d’ailleurs la loi n’avait pas pris cette sage précaution, les renonciations anticipées seraient devenues de style dans tous les contrats (car il n’est pas un seul débiteur qui osât se refuser à l’insertion d’une clause qui paraît si naturelle et si équitable); et dès lors la prescription, qui est, comme on l’a vu, l’un des plus fermes appuis de la société, n’eût plus été qu’un vain mot et un principe sans vie.
On peut très-bien, au contraire, renoncera une prescription accomplie, parce que ce n’est plus là qu’une question d’intérêt privé, et que la renonciation alors, loin d’être imposée par la dépendance où se trouve un futur débiteur, n’est plus qu’un acte de conscience et de délicatesse parfaitement libre, et auquel la société ne peut que gagner.
Quant à la renonciation faite à une prescription en cours de s’accomplir, son effet est réglé par la combinaison des deux principes ci-dessus. Cette prescription, en effet, étant chose acquise pour la portion accomplie, et encore future pour celle qui reste à courir, la renonciation sera donc valable pour la première et nulle pour la seconde. La renonciation, en d’autres termes, sera dans ce cas une interruption de la prescription (voy. art. 2248), en sorte que la prescription est effacée pour le passé, mais recommence immédiatement à courir.
Disons enfin, comme M. Troplong (n° 44), que la renonciation anticipée n’étant proscrite que comme dérogation à une loi d’utilité générale et d’ordre public, la nullité n’est édictée dès lors que pour les prescriptions légales et non pour celle qui serait purement conventionnelle. Si, par exemple, il avait été convenu, dans une vente à réméré, que le délai du rachat serait de deux ans, au lieu de cinq que la loi accorde (art. 1660), l’acheteur pourrait très-bien, dès le lendemain, renoncer à cette prescription conventionnelle de deux années et y substituer celle de cinq que la loi autorise.
II. — La nullité des renonciations anticipées ne régit pas seulement la prescription libératoire; elle régit de même, en principe, la prescription acquisitive, puisqu’elle est édictée par le Code d’une manière absolue et comme l’une des dispositions générales de notre matière. Mais elle est bien loin, en fait, d’avoir pour celle-ci la même portée que pour la première; et ses cas d’application, que tous les jurisconsultes s’accordent à reconnaître ici fort rares, y sont encore plus rares que quelques-uns ne le pensent, à cause d’un second principe qui vient alors s’ajouter au premier, et qui rend parfaitement efficace, par une autre voie, l’acte qui serait nul en tant que renonciation. Ce second principe, dont des professeurs mêmes de la faculté de Paris, si du moins on en juge par les répétitions écrites de M. Mourlon, paraissent n’avoir pas saisi les conséquences, doit fixer ici notre attention.
M. Mourlon, qui présente son livre comme résumant les leçons de l’école de Paris, commence ici (Presc., p. 13) par dire, et avec grande raison, que les cas d’application de notre règle de nullité, à la prescription acquisitive, sont assez rares; après quoi il ajoute qu’on peut néanmoins en citer quelques-uns, et il en indique deux. Or ces deux prétendus exemples portent à faux l’un et l’autre, et la doctrine dont M. Mourlon s’est fait ici l’écho, est profondément inexacte.
1° Dans le premier exemple, on suppose que, propriétaire d’un terrain voisin de votre héritage, je vous permets d’ouvrir des jours d’aspect sur ce terrain, mais en exigeant de vous un titre qui constate mon droit et par lequel vous reconnaissez ne pouvoir acquérir la servitude par prescription. Or on décide que ce titre est frappé d’impuissance par le principe qui déclare nulle toute renonciation au droit de prescrire, et qu’après trente ans de silence de ma part la prescription vous serait néanmoins acquise...Une telle règle serait bien désastreuse, si elle était vraie. Quoi de plus commun, en effet, et de plus utile en même temps, que l’hypothèse ici prévue? Vous construisez contre un mien terrain sur lequel des jours d’aspect ne me gênent pas quant à présent, vu la nature actuelle de ce terrain: je serai tout disposé, si j’ai le moyen d’empêcher rétablissement de la servitude et de me réserver de faire condamner vos jours quand ce me sera utile, à vous laisser jouir de ces jours jusque-là, et pendant vingt ans, quarante ans, cent ans peut-être. Je pourrai de même vous donner sous cette condition, soit un droit de conduite d’eau à travers mon terrain, soit tel ou tel autre droit fort avantageux pour vous sans être nuisible pour moi, et qui, malgré sa révocabilité, durera peut-être toujours, parce que je n’aurai jamais besoin de le révoquer. Mais si, au contraire, la prescription doit courir nonobstant l’acte que je me ferai donner par vous, quelle gêne, quelles entraves, quelle rigueur ne devront pas être apportées dans les relations du voisinage?... Et en ne considérant même que le passé, quel effet calamiteux ne produirait pas une telle doctrine, si les tribunaux s’avisaient de l’appliquer? Quelle masse de propriétaires se trouveraient dépouillés de droits qu’ils croient parfaitement saufs, et qui seraient dès longtemps éteints par prescription, si l’article 2220 avait ici la portée qu’on lui prête!... Il n’en est rien heureusement, et le genre d’acte que l’on prétend ici nul, est, au contraire, pleinement efficace.
L’art. 2220, en effet, ne prohibe et n’avait à prohiber que la renonciation au droit de prescrire; or l’acte dont il s’agit contient tout autre chose qu’une telle renonciation... Quand vous venez solliciter de moi la permission, par moi révocable, d’ouvrir ou de conserver des jours auxquels vous n’avez pas droit, et que (soit gratuitement, soit à la charge de me payer une somme de... pour chaque année de jouissance) je vous accorde cette permission, n’est-il pas clair que la jouissance de ces fenêtres ne sera pas exercée par vous animo domini et jure proprio, mais jure alieno; que vous ne l’aurez pas comme chose à vous propre et venant de vous, mais au contraire et précisément par le seul effet et par l’exécution même de la concession que je vous ai consentie; n’est-il pas évident que pour ces fenêtres, à la différence de ce qui a lieu pour le reste de votre héritage, vous ne jouirez pas et ne posséderez pas en conséquence et par la vertu de votre pleine et propre maîtrise de la chose, mais comme étant, quant à ce, investi du droit d’un autre? Or, puisqu’il en est ainsi, puisqu’en face du titre émané de vous pour nier votre droit et contester le mien, votre possession ne peut pas vis-à-vis de moi constituer de votre part une prétention de maîtrise et d’indépendance mais n’existe au contraire que comme effet de votre qualité de concessionnaire révocable à toujours, cette possession est donc une possession précaire, qui, dès lors, ne peut jamais, et par quelque laps de temps que ce soit, vous conduire à la prescription, d’après les dispositions des art. 2236 et 2240. Selon que vous payez ou ne payez pas l’avantage que je vous procure, vous êtes, pour la jouissance des jours, ce que sont, pour la jouissance de ma maison, soit le locataire à qui je la loue, soit la personne à qui je permets de s’y loger gratuitement... Ainsi donc, ce n’est pas du tout parce que l’acte émané de vous contient une renonciation au droit de prescrire, que vous ne prescrirez pas (car la renonciation, comme telle, est parfaitement insignifiante); c’est parce que cet acte établit un état de choses imprimant à votre possession un caractère qui la rend impropre à engendrer jamais la prescription. C’est aussi ce qu’enseigne très-bien M. Duranton, incidemment, il est vrai, mais très-nettement toutefois (XXI-116).
2° Le second exemple est celui d’un possesseur d’immeuble qui, frappé ou menacé par moi, véritable propriétaire, d’une action en revendication, me donne, pour éviter une condamnation et être maintenu en jouissance, un acte par lequel il renonce à se prétendre désormais propriétaire et à jamais m’opposer la prescription. On décide encore, dans les leçons reproduites par M. Mourlon, que cet acte étant nul comme renonciation au droit de prescrire, la prescription dès lors, simplement interrompue, c’est-à-dire effacée pour le passé, recommence immédiatement à courir, et sera dûment acquise après trente ans à partir de cet acte. Or, qui ne voit combien ces idées sont inexactes, combien est fausse cette appréciation de l’acte intervenu? Qui ne voit que cet acte, loin de n’être de votre part qu’une pure renonciation au droit de prescrire, est véritablement, et de la manière la plus manifeste, une reconnaissance et de mon droit de propriété et aussi de la concession que je vous fais, en ma qualité de propriétaire, de la jouissance de la chose? Or, si c’est moi qui, à titre de propriétaire, vous mets ou maintiens en possession de l’immeuble, il est donc bien clair que vous ne le possédez que précairement, et ne pourrez dès lors pas le prescrire.
Ce qui a causé ici l’erreur que nous signalons, c’est que presque toujours les actes dont il s’agit, émanés de personnes peu familières avec les principes rigoureux du droit, sont faits sous la forme d’une simple renonciation au droit de prescrire, et que les jurisconsultes dont nous combattons la doctrine n’ont pas su écarter cette forme pour examiner le fonds, qui contient, comme nous l’avons dit, toute autre chose que cette renonciation.
L’acte, disons-nous, alors même qu’il est ainsi fait sous le nom et la forme d’une pure renonciation, est autre chose qu’une renonciation; et il est facile de le démontrer d’une manière rigoureuse et qui réfute nettement le raisonnement de M. Mourlon. Que suppose-t-on en effet? On suppose que sous le coup d’une revendication de l’immeuble que vous êtes en voie de prescrire, vous offrez et donnez au propriétaire, non pas seulement pour arrêter ou prévenir ses poursuites, mais aussi pour obtenir de lui qu’il vous laisse en jouissance du bien, un écrit par lequel vous déclarez renoncer et à la prescription partiellement acquise et aussi à la prescription à acquérir ultérieurement. Nous disons que votre acte (et c’est là ce que n’ont remarqué ni M. Mourlon ni le professeur dont il adopte le système) tend au maintien ultérieur de votre possession, aussi bien qu’à la cessation des poursuites, et que votre soi-disant renonciation porte sur la prescription à venir, aussi bien que sur la prescription partiellement acquise. C’est évident, puisque l’hypothèse nous est précisément donnée comme exemple d’une renonciation faite au milieu même de la prescription à laquelle elle s’applique, de telle sorte qu’il faut diviser, dit-on, cette prescription en deux parties, pour l’une desquelles la renonciation est valable, tandis qu’on la prétend nulle pour l’autre. Remarquez bien, en effet, que si la renonciation n’était faite par vous que pour le passé, elle serait, pour son objet entier, parfaitement valable, et on ne pourrait plus dès lors la présenter comme l’un de ces cas rares où s’applique, à la prescription acquisitive, le principe des renonciations nulles... Il est donc bien entendu qu’il s’agit de l’avenir, et que l’offre et la remise que vous me faites de l’écrit en question ne sont et ne peuvent être, quelle que soit la formule de cet écrit, rien autre chose qu’une demande que vous m’adressez, en ma qualité de propriétaire par vous reconnu, de vous laisser en possession ultérieure du bien, au moyen de l’acte qui doit, dans notre commune pensée, empêcher cette possession ultérieure de briser jamais mon droit de propriété. Or, si c’est là le sens et la signification de votre acte (et il n’en peut pas avoir d’autre), ne devient-il pas palpable que votre possession postérieure à l’acte, et qui n’a que l’effet de la permission par vous demandée au propriétaire et à vous accordée par ce propriétaire, n’est qu’une possession précaire, et pour laquelle dès lors il est impossible de parler jamais de prescription? Puisque la seule possession utile pour prescrire est celle qui a son principe dans le fait, sinon réel, du moins prétendu, de la maîtrise et pleine indépendance du possesseur, tandis que votre possession à vous, loin de s’être basée sur la moindre prétention de maîtrise, a été par vous mendiée près du propriétaire, dont vous vous êtes empressé de reconnaître le droit pour qu’il la tolérât, comment voulez-vous donc parler de prescription?
Et que devient, en présence de ces précisions, le raisonnement de M. Mourlon? A ces deux idées, que, d’une part, renoncer au droit de prescrire contre un propriétaire, c’est reconnaître son droit de propriété, et que, d’autre part, reconnaître son droit, c’est se constituer vis-à-vis de lui possesseur précaire, M. Mourlon répond que si la première est évidente, la seconde est fausse. Un possesseur, dit-il, peut très-bien, en reconnaissant à tel instant le droit d’un propriétaire, et en effaçant ainsi l’effet de la possession antérieure, recommencer dès l’instant suivant à posséder à titre de maître... M. Mourlon oublie toujours que dans la reconnaissance en question, il s’agit de l’avenir, et non pas seulement du présent et du passé. Sans doute quand le possesseur de l’immeuble qui m’appartient, renonçant seulement à la prescription accomplie, ne reconnaît ainsi que mon droit actuel, rien ne l’empêche de commencer dès l’instant suivant à posséder en maître et de manière à contredire et à détruire pour l’avenir le droit qu’il n’a reconnu et promis de respecter que pour le passé ; mais lorsque ce possesseur, comme dans notre espèce, renonçant aussi à toute prescription future, reconnaît ainsi mon droit pour l’avenir comme pour le présent, il est clair qu’il ne pourra plus, vis-à-vis de moi, expliquer sa possession ultérieure par l’existence, chez lui, d’un prétendu droit de propriété qu’il a reconnu ne pouvoir jamais être que chez moi. Quand l’acte émané du possesseur reconnaît seulement que j’étais propriétaire en 1850, il ne saurait sans doute entacher de précarité la possession de 1851 et années suivantes; mais quand cet acte de 1850 proclame que je continuerai d’être propriétaire à toujours et reconnaît que le signataire tiendra de moi sa possession ultérieure, il est bien clair que cette possession ultérieure ne pourra plus s’expliquer, envers moi, par le droit de propriété du possesseur, et qu’elle s’exercera, de la manière la plus évidente, precariò ab adversario... En un mot, la question de savoir si celui-là peut posséder ultérieurement à titre de maître, qui a reconnu mon droit de propriétaire, se résout par une distinction: il est évident qu’il le peut, s’il s’est borné à reconnaître mon droit actuel; mais il est évident qu’il ne le peut pas, s’il a reconnu mon droit ultérieur, puisque, par là, lui-même amis et reconnu mettre dans ce droit de son adversaire, le principe de sa possession à venir.
Il est donc bien certain que, dans la prescription acquisitive, l’acte qui se présente de la part d’un possesseur comme une simple renonciation à la prescription future ( et qui serait nul s’il était vraiment tel) n’a point, au fond et en réalité, du moins dans les circonstances ordinaires, ce caractère de simple renonciation, mais constitue une reconnaissance, par le possesseur, du droit du propriétaire et de la précarité de la possession du premier, reconnaissance qui est pleinement efficace et empêchera de prescrire, parce qu’une possession non précaire est indispensable pour acquérir par prescription. C’est, au surplus, ce que déclare nettement l’exposé même des motifs de notre titre. Après y avoir indiqué les raisons d’ordre public qui font proscrire les renonciations à prescription future et les avoir appliquées au cas de prescription libératoire, l’orateur du gouvernement passe à la prescription acquisitive, et fait voir que l’acte analogue y sera valable, parce qu’il ne sera plus une renonciation. «S’il a été convenu, dit-il, que a l’un possédera le fonds de l’autre sans pouvoir le prescrire, ce n’est
«point de la part du premier une simple renonciation à la prescription;
« c’est une reconnaissance qu’il ne possédera point à titre de propriétaire;
« or nul autre que celui qui possède à ce titre ne peut
«prescrire.» (Fenet, t. XV, p. 577.)
Nous devions insister d’autant plus sur ces idées que, malgré leur importance doctrinale et pratique, elles ne sont expliquées, à notre connaissance du moins, par aucun auteur, pas même dans le commentaire, si développé cependant, de M. Troplong.
III. — Il ne faudrait pas conclure de ce qui précède qu’une pure et vraie renonciation à la prescription future soit chose impossible, et qui ne pût jamais se présenter, en cas de prescription acquisitive. Cette renonciation sera sans doute extrêmement rare, aussi rare qu’elle serait fréquente pour la prescription libératoire si la loi ne l’avait pas prohibée;.mais enfin, elle pourrait se présenter dans certaines circonstances particulières, et elle serait, bien entendu, frappée de nullité par l’art. 2220.
Ainsi, par exemple, supposons qu’un possesseur, après avoir envoyé au propriétaire de l’immeuble une lettre dans laquelle il déclare renoncer à toute prescription future et lui demande d’être maintenu par lui en possession, reçoive une réponse qui refuse de tolérer plus longtemps sa présence et lui enjoint de déguerpir immédiatement, après quoi le propriétaire meurt, tombe en démence ou se trouve autrement empêché de donner suite à son injonction. Si, en pareil cas, le possesseur continue de jouir de l’immeuble pendant trente années et avec les autres conditions requises par la loi, la prescription s’accomplira, et nous aurons ainsi un cas d’application de l’art. 2220 à la prescription acquisitive.
D’une part, en effet, la concession de jouissance précaire que sollicitait le détenteur du bien n’ayant pas été accordée, ni expressément, ni tacitement, mais ayant été, au contraire, formellement refusée, ce n’est donc pas en vertu de cette concession que le possesseur a continué de jouir, mais de son autorité propre; et sa possession dès lors, dépouillée du caractère de précarité par la lettre du propriétaire, a pu engendrer la prescription. D’un autre côté, il est bien vrai que la renonciation à toute prescription future, que contenait la lettre du possesseur, subsiste toujours comme renonciation, nonobstant le refus du propriétaire d’obtempérer à la demande qui l’accompagnait; mais cette renonciation n’étant plus ici rien autre chose qu’une renonciation, elle est par conséquent nulle, comme portant sur une prescription future. Sans doute, si le propriétaire avait favorablement répondu à la demande du possesseur ou qu’il eût seulement gardé le silence, lequel silence eût été considéré tout naturellement comme un acquiescement tacite, la renonciation aurait été efficace, elle eût été d’année en année, aux mains du propriétaire et de ses représentants, la preuve de son droit, la négation de celui du possesseur et la constatation de la possession purement précaire de celui-ci: elle aurait eu ce caractère, alors même qu’elle n’eût pas été accompagnée de la demande formelle du maintien en possession, demande qui eût été tacitement comprise et sous-entendue dans la renonciation elle-même; mais le refus du propriétaire, de fermer la convention d’où devait résulter la possession précaire, ne permet plus à la renonciation de conserver cette signification habituelle et ordinaire. Cette renonciation n’est plus, sous ce rapport, que la preuve d’une offre qui n’a point été acceptée, d’un projet qui ne s’est point réalisé ; et elle demeure ainsi avec son caractère de pure et vraie renonciation, frappée dès lors de nullité par l’art. 2220.
Du reste, si la renonciation se trouve ici sans valeur et comme renonciation et aussi comme constitution de précaire, elle ne l’est pas comme reconnaissance du droit actuel du propriétaire, et elle produit, sous ce rapport, non pas seulement l’interruption de la prescription qui pouvait courir précédemment, mais aussi un autre effet portant sur la prescription nouvelle qui recommence. Cet effet consiste en ce que, quand même le possesseur, avant sa renonciation, aurait eu titre et bonne foi, et eût pu, dès lors, prescrire par dix à vingt années (art. 2265), la prescription nouvelle ne pourra s’accomplir que par trente ans. Le possesseur, en effet, en déclarant qu’il renonçait à prescrire, a dépouillé sa possession ultérieure du caractère de bonne foi, puisque la bonne foi est la croyance qu’on a d’être propriétaire, et que celui-là prouve qu’il ne se croit pas propriétaire de la chose, qui parle de l’acquérir par la prescription .
Terminons par une observation importante. Nous avons dit que nos explications de ces nos II et III ne s’appliquent qu’aux renonciations à prescription future, et que s’il s’agissait seulement de renonciations à la prescription acquise, l’acte, qui dans ce cas serait toujours valable, n’empêcherait pas une prescription nouvelle de recommencer immédiatement. Il n’en serait autrement, et la nouvelle prescription ne serait impossible ici, qu’autant que quelque circonstance particulière emporterait, de la part du renonçant, la reconnaissance de la précarité de sa possession ultérieure. Les deux cas sont ainsi le contre-pied l’un de l’autre: dans le premier, la prescription nouvelle est impossible en général, et ne devient possible qu’à raison de circonstances exceptionnelles; dans le second, au contraire, elle reste généralement possible, et des circonstances particulières peuvent seules l’empêcher. Cela étant, il est donc important de ne jamais confondre ces deux classes d’actes. Or il pourra souvent arriver qu’une renonciation soit formulée de telle façon qu’on ne voie pas clairement si elle est faite pour le passé seulement ou pour l’avenir. Dans ce cas, ce serait aux juges du fait à décider par les circonstances quel est le sens de l’acte, et s’il appartient à l’une ou à l’autre catégorie. Mais dans le doute et à défaut d’indices contraires, c’est, comme l’enseigne M. Duranton (n° 118), à l’aide d’une simple renonciation à la prescription acquise, qu’il faudrait s’arrêter, puisque le principe qui défend de présumer une renonciation, défend aussi, et par là même, d’en présumér l’extension.
IV. — Le principe qui permet de renoncer à la prescription acquise s’applique incontestablement à la péremption d’instance, puisqu’elle est une véritable prescription. Tout le monde est d’accord à cet égard; mais on ne l’est pas sur le point de savoir s’il en est de même pour les déchéances et notamment pour la déchéance du droit d’appel. Scaccia (De appellat., quest. 12, n° 101) incline à l’efficacité de la renonciation, M. Favard de Langlade en fait autant (v° Appel) et Merlin admet formellement cette efficacité (Rép. v° Appel) après avoir d’abord soutenu la thèse opposée. Au contraire, Balde, Salicet, Mysingerus et M. Troplong (1-51) tiennent pour l’inefficacité d’une pareille renonciation.
Cette dernière solution est seule exacte; et le désaccord des auteurs, ainsi que les incertitudes et les variations de Merlin, viennent ici d’une confusion qu’il fallait éviter, du défaut d’une distinction, assez délicate, il est vrai, mais exacte cependant et nécessaire à faire. — On dit, dans le sens de la dernière opinion de Merlin, qu’en définitive la déchéance accomplie du droit d’appel n’est rien autre chose pour l’intimé qu’une prescription acquise, et que puisque la prescription est acquise, celui-ci peut dès lors y renoncer valablement, et ne pourra plus, après sa renonciation, s’opposer à l’appel de son adversaire. Il est vrai, ajoute-t-on, que l’expiration du délai d’appel a transformé le jugement du premier ressort en jugement de dernier ressort et lui a donné force de chose jugée; mais ceci est indifférent, puisqu’on peut renoncer au bénéfice de la chose jugée comme à tout autre droit.
Ces prémisses sont exactes en elles-mêmes; mais la conclusion qu’on en veut tirer est fausse; elle repose sur une confusion de ce qui touche au droit privé avec ce qui touche au droit public et à l’organisation des pouvoirs. Sans doute, celui qui a gagné en première instance peut renoncer, en ce qui le concerne, au bénéfice résultant pour lui de la déchéance de son adversaire; il peut, si vous le voulez, renoncer au droit d’opposer la déchéance et se mettre dans l’impossibilité d’empêcher l’appel. Mais de ce qu’il ne pourra pas, lui, quant à son intérêt personnel et privé, empêcher cet appel, s’ensuit-il que l’appel sera possible et qu’il ne devra pas être écarté par la cour que l’on voudrait en saisir? Est-ce qu’il n’y a pas ici, à côté de la question de droit privé, la question de droit public, d’ordre public, de compétence matérielle? est-ce que l’incompétence ratione materiæ peut être changée par la volonté des citoyens? est-ce qu’il dépend de vous d’arriver, soit par votre silence, soit par une déclaration formelle de consentement, à faire juger par une cour d’assises une question de droit civil, ou seulement à faire juger par une cour d’appel une question jugée en dernier ressort par le tribunal de première instance?... Je puis très-bien, par exemple, après avoir obtenu contre vous un jugement qui vous condamne à me payer 1000 fr. que vous prétendiez ne pas me devoir, renoncer, en tout ou partie, au bénéfice de ce jugement, soit en reconnaissant que le jugement s’est trompé et que les 1000 fr. ne me sont pas dus, soit en remettant le débat en question pour le faire juger par des arbitres, soit en modifiant le dispositif de ce jugement d’une façon ou d’une autre; mais je ne puis pas faire que ce jugement que nous pouvons soumettre à la révision d’arbitres, soit soumis à la révision de la cour d’appel, laquelle, malgré tous consentements par moi passés à cet égard, devra déclarer l’appel non recevable, attendu qu’il s’agit de moins de 1500 fr... Il en est de même après l’expiration des délais, et la cour devra déclarer aussi l’appel non recevable, attendu que le jugement est signifié depuis plus de trois mois, ce qui n’empêcherait pas de revenir d’une façon ou de l’autre sur ce jugement et notamment, si l’on veut, en le remettant en question devant des arbitres.
Ainsi donc, nous ne disons pas, comme le fait M. Troplong, dont les termes nous paraissent impropres (quoique ses idées soient fort exactes), que la partie ne peut renoncer à la déchéance et qu’il y a ici exception au principe qui permet de renoncer aux prescriptions acquises; nous disons qu’une partie peut renoncer à toutes déchéances accomplies à son profit, mais que sa renonciation, toujours obligatoire et efficace pour tout ce qui sera question d’intérêt privé se discutant entre les deux adversaires, ne peut avoir aucune influence sur ce qui est d’ordre public, et ne saurait dès lors rendre recevable un appel que la loi déclare impossible.
V. — Dans tous les cas où la renonciation à la prescription est possible, c’est-à-dire quand il s’agit d’une prescription acquise, cette renonciation peut se faire expressément ou tacitement.
La renonciation expresse n’est pas seulement, comme le disent MM. Duranton (XXI-119), Troplong (1-52) et Taulier (XII, p. 444), celle qui résulte de la déclaration explicite contenue dans un acte faisant preuve de son contenu, mais bien celle qui résulte de toute déclaration soit écrite, soit purement verbale. La doctrine de ces auteurs ferait croire que, pour la prescription, la preuve est soumise à des règles particulières et ne peut se faire que par écrit, tandis qu’il n’en est rien. Les moyens de preuve sont ici les mêmes que partout ailleurs; et toute déclaration faite de l’abandon du droit sera dès lors efficace, non-seulement 1° quand elle sera formellement consignée dans un acte; mais aussi 2° quand elle sera avouée par son auteur; 3° quand, déniée par lui, elle sera prouvée par témoins avec simple commencement de preuve par écrit; 4° enfin, quand elle sera constatée même par simple témoignage s’il ne s’agit pas de plus de 150 fr. (art. 1341 et 1345).
Quant à la renonciation tacite, elle résulte, d’après le texte de la loi, comme d’après la raison, de tout fait qui suppose l’abandon du droit acquis. Et pour ce qui est de savoir quels faits et circonstances sont de nature à manifester ou faire raisonnablement supposer cet abandon du droit, c’est un point que les magistrats apprécieront en fait dans chaque espèce particulière. Sans doute il est des cas où le droit n’est pas possible. Ainsi, quand celui qu’on prétend débiteur a payé, soit un à-compte sur la dette, soit les intérêts ou arrérages; quand il a fourni une hypothèque, une caution ou autre garantie; quand il a opposé des compensations, réclamé des diminutions ou demandé des termes de payement, il est clair qu’il y a renonciation tacite, puisque chacun de ces faits est récognitif du droit du créancier et par conséquent exclusif de l’idée d’être libéré par la prescription. De même si un possesseur avait pris à bail ou offert de prendre à ce titre le fonds dont il prétend ensuite avoir été dès lors propriétaire par prescription, s’il avait acheté ou offert d’acheter un droit de vue, de passage ou autre servitude sur ce fonds, la renonciation tacite serait bien manifeste. Mais si l’on peut ainsi présenter quelques exemples, on conçoit qu’il est impossible de donner ou même de tenter une nomenclature complète, et que l’appréciation des circonstances diverses n’est plus l’œuvre de la doctrine, mais celle des juges du fait, qui auront à rechercher dans chaque affaire si le fait dont on veut induire la renonciation indique bien chez son auteur la pensée qu’il est débiteur (s’ils’agit de la prescription libératoire) ou qu’il n’est pas propriétaire (s’il s’agit de prescription acquisitive).
Un arrêt de la Cour de cassation, mais fort ancien déjà et dont cette Cour n’admettrait peut-être pas le principe aujourd’hui, quoiqu’il soit approuvé par M. Troplong, contredit cette idée que l’appréciation du fait appartient exclusivement aux tribunaux et cours d’appel; il veut qu’elle appartienne également à la cour suprême. La cour d’appel de Paris avait vu l’abandon de la prescription dans le fait, de la part du débiteur prétendu, d’avoir défendu à l’action par une production de pièces de laquelle il entendait faire résulter qu’il ne devait rien; et la cour suprême a cassé cette décision par un arrêt du 19 avril 1815, que M. Troplong (n° 56, alin. 5 et 9) approuve pleinement. La cour et M. Troplong disent que ce n’est pas renoncer à la prescription que de soutenir ne rien devoir, puisque la prescription est précisément une des causes sur lesquelles on peut se fonder pour dire qu’on ne doit rien, et le savant magistrat nous dit en outre que quand le juge du fait admet une renonciation là où elle n’existe pas, le Cour de cassation peut casser sa décision comme violant la loi. Or nous ne saurions admettre ces idées.
Remarquons d’abord que le défendeur à l’arrêt de Paris n’avait pas dit purement et absolument, comme le supposent la Cour de cassation et M. Troplong, qu’il ne devait rien, mais qu’il ne devait rien d’après les pièces par lui produites; il avait soutenu que l’absence d’obligation résultait pour lui de l’état de ces pièces. Or n’était-il pas très-possible que les pièces dont il argumentait, que le système de défense qu’il basait sur elles fût exclusif de l’idée de prescription et inconciliable avec elle?... Mais en admettant que la Cour de Paris se fût trompée et eût considéré comme contenant la renonciation tacite un fait qui réellement ne la contenait pas, serait-ce donc une violation de la loi? La négative nous paraît évidente. Le Code n’ayant pas indiqué (et il ne devait ni ne pouvait le faire) les caractères par lesquels le fait supposera l’abandon du droit, le jugement qui se trompera sur ces caractères ne sera donc qu’un mal jugé, et non pas une violation des règles du Code, puisque là-dessus le Code ne contient pas de règles. La seule et unique règle légale est celle-ci: «Il y a renonciation tacite, quand il existe un fait supposant l’abandon du droit.» Quant à savoir quand et comment le fait supposera l’abandon du droit, ce n’est plus la loi qui le dit, c’est le bon sens et la raison. Cela étant, il est donc manifeste que, quand le juge aura vu l’abandon dans un fait où une intelligence plus sagace aurait vu qu’il n’est pas, ce juge aura violé le bon sens et la raison, mais il n’aura pas violé la loi. Le juge ne viole jamais la loi, du moment que, pour écarter la prescription, il se fonde, à tort ou à raison, sur ce qu’il existe un fait supposant l’abandon du droit, puisque c’est là tout ce que la loi lui demande. — On objecterait en vain que, dans plusieurs cas, la Cour suprême peut et doit casser pour cette fausse appréciation des caractères du fait; par exemple, quand une cour d’appel déclare vente un contrat qui constitue réellement un louage, ou si elle a vu les caractères de tel délit dans un fait où ils n’étaient réellement pas. Nous avons nous-mêmes obtenu dans nos derniers mois d’exercice devant la Cour suprême, et nettement approuvé dans la Revue critique (t. II, p. 211), la cassation d’un arrêt de Rouen qui avait déclaré constitutif du délit d’escroquerie des faits qui ne le constituaient pas... L’objection serait sans valeur, attendu que, dans les cas dont il s’agit, c’est le texte même de la loi qui précise les caractères du contrat ou du délit; de sorte que le jugement qui s’en écarte contient une contradiction à des règles écrites dans le Code, une violation de la loi. Ici, au contraire, la loi n’indique que la nécessité d’un fait supposant l’abandon; et du moment dès lors que le juge aura constaté l’existence de ce fait supposant l’abandon, la saine et juste appréciation des choses pourra bien être blessée, mais la loi sera respectée.
Aussi M. Troplong lui-même, dans un autre endroit de son commentaire (n° 70, al. 5), admet-il des idées qui, sans qu’il l’ait remarqué sans doute, sont en contradiction avec celles que nous venons de combattre. Le savant magistrat, en parlant des rejets prononcés par la Cour de cassation pour des arrêts d’appel qui avaient nié la renonciation dans des cas où elle était manifeste, ne critique que les motifs (fort mauvais en effet) du rejet, et non pas le rejet lui-même; il dit que la Cour aurait dû rejeter purement et simplement et en se fondant sur ce seul motif qu’il n’y a pas violation de la loi. Or s’il en est ainsi, s’il n’y a pas violation de la loi, mais simple mal jugé dans la décision de fait qui contient ainsi la plus fausse appréciation des caractères constitutifs de l’abandon, c’est donc que cette appréciation est bien, comme nous le disons, une simple question de fait, du domaine souverain des tribunaux; et si M. Troplong est ici dans le vrai, il était donc dans le faux au n° 56.
Au surplus, si M. Troplong est en effet dans le vrai quand il finit ainsi par reconnaître qu’il n’y a pas là de violation de la loi, il y est parfaitement aussi quand il déclare profondément fausses les idées sur lesquelles la chambre des requêtes s’est quelquefois basée pour rejeter les pourvois formés en cette matière, notamment dans son arrêt du 15 décembre 1829 (nos 56 et 68). La chambre des requêtes, allant ici plus loin que le jugement même qui était attaqué devant elle et voulant faire un arrêt de principe non une simple solution d’espèce, est arrivée à la plus grave hérésie, en posant cette prétendue règle, que la renonciation ne peut pas s’établir par des inductions et qu’elle ne peut se prouver que par des aveux, affirmations ou consentements. Non-seulement cette incroyable doctrine n’est qu’un contre-sens, puisque, comme le fait très-bien remarquer M. Troplong (n° 56), dire que la renonciation résultera de faits QUI SUPPOSENT l’abandon du droit, c’est précisément faire appel à l’induction (une chose supposée étant précisément celle qui n’est admise que par l’induction tirée d’une autre chose, connue par elle-même); mais elle est de plus, ce que M. Troplong n’a pas dit (et ne pouvait pas dire, s’il avait sur la renonciation verbale l’idée fausse que nous avons signalée plus haut), la suppression de notre art. 2221, puisque dire qu’il faut des consentements, affirmations ou aveux, c’est dire qu’il faut une renonciation exprimée et rejeter ainsi la renonciation tacite! On ne saurait donc être plus malheureux que ne l’a été ici la chambre des requêtes: et son erreur est d’autant plus étonnante que, condamnée déjà comme on le voit par l’art. 2221, elle l’est encore une seconde fois un peu plus loin par l’art. 2224, qui nous parle des cas où la partie, D’APRÈS LES CIRCONSTANCES, doit ÊTRE PRÉSUMÉE avoir renoncé à la prescription. Il s’agit donc bien d’inductions et présomptions.
VI. — Nous ne croyons pas nécessaire d’insister ici sur cette idée, qui nous paraît assez simple pour qu’il suffise de l’indiquer sommairement, que le juge, dans son appréciation des faits dont on veut induire une renonciation tacite, doit évidemment tenir compte des protestations, réserves ou explications quelconques dont ils ont pu être accompagnés. Ainsi, par exemple, il est clair que si, en payant une partie de la somme que l’on prétend due par moi, j’ai eu soin de déclarer que je ne me reconnais débiteur que pour la partie que je paye, il sera bien impossible de voir là le payement d’un à-compte emportant renonciation à la prescription pour la totalité de la dette prétendue. Nos anciens docteurs avaient écrit sur les protestations de longues et subtiles dissertations; mais il nous semble, malgré le sentiment contraire de M. Troplong (n° 58), que non-seulement leurs mille subdivisions, mais encore leurs divisions principales peuvent être suffisamment remplacées, et peut-être même avec avantage, par cette simple règle de bon sens: que, le juge devant se décider par l’ensemble des circonstances de chaque affaire, et les protestations ou déclarations quelconques dont un fait est accompagné étant une des circonstances considérables, le juge doit donc peser et apprécier celles-ci comme toutes autres.
Nous disons que ce principe si simple nous paraît non-seulement suffisant, mais encore préférable aux nombreuses règles, tant principales que de détail, imaginées ici par les scolastiques. Nous pensons, en effet, qu’il est souvent dangereux, dans un livre de doctrine, de vouloir ainsi réglementer à l’avance, par de prétendus principes généraux, ces mille faits divers dont la variété échappe nécessairement à toute généralisation, et nous en trouvons un exemple dans la critique adressée par M. Troplong à un arrêt de Bordeaux, que le savant magistrat s’efforce de transformer en arrêt de principe, tandis qu’il n’est évidemment qu’un arrêt d’espèce. Voici cette espèce:
Le sieur Paupin jouissait depuis 44 ans d’un terrain contigu à son jardin, terrain dont aucun acte d’acquisition n’a pu être exhibé, mais qui, par le seul fait de ses 44 années de possession, pouvait lui être acquis par prescription. Le sieur Belcastel, voisin de Paupin, et se prétendant le véritable propriétaire de ce terrain, qu’il disait avoir été usurpé sur son auteur par l’auteur de Paupin s’en étant emparé en 1818 et l’ayant entouré d’une clôture pour le réunir au reste de sa propriété, Paupin n’éleva aucune réclamation contre le fait qui s’accomplissait ainsi sous ses yeux, et mourut bientôt après sans avoir rien dit. Après sa mort, ses enfants, qui habitaient avec lui la maison et le jardin contigus au terrain en question, ne réclamèrent pas davantage, et sept années s’écoulèrent sans qu’il y eût, de leur part, ni aucune action, ni même la moindre observation. — Au bout de sept ans, c’est-à-dire en 1825, les enfants Paupin, cédant à des conseils qui étaient venus changer leurs idées personnelles, se déterminèrent à agir et tentèrent une action en revendication. Ils produisirent une prétendue copie (mais copie informe et sans valeur aucune de leur propre aveu) d’un prétendu acte de vente qui aurait été souscrit au profit de leur auteur par l’auteur de Belcastel en 1774, et se fondèrent exclusivement sur ce que, leur père ayant possédé pendant 44 ans le terrain litigieux, ce terrain lui avait été acquis par prescription. — Après un jugement de 1re instance qui débouta les enfants Paupin en se fondant sur un motif manifestement illégal (et dont nous allons parler plus bas), la cour de Bordeaux, sur leur appel et par arrêt du 12 janvier 1828, les débouta de même, mais en écartant le faux motif des premiers juges, et en se fondant sur ce que le moyen de la prescription, le seul qui fût invoqué parles demandeurs, avait été tacitement abandonné par eux, par le fait même du silence absolu qu’ils avaient gardé, tant lors de la prise de possession de Belcastel que pendant les sept années suivantes.
Or tandis que M. Vazeille (I, p. 406) voit dans cette décision l’arrêt de la conscience qui restitue à César ce qui est à César, M. Troplong y voit, au contraire (n° 56), non-seulement une torture imposée à la vérité, mais de plus, le renversement de toute l’économie de la loi sur les prescriptions; en sorte que cet arrêt contient tout à la fois, à ses yeux, et un mal jugé et une profonde violation de la loi. Mais n’est-il pas manifeste que le savant magistrat, voyant à tort des expositions de principes là où il ne peut y avoir que des appréciations de faits, tombe ici dans l’erreur, et que quand même l’arrêt de Bordeaux contiendrait un mal jugé (ce qui n’est rien moins que prouvé), il ne contiendrait toujours pas une violation des règles du Code?
Quant au mal jugé, M. Troplong, qui se plaît à supposer que la pièce informe exhibée par les enfants Paupin était bien la copie réelle et sincère d’un acte de vente également réel, et malheureusement perdu, en tire tout naturellement la conclusion que Paupin avait acheté de l’auteur de Belcastel ou que du moins telle était et devait être la conviction de la famille, conviction fondée sur des documents et des traditions respectables, et qui, donnant à ces enfants la conscience d’un droit certain et loyal, ne permettait pas de voir une renonciation tacite dans le silence momentanément gardé par eux. Mais qui a pu garantir à M. Troplong l’exactitude de cette supposition? Comment vouloir, si loin du débat, en apprécier les mille circonstances et les détails divers, comme les magistrats devant lesquels se discute la question? On peut, à distance, discuter parfaitement des principes, mais non pas saisir sûrement les caractères et les nuances des faits. Qui a dit à M. Troplong que dans cette pièce informe, dont la sincérité supposée fait toute la base de son argumentation, les magistrats de Bordeaux n’avaient pas vu (sans avoir même besoin de s’en expliquer, parce que les demandeurs eux-mêmes ne s’en faisaient pas un titre) une pièce fabriquée après coup pour le besoin d’une position mauvaise?.... D’ailleurs, même en admettant la sincérité de la pièce et la complète conviction, chez la famille Paupin, de son droit loyal et certain, comment M. Troplong expliquera-t-il, autrement que pas une renonciation à faire valoir la prescription, le silence absolu de cette famille lors de la prise de possession de Belcastel et dans les années suivantes? Comment! voilà une famille qui sait n’avoir par de titre (puisqu’elle reconnaît que la seule pièce qu’elle possède n’en est pas un), qui sait que son seul titre, c’est sa possession; et lorsque, en pareil cas, voyant le voisin s’emparer du bien sous ses yeux, elle ne fait aucune opposition, réclamation ni protestation, son silence ne signifierait pas et même ne pourrait pas signifier qu’elle ne veut pas user de la prescription?... Quand celui qu’on dépossède a des titres, on s’explique jusqu’à un certain point son silence et son inaction par cette idée qu’il n’a pas besoin de se presser et qu’il sera toujours à temps, par l’exhibition de ces titres, pour reprendre son bien; on peut dire qu’il est patient et silencieux, parce qu’il se sent fort; mais quand il n’a rien autre chose que sa possession même, comment comprendre qu’il se la laisse enlever, lui présent sur les lieux, sans se récrier, sans protester, sans mot dire, en gardant un silence de deux, quatre, six années et plus, et n’y a-t-il pas alors, pour le juge du fait, non pas nécessité sans doute, mais possibilité, selon les cas et eu égard à l’ensemble des circonstances, d’expliquer son silence par une renonciation à faire valoir la prescription qui pouvait lui être acquise.
Que M. Boyer (Journ. de jurisp. de Bordeaux) et M. Dalloz, en rapportant l’arrêt, aient dit qu’il ne leur paraissait pas devoir faire jurisprudence, c’est tout simple, puisque ce n’est point un arrêt de principe, mais un arrêt d’espèce: la cour de Bordeaux n’a pas jugé que tout possesseur, qui, après avoir joui pendant le temps voulu pour prescrire, se laisse ensuite déposséder, ne peut plus opposer la prescription; elle a seulement jugé que tel possesseur, dans telles circonstances, ne pouvait plus, lui, opposer la prescription, parce qu’il était à considérer, à raison de ces circonstances, comme ayant renoncé à la faire valoir.
Mais en supposant qu’il y eût mal jugé dans cet arrêt de Bordeaux, il ne se peut toujours pas (et c’est là l’erreur de droit que nous tenions à relever dans la doctrine de M, Troplong) qu’il y ait violation de la loi. Cette violation existait dans le jugement de première instance, qui avait décidé que la prescription n’est qu’une exception, laquelle ne peut dès lors s’employer que pour résister à une demande et non pour expulser par voie d’action celui qui possède actuellement. C’est là une erreur profonde. La prescription étant un des modes d’acquérir la propriété, elle peut servir de base à une demande tout aussi bien qu’à une défense; et si l’arrêt avait admis à cet égard la doctrine des premiers juges, la critique de M. Troplong serait parfaitement fondée. Mais la cour de Bordeaux s’en est bien gardée; elle a seulement déclaré qu’il y avait eu de la part de la famille Paupin renonciation tacite à la prescription; et comme c’était là un point de fait, point dont l’appréciation appartenait dès lors souverainement à la cour d’appel, la violation de la loi n’est donc pas possible. En vain le savant magistrat nous dit que si t’arrêt ne consacre pas expressément le système erroné des premiers juges, il l’admet implicitement et sans oser l’avouer, en limitant arbitrairement le délai de l’action qui compète à l’ancien possesseur. «Car, dit-il, le silence du propriétaire dépossédé n’éteint son
«titre que quand il se prolonge pendant le temps requis pour la prescription.
« » Ainsi, M. Troplong voudrait que l’ancien possesseur ne pût jamais être ici déclaré déchu que quand la possession du nouveau se serait prolongée pendant trente ans. Mais c’est encore une erreur, et ce système, qui était celui des enfants Paupin n’est pas plus exact que celui qu’avait présenté Belcastel devant les premiers juges: c’étaient deux extrêmes erronés tous deux; et la dernière proposition de M. Troplong n’est qu’une confusion reposant sur l’oubli d’un principe fondamental en matière de prescription. Ce principe, que nous avons déjà vu le savant magistrat oublier dans certains endroits, après l’avoir formellement reconnu dans d’autres (voir plus haut, art. 2219, n° V), consiste en ce que la prescription n’opère jamais par elle-même et de plein droit, c’est-à-dire par le seul fait de l’expiration du délai, mais seulement quand elle est opposée par celui au profit duquel elle existe.
Dans les contrats translatifs de propriété, c’est à l’instant même où le contrat se forme, et par l’effet immédiat de ce contrat, que la propriété passe de l’une des parties à l’autre; de même dans les successions, c’est à l’instant même de l’ouverture, c’est-à-dire par le fait même du décès, que la propriété passe du défunt à son héritier; mais dans le cas de prescription, au contraire, ce n’est pas par l’échéance des trente années de possession que la propriété passe de l’ancien propriétaire au possesseur, c’est seulement par la déclaration que fait ce possesseur de sa volonté de bénéficier de la prescription. Tandis que les contrats opèrent immédiatement et par eux-mêmes, que la succession également opère immédiatement et par elle-même, la prescription n’opère que quand elle est positivement invoquée par le bénéficiaire. Il suit de là que, quand en 1818 Paupin fut dépossédé par Belcastel, Paupin, malgré sa possession de plus de trente ans, n’était pas encore devenu propriétaire; il était en mesure de le devenir dès qu’il le voudrait et par une simple déclaration de son intention à cet égard (ainsi, une protestation par lui signifiée à Belcastel, soit lors de la prise de possession de celui-ci, soit dans les premiers temps qui la suivirent, et dans laquelle il aurait déclaré que, vu sa possession antérieure de plus de trente ans, il était, à part tout autre titre et par ce fait seul, propriétaire du terrain, une telle protestation lui eût conféré cette qualité de propriétaire); il ne dépendait ainsi que de lui de le devenir, mais encore une fois il ne l’était pas: la propriété, qu’il pouvait d’un mot fixer sur sa tête, reposait encore, et allait continuer de reposer, tant qu’il ne parlerait pas, sur celle de l’ancien propriétaire, qui était Belcastel lui-même. C’est donc bien à tort que M. Troplong, adoptant le système de l’avocat des enfants Paupin, nous dit que Belcastel aurait dû, pour triompher, posséder pendant le temps voulu pour prescrire, c’est-à-dire pour briser le droit de propriété de Paupin; car il n’y avait pas chez Paupin, tant qu’il gardait le silence, de droit de propriété à briser. Et comme avant de rompre ce silence, Paupin et ses héritiers l’ont continué pendant un temps tellement long, que les juges du fait ont pu (et même dû, suivant nous, mais ce n’est plus la question) y voir une renonciation tacite à la prescription, et se sont ainsi rendu impossible tout recours ultérieur, il est manifeste que leur solution (en supposant qu’elle soit un mal jugé, ce que nous ne croyons pas) ne peut pas être une violation de la loi, comme l’enseigne le savant magistrat.
On voit donc qu’il n’est pas seulement inutile, mais dangereux aussi, de vouloir transformer en questions de principes, des points qui ne peuvent être que des questions d’espèce et d’appréciation de faits; et c’est pour cela que nous nous garderons bien de nous jeter, même partiellement, dans l’examen théorique de ce qu’ont pu dire les anciens docteurs sur la matière, toute de fait, des protestations.
VII. — La renonciation à la prescription (en elle-même) n’est jamais, pour celui au profit duquel elle est faite, un titre nouveau; c’est seulement la reconnaissance et le maintien de son titre antérieur, qui avait été sur le point d’être brisé, et qui continue de subsister, en échappant au danger qui le menaçait. Ainsi, lorsque mon débiteur renonce à invoquer contre moi la prescription accomplie de ma créance, il ne faut pas croire que j’aie cessé d’être créancier par l’expiration du délai de la prescription, et que je le sois redevenu par la renonciation; la vérité est que je n’ai jamais cessé d’être créancier: ma créance, qui était menacée d’extinction par l’expiration du délai, continuait cependant toujours de subsister tant que le débiteur ne se prévalait pas du bénéfice à lui offert; et comme, au lieu de se décider à en user, il finit au contraire par y renoncer, ma créance échappe au danger et continue d’être ce qu’elle était. De même, lorsque celui qui a possédé mon immeuble pendant trente ans renonce à en faire valoir la prescription, mon droit de propriété, après avoir été sur le point d’être brisé, demeure intact et continue d’être ce qu’il était auparavant.
Mais si la renonciation n’apporte aucun changement au droit par elle-même, il se pourrait très-bien qu’elle le modifiât en prenant un autre caractère que celui de simple renonciation. Ainsi, par exemple, lorsque, après la prescription échue d’une lettre de change ou d’un billet à ordre, prescription qui s’accomplit par cinq ans, le débiteur passe une renonciation que les juges du fait trouvent n’être pas seulement une renonciation à la faculté de refuser le payement du billet, mais constituer aussi une reconnaissance nouvelle de la dette que ce billet constatait, la créance alors, et par l’effet de cette connaissance, deviendra différente de ce qu’elle était précédemment; ce ne sera plus une dette par lettre de change ou billet à ordre et prescriptible par cinq années, ce sera désormais une dette ordinaire, prescriptible seulement par trente ans. Au contraire, tant qu’il n’y a qu’une simple renonciation à la faculté d’opposer la déchéance du billet, aucune novation ne s’opère; le seul effet produit, c’est que le billet continue d’avoir la même force que si la prescription n’avait jamais couru contre lui, en sorte qu’une prescription nouvelle serait nécessaire pour éteindre la dette; mais cette prescription, puisqu’il s’agit de billet à ordre ou de lettre de change, ne serait toujours que de cinq années et non pas de trente. — C’est aux juges du fait, bien entendu, à décider si l’acte invoqué par le créancier constitue seulement une simple renonciation, ou s’il contient une reconnaissance formant novation et substituant une dette ordinaire à la dette sui generis qui existait d’abord .
Il va sans dire que la renonciation n’a d’effet que contre celui de qui elle émane, ou ses représentants, et non contre les tiers. Ainsi la renonciation faite par un débiteur n’empêchera pas la prescription d’être utilement opposée, soit par ses co-débiteurs solidaires, soit par des cautions ou des tiers détenteurs d’immeubles hypothéqués à la dette. Il va sans dire aussi que la renonciation ne doit pas être étendue au delà des limites dans lesquelles elle a été faite, comme réciproquement elle ne doit pas être restreinte en deçà. Ainsi, on ne devra pas, si elle est conditionnelle, lui donner un effet absolu, ni quand elle est faite au profit d’une seule personne, l’étendre à d’autres; réciproquement, on ne pourra pas, si elle est pure et simple, la soumettre à telle ou telle condition, ni la restreindre au profit de tel des créanciers, quand elle est faite sans distinction et au profit de tous.
Du reste, quand on dit, comme nous l’avons fait, que la renonciation n’opère aucun changement dans le droit et le laisse seulement subsister tel qu’il était, il est évident qu’il ne s’agit que de la renonciation à une prescription qui, bien qu’elle soit acquise par l’échéance du délai, n’est pas du moins consommée par l’invocation qu’en aurait faite le bénéficiaire. Si, en effet, la prescription était une fois consommée, c’est-à-dire si le bénéficiaire s’en était prévalu, il y aurait eu dès lors, au profit de celui-ci, soit extinction de l’obligation, soit translation de la propriété, et la renonciation qu’il ferait ensuite serait par conséquent l’attribution d’un droit nouveau à l’ex-créancier ou ex-propriétaire. La différence entre ces deux cas, de prescription simplement échue et de prescription déjà consommée, ne présentera pas, il est vrai, d’importance pratique pour la prescription libératoire, puisque, la prescription consommée laissant subsister l’obligation naturelle, comme on l’a vu plus haut (art. 2219-IV), la renonciation alors ne sera qu’une consécration civile de cette obligation, et non une création d’obligation. Mais il en serait autrement dans la prescription acquisitive. Car la prescription consommée ayant alors anéanti complètement le droit du précédent propriétaire, la renonciation du possesseur est véritablement une rétrocession opérant translation de propriété, et pour laquelle le fisc serait dès lors fondé à exiger les droits de mutation.
C’est donc avec raison, quoi que dise M. Troplong (n° 75), que Dunod, dans ce cas de prescription acquisitive consommée, exigeait autrefois un titre nouveau, et (pour les choses corporelles) une nouvelle tradition (ch. XIV, part. 1). Sans doute la tradition n’est plus nécessaire aujourd’hui que la propriété se transfère par l’effet immédiat des conventions; mais quant au titre nouveau, on ne saurait le nier, puisqu’ ici, encore une fois, le possesseur est devenu propriétaire du bien, et que la restitution qu’il en fait est dès lors une véritable aliénation de sa part, et une acquisition nouvelle pour l’ex-propriétaire.
Toutes les fois, au surplus, qu’on parle de renonciation à prescription, sans rien ajouter ni autrement préciser, c’est de la renonciation à la prescription simplement échue et non consommée qu’il s’agit. Elle seule, en effet, est vraiment une simple renonciation; l’autre est, en matière réelle, une véritable aliénation.
VIII. — Si la renonciation proprement dite n’est jamais une aliénation, puisque le possesseur la fait avant d’être devenu propriétaire du bien et qu’elle a précisément pour objet de l’empêcher de le devenir, elle est du moins, en fait, pour ce possesseur, l’équivalent d’une aliénation, puisqu’il s’y dépouille de tout droit sur une chose dont il ne tiendrait qu’à lui d’être propriétaire à l’instant même et d’un seul mot. Pour cette raison, la loi ne permet la renonciation qu’à ceux qui peuvent aliéner, et tous ceux qui sont incapables de vendre sont par là même incapables de renoncer à la prescription. Ainsi, ce serait une renonciation nulle que celle qui serait faite par un mineur non émancipé, par un interdit, par une femme mariée non autorisée, par un prodigue non assisté de son conseil judiciaire, par des préfets ou autres administrateurs qui ne seraient pas munis de l’autorisation nécessaire pour l’aliénation des biens de l’État, des communes, des hospices et autres établissements publics; et quant au mineur émancipé, comme il n’a capacité que quant aux revenus, il pourrait bien renoncer utilement à la prescription échue d’intérêts ou d’arrérages, mais non pas à celle du capital ou de la rente.
On est d’accord à cet égard; mais un autre point, qui nous paraît cependant également simple, fait ici difficulté et divise les auteurs. C’est celui de savoir si la renonciation qui ne peut pas être faite par l’interdit et le pupille peut l’être par leur tuteur, muni de l’autorisation qui lui serait nécessaire pour aliéner. Ainsi quand un tuteur renoncera à la prescription d’un immeuble en vertu d’une autorisation donnée par le conseil de famille et homologuée par le tribunal civil sur les conclusions du ministère public (art. 457-458), la renonciation sera-t-elle valable? Pour notre part, nous n’hésitons pas à répondre affirmativement, comme le fait M. Dalloz (ch. I, sect. 1, art. 2, n° 3); mais la négative est enseignée par M. Troplong (nos 80-81), dont la solution et les motifs sont adoptés par M. Taulier (VII, p. 445), et paraîtrait l’être aussi par un ou plusieurs des professeurs de la faculté de Paris, si l’on en juge par les Répétitions de M. Mourlon (p. 15). Malgré cela, nous croyons cette doctrine de M. Troplong inexacte et arbitraire.
Que demande, en effet, la loi pour permettre la renonciation? Elle demande, ni plus ni moins, que celui qui la consent ait capacité pour aliéner le bien. Or le tuteur, quand il est muni d’une autorisation homologuée par le tribunal, ne peut-il pas aliéner les immeubles? s’il peut les aliéner, il peut donc par là même renoncer à leur prescription. On reconnaît que la femme, du moment qu’elle est autorisée par le mari, qu’un préfet pour l’État et un maire pour sa commune, du moment qu’ils y seraient autorisés législativement, comme il est nécessaire pour l’aliénation des biens nationaux ou communaux, peuvent valablement renoncer (Troplong, n° 82), parce qu’ils sont dans le cas où ils peuvent aliéner; mais comment ne voit-on pas que, par cela même, le tuteur est en mesure de renoncer du moment qu’on a fait dans ce but ce qu’il faudrait faire dans le but d’aliéner? comment ne voit-on pas que refuser le droit de renoncer là où le droit d’aliéner existe, c’est aller plus loin que le Code, ajouter à la loi et par conséquent faire de l’arbitraire?
On objecte que la renonciation équivaut, non pas à une aliénation ordinaire, mais à une aliénation gratuite, et que ce genre d’aliénation est absolument interdit au tuteur. Mais on n’a pas pensé à la distinction qui se présente ici tout naturellement. Si la prescription à laquelle il s’agit de renoncer est un moyen de faire valoir un droit qu’il y a lieu de croire fondé, ou du moins qu’on peut supposer raisonnablement tel, alors, il est vrai, la renonciation peut être considérée comme une aliénation gratuite; mais alors aussi on ne trouvera jamais un tuteur, un conseil de famille, un ministère public et un tribunal assez coupables pour demander, accorder et approuver l’autorisation de renoncer. Si, au contraire, le droit qu’il s’agirait de faire valoir par la prescription est manifestement mal fondé, et ne devait être que la consécration d’une criante iniquité, alors, il est vrai, l’autorisation de renoncer pourra bien être donnée et homologuée, mais alors aussi la renonciation serait un acte de justice dont l’inaccomplissement pourrait bien, même pécuniairement, nuire au mineur plus que lui profiter. N’oublions pas, en effet, que, même comme question de spéculation et d’intérêt matériel, l’argent n’est pas tout heureusement; que le défaut de confiance, la déconsidération et les autres conséquences de l’improbité peuvent souvent se traduire en pertes plus grandes que celle qui serait résultée du loyal abandon d’un bien auquel on n’avait pas droit; que la Providence permet beaucoup plus souvent et de plus de manières que ne le pensent certaines gens, la réalisation du vieux proverbe: Bien mal acquis ne profite pas; et que ce sera quelquefois respecter le véritable intérêt du mineur, en même temps que la justice, que de renoncer pour lui à la prescription.
On objecte encore que, la renonciation à la prescription étant une question de délicatesse et une affaire de conscience, elle ne peut dès lors émaner que de la personne intéressée elle-même, non de son représentant; et M. Troplong surtout, insistant fortement sur cette idée, nous dit que cette renonciation n’est plus qu’un jeu, une dérision et une source de dangers, si elle n’est pas rigoureusement personnelle à celui qui acquiert ou se libère, si on le fait homme ultra-délicat par procureur, si on lui impose à son insu l’abnégation chevaleresque d’un chrétien. Mais qui ne voit qu’il y a ici la même méprise et la même exagération que plus haut? Que viennent faire ces idées d’abnégation cheyaleresque et d’homme ultra-délicat, quand on vous dit que la renonciation ne devra pas avoir lieu et n’aura certainement pas lieu, grâce aux conditions requises, s’il y a seulement des doutes sérieux sur l’illégitimité du droit de l’incapable, et qu’elle n’est possible que quand cette illégitimité sera certaine? Sans doute on ne doit jamais imposer à un incapable une abnégation chevaleresque, et nous l’accordons sans peine; mais comment M. Troplong n’accorde-t-il pas aussi, réciproquement, qu’il faut toujours lui épargner un acte de friponnerie? Que M. Troplong se rassure: ces abnégations chevaleresques, qu’il redoute tant, sont malheureusement, dans nos mœurs, peu fréquentes et peu à craindre, et des actes d’improbité le sont assurément beaucoup plus; en tout cas, c’est à ces derniers seulement que notre règle est applicable. Or il est bien évident que, si de purs actes d’abnégation, de sacrifices et de générosité ne peuvent être convenablement accomplis que par les intéressés en personne, il n’en est pas de même de ceux qui nous occupent ici, et que des tiers peuvent apprécier ceux-ci pour autrui, aussi bien que pour eux-mêmes (et quelquefois mieux encore). Des questions de dévouement, de grandeur d’âme, de charité chrétienne, comme en suppose ici M. Troplong, ne peuvent sans doute se résoudre que par les personnes elles-mêmes; mais tout le monde peut résoudre pour tout le monde des questions de justice et de loyauté.