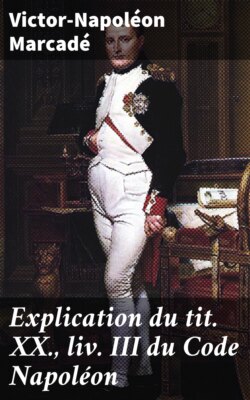Читать книгу Explication du tit. XX., liv. III du Code Napoléon - Victor-Napoléon Marcadé - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
§ 3. — Quand et par qui la Prescription peut être opposée.
ОглавлениеTable des matières
2224. — La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel, à moins que la partie qui n’aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
2225. — Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.
SOMMAIRE.
I. La prescription peut être opposée dans toutes les phases du procès, même après la mise en délibéré ou les conclusions du ministère public; réponse à la doctrine contraire de M. Duranton. Mais elle ne peut plus l’être devant la Cour de cassation.
II. L’art. 2225 n’est que l’application du droit commun: réfutation des systèmes contraires. — La renonciation accomplie peut être annulée quand il y a eu fraude; mais comment la fraude doit-elle ici s’entendre et se prouver?
III. Non-seulement les créanciers proprement dits, mais aussi tous autres intéressés peuvent user de l’art. 2225. Critique des exemples inexacts donnés par M. Troplong. Autres exemples et observations.
I. — La prescription étant un moyen extrême auquel il peut répugner de recourir même à l’appui d’un droit bien légitime (parce qu’il est rare qu’elle ne nuise pas, dans l’opinion publique, à la considération de celui qui s’en sert), moyen qu’un plaideur dès lors ne se décidera souvent à employer que quand il verra ses autres moyens devenir insuffisants par la tournure que prend le débat, la loi devait donc permettre de l’invoquer en tout état de cause et jusqu’au dernier moment, c’est-à-dire tant que la décision définitive n’est pas prononcée. C’est aussi ce que fait notre art. 2224.
Ainsi, celui qui, faute d’invoquer la prescription, a succombé en première instance, pourra l’opposer en appel, puisque ce n’est pas une nouvelle demande (art. 454, C. pr.), mais seulement un nouveau moyen à l’appui de la même prétention; et non-seulement il pourra l’invoquer ainsi pour la première fois au second degré de juridiction, mais il le pourra, pour ce second degré comme pour le premier, en tout état de la cause, tant que le procès dure encore et qu’il n’est pas tranché par le jugement d’appel. Il le pourrait donc, même pour une affaire mise en délibéré, ou après les conclusions du ministère public. Il est vrai que M. Duranton (XXI-135) et un arrêt d’Orléans (du 13 déc. 1822) décident le contraire; mais nous pensons comme M. Troplong (n° 95) que leur idée doit être rejetée. Elle est, suivant nous, contraire et au texte et à l’esprit de la loi: au texte, puisque le Code nous dit de la manière la plus absolue que la prescription peut être opposée en tout état de cause, c’est-à-dire tant que la cause subsiste encore, en quelque état qu’elle soit, et la cause subsiste tant que le jugement n’est pas rendu; à son esprit, puisque jusqu’au dernier moment, aussi bien après qu’avant la mise en délibéré ou les conclusions du ministère public, le plaideur peut sentir la nécessité de recourir à ce moyen extrême, et qu’il est même possible que ce soient précisément les conclusions du ministère public qui lui fassent sentir cette nécessité. Aussi Cujas nous dit-il à cet égard: Præscriptio QUANDOCUNQUE ANTE SENTENTIAM opponi potest; et l’on peut dans le même sens tirer argument de deux arrêts, l’un de la Cour suprême du 7 nov. 1827, l’autre de Nancy du 11 fév. 1833.
Mais si la prescription peut être opposée toujours, à quelque moment que ce soit, devant chacun des deux degrés de juridiction, elle ne peut l’être jamais, au contraire, pas plus au début de l’instance que plus tard, devant la Cour de cassation, dès là qu’elle ne l’a pas été devant les juges du fond. Il ne faut pas oublier, en effet, que la Cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction, qu’elle n’est pas un véritable tribunal, et que la question qui s’agite devant elle, au lieu d’être celle qui se discutait précédemment, est toujours et uniquement celle de savoir si, oui ou non, la décision qu’on attaque a violé la loi. Or comment pourrait-on casser un jugement comme violant la loi, parce qu’il n’applique pas une prescription que n’a pas invoquée le plaideur, alors que la loi défend, au contraire, au juge, et de la manière la plus expresse (art. 2223), d’appliquer la prescription d’office? Sans doute si, par un autre motif, il y a cassation, la prescription pourra fort bien être opposée pour la première fois devant le tribunal de renvoi, puisque devant ce tribunal tout est remis en question et le fond de nouveau discuté, comme devant celui dont on a cassé le jugement; mais devant la Cour suprême, c’est impossible, puisqu’on ne peut pas s’y occuper du fond de l’affaire.
Au reste, il faut évidemment, pour que le plaideur puisse opposer la prescription, qu’il n’ait pas présenté quelque moyen de défense, ou accompli quelque fait (soit pendant le procès, soit avant) qui soient de nature à constituer une renonciation tacite. Il n’est pas besoin d’ajouter qu’une renonciation formelle produirait le même effet, et que si la loi ne parle ici que de celle qui se ferait présumer par les circonstances, c’est par suite de cette idée que souvent les circonstances constitutives de la renonciation tacite se trouveront précisément dans les moyens invoqués, ou dans les actes mêmes de procédure accomplis par le plaideur, qui veut ensuite, mais trop tard, recourir à la prescription.
II. — Le droit d’invoquer la prescription n’est pas un de ceux qui soient exclusivement attachés à la personne; il appartient, au contraire, à tous intéressés, et notamment aux créanciers de celui au profit duquel la prescription est accomplie.
Telle est la disposition de l’art. 2225, disposition sur la portée précise de laquelle le texte a soulevé des difficultés et fait naître plusieurs systèmes. — La plupart des auteurs, notamment M. Troplong (n° 101), M. Duranton (XXI-150) et M. Taulier (VII, p. 447) ne voient dans cet article que l’application du droit commun, c’est-à-dire l’application, faite à notre matière de la prescription, des deux règles générales des art. 1166 et 1167. Dans ce système, tant que celui au profit duquel la prescription est échue ne déclare pas s’il entend l’invoquer ou y renoncer, son créancier peut l’invoquer à sa place, en quoi il ne fait qu’exercer le droit de son débiteur aux termes de l’art. 1166; que si, au contraire, ce débiteur a déclaré renoncer à la prescription, le créancier peut, mais pourvu que la renonciation ait été faite en fraude de ses droits, faire annuler cette renonciation pour s’appliquer le bénéfice de la prescription, conformément à l’art. 1167. La disposition de l’art. 2225 ne serait donc ainsi qu’une application des principes ordinaires. — D’après M. Vazeille (1-352) et M. Dalloz (Presc., p. 243), notre article, au lieu d’être ainsi l’application du droit commun, en serait, au contraire, une restriction, et ne permettrait aux créanciers d’invoquer la prescription échue au profit de leur débiteur qu’autant que celui-ci n’y a pas renoncé. Ces mots de l’article: encore que le débiteur y renonce, signifieraient seulement: encore qu’il néglige de s’en servir, et du moment qu’il y aurait eu renonciation, le créancier ne pourrait plus rien faire. On en donne pour raison que l’usage ou la répudiation de la prescription est une chose de conscience et de for intérieur, qu’on ne peut pas soumettre au contrôle d’un tiers. — D’autres enfin, notamment des professeurs de la faculté de Paris (à en juger par les répétitions de M. Mourlon, p. 19), enseignent que, loin d’être une restriction au droit commun, l’art. 2225 en est une extension et forme une règle à part, indépendante des art. 1166 et 1167, et qui permet aux créanciers et autres intéressés de tenir la renonciation de leur débiteur pour non avenue sans aucune condition de fraude.
De ces trois systèmes, le premier seul nous paraît admissible.
Et d’abord, celui de MM. Vazeille et Dalloz se trouve condamné tout à la fois et par l’esprit et par le texte de notre art. 2225. — Quant à son esprit, s’il était vrai que le législateur ait entendu refuser aux créanciers le droit de critiquer la renonciation de leur débiteur, comme étant un acte de conscience pour lequel on doit lui réserver toute liberté, il leur aurait refusé de même le droit d’user de la prescription en son lieu et place, et contre sa volonté, puisque ce droit porterait la même atteinte à sa liberté de conscience: si vous ne pouvez pas critiquer la renonciation que j’ai faite, parce que ma conscience en est le seul juge, comment pourriez-vous davantage empêcher celle que je veux faire? Évidemment, si le législateur, par le motif qu’on lui prête, avait cru devoir écarter ici l’application de l’art. 1167, il eût écarté de même celle de l’art. 1166. Ce motif, en effet, reviendrait à dire que le droit d’invoquer ou de répudier la prescription est un droit exclusivement attaché à la personne; en sorte que l’art. 1166 serait alors inapplicable d’après ses propres termes. — Le texte de notre art. 2225 n’est pas moins décisif, quand il dit que «les créanciers peuvent op« poser la prescription, encore que le débiteur y renonce,» et c’est vainement que, pour échapper à cette dernière proposition, on prétend la restreindre au simple cas d’un débiteur qui n’invoque pas la prescription, mais qui ne la répudie pas non plus et garde le silence à cet égard. Cette interprétation est doublement malheureuse; car, outre qu’il est par trop libre de traduire un débiteur qui renonce par un débiteur qui ne renonce pas et se contente de garder le silence, cette singulière explication n’aboutirait d’ailleurs qu’à faire de la disposition un contre-bon sens. L’article, en effet, signifierait que les créanciers peuvent opposer la prescription au nom de leur débiteur, même quand celui-ci ne l’oppose pas; or ce même (ou encore que) serait absurde, puisque cette hypothèse d’un débiteur qui n’oppose pas la prescription est précisément la seule dans laquelle ses créanciers puissent l’opposer: le non-exercice d’un droit par le débiteur est évidemment la première condition nécessaire pour que les créanciers puissent l’exercer à sa place! Comment voulez-vous dire qu’un vice-président pourra présider le tribunal, même quand le président ne le fera pas; ou qu’un lieutenant pourra commander la compagnie, même à défaut du capitaine?... Ce système restrictif du droit commun est donc manifestement inacceptable .
Quant au système diamétralement opposé, il est vrai qu’il n’a rien de contraire au texte de la loi, mais nous ne le croyons pas conforme à sa pensée. Comment admettre que le législateur ait été plus favorable aux créanciers et plus rigoureux contre le débiteur pour une renonciation à prescription que pour les donations elles-mêmes? Si cette renonciation est quelquefois faite sans motifs bien graves et presque par générosité, elle n’est quelquefois aussi que l’accomplissement d’un devoir rigoureux; et il est dès lors bien impossible de croire que le législateur ait entendu permettre aux créanciers de la faire annuler absolument et toujours, alors qu’il ne leur permet de faire annuler une donation elle-même que sous la condition de fraude.
C’est donc à la doctrine de MM. Troplong, Duranton et Taulier, qu’il faut ici s’en tenir, en disant que tant que le débiteur n’invoque pas la prescription, les créanciers peuvent l’invoquer en son lieu et place (art, 1166), et que s’il y renonce, ils peuvent faire annuler sa renonciation, en prouvant qu’elle est faite en fraude de leurs droits (art. 1167). Mais quand la renonciation pourra-t-elle être considérée comme frauduleuse? est-ce seulement quand il y aura fraude caractérisée, c’est-à-dire intention formelle du débiteur de faire tort à son créancier? Ici les jurisconsultes se divisent encore, et cette décision a permis à M. Mourlon de présenter notre article comme faisant naître cinq systèmes; mais comme ces dernières dissidences sont plutôt les subdivisions et les nuances d’un seul et même système, nous avons cru plus logique de ne compter à cet égard que trois théories principales, dont l’une suit le droit commun, tandis que les deux autres s’en écartent, la première pour le restreindre, la seconde pour l’étendre. Quant à notre question particulière, qui nous paraît fort délicate à raison du mutisme du Code sur ce point, voici ce qui nous semble le plus conforme, soit à la nature de la prescription, soit à la combinaison des différentes dispositions analogues à la nôtre (art. 622, 788, 882). En principe, la fraude est nécessaire; mais elle n’aura pas besoin d’être directement prouvée par le créancier: du moment que celui-ci prouvera que la renonciation a été faite au préjudice de ses droits, c’est-à-dire qu’elle a causé ou augmenté l’insolvabilité de son débiteur, ce débiteur sera présumé, jusqu’à preuve contraire à faire par lui, avoir agi frauduleusement; mais si celui-ci prouve à son tour qu’il était, à raison de circonstances particulières, dans une ignorance excusable de son insolvabilité ou qu’il a eu de très-légitimes motifs de faire sa renonciation, qui n’a vraiment été qu’un acte de rigoureuse justice, cette renonciation devrait être maintenue. En un mot, il doit, selon nous, suffire au créancier de prouver le préjudice; mais c’est ensuite aux juges d’apprécier les circonstances pour décider si la renonciation doit être maintenue comme un acte que la probité commandait d’accomplir, ou si elle doit être annulée comme le résultat, soit d’une intention coupable, soit au moins d’une délicatesse mal entendue.
Quand c’est d’un jugement rendu contre le débiteur, faute par lui d’avoir opposé la prescription ou sur la renonciation qu’il y a faite, que résulte le tort causé au créancier, celui-ci peut attaquer ce jugement, soit par appel, si l’appel est possible, soit par la tierce opposition dans le cas contraire .
III. — Ce n’est pas seulement par les créanciers de celui qui néglige d’user de la prescription ou qui la répudie que cette prescription peut être opposée; c’est aussi, d’après notre article, par toutes autres personnes ayant intérêt à la faire valoir.
M. Troplong (n° 104) en donne pour exemples: 1° la caution d’un débiteur qui renonce à la prescription acquise de sa dette; et 2° le garant d’un acquéreur qui, après avoir possédé l’immeuble pendant 10 à 20 ans avec titre et bonne foi, n’invoque pas ce moyen et se laisse déposséder. Or ces deux prétendus exemples sont inexacts tous deux, et ni l’un ni l’autre ne nous offre l’application de l’art. 2225. — 1° Celui qui cautionne une dette y est personnellement obligé, le créancier se trouve alors avoir deux débiteurs et il existe deux obligations. Dans ce cas, les circonstances qui ont fait prescrire l’obligation du débiteur principal au profit de celui-ci, ont aussi fait prescrire l’obligation de la caution au profit de cette caution; d’où il suit que quand même le principal débiteur renoncerait à sa prescription, la caution, elle, n’en resterait pas moins maîtresse d’invoquer la sienne, sans avoir aucun besoin pour cela de faire annuler la renonciation du premier. On ne rencontre donc pas ici l’application de l’art 2225, puisque cet article suppose une personne ayant intérêt à la prescription acquise par une autre et non par elle, une personne qui n’oppose que cette prescription d’une autre personne, et qui, s’il y a eu renonciation par celle-ci, a besoin de faire annuler cette renonciation. L’art. 2225, comme l’explique très-bien M. Troplong lui-même, suppose une personne qui, en vertu des art. 1166 et 1167, vient exercer le droit d’une autre, tandis qu’ici c’est son droit propre que la caution exerce, c’est pour son compte qu’elle agit, c’est une prescription accomplie pour elle-même qu’elle oppose, en sorte que son droit ne changerait pas, alors même que les art. 2225, 1166 et 1167, seraient supprimés du Code. — 2° De même, lorsque, comme vendeur ou à tout autre titre, je me trouve tenu de vous garantir la possession d’un immeuble, et que, recherché par vous après votre dépossession, j’échapperai à votre demande de garantie en me fondant, comme le suppose M. Troplong, sur ce que vous n’êtes dépossédé que par votre faute, ici encore il n’y aura pas application de notre article, puisque je ne parlerai pas de faire annuler votre renonciation, et que, quand même les art. 2225, 1166 et 1167 n’existeraient pas, je n’en pourrais pas moins vous dire que votre dépossession n’est imputable qu’à vous et que vous en devez seul subir les conséquences.
Il faut donc, pour avoir des cas d’application de notre règle, supposer une personne qui, d’une part, a besoin d’user de la prescription, et qui, d’autre part, ne peut invoquer que celle qui est acquise au tiers au nom duquel elle agit. — Ainsi, par exemple, lorsque vous me vendez un immeuble hypothéqué à une dette par vous contractée, et que cette dette vient à se prescrire (sans qu’il y ait prescription de l’hypothèque en elle-même), l’hypothèque se trouve éteinte, non pas par la prescription et d’après le 4° de l’art. 2180, mais par l’extinction de l’obligation principale et d’après le 1° de ce même article. Or, dans ce cas, j’ai intérêt à invoquer la prescription de votre dette pour dégrever mon immeuble, et comme je ne puis l’invoquer qu’en exerçant votre droit et non jure proprio, c’est bien alors un cas d’application de notre article. — Ainsi encore, si pendant que vous étiez en voie de prescrire un immeuble vous m’avez concédé sur cet immeuble un droit qui n’est pas de nature à s’acquérir par prescription, v. g., un droit de passage, j’aurai intérêt, quand vous aurez acquis la prescription de l’immeuble, à invoquer et faire maintenir cette prescription, pour que ma servitude soit reconnue émaner du propriétaire du bien, et ce sera par conséquent encore en cas d’application de notre article. Il en serait différemment, si le droit que je tiens de vous était prescriptible et que j’en eusse acquis la prescription en même temps que vous acquériez celle de l’immeuble: dans ce cas, comme dans celui de la caution, c’est la prescription personnellement acquise par moi que j’invoquerai, et la renonciation que vous pourriez faire à la vôtre ne me gênerait en rien.
Remarquons, au surplus, que quoiqu’on dise ici que la prescription est alors invoquée par des intéressés autres que des créanciers, ces intéressés sont véritablement aussi des créanciers, en prenant le mot dans son sens large: il ne leur est pas dû d’argent, il est vrai, mais il leur est dû autre chose, et celui qui a prescrit était vis-à-vis d’eux dans les liens d’une obligation. Il est clair, en effet, que quand vous me constituez un droit de servitude, vous prenez implicitement l’obligation de faire tout ce qui dépendra de vous pour que ce droit soit respecté ; et de même, en me vendant un immeuble hypothéqué à votre dette, vous vous obligez, dans notre pensée commune, à le dégrever dès que vous le pourrez. Dans les deux cas donc (et il en serait de même dans tous autres) il existe une obligation, dans les deux cas je suis créancier, et c’est à ce titre que je puis invoquer les art. 2225, 1166 et 1167.