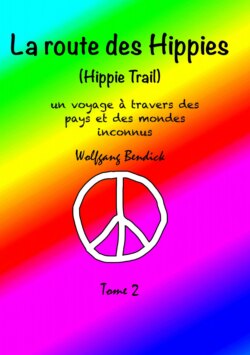Читать книгу La route des hippies - Tome 2 - Wolfgang Bendick - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
MILES FROM NOWHERE
ОглавлениеDepuis des jours l’horizon n’était plus qu’une ligne presque indéfinie où le bleu du ciel se confondait avec celui de la mer, et depuis quelques heures il semblait que cette ligne s’accentuait à nouveau et formait une fine bande, comme une trainée. « Terre en vue ! » entendit-on retentir depuis la passerelle de commandement. Les passagers se rassemblèrent alors sur le pont à bâbord en se protégeant les yeux avec la main ou des journeaux, afin de mieux voir à la lueur éclatante du soleil : L’Australie ! Ce pays où tout est à l’envers, m’avait-on dit dans mon enfance! Heureusement nous possédions un globe que l’on pouvait même éclairer le soir, ce qui me permit de me rendre compte que si tout le monde était certes à l’envers, ils avaient quand même les pieds sur terre !
Au retour de ses courses ma mère rapportait parfois des images à collectionner, presque aussi grandes que des cartes postales, et qui brillaient et avaient un drôle de parfum, celui des couleurs imprimées. Mais moi je pensais que c’était celui du pays. Ces images étaient de couleurs si variées, les couchers de soleil si fantastiques et les animaux si bizarres, que je ne me lassais pas de les regarder et que je les accrochais aux murs ! J’échangeais même les images d’autres pays avec des copains contre celles de l’Australie. J’étais curieux de voir pour de bon si les levers et les couchers de soleil étaient vraiment aussi colorés que sur les images ! Ceci dit en ce moment tout est plutôt gris, hormis une trainée beige qui s’approche lentement, le désert ! Je m’en doutais, car dans l’hémisphère sud on trouve des territoires désertiques sur la côte ouest des continents. Je mets cela sur le compte des alizés. Entretemps les derniers passagers sont arrivés sur le pont, nous sommes tous à bâbord pour saluer la terre ferme, qui est pour la plupart leur vieux pays natal et pour quelques autres comme moi leur nouvelle patrie. L’Australie est un pays aussi grand que les USA, mais avec seulement le même nombre d’habitants que Londres, ce qui ne fait pas tout à fait deux habitants par kilomètre carré contre 245 en Allemagne!
L’« Australasia » accoste devant un grand hangar, sans doute le hall d’enregistrement de la douane qui est surmonté sur son toit du drapeau australien : la Croix du Sud sur fond bleu et avec à l’angle supérieur l’Union Jack, les couleurs de l’Angleterre. Pendant un moment il ne se passe rien, car il faut d’abord procéder aux formalités de déclaration d’entrée du navire et surtout les carnets de santé doivent être vérifiés. Dans une notice j’avais lu que toute importation de cuir, plantes, produits animaliers, aliments, bref que tout était interdit ! « Tu vas voir, ils vont même nous enlever les ceintures et les lacets ! », me dit John en râlant. Peu après on nous donne l’autorisation de rejoindre la terre ferme et nous nous rendons dans un hall spécial pour les immigrants que nous sommes et où les contrôles sont très stricts, alors que la procédure est plus rapide pour les anciens Australiens. On commence par le contrôle des visas et l’inscription des dates de débarquement. « Vous avez de l’argent ? » me demande-t-on. Je montre alors fièrement mes 55 dollars, mais ce sont des dollars US et le dollar australien a plus de valeur, ce qui fait qu’en convertissant j’arrive seulement à 48 dollars! Après consultation, ils acceptent.
Comme je n’ai que mon short sur moi, je ne peux pas cacher grand-chose mis à part les bijoux de famille. Mais sous la chemise ! Il me faut vider la pochette ventrale en cuir et enlever les chaussures « Rien de caché à l’intérieur? Le cuir est interdit ! » En fait ils sont plus concentrés sur mes chaussures, comme déjà auparavant les douaniers dans tous les pays traversés. Qu’ont-elles de si particulier ? « Je ne peux quand même pas marcher pieds nus sur ces routes aussi chaudes ! » « Gardez -les ! » John pendant ce temps a déjà passé le bureau de l’immigration et m’attend à l’extérieur, alors que je suis en train de déballer mon sac à dos, en me disant que c’est certainement à cause des tampons sur mon passeport. Finalement je peux avancer, mais je m’étonne tout de même qu’ils n’aient pas du tout remarqué ce qui se voit le plus sur moi, le chapeau malaysien avec la peau de cobra que je n’ai même pas eu à enlever ! Quant aux Cartwright, ils ne sont pas tirés d’affaire et doivent d’abord faire désinfecter leur véhicule, sinon ils ne pourront pas rouler avec. C’est leur habitation et il faut espérer qu’ils pourront y dormir cette nuit ! John m’offre alors une bière, je lui rends ses 50 dollars et il me laisse une adresse à Perth, la capitale de l’ouest de l’Australie pas loin d’ici et où je pourrai le joindre. Il veut y faire la plonge dans un restaurant, alors que moi je préfère rester à Fremantle qui est une petite ville et qui m’est plus sympathique.
Me voici seul sur la grande rue, avec la sensation d’être un cowboy dans un western. Tout seul ! Les maisons sont basses avec très souvent seulement un rez-de-chaussée ou simplement un étage, beaucoup sont en bois et présentent des façades en trompe l’œil, les rares voitures roulent toutes à gauche, il y a peu de gens qui circulent. C’est vrai que vu la densité de population on ne se marche pas sur les pieds, tout au plus on trébuche sur les siens ! Soudain arrive quelqu’un que j’aborde : « Hôtel bon marché? » Il grommèle alors quelque chose en m’indiquant une direction. Qu’est-ce que c’est que ce charabia ? me dis-je, moi qui croyait qu’ici on parlait anglais! Je prends la direction indiquée et me retrouve bientôt devant un bâtiment de bois blanc avec l’inscription ‘hôtel’. Je grimpe les quelques marches de bois, et en demandant le prix je tombe presque à la renverse ! 43 dollars la semaine, je n’ai même pas assez pour une nuit! L’employé de l’hôtel semble comprendre mon problème. J’ai l’impression qu’ici tout le monde n’a pas les poches pleines. Il me dit que la seule chose accessible pour moi dans mon cas serait un ‘boarding-house’ et il me montre la direction pour m’y rendre. Je me demande si ça va être comme à Penang, car ‘boarding’ sonne un peu comme bordel ! Et puis cette langue! Elle doit avoir des rapports avec l’anglais mais avec une prononciation complètement dénaturée ! J’ai la sensation d’être un Prussien en Bavière : je dois observer avec précision la gestuelle et imaginer le reste en pensée !
Heureusement il y a un panneau accroché au-dessus de ladite maison. En arrivant je suis un peu rassuré. Si c’est un bordel, alors c’est plutôt un bordel pour hommes, car je ne rencontre que des hommes dans cette maison en bois qui sent la cire ! « Une chambre ? 40 dollars la semaine ! » « Quoi? », dis-je. « On m’avait dit qu’un ‘boarding-house’ est meilleur marché qu’un hôtel! » « Il l’est, mais les chambres sont beaucoup plus grandes, il y a quatre ou six lits, venez ! ». L’employé frappe à une porte et me fait entrer. A l’intérieur de la pièce où il fait très chaud sont assis quatre hommes mal rasés et mal peignés, un peu grisonnants, en short de gym et tricot de corps. Ils sont en train de regarder devant deux téléviseurs à la fois les différents programmes de l’après-midi. « There is a mate looking for a room ! », « Il y a un bonhomme qui cherche une chambre », ‘mate’ devant vouloir dire ici ‘homme’. Ils me regardent et me demandent dans un mauvais anglais d’où je viens. Quand je leur dis que je viens d’Allemagne, leurs visages s’illuminent, ils sont Hongrois, Polonais et Tchèques. Nous nous exprimons donc en allemand, langue qu’ils maitrisent mieux que l’anglais. Ils cherchent aussi du travail comme moi et ont loué la chambre ensemble pour 40 dollars la semaine, ce qui fait 10 dollars chacun. Avec moi le prix tombe à 8 dollars, et je suis donc le bienvenu. Au moment de sortir mes derniers dollars pour laisser un acompte, l’hôtelier fait signe que ce n’est pas la peine, que je dois d’abord chercher du travail et que nous parlerons ensuite du paiement. Voilà une idée raisonnable ! J’investis alors mes derniers sous dans quelques bouteilles de bière, histoire d’arroser ma venue !
Je suis content d’avoir trouvé à me loger. Ils me posent des tas de questions sur la situation en Europe, la politique, etc. Je leur dis que pour la première fois le SPD, le Parti Socialiste, est au pouvoir avec Willy Brandt comme chancelier et que les rapports avec l’est devraient bientôt se détendre. Ils sont quant à eux en Australie depuis déjà respectivement six et huit ans et devraient donc déjà avoir un peu le mal du pays ! Mais ce qui m’intéresse moi, c’est ce qui concerne le travail ici ! « Tu veux plutôt dire le chômage ! » rectifient-ils. Depuis des semaines ils sont en effet sans travail et bientôt va arriver l’été (l’hiver en Europe) avec la saison des pluies au nord, période pendant laquelle beaucoup d’entreprises ferment et encore plus de chômeurs migrent vers le sud. Qui veut bien rester en été dans les Tropiques ? J’objecte que l’Australie recherche en Europe des immigrants, que l’on m’a donné un visa d’immigration à durée indéterminée, et que donc le gouvernement ne chercherait pas des travailleurs s’il n’y avait pas de travail ! « Tout ça c’est de la politique! » me rétorquent-ils. « Les hommes politiques font toujours le contraire de ce qui serait bon… » Il y a bien une agence pour l’emploi où l’on peut se faire enregistrer comme demandeur d’emploi, mais d’après eux ils n’ont pas de travail à proposer. « Et pour ce qui est des indemnités de chômage ? » dis-je. « C’est à toi de te les mettre de côté si tu trouves un job, parfois il y en a de bien payés mais jamais pour bien longtemps ! Vas voir au service de l’immigration à Perth. Normalement les immigrants obtiennent un logement et des aides. Essaye, tout au plus tu auras un refus ! » me disent-ils pour me consoler. Ils ajoutent : « Il y a aussi des agences pour l’emploi privées et avec quelques combines tu auras du boulot, mais il te faut y être dès 7 heures du matin ! » « Des combines ? Expliquez-moi ça plus en détails ! » dis-je alors. « Cela peut attendre ! D’abord la piste officielle! Allez santé ! » Nous trinquons. « Santé à l’Australie ! » dis-je à mon tour et lève la bouteille. « Santé aussi à l’Europe ! » répondent-ils en prenant une deuxième gorgée. Heureusement la nuit il fait un peu plus frais. C’est ainsi que se passe ma première nuit dans le nouveau monde.
Le lendemain matin il y a de l’agitation très tôt déjà dans le ‘Boarding House’. Il n’y a apparemment pas que des chômeurs en Australie! En observant cette petite ville un peu plus en détails, je voie partout des ‘Fish and Chips’, des petits magasins, ou on peut acheter ou manger du poisson pané et des frites, de nombreux bars, quelques restaurants et ‘clubs’ dont je demande un peu plus tard le sens exact à mes nouveaux copains. Ils me disent alors : « Ce sont des sociétés fermées où l’on se retrouve pour jouer aux cartes, danser, boire ou autre chose, mais surtout pour boire, et il faut être membre adhérent. » « Pourquoi donc un club pour boire ? », dis-je. Ils me répondent : « Attends ! Tu vas être étonné ! Ici les bistros ferment dès 22 heures et le dimanche à 20 heures, c’est plutôt démoralisant ! »
Au fur et à mesure que le soleil monte, la chaleur augmente, ce qui est normal jusque-là, moins par contre le bourdonnement des mouches tout autour de moi quand il fait plus chaud. Je me dis qu’une bonne douche à nouveau ne nuirait pas à l’affaire pour évacuer les odeurs du voyage, une seule douche ce n’est pas assez. De l’autre côté de la rue des gens semblent me faire signe, mais je ne les connais pas du tout ! S’étaient-ils trouvés avec moi sur le bateau ? Par courtoisie je réponds à leur salut, ils me regardent avec étonnement. Pourtant je ne semble pas le seul à être enveloppé d’une nuée de mouches! En fait presque tout le monde tient à la main un journal plié ou autre chose et se ventile élégamment un peu d’air frais avec. Soudain il me vient une lueur d’esprit : ils chassent les mouches, ces véritables enquiquineuses qui rampent jusque dans les oreilles et les narines ! Le pire c’est quand un de ces gros machins te pénètre dans la bouche et te reste en travers de la gorge sur le chemin vers les poumons ou vers l’estomac et le derrière ! Il faudrait faire comme les Jains en Inde et se mettre un tissu devant la bouche, ou encore mieux, se recouvrir d’une burqa afghane ! Cela aurait un beau succès ici, des burqas pour hommes ! J’imagine soudain toutes les possibilités insoupçonnées qui m’attendent ici! Je ne serais sûrement pas cireur de chaussures, mais certainement millionnaire avec des idées aussi grandioses ! Bon, ceci dit pour l’instant j’ai rendez-vous avec l’agence pour l’emploi…
« Vous venez d’arriver ? » constate la demoiselle. « Oui, pour autant que je sache. Je cherche du travail! », dis-je en guise d’explication. « Et vous avez de l’expérience ? » « Oui, dans la construction, la construction des routes, la marine, le travail en usine, et je parle français et allemand! », lui confiais-je alors. « Vous êtes bien jeune pour avoir tant d’expérience! » me dit-elle. Je ne demandais pas tant d’intimité. « Revenez donc dans quelques jours ! » ajouta-t-elle. Donc pas de rendez-vous le soir pour ‘parfaire mon manque d’expérience’ ! Me voici à nouveau dans la rue.
Je cherche une cabine téléphonique, et ce n’est qu’à la troisième que je trouve un annuaire fixé par une chaine dans lequel je trouve l’adresse du bureau d’immigration que je m’empresse de noter. Je vais ensuite à l’arrêt du bus. Au-dessus du chauffeur est écrit ‘Perth’. Dois-je oser voyager au noir? C’est impossible ici, car on passe devant le chauffeur pour monter et très souvent aussi pour descendre, pour éviter ainsi qu’un resquilleur ne monte par la sortie. Il faut même passer par une sorte de croisillon rotatif. Sur un tableau sont notés les différents tarifs. Je dis au chauffeur que je cherche du travail et que je n’ai pas d’argent. « As-tu au moins 20 Cents ? », me demande-t-il. « Tout juste ! », lui dis-je. Il poursuit alors : » Mets les là-dedans et passe le croisillon, c’est le tarif jusqu’au prochain arrêt. Tu resteras assis, je n’ai rien vu ! » Au bout d’une bonne dizaine de kilomètres il me fait signe et je descends. Je demande mon chemin à un passant qui s’évente avec un journal, car ici dans la grande ville, comme je peux le constater, il y a encore plus de mouches qu’à la campagne !
Me voici à présent dans les bureaux où l’on me demande si j’ai rendez-vous. « Non ! » dis-je, « Mais je suis arrivé hier à Fremantle en tant qu’immigrant et je voudrais parler avec quelqu’un, entre-autre de travail ! » « Dans ces conditions il vous faut aller à l’agence pour l’emploi ! », me dit l’employé. J’invente alors rapidement une réponse : « Mais ils m’ont envoyé ici ! Ils ne vous ont pas appelés ? ». « Attendez, peut-être qu’il y a quelqu’un de libre quelque part ! » Peu après je me retrouve assis dans un bureau dans la pénombre avec un ventilateur qui bourdonne sur la table. En face de moi il y a une femme assez corpulente, pâle, avec des taches de rousseur, vêtue de la même couleur que ses dossiers empilés sur le bureau. « Bon sang de bon sang! », me dis-je, « émigrer d’Irlande pour finir dans un bureau comme ça faire des trous dans des dossiers et aller les classer ! La conversation s’engage : « Vous venez d’arriver ? » « Oui, hier! » « Avec quel bateau ? » « L’Australasia ! » Elle parcourt une liste, mais mon nom n’apparait pas. « Vous êtes venu par le ‘passage assisté’ ? » De quoi s’agit-il encore ? Que dois-je répondre pour qu’elle ne m’expédie pas dehors de suite ? Je lui dis que je suis venu avec le bateau de Singapour. « Et jusqu’à Singapour ? » « Et bien par voie terrestre! Tout le trajet ! », lui dis-je. Elle veut alors voir mon passeport, feuillette ses classeurs et trouve effectivement une inscription à mon nom !
Elle m’explique que si j’étais venu par bateau ou par avion aux frais du gouvernement australien, j’aurais droit à un hébergement complet dans un camp d’accueil et à une aide financière. Un camp d’accueil ? Cela sonne comme ‘camp d’écueil’. Non merci, pas question ! Je lui explique qu’en venant par mes propres moyens j’ai épargné beaucoup d’argent au gouvernement et qu’il doit bien y avoir une possibilité d’obtenir une aide de démarrage ! Elle me dit que malheureusement non et que pour cela ce sont les associations caritatives comme l’Armée du Salut qui sont compétentes. Si je ne trouve pas de travail je pourrai à n’importe quel moment quitter le pays, ce que ne peuvent pas faire ceux qui sont venus par le ‘passage assisté’. Ces derniers doivent en effet rester six ans dans le pays ou rembourser au gouvernement les frais d’immigration. Tel est le prix de la liberté ! Je lui fais remarquer qu’il s’agit de leur liberté, pas de la mienne. Elle me dit que je peux repartir à tout moment. « Mais ce n’est pas pour repartir que je suis venu, je suis venu pour bosser ! Vous n’avez pas une petite idée de ce que je pourrais faire ? » Tout en mâchonnant son stylo à billes, elle réfléchit si elle ne pourrait pas m’embaucher comme jardinier, comme aide-ménagère ou même comme père de ses futurs enfants ?! Rien de tout cela, comme je peux le remarquer. « J’ai une idée! » Elle fait alors un numéro de téléphone et me demande mon adresse. Je la lui donne. Me planifie-t-elle par hasard un rendez-vous ? Je l’entends dire : « Ok! C’est bon ! Je le lui dis ! » Elle raccroche soulagée. Elle vient d’appeler une de ses connaissances qui est professeur d’allemand. Si un de ses élèves avait besoin de cours de soutien, ils m’appelleraient au boarding-house… 20 Cents et une demi-heure plus tard, me voici à nouveau à Fremantle!
Heureusement j’ai encore mon réchaud à essence et je peux ainsi préparer le repas pour mes colocataires d’Europe de l’Est, afin de me rendre un peu utile. Ce n’est pas permis certes, mais comment survivre sinon ? En plus la centrale électrique vient de se mettre en grève et toute la ville s’éclaire à la lueur des bougies. En voyant les collègues se frotter les mains, je leur demande ce qu’ils trouvent de si positif à une situation comme celle-là ? « Il y a quatre ans c’était pareil, pendant deux mois pas de courant ! Nous sommes allés à la campagne avec les fusils et nous avons abattu des bovins. Tu ne peux pas t’imaginer comme c’était super ! » « Qu’est-ce qui peut donc être si super ? », dis-je. « L’ambiance ! On campait dehors, on faisait des feux de camp, les citadins venaient manger avec nous, on faisait de la musique, on dansait, on partageait ! » « Et les flics ? » « Au début ils nous cherchaient des noises, mais à la fin ils étaient tous contents d’avoir eux-aussi quelque chose à manger, et ils eurent même comme mission de nous donner un coup de main pour attraper les bovins ou pour du moins tenir à distance les fermiers. »
Mais on n’était pas encore là! On pouvait encore acheter des bougies mais on ne trouvait plus à la vente de réchauds à alcool à bruler ni même bientôt de l’alcool. Je leur parlai de ma visite au bureau d’immigration, ce qui les fit bien rire. « Ils devraient arrêter de chercher des immigrés! », dis-je. « Ils veulent des immigrés qui ont de l’argent et le dépensent, pas des pauvres types comme nous ! », ils répondirent, « Des gens qui ouvrent des magasins, fondent des entreprises, et ça rapporte au gouvernement des impôts et d’autres rentrées d’argent. Nous on ne fait que combler les trous, quand l’économie marche on nous sollicite, et quand ç’est le marasme on nous oublie. Comme ça on ne coûte rien à l’état ! »
Le lendemain je veux quand même essayer avec une de ces agences d’intérim privées. Le soir est consacré au casting comme au cinéma ! Je dois me mettre au centre de la pièce. « Tourne-toi ! Stop, attends ! Retrousse les manches ! Bon, ça va. Enlève ce chapeau stupide et prends ma casquette! Un peu plus en biais ! Bon, un instant ! » Quelqu’un va chercher un crochet de main comme celui du Capitaine Hook dans Peter Pan et je dois le passer au-dessus de l’épaule. « A quoi ça sert un truc pareil ? », dis-je. « A soulever et à manipuler des balles de laine ! Mais pour ça tu n’as pas encore tout à fait assez d’abdos, elles pèsent dans les 200 kilos, et de toute façon il n’y a pas de laine en ce moment. Ceci dit, tu as quand même bonne mine ! » « Oui, mais deux cents kilos... » « Ne t’en fais pas, ils ne te prendront quand même pas de toute façon ! Et si c’était le cas il s’agit seulement de les incliner pour mettre dessous un chariot, un diable, pas de les lever. Tant qu’une balle est sur la tranche, elle est facile à manier. Tu vois, il faut que tu donnes l’impression d’avoir de l’expérience, et si on te demande, tu dis que tu as déjà tout fait ! Montre tes mains ! Merde, elles ne sont pas calleuses, pas de cicatrices, mais ça viendra ! Le vieux pantalon va bien, une cigarette au bec ferait bien l’affaire aussi ! » Et c’est ainsi que se poursuit le défilé de mode à la lueur des bougies et devant une bière. Comme la télé ne marche pas sans courant, cela leur donne le temps de me donner un look de vieux baroudeur. « Il te faudrait de plus gros biceps, poilus et tatoués! » « Eh doucement, je ne suis pas Superman ! », dis-je. « N’oublie pas de leur raconter des salades, tu as tout fait déjà cent fois, tu as de l’expérience ! » « Mais ils vont bien voir dans mes papiers que je viens d’arriver! » « Tu n’as qu’à leur dire que tu as fait trois saisons de laine en Allemagne ! » « Mais il n’y a pas de moutons là-bas ! » « Ne t’inquiète, ils ne le savent pas ! »
Tôt le lendemain matin ils sont tous debout pour m’aider à ajouter la dernière touche. « N’oublie pas, tu sais tout faire ! Et tu dis toujours oui ! Allez, vas-y ! Fonce ! Cela va peut-être marcher ! » Je me hâtai en direction du lieu de rendez-vous qui était à un arrêt d’autobus à la périphérie de la ville. Il y avait là une vingtaine d’hommes pour la plupart balèzes, cigarette au bec, certains vêtus d’un boxer, tout en muscles et chevelus. Un minibus passa et je compris qu’il n’y aurait de travail que pour huit personnes au maximum. Le conducteur descendit, examina des pieds à la tête l‘assemblée à présent quasi muette, en tenant dans la main une liste et un stylo. « Trois personnes pour le nettoyage du terrain ! Qui s’y connait ? » Tous levèrent négligemment la main. Moi aussi, le crochet me tombait presque de l’épaule! Il pointa le stylo sur trois personnes. « Noms ? » Il les inscrivit tandis qu’ils montaient les uns après les autres. « Papiers! » Ils les lui tendirent, il les mit dans la poche arrière de son jeans. « Il me faut cinq maçons pour des travaux de terrassement ! A nouveau la même procédure. « Montez ! » Il démarra alors et les occupants du minibus nous regardaient par les vitres d’un rire moqueur.
De nouveaux postulants arrivèrent au lieu de rendez-vous, certains n’hésitèrent pas à se mettre devant. Cela ne dérangeait pratiquement personne, étant donné qu’il était clair pour tout le monde que c’était les ‘chef’ qui choisissaient qui prendre dans la file. Trois autres minibus arrivèrent et pour finir il ne restait plus qu’une dizaine de personnes dont moi. Quelqu’un regarda sa montre et dit : « C’est tout pour aujourd’hui ! » Tout le monde partit quasiment, sauf quelques-uns dont moi qui insistèrent un moment sur le lieu de rendez-vous, plus pour remplir la journée que dans l’espoir d’avoir encore une chance. Nous échangeâmes nos expériences, des conseils ou nos adresses. Maintenant que la sélection avait été faite, il n’y avait plus de rancune ou de jalousie. Quand on est dans le besoin, on se sent sur un pied d’égalité !
Je repartis en flânant vers le ’boarding-house’ où tout le monde sommeillait sur son lit. Sans télévision la journée était encore plus longue. Les rideaux étaient à demi fermés, au moins comme ça il n’y avait pas de mouches, vu qu’elles préféraient regagner la lumière du jour. « Alors? », me demandèrent-ils. « Quoi alors ? », dis-je. « Vous voyez bien que je suis de retour ! Il y a à peu près dix personnes qui sont restées. » Je pris ensuite mon équipement de pêche et me rendis au port, où je m’assis à l’ombre d’une grue sur le quai et tentai d’appâter les poissons avec du pain, des vers et des grosses mouches. L’eau reflua lentement avec la marée descendante et libéra ainsi le tapis de moules sur les ducs d’albe (plots d’ancrage), mais pas les poissons qui s’étaient apparemment retirés dans des zones plus fraiches et plus profondes. J’observai les autres pêcheurs qui étaient dans la même situation que moi. Le lendemain je retentai ma chance sur le marché du travail. Cette fois les 2/3 restèrent sur le carreau, ce qui me fit comprendre pourquoi mes copains jouaient à la loterie malgré leurs maigres économies. Il y avait en effet plus de chances de gagner là que de trouver un job! L’après-midi le courant était de retour. Le syndicat avait-il atteint son but, ou était-ce à cause du week-end imminent que les ouvriers voulaient éviter une source de conflit avec leurs épouses ?
Mon premier dimanche australien arrivait. Je me levai tôt et voulus me rendre en ville. Les autres n’étaient même pas devant la télé. « Vous venez ? C’est dimanche ! » leur dis-je. « Rien de pire qu’un dimanche en Australie! », telle fut leur réponse. Je m’en étonnai. La veille au soir ils avaient insisté pour que j’accepte cinq dollars comme prêt pour que je puisse sortir. Je ne voulais d’abord pas les accepter, mais je ne voulais pas non plus qu’ils le prennent mal, et c’est vrai que j’étais complètement fauché. Je partis et découvris des rues presque vides, mis à part quelques femmes en bigoudis et peignoirs roses ou bleus-clair qui sortaient leurs toutous pour leur faire faire leur pipi. Tous les troquets étaient fermés, le ‘Frühschoppen’, la boisson du matin après la messe était inconnue ici. Je me rendis au port où régnait le calme plat, et là je vis les hommes assis pour la plupart en petits groupes, en train de discuter et de faire prendre un bain à leurs asticots, sans doute pour ne pas encombrer à la maison. Les mouches commençaient à sonner le réveil, les cloches des clochers anglicans aussi d’ailleurs. Des enfants en uniformes scolaires affluaient à l’église, avant de se rendre à ‘l’école du dimanche’ après la messe. Quelle horreur !
A midi enfin les bistros ouvraient, et les hommes pouvaient s’offrir leur première bière de la journée. On n’y voyait aucune femme. Mes amis m’expliquèrent la raison : en Australie les femmes n’ont tout simplement pas le droit de rentrer dans les bars! Je m’assis ensuite dans le parc à côté de gens qui avaient souvent à leurs pieds une poche de papier d’emballage qu’ils portaient de temps en temps à leur bouche. Je me sentis alors replongé en Inde et dans la culture de la boisson à l’anglaise ! Pour la première fois je vis ce jour-là aussi les premiers autochtones noirs assis en groupe derrière un buisson du parc, la mine noire comme du charbon, trapus, certains parmi eux barbus, avec des cheveux crépus pour la plupart jaune pâle. Bizarre me dis-je, se cacheraient-ils par hasard ? Ma curiosité me poussa à m’approcher un peu. L’un d’eux me fit signe, à moins que ce ne soit pour chasser les mouches ? Non, il devait bien m’avoir fait signe, car ils ne semblaient pas se laisser troubler par ces insectes qui rampaient sur eux. L’un d’entre eux leva une bouteille et me porta un toast, à moins qu’il ne voulût me l’offrir ? Elle n’était pas dans un cornet, car ce n’était pas de la bière. J’étais horrifié en découvrant que c’était de l’alcool à brûler, le même que mes collègues utilisaient pour chauffer leurs réchauds !
Aux alentours de midi je me rendis dans un Fish and Chips où l’on trouvait pour 50 ou 70 Cents une tranche de poisson pané frit dans de l’huile, le traditionnel cornet de frites salées ou aspergées du vinaigre. Je préférais au vinaigre. La nourriture des pauvres quoi ! Mais je trouvais ça très bon et je crois même que la moitié de l’Australie se nourrit ainsi. Beaucoup des propriétaires de ces boutiques de poissons étaient des Basques espagnols, ou plus exactement des Basques qui avaient émigré d’Espagne, comme l’avaient fait les ‘Irlandais anglais’. A-t-on déjà vu des ‘Anglais irlandais’ ? Partout dans le monde des gens émigrent, souvent non pour échapper à la misère mais à la persécution politique ou religieuse. Je comprenais peu à peu que je n’étais pas le seul immigré et que toute la ville en regorgeait. J’étais habitué à voir des gens fiers d’être Allemands ou Autrichiens, mais ici ça venait au troisième rang. Ici on était fier tout simplement d’être immigrant et d’être Australien.
L’après-midi les rues s’animèrent un peu, et les enfants qui avaient fini leur école du dimanche se rendaient chez Cleo, la seule discothèque de la ville, un club qui diffusait jusqu’à 18 heures un programme pour les Teenagers, avec entre-autre Cat Stevens qui était ici à la mode et dont la musique envahissait même doucement la rue. « Miles from nowhere, I guess I’ll take my time, oh yeah to reach there… Lord my body has been a good friend, but I won’t need it, when I reach the end… » (« A des miles loin de tout, je crois que je prendrai le temps d’arriver là-bas. Seigneur, mon corps a été un bon compagnon, mais je n’aurai plus besoin de lui quand ce sera pour moi la fin… ») De 18 jusqu’à 20 heures la discothèque fermait et ouvrait à nouveau ensuite, cette fois pour les plus de 18 ans. Je restais assis en face dans un bistro à déguster une bière, pendant que quelques enfants nantis faisaient crisser les pneus de leurs bagnoles rutilantes, en faisant quelques tours de piste avec tout un attroupement autour d’eux. On attendit que les clubs ouvrent. Puis le barman du bar dans lequel j’étais assis, s’écria : « C’est l’heure, Gentlemen, s’il vous plait ! » C’était alors le signal que le service était terminé, que chacun devait finir son verre et quitter les lieux. Je comprenais à présent pourquoi certains clients avaient commandé peu auparavant et aligné devant eux un ou plusieurs ‘midis’. Ce n’était pas parce qu’ils attendaient des amis ! Un policier entra et se mit au bout du comptoir où on lui servit une bière, avant même qu’il ne la commandât. La conversation bruyante s’interrompit alors et le flic sirota son verre, tout en posant la main sur les fesses de la serveuse. Tous les autres avalèrent leur bière et disparurent, tandis que le policier commanda à nouveau une bière tout en continuant à badiner avec la serveuse. Il était pourtant là en service pour faire respecter la loi ! Je restais dehors interloqué. C’était 20 heures, l’heure de la fermeture. En Allemagne une telle situation provoquerait un renversement de gouvernement ! A 20h15 j’étais de retour auprès des copains qui avaient mis les téléviseurs l’un à côté de l’autre et regardaient les deux programmes à la fois, comme ça c’était moins ennuyeux. « Alors, on s’est bien amusé? » « Des clous oui ! »
*
Le lendemain dans la matinée retour à l’arrêt de bus. Nous commencions à nous connaitre tous, et en général c’était toujours les mêmes qui étaient pris. Il arrivait que le ‘chef’ teste en tâtant les muscles des nouveaux avant de faire son choix. Même mon crochet ne compensait pas l’absence de mes muscles, quant du salaire on n’en parlait quasiment pas, sauf un de temps en temps qui disait ce qu’il avait gagné ailleurs, mais en tout cas pas avec ce ‘chef’. Personne ne voulait se mettre à nu ou perdre les faveurs du ‘chef’, on devait prendre ce qu’il donnait. Il arrivait que quelqu’un parle du job de la veille, surtout quand quelque chose ne s’était pas passé normalement, qu’ils avaient droit à une bière gratuite ou à un bon repas, ou quand il y avait si peu de travail qu’ils avaient du mal à donner l’impression qu’ils avaient beaucoup à faire jusqu’à la fin de la journée. Les ouvriers étaient déposés sur les chantiers ou chez des privés par le ‘chef’ qui venait les récupérer le soir et qui les payait alors. Par la suite je repassai à l’agence pour l’emploi...
Mercredi je fus dans les bonnes grâces de ‘Boulot’, le très occupé ‘Dieu du Travail’ ! Peut-être que la nana en charge de l’agence avait eu pitié de moi ou qu’elle me jugeait sérieux, ou alors peut-être était-ce tout simplement parce que chaque recruté balançait ce job au bout d’une journée, comme je l’appris d’ailleurs plus tard ! Toujours est-il que Dunlop cherchait un ouvrier sans obligation d’expérience, mais par contre pour débuter de suite, c’est-à-dire le lendemain matin à 8 heures. C’était juste ce qu’il me fallait et je pouvais donc rendre mon crochet à main aux copains. Le salaire était de 43 dollars net par semaine pour 40 heures de travail soit un peu plus de 1 dollar par heure, ce qui correspondait à deux bières. On ne pouvait pas boire aussi lentement que l’on gagnait cet argent!
Je laissai mes copains dormir et me rendis à l’arrêt du bus, mais à un autre cette fois. Il y avait à peine dix minutes de trajet, souvent même je le faisais à pied, mais pas les premiers jours car j’étais trop groggy. Il s’agissait d’une usine géante dont le nom était mentionné sur un des halls en grands caractères jaunes. Partout alentour ça sentait le caoutchouc chaud. Je fus enrôlé dans le service de rechapage et travaillais à l’heure, alors que les autres travaillaient à la tâche. Ils donnaient le tempo et je devais suivre. Il faisait déjà très chaud dehors et à l’intérieur on pouvait qualifier cela de brûlant. Dans les énormes halls l’air était plein de vapeur et de poussière de caoutchouc, comme une femme après 270 jours de grossesse ! Et quel vacarme ! Certains portaient des bouchons dans les oreilles, mais moi je ne pouvais pas les garder, sinon la transpiration me ressortait par les narines ! En outre il fallait arriver à se faire comprendre, ce que l’on faisait en criant ou par gestes.
Je réceptionnais les pneus qui étaient déjà fraisés, donc sans profil, et j’étais chargé de les trier. Au début j’étais obligé de lire sur chacun sa taille, mais petit à petit je voyais en un coup d’œil où il devait aller. Puis, dans chaque pneu à rechaper je devais insérer une chambre à air en caoutchouc épais qui était encore brûlante à cause de son utilisation précédente. Ensuite je mettais dans le pneu quatre à six modules en alu courbés en forme de croissant de lune. Ces derniers formaient un cercle fermé, comme une jante mais à l’intérieur du pneu, et enfermaient la chambre à air. Le pneu ainsi équipé partait alors chez un collègue qui le serrait dans un dispositif tournant, et le recouvrait d’une épaisse bande de caoutchouc qu’il déroulait à partir de rouleaux énormes de largeurs différentes. Ensuite il allait dans un grand moule ouvrable qui possédait à l’intérieur un dessin de profil et était raccordé à une conduite de vapeur. Le pneu y séjournait un certain temps à haute pression et haute température. Ces moules avaient tous les profils en usage, donc aussi ceux de Michelin et Kleber. Le pneu y était pour ainsi dire ‘cuit’. Au début j’avais seulement deux collègues à ravitailler, puis ce furent trois.
Quand tous les moules étaient raccordés, on se mettait à ressortir le pneu du premier moule: il fallait donc d’abord laisser s’échapper la vapeur chaude, extirper le pneu du moule et le faire rouler jusqu’à mon lieu de travail ou me l’envoyer, selon la taille de la montagne de pneus qui s’entassaient devant moi. Ensuite je devais les taper un par un sur une arête pour que le cercle d’alu à l’intérieur s’ouvre, lui enlever les différentes parties, puis la chambre à air, et tout remettre dans d’autres pneus, cela sans cesse et de plus en plus vite. Il y avait bien une pause de deux fois quinze minutes prévue, mais comment faire alors qu’il y avait toujours quelque chose à monter ou à enlever ? En plus les collègues étaient rémunérés à l’unité, et comme c’était des adeptes de la nouvelle religion où le temps c’est uniquement de l’argent et pas un instant d’éternité, ils préféraient renoncer à la pause ! Pas loin du lieu de travail il y avait un robinet d’eau glacée, c’était là notre seul réconfort. A midi on avait droit à une pause d’une heure, tout juste le temps de faire l’aller et retour à un Fish and chips et d’engloutir rapidement le repas entretemps. Un autre réconfort c’était quand une machine tombait en panne pendant un bref laps de temps! Mais cela provoquait le mécontentement des travailleurs à la pièce, parce qu’alors ils ne gagnaient rien ! Au début je ne ressentais que de l’épuisement et des douleurs, mais au bout d’une semaine une certaine fierté d’accomplir un travail aussi rude dans de telles conditions m’envahissait, et aussi de pouvoir rendre à l’aubergiste et aux copains l’argent que je leur devais!
J’avais au bout des doigts brulés des ampoules qui me faisaient mal, les mains et les doigts contusionnés. Mais bientôt je pigeais le truc et trouvais même le temps pour aller fumer une cigarette avec les trois collègues, quand les moules étaient tous pleins et qu’il fallait respecter la durée de cuisson. La fumée de cigarette nous faisait oublier pendant un instant la puanteur du caoutchouc. Au bout de trois semaines je reçus trois dollars d’augmentation de salaire, l’ambiance dans notre coin de hall fut plus détendue, on s’envoyait des plaisanteries que l’on ne comprenait qu’à moitié à cause du vacarme, mais qui du coup nous faisaient rire deux fois plus fort. On trouvait même le temps de faire de petites blagues à ceux des autres ateliers, comme de déplacer en passant l’outil qu’ils avaient mis à leur droite pour le leur mettre à gauche. Nous nous cachions alors, morts de rire de les voir chercher partout et ne pas trouver leur outil, se gratter la tête et se demander s’il n’était pas temps de prendre des congés… Notre plus grand plaisir après le travail c’était de partager deux ou trois bières dans notre bistro habituel, avant de repartir chacun chez soi plutôt morts de fatigue. Il y avait des jours où nous battions le record de trois jours auparavant, on l’inscrivait sur un tableau, et de fierté on en remettait une couche !
Heureusement que je travaillais dans l’atelier des pneus de voitures. Je plaignais le pauvre bougre qui faisait le même boulot que moi dans le service des poids lourds, ceci dit il avait des bras de la grosseur de mes jambes ! L’atelier le plus géant était celui qui réparait les pneus des camions des mines ou ceux des chargeurs, car ces pneus avaient un diamètre extérieur de près de trois mètres, et il fallait monter à l’intérieur pour travailler. L’ouvrier qui les réparait avait lui-même une taille au-dessus et pouvait rentrer tout juste dans les pneus. Ceux-ci n’avaient pas de moules. Ils étaient fabriqués en Amérique, et pour les rechaper on enlevait les restes du profil en les fraisant à la main, puis on martelait et chauffait les crampons un par un. Ces pneus étaient souvent percés par des cailloux qui étaient parfois encore coincés dans leur carcasse. Ici tout se passait à grands coups de masse, d’abord il fallait casser le caillou, fraiser le trou, poser de nouvelles bandes de toile, ajuster les nouveaux crampons et les vulcaniser sur la carcasse moyennant des dispositifs chauffés à la vapeur. Il fallait faire attention avec les pneus fraichement livrés. Je pensais d’abord que les collègues me faisaient une plaisanterie, quand ils me montrèrent une toute petite araignée rouge dans un des pneus, une ‘redback spider’ dont la morsure est mortelle !
Ainsi passèrent les semaines. Je pus payer le loyer ainsi qu’une tournée, et je réussis même à économiser un peu de mon salaire. Je calculais qu’en continuant à vivre ainsi frugalement et à mettre autant de côté, je pourrais me payer dans six ans le retour en Allemagne ! Peut-être y avait-on ainsi calculé la disposition réglementaire des six ans pour les immigrants entrés dans le pays avec une aide gouvernementale ? En attendant je connaissais Fremantle et les environs par cœur. Je me rendis au Jardin Botanique de Perth où il y avait encore plus de mouches qu’en ville et rendis visite à John qui faisait la plonge dans un restaurant. Il se plaignait qu’il n’y avait pas d’herbe en Australie ou du moins qu’il n’en trouvait pas. A chaque fois qu’il adressait la parole à des jeunes à ce sujet, ils pensaient qu’il était flic, car personne ne pouvait s’imaginer qu’on pouvait fumer de l’herbe à cet âge-là ! Il m’expliqua aussi pourquoi la reine d’Angleterre était partout si aimée : tous ceux devant qui elle passait dans sa Rolls Royce, croyaient qu’elle leur faisait signe, ce qui n’était pas du tout le cas ! En fait elle était tellement habituée lors de ses fréquentes visites en Australie à chasser les mouches qu’elle ne pouvait pas s’empêcher de le faire aussi ailleurs !
*
C’était la première semaine d’octobre et partout des affiches annonçaient la ‘Fête d’Octobre’ ou ‘Fête de la Bière’ à Perth pour le dimanche à venir. Les Australiens n’avaient donc plus besoin de s’envoler pour Munich, la ‘Fête de la Bière’ venait à eux ! En plus comme elle se tient à Munich la dernière semaine de septembre, la Jet Set australienne peut la fêter deux fois ! Même le maire de Munich ou du moins son adjoint devait venir, l’autre faisant une cure de gruaux après les fatigues de la ‘Wiesn’, ‘pré’ comme on nomme l’évènement, en parlant du terrain des festivités munichoises. En plus il y aurait de la bière de Munich, de l’authentique Löwenbräu ! Depuis que je suis en Australie, j’ai remarqué que la bière est ici la boisson nationale et que les Australiens se prennent pour les champions du monde de sa consommation. Le fait que les Munichois revendiquent le même titre est pour eux présomptueux. Ils allaient donc voir ce qu’ils allaient voir ! Ils descendraient en un jour ce que les Munichois picolent en une semaine!
Je ne voulais pas rater un tel évènement culturel et m’étais donc mis assez tôt en chemin ! Je fis du stop, et par un heureux hasard les occupants du véhicule qui s’arrêta bientôt s’y rendaient aussi. Il semblait même que toutes les voitures s’y rendaient et de partout. Sur le parking je vis même des véhicules en provenance des autres états fédéraux. J’ignorais jusqu’à présent que les Australiens étaient si avides de culture! Les festivités devaient se dérouler dans un stade, sans chapiteau à bière et en plein air. De toute façon il ne pleut pratiquement jamais à Perth, tout au plus peut-être une fois tous les cinq ans ! Les préparatifs étaient presque terminés et cela devait démarrer à midi et terminer avant le soir. De partout s’élevaient dans le ciel immaculé des colonnes de fumée, les Australiens étant les rois du barbecue et de la viande grillée. L’odeur qui parfumait l’air me rappelait un peu Bénarès!
Des bœufs entiers tournaient sur des broches, ainsi que des moutons, des cochons et des poulets. Bientôt on allait faire des offrandes à Bacchus, le dieu des buveurs et des mangeurs! Des prêtres en tabliers de boucher maculés de sang accomplissaient le rituel avec sérieux et précision. On avait préparé aussi d’autres plats et de longues rangées de tables avec des bancs de chaque côté, pour nourrir les mangeurs fatigués de boire. Quelques bâches étaient tendues pour donner un peu d’ombre et dans un coin du stade il y avait même un manège et des balançoires pour les enfants. On avait vraiment pensé à tout, même les toilettes et les vestiaires avaient été réaménagés pour la circonstance ! Tous les miroirs avaient été démontés et toutes les portes enlevées. Accès libre aux toilettes ! Afin d’endiguer le flot d’urine qui suivait celui de la bière, on avait raccordé aux robinets des tuyaux qui répandaient de l’eau sur les sols carrelés. Celle-ci à son tour était chargée d’amener jusqu’aux grilles d’égout l’urine qui dans l’urgence était déversée ailleurs. Ces locaux étaient prévus pour accueillir tout au plus deux équipes, mais pas des milliers de visiteurs d’un évènement culturel atteints d’incontinence aigue ! Mais on n’en est pas encore là...
Pour le moment le maire de Perth tenait un discours qui n’en finissait pas de remerciements, puis ce fut au tour du maire-adjoint de Munich, à la munichoise bien sûr, et il fallut traduire, ce qui en fit doubler la durée ! Ceci dit, personne n’écoutait de toute façon, et avec le boucan on n’entendait même pas les haut-parleurs ! Puis vint enfin le moment de mettre en perce le premier fût sur un podium à la vue de tout le monde. L’élu de Munich tenait le robinet pendant que celui de Perth frappait avec le marteau en bois. La mousse gicla, la foule était en liesse, le ‘cuivre munichois’ qui avait fait le déplacement, sonna une fanfare. Mais ‘le jus d’orge’, la bière de choix d’importation du tonneau, n’était destinée qu’à quelques privilégiés qui savaient l’apprécier, comme les deux maires, le Consul de Bavière, le représentant de BMW et quelques autres tricheurs encore qui s’étaient faufilés jusque sur la scène décorée de bleu et blanc ! Les gens du peuple comme nous avaient droit à la bière en bouteilles, l’Export. De toute façon une autre n’aurait pas supporté le long transport. L’ambiance monta, les vendeurs de bière n’arrivaient pas à tenir la cadence pour ouvrir les bouteilles, car les Australiens sont des buveurs rapides ! D’ailleurs il valait mieux qu’il en soit ainsi vu les températures qui régnaient, sinon la bière allait s’évaporer au préalable dans la bouteille. Qui plus est, c’était dimanche aujourd’hui et à 20 heures c’était l’heure de la fermeture, le moment où normalement ça allait commencer vraiment à devenir convivial ! Sans doute en plus y avait-il un peu la fierté nationale qui jouait, et il s’agissait de montrer aux ‘têtes à choucroute’ qu’on a une meilleure descente par tête d’habitant et par jour que la concurrence des antipodes du nord!
Il faisait très chaud et même la transpiration pourtant plus forte ne suffisait pas à éliminer le surplus de liquide. Il aurait fallu prendre de la bière forte, de la triple ou de la quadruple ! On aurait alors peut-être été maitre de la situation sanitaire qui s’en suivait à présent! Au début on faisait la queue devant les portes qu’on avait enlevées, ensuite on faisait couler l’eau dans les cabines du vestiaire, c’était prévu pour. Toutefois l’affluence augmentait et la file d’attente s’allongeait. Pour pallier au temps d’attente, beaucoup emportaient leur bouteille aux toilettes ! Mais les bouteilles étaient plus vite vidées que les vessies ! Que faire au fait des bouteilles vides, car les Australiens ne sont pas des ‘hamsters de la bouteille’ comme nous, ils ne connaissent pas les bouteilles consignées, ils les déposent quelque part, ou bien les jettent dans un coin où elles finissent en tessons. Bientôt les mouches arrivèrent en bourdonnant dans la salle, attirées par l’odeur ou pour satisfaire leurs besoins personnels elles aussi. Certaines se posèrent, on essaya de les attraper en leur tapant dessus, quelqu’un même leur balança une bouteille, d’autres suivirent, cela finit dans des hurlements par une vraie chasse aux mouches ! Les vestiaires où dominaient jusqu’à présent le vomi, les excréments et l’urine, se transformèrent en une seule et unique mer d’éclats de verre ! Seuls les plus prudes s’aventuraient encore à l’intérieur, les autres accomplissaient leurs affaires pressantes dehors autour des bâtiments, ou vidaient leurs vessies prêtes à éclater contre les barrières !
Cela faillit tourner en catastrophe quand vers 19 heures il n’y eut plus de bière munichoise ! Heureusement les vendeurs ont pu se procurer encore dans les temps de la bière australienne et la fête put continuer à battre son plein. Une Harmonie australienne avait depuis un bon bout de temps déjà pris la relève de la munichoise et jouait des airs du pays que la plupart des gens reprenaient en chœur. Personne n’avait levé les yeux vers le ciel ni entendu gronder l’orage. On se mit à faire des provisions de bouteilles pleines, car l’heure de la fermeture approchait. Soudain les nuages se mirent en plus des buveurs à vomir leur surplus de liquide, les éclairs fusèrent, les gens s’enfuirent sous les quelques bâches que le vent emportait. Chacun saisit ce qui lui était le plus cher, les hommes les bouteilles, les femmes leurs maris ou leurs enfants, tout le monde se précipita aussi vite que possible vers les voitures. C’était pour ainsi dire une évacuation de la place à coup de lances à eau !
Lors de ces festivités j’avais fait la connaissance de quelques jeunes Australiens à peu près de mon âge, avec qui j’avais discuté devant quelques bières de voyages et de l’Europe. Ils se trouvaient assez coincés sur leur continent insulaire tout entouré d’eau, ne pouvant se rendre nulle part, alors qu’en Europe les portes de toute l’Asie et de l’Afrique nous étaient grandes ouvertes. Ils me ramenèrent à Fremantle en soirée.
*
Le travail était pénible, peu à peu se formait sur la peau de mes mains une corne résistante à la chaleur. L’augmentation de salaire était certes faible, mais en faisant le calcul sur une année cela faisait presque le salaire d’un mois ! Toutefois je me dis que je ne continuerais pas encore longtemps comme ça ! Mes compagnons de chambrée connaissaient entretemps tous les programmes télé par cœur et étaient en train d’inventer la télé stéréo ! Ils avaient en effet installé les deux téléviseurs l’un à côté de l’autre à un mètre de distance et mis le même programme. Ils tenaient devant leur nez le dos d’un journal à peine entrouvert à côté duquel ils lorgnaient le film qui passait. Je ne trouvais le résultat pas si excellent que ça, mais ils avaient le temps de faire progresser leur invention ! Comme de toute façon je trouvais la télé insipide, je me mettais la couverture par-dessus la tête pendant la nuit.
Lors de mes balades du week-end, j’avais vu en direction de mon lieu de travail un panneau avec l’inscription ‘chambre à louer’. Je me dis que je n’aurais plus besoin de prendre le bus et que cela me payerait la chambre plus chère. Je frappai, le propriétaire, un homme d’un certain âge m’ouvrit et m’amena voir son garage transformé, tout en me parlant de sa faible retraite. Il ne me revenait pas vraiment, contrairement à son logement qui était petit mais assez coquet et bientôt à ma disposition pour 15 dollars par semaine. Après lui avoir laissé un acompte, le week-end suivant j’acquittai ma facture de l’ancienne piaule, et après une bière d’adieu avec les copains je me rendis à mon nouveau ‘garage’. Je commençai par m’allonger sur le lit double au milieu de la pièce et appréciai vraiment d’être à nouveau seul, surtout sans ces télés en permanence ! Puis je m’assis sur le canapé et lus un peu. Avec l’armoire, la table et les deux chaises je me retrouvais un peu à l’étroit, mais je pouvais comprendre que le vieil homme devait caser sa camelote quelque part. Je cueillis à un buisson toujours vert quelques branches en fleur que je mis dans un vase. Si c’était trop étroit à l’intérieur, je pouvais toujours m’asseoir dehors dans le grand jardin. Le problème c’était que là le propriétaire me collait souvent aux semelles et n’arrêtait pas de me rabattre les oreilles, à tel point que j’aurais presque préféré les télés qui elles au moins ne me couraient pas après ! Mais la plupart du temps j’étais de toute façon à l‘extérieur au travail.
Comme la clef avait déjà un coût et qu’en plus on risquait de la perdre, je la déposai sur les conseils du propriétaire sous la citerne qui était vide. Seulement j’eus bientôt l’impression que la clef n’était plus à la même place sous le bidon quand je la cherchais! Je devins méfiant, bien que je ne puisse rien remarquer de particulier dans la pièce. Au bout de la deuxième semaine et en rentrant un soir à l’heure de la fermeture, après avoir descendu une ou deux bières avec les collègues de Dunlop, je tâtonnai à la recherche de la clef. Rien. J’étais pourtant sûr de l’avoir laissé là-bas! J’allai alors frapper chez le propriétaire qui sortit. Il m’expliqua qu’il l’avait prise parce il n’avait pas pu dire non à deux garçons sympathiques qui cherchaient une chambre, qu’il voulait leur rendre service tout comme il l’avait fait déjà pour moi, etc. Il ajouta qu’ils avaient déjà déposé leurs affaires dans la chambre, qu’ils amèneraient le reste demain et emménageraient. J’étais furax ! Je lui dis que j’avais loué la chambre seul et qu’en plus il n’y avait qu’un lit. Il rétorqua qu’il faut aider les jeunes et qu’on peut bien partager un lit, et que si je trouvais que c’était trop étroit avec les deux autres je pourrais dormir avec lui... ! Je le mis à la porte, débarrassai mon lit, fourrai le bazar des deux autres dans un coin, préparai mon sac à dos et m’allongeai. Le lendemain matin j’écrivis une lettre à mes successeurs que je mis sous la couverture du lit et dans laquelle je les avertissais que ce type était d’après moi une fouine, un escroc et sûrement une pédale, au vu de son offre de la veille ! Je pris alors mes quelques affaires, fermai à clef, pris cette dernière avec moi et la balançai dans l’eau, une fois arrivé au port. Je pris alors ma canne à pêche et me plongeai dans mes pensées, desquelles pas le moindre poisson ne me sortit. Peu après arrivèrent les autres pêcheurs qui semblaient avoir chacun leur place habituelle. Je n’attrapai bien sûr rien, les autres également restaient là assis immobiles à regarder leur flotteur, tout en se disant sans doute que c’était toujours mieux d’être là qu’à la maison !
Plus tard vers midi, j’allai récupérer chez mon Basque une portion de poisson et de frites. Comme je lui demandai d’où provenait son poisson, car je n’en avais pas vu du tout pendant ce temps passé à pêcher, il me dit que c’était essentiellement des bateaux de pêche japonais qui accostaient à Fremantle et approvisionnaient la ville en poissons! Je m’entretins un certain temps avec lui. Sa femme et ses enfants ne tardèrent pas à nous rejoindre. Le week-end il ne se passait pas grand-chose, mais ils ne fermaient jamais leur commerce, car ‘il faut être là quand le client est là’, telle était leur devise. Ils connaissaient un boarding-house non loin du port où les chambres étaient au premier étage au-dessus d’un troquet, ce qui n’était pas du tout gênant vu les heures de fermeture ici. J’y avais d’ailleurs déjà parfois consommé une bière et le patron me connaissait un peu. La chambre était aussi petite qu’une cabine de bateau, deux fois la taille du lit. Il n’y avait que trois ou quatre chambres louées, les dix autres étaient vides. Les portes étaient alignées les unes à côté des autres dans un long couloir et de chaque côté, les toilettes et les douches se trouvaient aux deux extrémités du couloir qui sentait autant la cire que dans les autres boarding-house.
Je choisis une chambre à douze dollars, côté cour à cause du bruit de la rue. Je pris mes quartiers, et comme on pouvait manger en bas à un prix raisonnable, je m’offris pour une fois ce petit luxe du week-end. Je passais la plupart du temps le dimanche après-midi à pêcher dans le port. Pendant ces six semaines je ne réussis pas à attraper le moindre poisson, et d’ailleurs je ne me rappelle pas avoir vu un seul pêcheur en sortir un de l’eau ! Si on voulait du poisson, il n’y avait qu’à aller chez le poissonnier! La pêche n’est peut-être qu’un remède contre la solitude et le poisson seulement un prétexte.
J’avais très souvent mon petit transistor acheté à Penang à mes côtés et le dernier tube à la mode était ‘Mamy Blue’ : « Je suis parti un soir d’été, sans dire un mot, sans t’embrasser, sans un regard sur le passé, oh mamy, oh mamy, oh mamy blue… ». Mon départ et les larmes de ma mère me revinrent alors en mémoire, et à présent c’était à moi qu’elles montaient aux yeux… Je pensais à elle et savais qu’elle songeait aussi à moi en cet instant, comme toujours ! J’étais si triste et en même temps aussi quelque part si heureux. A la fin de la chanson j’éteignis le poste de radio et me mis à fredonner la mélodie, tout en laissant mes larmes couler. Maintenant que j’étais consolé, je pouvais m’adonner à la nostalgie du pays sans me trahir moi-même! Je pris soudain conscience que j’avais fait la moitié du chemin et que le chemin encore à parcourir était le même que celui déjà parcouru. Mal du pays et des pays lointains avaient pris la même direction !
Je voulais repartir bientôt, car s’il y avait un avenir ce n’était certes pas dans ce bled délaissé même par les poissons ! A la radio et dans le journal local il y avait à la une: ‘Découverte de diamant dans une vieille mine d’or!’ Avec en plus des photos de la pierre précieuse, un truc gros comme le poing, la deuxième plus grosse au monde après le ‘Cullinan’ ! En observant ma carte routière, je vis que c’était exactement sur ma route en direction de Darwin vers le nord ! Il y avait deux itinéraires : celui à l’intérieur des terres et la route côtière. La pierre précieuse avait été découverte sur l’itinéraire à l’intérieur des terres. Je me mis à me procurer un équipement de prospecteur, de toute façon il y avait suffisamment de boutiques qui offraient ce genre de matériel et faisaient de grosses affaires toutes les fois où il y avait du chômage ou quand on entendait des annonces comme celle-ci. Mon équipement devait être peu encombrant et léger, car je voulais me déplacer en stop et à pied ensuite. J’achetai alors une bêche pliable, une battée d’orpailleur, un tamis et un sac à eau en toile d’une capacité d’un gallon, soit cinq litres, plus un sac de couchage léger, car les nuits pouvaient être froides.
J’utilisai aussitôt en guise de poêle la battée qui ressemblait à un récipient plat, et comme j’en avais marre de ne manger que des soupes, n’ayant en ma possession qu’une casserole, je me cuisinai à nouveau de vraies pommes de terre rôties avec de la viande, pour changer de l’éternel Fish and Chips! Souvent, la plupart du temps les week-ends, je me préparais moi-même à manger, ce que faisait d’ailleurs chacun en dépit du règlement qui l’interdisait, ne serait-ce qu’un café le matin. Quelques petits futés avaient essayé même avec des thermoplongeurs ou des plaques électriques, avec pour tout résultat l’arrivée après coup du propriétaire parce que les fusibles sautaient en permanence.
Un dimanche matin j’avais un beau morceau de steak presque de la même taille dans ma battée sur le réchaud à essence. Je me rendis rapidement dans la salle d’eau pour chercher de l’eau pour le thé que je voulais me faire juste après. En retraversant le couloir, cela sentait le brûlé, mais je pensais que cela venait d’en dessous puisque la propriétaire était aussi en train de faire sa cuisine du dimanche. En ouvrant la porte je dus faire face à un nuage de fumée et vis à peine à travers ce brouillard les flammes qui dansaient sur ma battée! Mince ! L’huile bouillante avait pris feu et toute la battée était en flammes ! Surtout pas d’eau me dis-je ! Je saisis alors la couverture de dessus du lit, la balançai par-dessus tout ça et maintient l’ensemble fermement, jusqu’à ce que je sois sûr que les flammes étaient étouffées. A tâtons et avec précaution j’essayai de fermer l’arrivée d’essence en dessous. Après j’ouvris complètement la fenêtre et fermai la porte. Je contemplai alors les dégâts, un grand trou noir béant dans la couette qui avait libéré de l’intérieur une sorte de flocons de feutre. Le steak aussi avait souffert, il était carbonisé et pané en même temps aux flocons ! J’ouvris alors toutes les fenêtres et toutes les portes dans le couloir pour dissiper la fumée, ainsi que les portes des toilettes pour neutraliser l’odeur.
Mon voisin de chambre qui avait apparemment senti également quelque chose, vint dans le couloir. « Tu ne trouves pas par hasard que ça sent un peu le brûlé ? » me demanda-t-il. « Un peu ? Et le brûlé ?! » dis-je en ne pouvant pas m’empêcher de ricaner. « Plutôt beaucoup et le carbonisé ! Viens voir ! » Je lui montrai alors la mouise dans laquelle je me trouvais : plus de déjeuner et la couverture inutilisable ! Mais la maison était sauvé! Je lui demandai s’il savait ce qu’une couverture comme ça et la parure pouvaient bien coûter, car il fallait bien que je les change. « Je dois parler avec la propriétaire ! » « Surtout pas ! » s’exclama-t-il, « sinon plus aucun d’entre nous ne pourra cuisiner ! En plus ils veulent qu’on mange tous en bas chez eux ! Il faut trouver une autre solution ! » « Oui, mais laquelle ? » « Regarde, là derrière à côté des chiottes, la chambre est vide, ils ne la louent pas à cause du bruit de la chasse d’eau, on n’a qu’à rentrer et échanger la couverture ! » Nous essayâmes d’ouvrir la porte à l’aide d’un ouvre-boite tordu, mais nous n’avions pas des dons de voleurs, seulement ceux de travailleurs honnêtes. Il me vint alors une idée : « Un instant ! Entre cette chambre et la mienne il y en a qu’une autre. Allons voir à quoi ça ressemble dehors ! »
On regardait par la fenêtre. En contre-bas, à peu près à hauteur du plancher, il y avait une corniche tout le long du mur. « Voyons si je peux marcher dessus! » Je grimpais dehors, tandis qu’il me tenait pour ne pas perdre l’équilibre. « Cela pourrait marcher ! » Je me collai alors à plat contre la maison, m’accrochai à l’ouverture de ma fenêtre, tâtonnai pour atteindre celle de la chambre voisine, et glissai lentement le long du mur jusqu’à la dernière fenêtre. Par chance ses battants étaient entrouverts pour pouvoir aérer, je les rabattis et rentrai prudemment, pris toute la couverture de dessus du lit superposé supérieur par-dessus mon épaule et fis prudemment le chemin inverse. D’un petit balancement mon pote récupéra mes affaires et me passa dehors la couverture cramée. Je me sentais mieux cette fois, peut-être sommeillait-il en chacun de nous deux un talent de cambrioleur qui n’attendait que l’occasion pour se réveiller ! Cela prit par contre un peu plus de temps pour tout replier afin que l’on ne se rende compte de rien. En plus, il fallait donner l’impression que c’était repassé ! Je passai pendant un certain temps la main dessus pour l’aplatir, sortis, remis à nouveau les battants de la fenêtre en position entrouverte et fis le chemin en sens inverse. Pour remplacer le repas de midi, il alla chercher deux bouteilles de bière et nous trinquâmes à notre chance encore une fois, sauf qu’il fallait encore faire partir l’odeur de fumée du couloir ! Il eut une idée : « On ferme toutes les fenêtres, chacun chie de son côté dans les toilettes et on laisse les portes ouvertes ! »
J’avais presque oublié l’incident, lorsqu’un soir on frappa fort à toutes les portes. Nous nous précipitâmes dehors, pensant que quelque chose s’était passé. C’était la propriétaire qui tenait dans les bras la couverture, et voulais savoir si quelqu’un s’était amusé à faire du feu. « Du feu ? Ici dans la maison ? Mais c’est interdit ! » nous écriâmes-nous spontanément. « Et où donc ? » Elle nous conduisit alors à la chambre à côté des toilettes. « C’est impossible! » s’écria quelqu’un. « Elle n’est même pas occupée! » « Si ! » s’écria-t-elle à son tour, en brandissant les guenilles sous notre nez. Nous deux avaient du mal à retenir un rire. « Quelqu’un aurait dû le remarquer et au moins le sentir ! », disait quelqu’un, et un autre : « Cela doit venir du fer à repasser ! ». Prise de colère elle descendit les escaliers quatre à quatre...
J’allais souvent au port, même après le travail. Je ne sortais plus la canne à pêche. Je me sentais très seul et même les magnifiques couchers de soleil sur la mer ne faisaient que renforcer cette sensation. Les étoiles m’étaient plus proches que les hommes, bien que les bistros soient pleins le soir et propices à des discussions sans fin. Une bière de plus, et le monde entier devenait ton ami ! Mais à partir de l’heure de clôture la solitude devenait la souveraine absolue du pays, ici en Australie. Une lettre de ma mère arriva avec 200 DM, ce qui me fit me demander si elle avait économisé cet argent sur le budget du ménage ou si c’était mon père qui était derrière tout ça? Il y avait joint en tout cas l’adresse de l’évêque catholique de Broome, au nord-ouest, sur ma route, et qui était le frère d’un ami en affaires. Il me fallait partir d’ici, car on disait qu’au nord les premières averses étaient tombées et que la saison des pluies allait bientôt commencer. Les pistes et les routes seraient alors pendant des mois sous plusieurs mètres d’eau et toute circulation serait impossible...