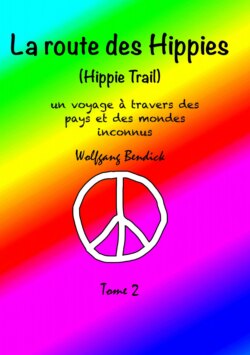Читать книгу La route des hippies - Tome 2 - Wolfgang Bendick - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
A TOUTE VAPEUR
ОглавлениеUn gong retentit dans les couloirs des cabines. C’était l’heure du dîner apparemment il y avait deux services. Le premier était végétarien et asiatique, le second une heure et demie plus tard européen et mixte. Arrivé dans le « dining-room » je voyais qu’il y avait aussi beaucoup d’Indiens qui voyageaient comme passagers des cabines. Ce n’était donc pas tant la couleur de la peau qui faisait la différence de classe que le porte-monnaie. Il y avait d’ailleurs plus d’Indiens qui mangeaient européen que d’Européens qui mangeaient végétarien ! Un peu plus tard je restai encore longuement sur le pont et contemplai les étoiles et l’eau. C’était une nuit calme en mer et une faible houle venait bercer le navire. Les légères vibrations dues aux rotations des hélices accompagnaient mon sommeil.
Le lendemain matin je continuai mon exploration du navire. Nous autres passagers des cabines, étions séparés des passagers des ponts intermédiaires, car de chaque côté du bateau une porte en fer munie de barreaux séparait ces deux mondes. Pour accéder à l’avant ou à l’arrière du navire il me fallait les traverser. Du côté superstructures du navire on pouvait ouvrir ces portes, mais pas depuis le pont. Je voulais voir ce que Sayonara faisait et je ne savais pas où il se trouvait. J’avais mis de côté une partie du déjeuner qui avait été très copieux. Je me tenais derrière la porte fermée et je regardais en bas vers le pont avant. Des voiles d’ombrage, des bâches-écran, étaient tendues pour faire de l’ombre sur le pont qui était chaud. Les gens avaient à présent en grande partie enroulé leurs couchages et étaient assis dessus ou sur les bittes d’amarrage, sur le pont même, au bord des écoutilles ouvertes qui étaient recouvertes de gros filets destinés à éviter toute chute. Chaque emplacement libre était littéralement ‘occupé’. Cela avait dû être également ainsi sur les galères à l’époque, sauf qu’ici personne n’était enchaîné ! Je n’apercevais Sayonara nulle part. Quelques Indiens remarquèrent ma présence et s’approchèrent de la porte. Certains tendaient la main à travers les barreaux et réclamaient un bakchich. Je donnai alors à un jeune quelques ‘paisa’ et lui demandai de bien vouloir se mettre à la recherche du Japonais.
Il revint peu après avec lui. Il s’était réjoui du repas, surtout parce qu’il n’avait pas acheté de provisions à terre. Je ne savais pas comment je pourrais descendre sans me couper le chemin du retour. Il y avait assez de panneaux accrochés qui signalaient que l’accès au centre du navire était interdit aux passagers des ponts intermédiaires et que de mon côté les passagers de première et deuxième classe ne devaient pas accéder non plus à ces ponts. J’ouvris donc la porte et il se faufila du côté interdit. Comme il y avait énormément de monde et surtout comme tous étaient nouveaux, on ne le remarqua pas au début. Nous bûmes une bière au bar et il se rendit aux toilettes. Il me raconta qu’en bas cela ne se passait pas bien du tout, parce qu’il n’y avait pas assez de toilettes et que les gens utilisaient les écubiers (les ouvertures pour la chaine de l’ancre) et les dalots (celles de rejet des eaux de refoulement en mer.) Il dit aussi que les premiers avaient eu le mal de mer et avaient vomi, il régnait une puanteur insoutenable dans les ponts intermédiaires. Parfois le vent renvoyait une nuée d’air vicié dans notre direction sur le pont promenade. Mais il est vrai que les Indiens ne sont pas très sensibles aux odeurs…
Sur le pont canots je discutais avec un vieux matelot, qui avait dû avoir raconté au capitaine qu’il y avait un marin allemand comme passager et qui aimerait bien faire une visite détaillée du navire. Il m’amena donc bientôt sur la passerelle de commandement où l’on me souhaita la bienvenue et me servit aussitôt du thé. Tout le monde m’observait avec étonnement comme une attraction, alors que la vraie attraction c’était en fait le navire ! La passerelle suivait légèrement la courbure du navire. Un peu de côté à tribord il y avait le double transmetteur d’ordre, avec lequel le sens d’avancement (avant-arrière) et la vitesse étaient transmis à la salle des machines. Le « Rajula » devait donc être un navire à deux hélices. Partout où c’était possible, il y avait des encadrements en laiton, ainsi que les différentes cloches. Tout cela reluisait tellement, même le gouvernail en bois et le boitier du compas, que je supposais que c’était astiqué tous les jours. J’eus même le droit de prendre le gouvernail et de piloter ce grand navire avec sa timonerie assistée par la vapeur. La transmission était un peu moins directe qu’avec le système hydraulique, mais cela venait aussi du fait qu’il n’y avait qu’un compas magnétique qui avait besoin de plus de temps pour réagir qu’un gyrocompas électrique. Il se passa un moment avant de se rendre compte que le navire avait légèrement dévié de son cap et il en fallut un autre pour l’y remettre. Il fallait un excellent sens de l’observation et beaucoup de feeling avec ce navire!
Hormis cela il était électrifié, même les lampes de position. Il y avait donc une machine à vapeur à bord qui actionnait un générateur. Je voulais en savoir un peu plus sur les treuils. Le matelot que j’avais rencontré reçut l’ordre de me montrer l’avant du bateau. Il avait 60 ans et avait commencé à l’époque comme mousse, puis était resté depuis lors 45 ans à bord, hormis quelques absences pour congés ! Il était tout étonné de voir ma curiosité pour cette technique démodée. Pour lui ça avait été à l’époque un navire hypermoderne et c’est comme cela qu’il le voyait encore aujourd’hui. Aussi il n’avait jamais navigué sur un autre bateau. Le guindeau (treuil de l’ancre) sur le gaillard d’avant (la partie surélevée de l’avant du bateau), était actionné par deux machines à vapeur en même temps. Le pont même était rugueux à cause des épaisses couches de rouille qui avaient été repeintes plusieurs fois. Des manches à vent, tuyaux d’aération avec une ouverture en entonnoir, étaient orientés en fonction du vent pour assurer aux passagers des ponts intermédiaires un peu d’air frais. Les mâts étaient rivetés, tout comme les mâts de charge. En haut du grand mât je reconnus une hune, un poste de vigie. Ils étaient légèrement inclinés vers l’arrière, et il y avait une vergue qui ne servait plus aux voiles, mais à hisser les pavillons.
J’étais étonné du bon état de conservation général du navire. Mais il est vrai que c’était le ‘pays’, le refuge de ces marins depuis des années, et c’est la raison pour laquelle il était si bien entretenu. J’insistai pour me rendre dans le pont intermédiaire. « Pas bon pour les Européens ! » me dit-il sur un ton dissuasif. Mais comme j’insistai pour tout voir, la construction de la coque, les fermetures des écoutilles, et ainsi de suite, nous descendîmes les escaliers raides dont même les marches étaient occupées, en chevauchant les gens qui se pressaient les uns contre les autres. Ceux qui y parvenaient, restaient près d’une ouverture pour récupérer le courant d’air, tandis que d’autres dormaient serrés les uns contre les autres. Je suspectais que les gens ici se levaient ou s’allongeaient alternativement, car il manquait tout simplement de place ! Tout cela n’était pas sans me rappeler l’hôpital de Bangalore. Le pont intermédiaire était aussi plein que le pont principal. Qu’adviendrait-il en cas de mauvais temps ? Les passagers devraient-ils alors tous descendre ? J’étais extrêmement content de voyager comme passager de cabine ! Sayonara put pour quelques jours encore quitter son existence de sardine, jusqu’au jour où un steward remarqua qu’il n’était pas passager de cabine. Depuis lors, la porte grillagée resta fermée à clef des deux côtés. Je réussis néanmoins à continuer à lui faire passer subrepticement de la nourriture, car pour nous elle était vraiment copieuse. Une sorte de chef-steward se tenait un peu à l’écart de son groupe de tables, tel un maitre de cérémonie. A peine avait-il remarqué que quelque chose allait être terminé ou manquait, qu’aussitôt sur un signe de sa part un autre steward arrivait et apportait un nouveau plat. La salle à manger était assez démodée et n’avait sans doute pas été modifiée depuis la mise en service, mais la présence en grande quantité de bois et de laiton lui conférait un certain charme qui manque indéniablement aux navires plus récents. Il y avait une salle de bal où se produisaient des orchestres ou des animateurs chargés de chasser l’ennui des passagers. Or c’était justement cela que beaucoup recherchaient, rester paresseusement allongés pendant des heures dans la chaise-longue ou debout contre le bastingage à regarder la mer…
Il y avait des tables de pingpong entourées la plupart du temps d’enfants. On pouvait jouer au ‘shufflebord’, une sorte de jeu avec des disques colorés en bois. Le pont en teck était recouvert de cases peintes avec des chiffres. Avec un bâton équipé par devant d’une planchette en forme de pelle, il fallait pousser à partir d’une certaine distance le disque de bois en forme de puck sur les cases chiffrées. Le perdant pouvait payer la tournée, car il y avait de l’alcool sur le bateau et pas seulement pour les Européens. Mais il faut dire que ça ne dégénérait jamais comme dans le ‘Goa Express’ ! Il y avait également une petite piscine quelque part plus bas et un cinéma qui passait de vieux films abimés en noir et blanc. Je pus revoir ainsi quelques-uns des films que j’avais vus enfant, comme ceux de Laurel et Hardy ou Charlie Chaplin. Non loin de là il y avait une bibliothèque que j’étais un des rares à fréquenter avec John, qui partageait la cabine avec moi. On pouvait y retrouver les perles de la littérature marine anglaise comme ‘Alone around the world’, ‘Seul autour du monde’ de Joshua Slocum, ou ‘As I walked out one midsummer morning’, ‘Quand je suis parti un matin d’été’, de Laury Lee.
Le vieux matelot du Rajula me fit faire la connaissance d’un machiniste de son âge, qui fut tout fier de me montrer le cœur de son navire et m’amena par des escaliers légèrement huileux dans la salle des machines. Ici-bas régnait une forte chaleur, sûrement plus de 45°, ainsi qu’un certain vacarme provoqué par les soupapes dont le mouvement rythmé assurait l’acheminement de la vapeur à travers les différentes conduites. C’était plutôt comme le bruit énorme d’une machine à coudre géante qui prédominait dans la salle des machines. Ce qui me sauta tout de suite aux yeux, ce furent les deux machines à vapeur verticales à trois cylindres, séparées de quelques mètres seulement. Là où elles n’étaient pas peintes en noir, elles reluisaient tellement elles étaient bien entretenues. La combustion des chaudières à vapeur était passée depuis quelques années déjà du charbon au pétrole brut. La plus grande partie de la chaleur venait de ces brûleurs et des deux chaudières. La vapeur ainsi produite à l’intérieur était véhiculée avec une pression élevée dans des tuyaux très isolés jusqu’aux parties les plus distantes du navire, à l’avant jusqu’au guindeau, à l’arrière jusqu’à la timonerie, et dans le mât pour la corne de brume. Les deux machines à vapeur actionnaient les deux hélices sous la poupe du navire, développant ensemble une puissance de 8000 chevaux, ce qui était une performance remarquable pour l’époque (année de construction 1926) ! Chaque machine consistait en trois cylindres, tous reliés à un entrelacs de tuyauteries et de vannes. Le premier qui était le plus petit était le cylindre de haute pression et c’est là-dedans qu’arrivait la vapeur avec la pression maximale. Celle-ci déplaçait alors le premier piston dont la bielle envoyait la poussée par l’intermédiaire du vilebrequin sur lequel les autres pistons également agissaient à l’arbre de transmission et donc à l’hélice. Le piston fonctionnait dans les deux sens et pouvait grâce à la vapeur envoyer de la pression de bas en haut et vice-versa. Une fois qu’elle avait traversé ce cylindre et perdu une partie de la pression mais gagné en volume, la vapeur était dirigée vers le deuxième cylindre. Ensuite après avoir cédé ici aussi de sa force, elle arrivait au troisième cylindre qui était aussi le plus gros. Quand elle avait déplacé à son tour son piston, la vapeur était enfin retransformée en eau par refroidissement et condensation et ramenée par pompage dans la chaudière.
Certes, il y a toujours un peu de vapeur qui se perd aux endroits qui ne sont pas étanches. L’eau ainsi perdue est remplacée par une nouvelle qui est condensée à partir d’eau de mer au préalable, afin de ne pas laisser dans la chaudière de dépôts calcaires ou de sel, qui amoindriraient le pouvoir de chauffe du brûleur. Il y avait tout un arsenal de pompes, réservoirs et autres ustensiles indéfinissables qui remplissaient la salle des machines. Le plus important parmi eux était le double transmetteur d’ordres, un truc en forme de tambour avec deux leviers à main et deux aiguilles, une pour chaque machine. De chaque côté il y avait un cadran rond qui allait par graduations de ‘à fond en avant’ à ‘à fond en arrière’, en passant par ‘stop’. Ce transmetteur d’ordres était relié avec celui de la passerelle de commandement. En y actionnant des leviers, les ordres pour la salle de machines étaient transmis à l’ingénieur. Il suffisait qu’on déplace sur la passerelle un levier, pour que l’aiguille correspondante ici en bas se mette sur la position demandée, et l’appareil sonnait alors jusqu’à ce que l’ingénieur ait fait coïncider son levier avec l’aiguille. Après il se mettait à exécuter les ordres, c’est-à-dire qu’il réglait la machine sur le mode de fonctionnement demandé. Depuis les chaudières, partaient d’énormes tuyaux de gaz d’échappement vers le haut en direction de la cheminée, et qui dégageaient bien au-dessus des ponts ce panache de fumée noire si typique des bateaux à vapeur.
Pendant le repas, j’étais assis à la même table avec quelques Occidentaux et John, qui, comme il le disait, avait parfois gagné son pain en travaillant comme serveur. Il m’avait prêté une veste et une cravate, étant donné que sur les navires la tradition prime et qu’une tenue chic est de mise pour les repas et surtout pour les bals. La famille irlandaise avait sa table personnelle, l’atmosphère était détendue parce qu’il y avait à bord des passagers de tous milieux culturels et que tout était fait pour que cela se passe en bonne intelligence. Je devais véritablement donner des ordres aux stewards pour qu’ils ne restent pas à mes côtés, dans l’intention de satisfaire la moindre de mes demandes ou de la susciter. Les gens parlaient les uns avec les autres, et lors de ces festivités les premières et les secondes classes étaient mélangées, sauf les ponts intermédiaires qui étaient éloignés et ignorés même d’un certain nombre de passagers.
Grâce à ce quotidien agréable, j’allais de mieux en mieux de jour en jour, et j’avais même presque la sensation d’être en cure, du moins me l’imaginais-je ainsi. Le deuxième soir je me remis à bourrer ma pipe en écume de mer pour la première fois depuis un certain temps. Dans la boutique à bord j’avais découvert du tabac hollandais, le même qu’auparavant à Peshawar au Pakistan et qui avait tenu jusqu’ici. « Vas- y, mets un peu de ça ! », me dit John, en posant à ma grande surprise un peu de haschich sur la table. Je n’arrivais pas à m’imaginer qu’un homme de 30 ans de plus que moi puisse fumer du haschich! Je pris le morceau et commençai par le sentir pour m’assurer qu’il ne voulait pas se moquer de moi. C’était bien de l’authentique, et même du bon ! Il se délectait de mon étonnement et me dit : « Ce ne sont pas les Hippies qui ont inventé le haschich! » Il était tendre et j’en rompis un petit morceau que je coinçai entre deux allumettes, tandis qu’avec une autre enflammée je le réchauffai jusqu’à ce qu’un petit filament de fumée s’élève. Ensuite je l’émiettai sur le tabac, mélangeai les deux et bourrai ma pipe avec tout cela. Je lui laissai l’honneur de commencer à fumer, et tard dans la nuit nous étions encore là, allongés sur le pont dans des chaises longues, observant le ciel étoilé et nous racontant mutuellement les plus grands moments de nos périples marins.
Nous fîmes escale dans les Nicobars, un groupe d’îles proche de Sumatra qui fait partie du territoire indien. Le navire y mouilla pendant une bonne demi-journée. Une douzaine de voiliers de transport semblables à des chalands vinrent vers nous et se placèrent avec adresse le long des deux côtés du Rajula. C’était de grands rafiots en bois d’une vingtaine de mètres de long et à peu près cinq de large, avec une grande voile latine, qu’une légère brise conduisit vers nous. Une fois que leur chargement était livré et hissé à bord au moyen des harnais de chargement actionnés par les treuils à vapeur du « Rajula », les passagers qui débarquaient ici montaient avec une certaine anxiété dans les embarcations qui se balançaient au gré d’une légère houle. Ensuite les longues vergues de bambou des voiles étaient hissées à la force solidaire des bras de l’équipage demi-nu, les cordes d’amarrage tombaient à l’eau, et ces voiliers qui étaient remplacés alors par d’autres, prenaient la direction des différentes îles. Il y avait une agitation et un va et vient que j’observai avec John depuis un des ponts supérieurs en nous penchant par-dessus le bastingage. Ces navires antiques sans le moindre fil métallique ni autres parties en fer suscitaient notre étonnement. Tout était uniquement en bois et le cordage en fibres de Sisal, même les poulies qui servaient à hisser les voiles étaient en bois !
En soirée, comme nous ne savions pas comment la douane de Penang, notre destination nous accueillerait et qu’il valait mieux être ‘clean’, nous fumâmes les restes de haschich de John. Singapour n’était pas loin et chacun savait qu’il était impossible d’obtenir là-bas un visa quand on portait des cheveux longs ! C’est pourquoi je demandai à John, bien que cela me soit difficile, de me couper les cheveux et par là-même réduire à néant l’œuvre de deux années de ’croissance’ ! Mais à cela s’ajoutait un autre problème : en fouillant dans mon sac à dos, j’en extirpai le revolver au grand étonnement de John qui ne s’y attendait pas. « Qu’est-ce que tu veux faire avec ça ? » me demanda-t-il. En le soupesant avec la main, je lui répondis : « Puisque je n’en ai pas eu besoin jusqu’à présent, il n’y a pas de raison que j’en aie plus besoin dorénavant ! » Le hublot était ouvert afin de permettre à l’air frais du large de pénétrer dans notre cabine où il faisait très chaud. Je le lançai alors à toute volée dans la Mer Andamanne, la poignée de cartouches suivit le même chemin. Je n’entendis même pas le plouf dans l’eau, tant le Rajula sillonnait la mer à grande vitesse. « Si tout le monde faisait de même, il règnerait bientôt la paix sur terre ! », dit John.