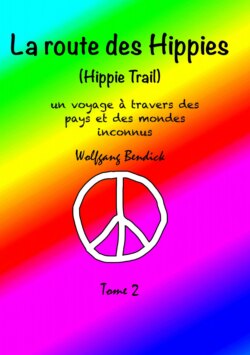Читать книгу La route des hippies - Tome 2 - Wolfgang Bendick - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LE PARADIS OUBLIE
ОглавлениеVingt heures plus tard nous accostâmes à George Town, un port de l’île de Penang, pas loin de la terre ferme malaisienne. Terminus. C’était là que se séparaient nos chemins. John partit pour Kuala Lumpur où il connaissait un hôtelier et espérait pouvoir y trouver un petit job. Sayonara, quant à lui se perdit dans la cohue et je ne devais plus le revoir. Au premier coup d’œil l’Asie du sud-est se distinguait de l’Inde par ses rickshaws différents : en effet en Inde les passagers sont assis derrière, et ici ils sont assis devant, dans une sorte de grand fauteuil avec deux roues de côté. Le conducteur est donc assis derrière, sur une partie arrière de vélo presque normal qui est raccordée au fauteuil par un axe articulé. Pour effectuer les manœuvres il se sert d’un grand arceau fixé derrière le dossier du ‘sofa’. C’est là que se trouvent également les leviers de frein, la sonnette ou le klaxon en balle de caoutchouc. Je pris mes quartiers dans un hôtel pas cher où quelqu’un qui ne comprenait pas le moindre mot d’anglais m’avait amené. J’avais la sensation de me retrouver au Japon avec ces cloisons intérieures en carton-pâte. Autres pays, autres normes sismiques, me dis-je, tout en déposant mes bagages avant de partir en reconnaissance et à la recherche de nourriture.
A l’entrée de la ville s’étendait une cité sur pilotis. A en juger aux douzaines de péniches et de voiliers de transport en bois qui tanguaient entre le môle, (la digue qui protège contre la mer), et les bâtiments sur pilotis, vivaient là leurs propriétaires, ainsi que les équipages avec leurs familles. Certaines de ces ‘maisons à échasses’ étaient inoccupées et en mauvais état, sans doute du fait que la navigation à moteur rendait difficile l’existence des navigateurs à voile. Beaucoup de sans-abris ou de réfugiés de la guerre du Vietnam et des pays limitrophes s’étaient installés ici et menaient une existence misérable. Les enfants jouaient ‘au chat’ sur les passerelles qui entouraient les maisons et de là sautaient dans l’eau, avant que le ‘chat’ ne les rattrape. Pour eux au moins c’était le paradis…
La ville regorgeait de boutiques. Penang était une zone de libre-échange où presque tous les habitants essayaient de tirer profit de cette situation. Un bac conduisait à la terre ferme qui était proche, mais il fallait d’abord passer par la douane. Dans cet enchevêtrement de boutiques de toutes sortes je trouvai une ‘agence de voyages’, où l’on me confirma qu’il n’y avait pas une place de libre pendant deux mois sur le navire qui se rendait de Singapour à Fremantle en Australie. On me recommanda alors de réserver plutôt ici. On pouvait obtenir en règle générale un visa de transit pour Singapour, mais seulement valable un jour. Ici en Malaisie je pouvais rester trois mois sans visa, mais la gérante de l’agence me consola en me disant qu’à la dernière minute il arrivait que des billets soient annulés et donc restitués. J’avais donc encore une chance de partir plus tôt et donnai trente dollars d’acompte ainsi que mon adresse à l’hôtel Aung Youn, en promettant de revenir bientôt pour que le billet ne me file pas sous le nez !
Mon futur était donc assuré et je voulais maintenant m’occuper de mon présent, c’est-à-dire manger ! Comme je ne connaissais pas les prix et que je venais d’échanger seulement quelques dollars américains contre des dollars malaisiens, je m’étais laissé surprendre. En observant la population dans les rues, j’avais l’impression qu’il y avait ¼ d’Indiens, ¼ de Chinois et la moitié de Malaisiens qui sont peut-être un mélange des deux…Comme je connaissais la cuisine indienne, je me décidai pour la cuisine chinoise. Il suffisait de regarder les panneaux des restaurants pour savoir quelle cuisine était servie, et le cuisinier pour reconnaitre en plus de ses origines la qualité de ses plats : plus il était gros, meilleurs étaient les aliments ! On me porta alors la carte en anglais, mais elle aussi était comme du chinois pour moi, c’était le cas de le dire ! Comme les noms des plats ne m’évoquaient rien, le cuisinier m’emmena dans la cuisine où je lui montrai dans les casseroles ce que je voulais manger. Il me prépara une assiette composée et me donna des baguettes pour manger et une grande cuillère en porcelaine en forme de petit bateau pour la soupe ! En attendant d’être servi, j’observais les autres clients se saisir des baguettes et je les enviais presque de les voir les manier avec tant de dextérité. Quant à moi, chacune des deux baguettes ‘menait sa propre existence’, si bien que mon repas ne tarda pas à refroidir ! Je remarquais que quand les clients n’avaient plus grand chose dans le bol ou dans l’assiette, ils la mettaient devant la bouche et enfournaient le reste avec les deux baguettes côte à côte. Je fis alors de même en commençant dans une certaine mesure par la fin. J’étais surpris par la bonne préparation des plats. On dégustait ce que l’on mangeait, les épices ne servant qu’à relever le goût. Par-dessus cela une bière bien fraiche, vu que l’alcool était autorisé et que même les Indiens présents semblaient s’en accommoder facilement ! Au moment de payer et de faire la conversion, je constatai qu’ici les prix étaient doubles de ceux pratiqués en Inde, ce qui était bon à savoir pour mes estimations de frais !
Je me baladai alors encore un peu dans les rues et découvris des halles couvertes qui grouillaient à ce moment de la journée d’enfants et d’adolescents vêtus de blanc. Ils s’entrainaient au judo, ce qui était peu courant en Allemagne à l’époque. C’était impressionnant de voir des bambins en saisir d’autres, les jeter en l’air d’un geste adroit et puis les immobiliser sur le sol. Il régnait ici une discipline de fer, car tous se mettaient en ligne droite et saluaient le maitre en faisant une révérence très respectueuse. Celui-ci faisait de même à son tour, ainsi que tous les combattants qui se saluaient avant et après le combat, et quelle qu’en soit l’issue ! L’idée de base de savoir se défendre en toutes circonstances me paraissait très bonne, mais je trouvais encore plus important d’apprendre le respect mutuel et le fair-play dans toutes les situations, même quand on perd ! Il arrivait que ces exercices aient lieu en plein air. Il y avait alors partout les tatamis nécessaires, sauf à la plage où le sable suffisait ! J’ai rencontré ces salles d’entrainement jusqu’en Thaïlande. Tout le sud-est asiatique semble s’adonner au judo, de même que chez nous on est adepte du football.
De retour à l’hôtel qui s’était un peu animé, je remarquai quelques jeunes filles attroupées et en train de discuter entre elles ou avec les clients. On aurait dit des teenagers plutôt jeunes et habillées à la mode mini, apparemment d’après moi les filles de la famille du patron, ou leurs amies ou encore leurs nièces, faisant office de petites mains en cas de besoin. Toutes me saluèrent extrêmement cordialement, et je fis de même en retour sans pouvoir dire un mot dans leur langue qui m’était totalement étrangère. Une fois dans ma chambre, je fus intrigué à la vue de quelque chose qui m’était passé inaperçu auparavant : dans les cloisons en papier mâché il y avait des boulettes de papier toilette qui semblaient obturer des orifices. Je me demandais si quelqu’un aurait par hasard tiré avec un fusil à chevrotines. En libérant un trou et en regardant à travers, je pouvais voir en détails dans la chambre qui jouxtait la mienne et qui était inoccupée. Je refermai le trou.
En bas on entendait résonner des rires. Je me rendis dans le couloir et je vis en bas quelques hommes qui venaient d’arriver sans bagages et réglaient leur chambre. S’agissait-il d’hommes d’affaire pressés ? Quelques jeunes filles les précédaient, apparemment pour leur montrer leurs chambres. Je descendis boire une bière et observai le remue-ménage de cette heure pas encore trop tardive. Une des filles s’assit à mes côtés. Je pensais qu’elle voulait me poser les questions habituelles. Mais allez-donc essayer de comprendre quelques mots de chinois ! Devais-je l’inviter à prendre une bière avec moi ? Mais ce n’était encore qu’une enfant, bien qu’elle ne fît pas son âge. Quel est en fait l’âge limite ici pour boire de l’alcool? Je revins ensuite dans ma chambre pour dormir, mais l’agitation de l’hôtel ne cessa pas et toute la nuit j’entendis des pas, des rires, des gémissements et des bruits de porte dans cet établissement plutôt bruyant. Je songeai à en chercher prochainement un autre et finis par m’endormir. A mon réveil le lendemain matin, je remarquai des boulettes de papier toilette sur mon lit ! Quelqu’un avait donc ouvert les orifices de l’autre côté et essayé de m’observer. Comme je me demandais ce qui pouvait bien se passer ici, il me vint soudain une lueur d’esprit : je me trouvais dans un bordel ou un hôtel de passe comme on dit aussi ! Cela expliquait la literie changée de frais et le prix bon marché des chambres. Ce qui justifiait le prix, c’était le supplément ! J’avais pour ainsi dire ‘loué l’assiette vide’, comme en Italie où on paye le couvert à part. J’avais dédaigné le plat principal ! Penang, la ville sans taxe ! Ici tout s’achète et même l’amour est détaxé !
Comme j’avais indiqué à l ‘agence que c’était mon domicile, je restais néanmoins encore deux jours dans cet hôtel dont j’étais sûr que tout le monde en ville connaissait l’existence en tant que bordel. L’employée a dû me prendre pour un étalon ! Le troisième jour je reçus un appel de l’agence me demandant de m’y rendre de suite, car deux billets avaient été restitués. Singapour avait immédiatement appelé l’agence pour demander confirmation. Le navire devait lever l’ancre dans deux semaines ! C’est ainsi que je payai sur le champ les 145 dollars encore dus et qui faisaient de moi le détenteur aux anges d’un billet de bateau pour l’Australie ! Le navire s’appelait ‘Australasia ‘et la traversée devait durer sept jours, ce qui me permettait de déterminer la date de mon arrivée à Fremantle! C’est ce que je fis, et puisque j’étais dans les calculs, je fis le compte en même temps de ce qui me restait et le divisais par 14. Je vis alors que j’avais plus que ce que je dépensais quotidiennement et me dis à quoi bon emporter de l’argent en Australie, alors que là-bas il est par terre dans la rue! Peut-être pas partout, mais je m’y rendais pour en gagner un peu ! Peut-être que tout homme normalement constitué aurait commandé maintenant en plus du ‘couvert’ le ‘plat principal‘ et gâté ces jeunes écolières pendant deux semaines.
Au lieu de cela je me rendis à la gare routière pour acheter un billet pour Bangkok en Thaïlande. En chemin, comme le soleil tapait parfois fort, je me procurai un grand chapeau de paille que j’entourai de ma peau de cobra qui faisait d’habitude office de bandeau dans les cheveux. Dix jours en Thaïlande..., ce ne serait pas rien! J’avais mon sac à dos sur mes épaules et le bus n’attendait que moi pour démarrer. Il était 11 heures et il devait arriver en Thaïlande à 1 heure du matin. C’était un bus thaïlandais avec suffisamment de place pour mettre les jambes et toutes les places étaient occupées. Sauf que j’ignorais que les véhicules thaïlandais n’ont pas de silencieux, juste le collecteur d’échappement. Je sursautai donc au moment où le chauffeur mit le moteur en marche. On aurait dit le bruit d’un avion qui décolle et toute conversation était impossible. De toute façon dans le bus aucun passager ne parlait l’anglais, et encore moins l’allemand. Tout au plus le bruit épargnait-il au chauffeur l’usage du klaxon ! Les gens et les bêtes se précipitaient à l’écart de la route à l’approche du bus, du moins en Malaisie. En Thaïlande tous les véhicules étaient si bruyants que les êtres vivants riverains avaient appris à vivre avec le boucan ! Plus le véhicule était bruyant, plus grand était le prestige du chauffeur, ce qui me faisait penser à mon ‘époque-mobylette’ ! Ici ce n’est pas l’étoile sur le radiateur qui compte, mais le boucan du coude du pot ! Comme tous ses collègues dans tous les pays du monde, le chauffeur du bus se prenait pour le conducteur parfait qui n’attendait que d’être découvert pour la compétition. La route lui appartenait ! Chez nous on appelle parfois les conducteurs de poids lourds les ‘rois de la route’. Ici on peut les cataloguer de ‘tyrans de la route’. J’étais assis tout à l’arrière, car j’avais été le dernier à acheter son billet, ceux-ci ayant été vendus conformément aux numéros des sièges à partir du premier et en remontant. Cela me laissait donc encore assez de chance de m’en sortir en cas de choc frontal, à condition toutefois que l’on ne s’arrêta pas, vu qu’un autre pourrait alors nous foncer dedans par derrière! Je riais de moi-même. Je n’avais qu’à ne pas monter si je craignais quelque chose, je ne devrais même pas être là !
Le bus traversa à toute vitesse de beaux paysages. Pendant un moment nous longeâmes le tracé de la côte et vîmes de temps en temps des plages de sable blanc, avant de remonter en direction des écueils d’où notre regard survolait le bleu de la mer. Après le passage de la frontière, quelques passagers descendirent et d’autres montèrent, de plus en plus nombreux, si bien que le couloir fut bientôt plein. C’était sans doute là le revenu supplémentaire du chauffeur. A un certain endroit monta un vieil homme, certainement un paysan, avec un enfant de six ans environ. Comme ils s’assirent par terre, et pour lui laisser un peu de place sur le bord du siège, je me serrai contre mon voisin et nous prîmes le gamin sur les genoux. L’homme paraissait éreinté par le travail avec ses mains calleuses et sillonnées de rides. Il ne parlait évidemment pas l’anglais, et à l’arrêt suivant je leur offris un thé. Nous reprîmes la route. A un moment donné vers 23 heures, le bus s’arrêta au milieu de l’obscurité pour faire descendre l’homme et son petit-fils. Il me proposa de l’accompagner dans son village qui était à quelques heures de marche d’ici, c’était quelqu’un du bus qui me traduisait. Si seulement il avait fait jour…! Toutes sortes de choses me traversèrent alors l’esprit, les tigres, le Viêt-Cong… Quand le bus redémarra, je me dis que j’avais peut-être raté là la chance de vivre une grande aventure. Au lieu de cela je me rendais dans la plus grande ville du pays!...
Vers deux heures nous voici donc en train de traverser les faubourgs de Bangkok et il pleut des cordes. Le bus s’arrête sur une énorme place où les rares réverbères se reflètent dans les flaques d’eau huileuses. Par chance les pluies diluviennes ont cessé. Tandis que chacun descend et suit son chemin et que le bus redémarre, je me retrouve là tout seul à côté de quelques autres bus garés un peu plus loin en bordure de la place. Il se remet à bruiner et à ce moment-là un profond sentiment de solitude m’envahit, comme si je m’étais échoué dans l’endroit le plus désolé du monde. Où puis-je donc passer les dernières heures de la nuit ? Où puis-je être dans une certaine mesure à l’abri des voleurs et des clébards?
*
Je hisse alors mon sac sur le dos et choisis une direction au hasard, en me disant que je vais bien atterrir quelque part… C’est alors que quatre personnes viennent à ma rencontre, quatre jeunes qui ont plutôt l’air inoffensifs, une constatation qui me rassure. Quiconque a voyagé sait bien que l’on a toujours un peu d’argent sur soi, et surtout que dans ces pays on en a toujours plus que les autochtones. Reviennent-ils d’une fête ? Ils me saluent en anglais, ah, c’est donc qu’ils vont au moins à la grande école et qu’ils ont des parents qui ont les moyens de donner une éducation à leurs enfants! Comme ils me demandent d’où je viens et où je vais, je leur dis que je veux aller au YMCA (sorte d’auberge de jeunesse américain) qui est loin d’ici et en plus chère, huit dollars la nuit, ils disent. « Donne-nous huit dollars et nous te trouverons un hébergement! », me disent-ils alors. Ils me conduisent dans un hangar où il y a une table de billard et deux babyfoots. Dans cet endroit qui est plutôt crasseux et mal entretenu roupillent quelques individus qui ne me reviennent pas vraiment. Je dis alors aux jeunes que l’endroit ne me plait pas et que je vais aller au YMCA. Après s’être consultés, ils me proposent de dormir chez eux en prétextant que je suis leur ami. Je les suis tout en répondant à leurs questions, pour satisfaire leur curiosité et en m’attendant à trouver une piaule d’étudiant.
Nous arrivons alors dans un quartier chic où ils se séparent. Deux d’entre eux qui sont apparemment frères m’emmènent avec eux et me disent : « Au cas où nos parents te poseraient des questions, tu dis que tu es un étudiant allemand que nous avons invité ! » Après avoir passé la nuit dans leur chambre par terre sur une natte, les parents qui ont entretemps appris qu’il y avait de la visite et ne parlent que quelques bribes d’anglais, viennent le matin me souhaiter la bienvenue en tant qu’hôte, en me faisant plein de révérences. Ils sont fiers de leurs enfants qui ont le respect d’autrui et pratiquent les règles de l’hospitalité. Il s’en suit un petit déjeuner en commun et des adieux à grand renfort de ‘Thank You ! ‘ Un des deux frères prend alors mon sac à dos pour le sortir, tandis que je salue à mon tour les fiers parents qui me font un signe depuis le pas de la porte. Celui qui a mon sac à dos prend tout à coup la fuite à l’angle d’une maison pendant que l’autre me retient, rejoint soudain par ses copains de nuit : « Ce sera dix dollars pour le gîte et le couvert si tu veux récupérer ton sac ! », s’écrie-t-il. En protestant je lui dis : « Alors c’est ça l’hospitalité thaïlandaise ? » Comme ils insistent, subrepticement je sors de ma réserve un billet de dix dollars que je leur présente. A ce moment-là, l’autre sur un signal d’eux s’approche avec le sac. « Money first ! » Ils veulent l’argent d’abord. Je suis interloqué. Celui avec le sac à dos s’approche un peu plus. Je tends alors un peu la main avec le billet, il fait de même avec le sac à dos, les autres restent à distance en attendant, je m’empare rapidement du sac et lui de l’argent, et tous disparaissent alors en courant dans différentes directions. Bienvenue à Bangkok !
C’est une ville géante dans le delta fluvial du Chao Phraya et qui est parcourue par de nombreux canaux et bras de rivières. Où que je tourne la tête, partout se dressent haut dans le ciel des tours de temples en or ou des palais. Je parcours les derniers kilomètres dans un rickshaw. Le conducteur m’explique en passant les différentes curiosités. J’ai l’impression qu’il veut me faire faire un tour de ville, mais je l’exhorte à prendre le plus court trajet pour l’YMCA où je prends un lit dans une chambre pour quatre. A cette heure de la journée je suis encore le seul, mais en soirée au retour de mon tour en ville tous les lits sont occupés. Je partage la chambre avec trois jeunes Américains, le prix est effectivement de huit dollars, mais par lit, pas par chambre ! La nuit est bruyante, car il y a toujours quelqu’un qui passe dehors en voiture et on dirait même parfois qu’il y a des courses de nuit, à entendre les moteurs qui grondent et les pneus qui grincent. Ceux qui ont une copine et une voiture viennent lui chanter la sérénade sous sa fenêtre en faisant hurler le moteur !
Pour le lendemain matin mes colocataires ont loué une embarcation avec chauffeur. Ils me demandent si je ne veux pas les accompagner contre une participation de trois dollars, ce que je trouve être une bonne idée d’après ce que j’ai vu de la ville, d’autant plus que beaucoup de curiosités sont plus accessibles ou mieux visibles depuis la rivière. C’est une embarcation à moteur lente, équipée même d’un silencieux! Nous faisons halte devant plusieurs temples et descendons les voir : l’ancien palais royal dont le caractère imposant et le luxe ostentatoire nous attirent, avec en face le nouveau, encore plus monumental et plus majestueux, avec ses toits de tuiles émaillés rouges-verts, dont les faitages sont décorés à leur extrémité de sculptures en or et se balancent avec leur forme de corne dans les airs vers le ciel ! Aussi beaux ces palais soient-ils, je trouve néanmoins qu’il y a au moins un de trop. D’énormes stupas émergent dans le ciel comme des cloches en or posées par terre, encore plus monumentaux que tous ceux que j’ai vus jusqu’à présent. Les sites des temples sont parsemés de ces stupas de toutes tailles, avec au milieu des pagodes aux toits empilés de toutes les couleurs et en or. Des statues de gardiens hautes comme des maisons et aux visages grimaçants s’appuient sur leurs épées et surveillent de chaque côté les accès aux temples. Le sol de cette ville-temple est de marbre blanc tout comme les marches. Où que je tourne la tête, tout est en céramique multicolore, en or et en marbre, décoré de la manière la plus exubérante, et les ornementations sont elles-mêmes décorées jusque dans le moindre détail. Je n’ai jamais vu encore jusqu’à aujourd’hui un site de temple aussi grandiose !
Tout reluit de propreté, il n’y a pas de puanteur qui plane sur cet ensemble, seul le parfum de l’encens se répand depuis l’intérieur des temples, dans lesquels se dressent des statues surdimensionnées le plus souvent de Bouddha assis et souriant. A la position des mains, le fidèle reconnait si le temple est consacré à l’ancien Bouddha, celui de notre ère, ou au prochain. Devant les statues sont alignés de majestueux bassins remplis de sable, dans lesquels les pèlerins et d’autres visiteurs déposent des bâtonnets d’encens. La fumée s’élève sous forme de filaments se dressant lentement dans les airs depuis les extrémités incandescentes, et se dépose en couches odorantes dans la salle. Certains bâtons de l’épaisseur d’un bras font plus de deux mètres de long et leur odeur ressemble à celle des temples lamas du Népal. En dehors du bois de santal il doit y avoir de grandes proportions de copeaux de genévrier. Là où un rayon de soleil transperce la pénombre à l’intérieur, l’encens se transforme un éclat lumineux comme le rayon d’un phare. Non content que les toits soient décorés à l’extérieur, toutes les tuiles visibles à l’intérieur, la moindre latte ou poutre, sont richement habillées d’or, d’écailles de céramique, de tissus de soie ou de pierres précieuses. Des représentations des dieux et des démons que j’avais déjà vues au Népal apparaissent ici aussi souvent, mais en or et sous une forme épurée, sans être barbouillées de sang ou de peinture.
A côté des entrées poussent des palmiers en éventail bien rangés, et des parterres de fleurs étalent la magnificence de leur palette de couleurs. On sent qu’ici les architectes ont côtoyé les artistes, car il ne règne aucun chaos mais un ordre, un ordre céleste même ! Parmi tous les visiteurs déambulent toutefois quelques moines, qui, quand ils n’officient pas dans le temple ou le monastère, parcourent la ville en mendiant ou restent assis en rangs au bord de certaines rues. Tels des princes qui en prenant donnent l’impression de donner, ils attendent patiemment une aumône en tendant l’écuelle en silence. La Thaïlande doit être un pays très pieux et très riche et de tels bâtiments ne peuvent pas naitre ni être entretenus que grâce au bénévolat. Malgré l’époque défavorable de la mousson, on trouve ici des centaines de touristes étrangers dont quelques Gis américains en permission du front. Le Vietnam et la guerre sont tout près…
Bangkok est parcourue par un labyrinthe de canaux qui ne sont pas tous identiques : il y a les canaux de prestige qui s’allongent le plus souvent en ligne droite entre les palais et les temples, il y en a d’autres au bord desquels on trouve des dépôts de marchandises d’où ces dernières sont acheminées par voie d’eau, il y en a enfin le long desquels des boutiques ou des quartiers d’habitation ornent leurs rives. On rejoint aussi beaucoup de champs et de jardins par les canaux qui se frayent souvent un chemin en serpentant à travers la végétation luxuriante. Des petites passerelles en bois conduisent vers l’eau pour permettre le chargement des péniches, tandis que d’autres servent au drainage du delta du fleuve dans le but de gagner un peu plus de surface agricole. Nous glissons avec notre embarcation au-dessus de l’eau verte comme dans un tunnel et parfois nous arrivons dans un des bras du fleuve. Le niveau de l’eau qui est partout très élevé, est déterminé par la mousson. Les plus petits canaux, ceux qui évacuent les eaux de rejet de la ville, ne sont recouverts qu’au départ avant de se déverser dans les plus grands. Par chance il ne manque pas d’eau en ce moment, et les enfants qui sautent dans l’eau depuis les embarcadères des maisons sur pilotis ne risquent rien, même pas la femme qui est en train de se savonner !
La rivière est l’artère vitale de la ville depuis des temps immémoriaux. Dans ses bras principaux, là où elle débouche dans le port, sont même amarrés quelques bâtiments de guerre, dont deux sont des frégates sans fenêtres. Pour quel genre de guerre sont-ils construits ? Ils n’ont ni pavillon, ni numéro. S’agit-il de navires américains qui se camouflent en attendant une éventuelle intervention au Vietnam ? Peut-être est-ce la raison de cette absence de signe de reconnaissance nationale ! Un cargo se fait construire à proximité dans un chantier naval, à l’aide d’une énorme grue de chantier qui met en place les structures de la passerelle préfabriquée. Des ‘embarcations-bus’ conduisent les hommes sur leur lieu de travail et les enfants à l’école. Ceux qui sont pressés prennent un ‘Speed-Boat’, une embarcation étroite profilée avec seulement deux places assises côte à côte et cinq à dix rangées. A la poupe est fixé un énorme moteur de poids lourd ou de voiture raccordé à un arbre de transmission d’au moins cinq mètres de long, sur lequel se trouve l’hélice. Cette fixation pivote et sert en même temps à manœuvrer. Le moteur bien sûr sans silencieux donne à ces ‘embarcations de course’ une telle poussée qu’elles fusent dans le sillon d’une vague d’étrave énorme en glissant presque sur l’eau. J’estime leur vitesse à plus de 70 km/h. Une petite barcasse avec certainement moins de chevaux que le speeder fait lentement remonter contre le courant du fleuve quatre chalands chargés. Ils sont si lourdement chargés que leur pont est envahi par l’eau et que seuls les hauts surbaux les empêchent de sombrer. Sur chaque chaland il y a un abri simple que l’on a élargi avec des nattes de raphia tressées et dans lequel vivent apparemment les familles. Les enfants courent sur les ponts latéraux inondés et par-dessus les haussières de remorquage vers l’avant. De là ils plongent dans l’eau pour regrimper à bord de la dernière barque. A la poupe de chaque péniche se trouve un grand safran peint de toutes les couleurs avec une longue barre sur laquelle se tient le barreur. Les écoutilles de chargement sont protégées de la pluie par des tôles ondulées demi-circulaires ou par des toits d’herbe en pointe. Aux heures de pointe il en va sur les canaux comme dans les rues, avec pour petite différence le fait que les chalands n’ont pas de freins…
Nous traversons des quartiers où les toits sont recouverts de rouille au lieu d’or, et où au lieu de canots à moteur les gens pagaient les pirogues pour aller faire les courses ou causette avec le voisin, ou encore pour se rendre dans les jardins. Souvent les vagues provoquées par les speed-boots mettent en danger les embarcations qui ne dépassent de la surface de l’eau que de quelques largeurs de doigts. Très souvent la proue est redressée à temps contre les vagues au prix d’une manœuvre rapide avec la pagaie, et en même temps l’eau qui est rentrée est écopée à l’aide d’une petite ‘pelle’ en bois. Notre embarcation fait un bruit de teuf-teuf comme un tracteur qui se déplacerait à travers les canaux. Une natte tressée nous protège contre le soleil et les averses éparses, et à chaque coude du fleuve de nouvelles surprises nous attendent. Ainsi des ‘marchands aquatiques’ pagaient dans leurs pirogues surchargées, de hutte sur pilotis en hutte sur pilotis. Les légumes s’entassent en pyramides ordonnées multicolores, et de véritables cuisines ambulantes vendent leurs spécialités qui baignent dans l’huile des poêles sur un feu de charbon de bois. Même l’artisan arrive dans sa barque, peut-être aussi le mendiant. Une ‘station-service flottante’ alimentée par un moteur se dirige vers nous.
Non loin d’un croisement de fleuve, sous les branchages d’un arbre aux larges rameaux retombants, il y a un marché flottant. Les commerçants et les marchandes ambulantes s’accrochent aux branches qui touchent presque la surface de l’eau, afin de ne pas être emportés par le courant. De tous les petits canaux arrivent des pirogues semblables à des caddies flottants et qui servent à faire les achats quotidiens. On dirait que les marchands rivalisent pour avoir la plus belle embarcation, peut-être parce que les gens préfèrent acheter là où c’est le plus beau que là où c’est le moins cher ! En tout cas on marchande à tour de bras ! Même le boucher arrive en pagayant et découpe ses moitiés de cochon sous le regard avisé de la clientèle. Presque toutes les femmes portent le couvre-chef sud-asiatique typique qui ressemble à un abat-jour. C’est un chapeau tressé en bambou finement réparti ou avec une sorte de roseau. Il est légèrement rehaussé sur un support de tête comme un petit abat-jour, ce qui permet à l’air de circuler. Plus la ville se retire, plus la végétation devient dense. Des palmiers se penchent au-dessus de l’eau, de grands arbres étendent leurs branchages largement sur la rivière, tout semble rechercher la lumière. Ici aussi un speed-boat passe parfois à toute vitesse et ses remous viennent grignoter les rivages. Le zèle ne connait pas de frontières, il est international !
Au YMCA je fais connaissance avec une Américaine qui travaille à Luang Prabang au Laos, plus au nord, dans un camp de réfugiés. Elle nous parle de son quotidien et raconte comment des milliers de gens à demi morts de faim et les victimes des mines doivent être approvisionnés. Ils cherchent des volontaires pour les aider, mais les autorités ne veulent pas délivrer d’autorisation sous prétexte que la région n’est pas sécurisée au nord. Même en territoire thaïlandais le Viêt-Cong est actif, essentiellement en perpétrant des attentats. Il paraitrait que hier on aurait fait sauter la ligne de chemin de fer reliant la Thaïlande à la Malaisie, et même le train qui passait à ce moment-là ! Bilan, cinq morts et d’énormes dégâts. Je réfléchis pour savoir si je ne vais pas la suivre à Luang Prabang et différer un peu mon départ pour l’Australie. Mais seulement des gens faisant partie d’associations humanitaires et mandatés par le gouvernement correspondant, en l’occurrence pour moi le gouvernement allemand, peuvent se rendre là-bas. Or celui-ci veut plutôt me retirer de la circulation pour cinq ans…
Le lendemain nous louâmes ensemble un taxi et nous nous rendîmes à ‘Timland’, une sorte de parc d’attractions destiné à transmettre en un jour la culture thaïlandaise au visiteur. Là, des milliers de touristes étaient dirigés vers les différentes animations, dont la plus intéressante pour moi fut de voir les éléphants à l’œuvre, tirant et faisant rouler les troncs d’arbres par terre avec leurs défenses. Les danses populaires également, les costumes des danseurs, les instruments de musique, tout cela était digne d’intérêt, sauf que c’était sorti du contexte de la vie quotidienne et fait pour ceux qui veulent en finir de la Thaïlande en trois jours, comme ce fut finalement le cas pour moi. Au terme d’une troisième nuit interrompue sans discontinuité par le hurlement des moteurs, je me rendis à la gare. La vie ici était en général trop chère. Je dépensais plus de 20 dollars par jour. Seulement les transports étaient moins chers, surtout le train. Malgré l’attentat à la bombe, c’était aussi le moyen le plus sûr! A l’endroit concerné il y avait encore les wagons endommagés couchés à côté des voies et le train traversait lentement, étant donné que les rails n’étaient pas encore complètement réparés. Aussi les trains ne respectaient plus les horaires pour limiter le risque d’attentat. En continuant ainsi vers le sud, je rencontrai, dans le même wagon, deux Allemands qui étaient arrivés il y a quelques jours à Bangkok avec un vol bon marché et voulaient se rendre en Malaisie, parce qu’on leur avait laissé entendre que la vie là-bas était plus que deux fois moins chère qu’en Thaïlande, ce que je pus leur confirmer. Je leur parlai en outre beaucoup de Penang, suite à quoi ils décidèrent d’y rester un certain temps.
Au moment de quitter le bac qui nous avait amené de la terre ferme jusque sur l’île, un conducteur de rickshaw se mit littéralement à nos trousses, et à chaque mètre que nous faisions, il baissa le prix. « Nous voulons tester la résistance de ce genre de véhicules ! », dirent mes compagnons, et ainsi à trois avec les bagages sur les genoux nous nous faufilâmes sur le siège, ce qui souleva dans les airs le module à propulsion accroché derrière avec son propriétaire ! Ce dernier surpassait déjà du double par son poids ses collègues indiens. Notre gondole se renversa par devant jusqu’ au marchepied, ce qui nous fit partir tous dans un grand éclat de rire, y compris le conducteur. Nous descendîmes tous alors car nous voulions continuer à pied, mais il insista pour continuer la course, estimant que son honneur était en jeu ! Il souleva nos sacs à dos, prit le plus lourd sur son dos, suspendit les deux autres à l’extérieur sur le côté au ‘guidon’, ce qui conférait à l’engin un volume énorme. Nous étions néanmoins en équilibre, il mit le pied sur les pédales, mais la course s’acheva au bout de 200 mètres. Un convoi funéraire d’au moins un kilomètre de long s’étirait dans la rue principale en direction du cimetière et paralysait toute la circulation.
Nous étions assis aux meilleures loges et pouvions ainsi en toute tranquillité l’observer. Il était précédé par une rangée double d’une bonne douzaine de rickshaws vides, arborant de chaque côté du siège un grand fanion noir d’environ quatre mètres de haut avec des inscriptions. Une procession d’enfants également alignés sur deux rangs suivait, avec sur l’épaule droite un fanion de plusieurs couleurs fixées à une longue tige de bambou et orienté dans le sens de la marche. Des hommes portaient d’énormes lampions ou des moulins à prières en papier, d’autres couverts d’un chapeau de paille jaune tapaient sur des tambourins noirs, tandis que des femmes portaient des chaises à porteur en papier ornées de fleurs. Il y avait aussi une timbale en forme de chaudron portée à l’aide de deux barres comme une chaise à porteur, à nouveau des rickshaws vides et plusieurs figures de temple voilées de blanc. Une fanfare militaire soufflait dans les instruments, en uniformes tropicaux et avec des casques tropicaux sur la tête, un groupe de femmes portait des chaises à porteur de papier et de soie vides sur les épaules, suivies d’un camion bleu et jaune pourvu d’un baldaquin et apparemment réservé à l’usage des cérémonies funéraires. En-dessous il y avait le cercueil, un énorme tronc d’arbre découpé dans le sens de la longueur et creusé. Des guirlandes de fleurs orange décoraient le cercueil et le camion. Des hommes habillés de toile de jute, avec sur la tête de longues capuches jaunes avec des oreilles d’ânes qui leur tombaient sur les épaules, se tenaient légèrement penchés, aux barres d’appui du baldaquin et aux balustres tout autour. Ce groupe semblait être des pleureurs professionnels, car ils étaient les seuls du convoi funéraire qui exprimaient par des lamentations sonores la souffrance des autres. Ceux qui suivaient devaient être des membres de la famille, et chacun portait par-dessus l’épaule droite un tissu jaune plié dans le sens de la longueur, le jaune étant la couleur du deuil. Le défunt avait dû être un gros bonnet, sans doute un ancien militaire, étant donné qu’il était conduit en grande pompe jusqu’à sa sépulture. D’autres rickshaws vides suivaient, ainsi qu’une foule d’autres participants à la cérémonie et de curieux. Une fois le trafic qui suivait le convoi un peu dissipé, notre trajet test put continuer.
Nous passâmes devant le bordel dans lequel j’avais logé pendant trois nuits et où les écolières continuaient certainement à rire du touriste particulier que j’avais été. J’en parlai à mes copains. « C’est ça qu’il nous faudrait ! » ricanèrent-ils. En fin de compte ils atterrirent dans un hôtel que le conducteur de rickshaw leur avait recommandé, vu que dormir comme moi sur la plage leur semblait trop risqué. Je me rendis donc tout seul au petit village de pêcheurs que j’avais découvert lors de mes précédentes pérégrinations et qui s’appelait Telok Bahang.
Je vis bientôt la mer reluire derrière les palmiers, je partis vers la gauche et marchai jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de maisons. La route débouchait sur une place ronde, à côté de laquelle se dressait un toit de tôle ondulée abritant un baby-foot et une vieille table de billard autour desquels se pressaient des jeunes. A proximité il y avait un débit de boissons dont nous avions fait plus tard un point de rencontre avec les copains, et où les pêcheurs venaient se divertir et dépenser leur maigre solde quand ils ne sortaient pas en mer. En contre-bas de cette cabane une longue passerelle en bois aujourd’hui abandonnée conduisait à la mer. Seuls quelques filets pendaient au-dessus des poutres en attendant de sécher ou d’être réparés. C’était marée basse et à droite de la passerelle trois barques de pêche à hélice attendaient là sur la plage. Ça sentait la vase, le poisson et la peinture fraiche, et d’ailleurs quelques pêcheurs étaient en train de passer au rouleau de la peinture antifouling rouge sur une coque de navire, pendant que d’autres enlevaient les algues et la peinture écaillée du fond des autres embarcations avec des racloirs. Ils me firent un signe. Je m’assis sur la passerelle et les regardais faire.
Plus tard quand le soleil se rapprocha de l’horizon, je pris mon sac à dos et laissai la passerelle pour longer la longue bande de sable blanc. J’ôtai mes chaussures et appréciai de sentir le contact du sable chaud ! Je contournai une baie tantôt dans l’eau tantôt à sec, gravis quelques rochers voisins et parvins à une autre baie où je retrouvai le sable fin et blanc, ainsi que les cocotiers qui s’inclinaient en direction de la mer, tandis qu’une légère houle parcourait doucement les vagues transparentes. Le soleil se dirigea vers l’horizon. Je trouvai un endroit entre deux gros rochers où je posai mon sac à dos et gravis le talus du rivage que la mer avait légèrement creusé. Je ramassai alors un peu de bois sec sur le rivage, bien que le meilleur soit en contre-bas, du bois de flottaison en provenance de la mer et des feuilles de palmiers sèches. Quand l’horizon doré enlaça la terre, je fis un feu en utilisant quelques cailloux pour poser ma casserole. Un demi paquet de pâtes chinoises, un cube de bouillon, une tranche de pain, ça bouillonnait déjà : « Malaysia for one dollar a day ! » « La Malaisie pour un dollar par jour ! »
Je restais longtemps assis encore sur ma couverture à regarder cette mer sombre, en cette nuit chaude où les vagues se poussaient en douceur sur le sable et où un calme presque absolu régnait. C’était un vrai régal après les trois nuits à Bangkok! Quand l’horizon disparut, je m’allongeai sur la couverture et me recouvrai du drap de lin indien, de sorte que les moustiques n’avaient plus beaucoup de prise sur moi. Les étoiles avaient déployé leur magnificence absolue et je les observais un moment, en essayant de me représenter les distances tout là-haut dans le ciel. Là où je ne pouvais plus rien voir, cela continuait quand même, car le néant est infini. Et je plane moi aussi quelque part dans tout ce bazar qui scintille, sur cette boule de poussière que quelqu’un avant nous a appelée terre, Terra, Gaïa… Encore plus dingue, mon corps de 72 kilos est exactement bâti comme l’univers : beaucoup de vide avec à l’intérieur mes atomes et mes molécules pareils à des galaxies! Et qu’en est-il donc de ce qui est encore plus grand, si l’univers tel qu’on le voit n’est lui-même qu’une molécule ? « We are stardust, we are golden… », « nous sommes poussière d’étoile et d’or… », comme le dit la chanson de Joni Mitchell dont l’air berce à présent mon sommeil…
A un moment donné dans la nuit je me réveillai, était-ce à cause de la fraicheur ou d’un bruit derrière moi dans la forêt tropicale ? Il me semblait voir une paire d’yeux lumineux qui m’observaient. Le serpent Ka ou la panthère Baghira ? Je me mis à frissonner et me glissai sous la couverture. Après avoir piqué du nez à nouveau, des salves de mitrailleuse me sortirent à nouveau de mon sommeil. J’épiais pendant un moment. Elles étaient en tout cas loin sur la terre ferme, lorsque retentit une pièce d’artillerie ou un mortier. Boum, boum, boum ! S’agissait-il de manœuvres militaires ou de la guérilla communiste ? La guerre du Vietnam avait rendu les pays limitrophes peu sûrs. Ce n’était pas seulement que le mode de vie des classes dominantes provoquait le mécontentement général, il y avait aussi le ravitaillement des guérilléros qui passait le plus souvent par les pays voisins. Je n’arrivais pas à me rendormir et réfléchissais à ce que je ferais au cas où un animal sauvage voudrait s’en prendre à moi, je pourrais toujours courir dans l’eau ou m’échapper en plongeant. Pour ce qui est des balles perdues, j’avais entendu dire que quand on entend les coups de feu c’est que le danger est passé, étant donné que les balles avancent plus vite que le son et que la mort arrive en silence pour celui qui est touché. J’entendis des coups de feu presque toutes les nuits, et quand je demandais aux pêcheurs, ils haussaient les épaules en disant que c’était loin et que c’était l’armée.
Je me réveillai quand le soleil réapparut au-dessus de l’horizon, à peu près là où j’avais entendu les coups de carabine. Je pris mon bain matinal dans l’eau peu profonde, sortis ma canne à pêche et mixai mon müesli, le tout suivi d’un petit bain de soleil juste avant que celui-ci ne devint trop fort. Mon regard tomba alors sur les noix de coco en haut sous les feuilles des cocotiers, et je me mis à escalader le tronc fibreux, ce qui ne présenta pas de difficultés sur le bas, là où il est le plus épais et légèrement incliné. Mais c’était tout. Je glissai le long de l’écorce lisse et ne dus mon salut qu’à un saut dans le sable mou. J’essayai alors à nouveau en me cramponnant au tronc, et heureusement il y avait en-dessous le sable dans lequel je me retrouvais chaque fois. Je pouvais donc rayer la noix de coco de mon menu !
Plus tard dans la matinée arrivèrent une douzaine d’étudiants avec leur professeur, à peine plus âgé que moi, en longeant la plage. Ils ramassaient des crustacés pour un projet concernant la biologie marine. Tandis que les étudiants cherchaient sous les cailloux, près du bois flottant et dans le sable, le professeur discuta avec moi, et à midi toute la troupe repartit avec les récipients pleins. Dans l’après-midi une barque à rames en bois assez grande s’approcha avec deux pêcheurs dedans. La poupe était évasée et se terminait par deux croissants en bois entre lesquels était fixée une barre ronde. Servait-elle à descendre les filets et ensuite à les récupérer ? Ils tirèrent la barque pas loin de mon campement sur le sable. Munis de haches ils se rendirent ensuite dans la forêt, d’où des coups de hache sourds ne tardèrent pas à se faire entendre jusqu’à moi. Au bout d’un moment, des mouvements à la couronne des arbres furent suivis du craquement de deux arbres qui s’abattirent dans le sous-bois. Ils tirèrent bientôt les arbres étêtés vers la plage, puis taillèrent une extrémité en pointe et nivelèrent l’autre, d’où j’en conclus qu’ils préparaient des pieux pour la passerelle d’accostage au village. Ensuite ils tirèrent les troncs dans l’eau, un pour chaque côté, jusqu’à la barque. Ils avaient fait des nœuds coulants autour des troncs pour les empêcher de sombrer dans l’eau, car le bois était plus dense que l’eau. Ils poussèrent alors la barque vers des eaux plus profondes, et pendant que l’un s’assit à la poupe, l’autre se mit à ramer debout, le regard tourné vers l’avant et en croisant les poignées des rames. Le lendemain je les vis dresser ces pieux avec des cordes le long de la jetée et les enfoncer dans le sous-sol sableux depuis un podium installé pour la circonstance moyennant une section d’arbre équipée des poignées en fer.
Les villageois avaient appris par ces deux pêcheurs en quête de bois et peut-être aussi par les étudiants, que je logeais ici à l’extérieur. Un groupe d’enfants ne tarda pas à venir voir mon campement, mon attirail de pêche et tout le reste. Après de brefs palabres entre eux, ils se mirent à me ramasser des réserves de bois flottant, car ils savaient où il y en avait. Je devais leur paraitre exotique, et comme ils ne parlaient pratiquement pas anglais, chaque fois qu’ils ne comprenaient pas, ils riaient et répétaient tant bien que mal ce que je venais de dire. Cela me faisait rire aussi, car c’était alors également incompréhensible pour moi. En tout cas le rire est le meilleur moyen de communication pour se comprendre. Je grimpai aussi haut que possible sur un cocotier jusqu’à ce que je retombe dans le sable, ce qui les rendait hilares et les faisait se tordre de rire par terre. Les plus jeunes m’imitaient et atterrissaient aussi dans le sable. Un gamin assez grand d’environ dix ans se pointa lui-même du doigt, puis pointa le doigt vers les noix de coco en haut de l’arbre et enfin vers moi. Il grimpa en utilisant les écailles du tronc comme un escalier tant que celui-ci était penché, et quand le tronc fut presque à la verticale il le saisit des deux bras sur le ventre et releva ses pieds de côté contre le tronc, presque au niveau de ses hanches, tel un crapaud qui va sauter. Il allongea alors les jambes, se tenant à l’aide des bras et avança un peu plus haut en glissant. Puis il s’agrippa autour du tronc, replia les jambes, et répéta l’opération une douzaine de fois jusqu’à ce qu’il ait atteint le sommet de l’arbre. Il secoua ensuite les noix de coco qui étaient à portée de main sous le feuillage dense et en fit tomber deux. Il se tapa alors énergiquement sur la tête et le corps et cria quelque chose qui fit rire tous les autres, puis se laissa glisser le plus vite possible en bas, sauta dans le sable, courut dans l’eau, plongea et revint en riant. De ses cheveux mouillés il se mit alors à extraire quelques grosses fourmis qui s’étaient faites un nid en haut du cocotier.
A Georgetown j’avais acheté, déjà la dernière fois, un nouveau poignard scout en remplacement de celui que j’avais cassé en Grèce, ainsi qu’une radio transistor minuscule. J’essayai à présent de trancher la première noix de coco avec ce couteau. Les enfants me regardèrent un moment, puis l’un d’entre eux me demanda le couteau et en un tour de main il avait extrait la noix de ses fibres enveloppantes. En soirée je me rendis au troquet des pêcheurs pour me payer un Fanta. Les barques étaient presque toutes de retour et les pêcheurs étaient en train de claquer le peu d’argent qui leur restait autour d’un baby-foot ou d’une partie de billard. Sur un grill étaient étendus des poissons frais qui aiguisaient mon appétit. Je me liai rapidement d’amitié avec les pêcheurs dont quelques-uns seulement parlaient un peu anglais, et appris ainsi qu’une route faisait le tour de l’île, que de nombreux temples l’entouraient et qu’il y avait même un téléphérique sur la montagne la plus élevée !
Ainsi, le lendemain matin, me voilà en train de traverser la forêt dense sur un sentier pour rejoindre la route. Je veux essayer aujourd’hui de faire le tour de l’île en auto-stop. Partout dans les branches j’entends des piaillements et des chants, et pourtant il n’y a pas beaucoup d’oiseaux qui s’offrent à ma vue. J’arrive alors à la route. L’île a un périmètre de 40 kilomètres, et donc si nécessaire je pourrais toujours rentrer à pied, car Georgetown la ville principale de l’île grouille de gens et de voitures, la campagne ici semble plutôt abandonnée.
Je me rends à pied au premier temple qui est le temple aux serpents, bouddhiste et de style chinois, avec les toits relevés aux deux extrémités en forme de corne et couverts de tuiles. Presque tout le bois est peint en rouge. Dans la cour intérieure sont plantés toutes sortes de buissons souvent dans des vases de céramique. Je dépose alors mes chaussures à côté de l’entrée du temple et m’assois un instant devant le Bouddha principal. Nulle part je ne remarque de serpents alors que les pêcheurs avaient affirmé qu’il y en avait des centaines ! Je demande alors à un moine qui s’approche et me montre sans rien dire un buisson dans l’enceinte du temple, pas loin de là où je suis assis. En m’approchant, je comprends que ce que j’avais pris pour une variété de plantes avec un bourgeon fleuri est en fait un petit serpent vert. Et il n’est pas le seul ! La moitié du buisson grouille de vie et me dévisage gueule ouverte et en tirant la langue ! Je sursaute alors et demande : « Ils ne sont pas venimeux au moins ? » « Ils le sont, mais ils ne mordent pas dans un temple ! », me répond-t-il. Quel humour ! Pourquoi ne mordraient-ils pas dans un temple? Est-ce qu’il veut me faire accéder au nirvana par un raccourci ? Il me fait ensuite faire un petit tour et me montre les différentes sortes de serpents dans leurs buissons respectifs, ce qui me fait penser un peu à des images masquées où quand on a trouvé le premier on trouve les autres plus vite. Ils s’étirent même dans des étagères de bois et autour des porte-manteaux. Pourquoi de tels temples ? Les fidèles font-ils preuve de compassion et d’un amour sans borne pour tous les autres êtres vivants? Ou bien le chemin de l’illumination intérieure doit-il être aussi accessible aux animaux ?
Mon voyage en auto-stop se poursuit malgré le faible trafic, le plus souvent d’un village à l’autre, ce qui me donne l’occasion de visiter presque tous les temples. Le prochain est celui du Bouddha gisant tout en or qui fait plus de 30 mètres de long et me sourit. Il est recouvert d’une énorme halle. Le temple des mille Bouddhas est en même temps un monastère, dans la haute tour duquel doivent se trouver mille statues de Bouddha dans des niches. Tout le complexe est construit sur la pente et ressemble à un parc géant. La voiture suivante me dépose au pied du téléphérique devant le guichet, et je décide de m’offrir un petit luxe. Je monte dans cette cabine dont le plancher à l’intérieur est composé de marches, qui se déplace sur des rails et est reliée par un câble à une autre cabine qui se trouve en haut pour le moment. Elle se met soudain en mouvement en cahotant et croise bientôt l’autre à mi-chemin à un endroit qui permet l’évitement. Je suis à plus de 800 mètres d’altitude au-dessus du niveau de la mer, et au loin je peux voir la terre ferme ainsi que des navires qui mouillent dans l’étroit chenal, tandis que derrière moi se dressent quelques chaines de montagnes recouvertes d’une épaisse forêt vierge. Dans les cimes des arbres s’ébat un clan de singes en poussant des cris stridents.
Le lendemain les étudiants sont de retour. Depuis que je loge ici dehors, la bande de plage ne cesse de rétrécir. Le professeur m’explique que dans trois jours ce seront les grandes marées, que l’eau atteindra son plus haut niveau et fera disparaitre complètement la plage, et que donc il ne me restera plus qu’à aller dormir directement dans la forêt vierge. Le professeur a alors une idée : si je veux, je peux dormir sous le toit du troquet des pêcheurs, car le propriétaire est une de ses connaissances et sera certainement d’accord. Ainsi l’après-midi je prends mes cliques et mes claques et me mets en chemin direction la ‘salle de jeux’. Comme le propriétaire ne veut rien pour l’hébergement, je lui achète du poisson frit pour qu’on ne puisse pas dire que je ne suis pas client. Et quelle n’est pas ma joie d’avoir déménagé en cette nuit à venir ! Un orage tropical qui semble ne pas vouloir s’arrêter, s’abat si violemment que j’ai peur que les éclairs frappent la cabane ou que la tempête la fasse s’envoler en mer !
Le lendemain matin je remarque un grand attroupement dans la crique. Une barque conduite à la rame, du même genre que celle qui avait transporté les poteaux, arrive en marche arrière sur la plage. A la poupe est déposé un filet dont le bout est amené à terre et où il est fixé, pendant que la barque repart à la rame et le tend lentement. Il fait 1,50 mètres de haut et possède sur le haut des flotteurs cousus dans la corde qui le soutient. Il semble légèrement alourdi sur le bas. Pendant qu’un pêcheur le descend doucement dans l’eau, la barque décrit un demi-cercle, et lorsqu’il est complètement tendu, ils ramènent son extrémité vers la plage en ramant, où il est alors pris en charge par les hommes et les femmes qui tirent en même temps les deux extrémités sur la plage. Le filet est suspendu comme un rideau dans l’eau, et oblige les poissons qui se trouvent dans la partie supérieure à nager en direction de la plage. Là les enfants sont déjà dans l’eau jusqu’au ventre et essayent d’attraper les premiers avec des épuisettes. Plus l’espace délimité par le filet est petit, plus l’eau grouille de poissons qui s’enfuient parfois jusque sur la plage. C’est maintenant l’heure de la pêche miraculeuse : les poissons sont attrapés le plus souvent à mains nues et jetés au loin sur la plage, pour que tout se passe le plus vite possible. Là ils sont ramassés facilement, étant donné que leur peau glissante et visqueuse est pleine de sable. J’ai l’impression d’être à une fête foraine, tellement l’ambiance est décontractée ! A la fin tout est partagé.
*
Les pêcheurs me demandent si je veux sortir en mer avec eux pour aller pêcher. Une virée de trente heures en mer, bien sûr que je veux ! Le départ est prévu demain vers midi et le retour le lendemain après-midi ou le soir. Je regarde l’embarcation : elle fait peut-être neuf mètres de long pour trois de large. Partir avec en haute mer ? Très bien, mais qu’est-ce que je fais de mon argent, du billet et des papiers si on coule ou si ce sont des pirates et pas des pêcheurs ? Dans la matinée je vais donc à l’Office de Tourisme où je dépose mes traveller-chèques et le billet du bateau pour l’Australie dans leur coffre-fort, puis je confie mon passeport aux deux amis allemands que j’estime fiables et laisse mon sac à dos au bistrot. Je monte donc à bord en tongs, shorts de gym et chemise, la tenue officielle de travail des pêcheurs de Penang! Avant de démarrer, il faut encore faire le plein de diesel avec un fût qui est roulé par la passerelle jusqu’à l’embarcation, ensuite on aspire avec un tuyau, et la force gravitatoire fait le reste. Un petit camion vient de livrer de la glace que chaque équipage embarque sous forme de blocs de 1m x 0,5 m x 0,25 m, en les poussant sur les planches de l’appontement jusqu’à côté de l’embarcation. Ici on fixe une poulie à un des pilotis, avec par-dessus une corde avec une pince au bout pour descendre le bloc sur le pont du bateau. Pour éviter qu’il ne glisse à cause des mouvements, on le pose sur une natte en fibres de coco. Aussitôt une partie est hachée menu avec une hache, mise dans une grosse toile pour qu’elle ne fonde pas trop vite, et entassée dans les deux petites écoutilles. On procède plus tard de la même façon avec le reste qui étant plus léger à présent, et on le stocke entier. Plus tard on répartit le tout dans les différentes caisses et corbeilles avec le butin de la pêche. L’appontement s’allonge sur une bonne cinquantaine de mètres dans la baie, et permet ainsi aux embarcations de mouiller à l’autre bout aussi par basses eaux. En ce moment il y a une bonne douzaine de bateaux de pêche amarrés, certains par groupes de deux ou trois. Il règne une agitation fébrile, car les équipages préparent tout pour la prochaine sortie, et les enfants contaminés par l’excitation du départ gambadent partout. Pourquoi partent-ils donc tous à la pêche au même moment? Est-ce un moment favorable, un négociant aurait-il un besoin urgent de poissons, ou les embarcations ne sortent-elles et ne rentrent-elles que quand le niveau de l’eau est élevé? Le problème c’est que personne ne parle anglais ! On verra bien…
Le capitaine qui est aussi machiniste et endosse tous les rôles selon les besoins, a fort à faire avec le moteur qui est le cœur et les muscles du bateau et semble assez ancien. Une légère flaque d’eau huileuse se déplace au rythme de la mer sous ses fixations et entre les membrures. Le moteur est situé juste derrière le poste de pilotage, dans un petit compartiment accessible depuis ce même endroit ou par une écoutille sur le pont. Ici ça sent le diesel, alors que partout ailleurs ç’est l’odeur du poisson qui domine. L’embarcation est prête, le filet et ses cordages sont sur le pont, prêts à être sortis. Il y a peu de place sur le rafiot, car le poste de pilotage occupe une partie du tiers arrière. Devant il y a un petit mât avec un mât de charge qui peut faire fonction de grue. Devant le mât, un arbre rotatif et transversal s’étire sur presque toute la largeur, avec de chaque côté une poupée de treuil, (un tambour en forme de jante servant à hisser), avec lesquelles les câbles du filet peuvent être récupérés en passant à côté de la timonerie. Elle sert aussi à enrouler les cordes d’amarrage, la chaine de l’ancre et à actionner le harnais de chargement. Sur le pont avant se trouvent deux écoutilles, plus une derrière la timonerie et l’emplacement du moteur, qui sont entourées d’un surbau (encadrement) de vingt centimètres et peuvent être verrouillées par un couvercle étanche.
Les premières embarcations prennent déjà la mer, notre capitaine met la manivelle en place, quelques derniers réglages au moteur, ça tourne. La transmission doit avoir une boite de vitesses avec embrayage et un volant lourd. Après la mise en rotation, quelqu’un actionne un levier, et le moteur qui est alors lié avec le volant et mis en mouvement, s’éveille à la vie dans une grande pétarade et un gros nuage de fumée, qui font passablement vibrer l’embarcation. Une fois le moteur chaud et que son régime a augmenté, tout s’apaise à peu près. Les enfants décrochent les cordes d’amarrage, les hommes poussent la proue de l’embarcation légèrement en direction de la mer, la vitesse s’enclenche dans un léger raclement, on met un peu les gaz et l’appontement disparait lentement à l’arrière. Quelques mouettes se détachent de leur escadron en cercle et se mettent à la poursuite l’embarcation, tandis qu’une brise légère vient agrémenter la croisière et que le capitaine à la barre met le cap sur la haute mer. Chaque embarcation garde une certaine distance par rapport aux autres. Ils sont quatre à bord, plus moi, ce qui fait peu de place de libre. Les deux plus jeunes descendent découper le reste de glace dans la cale.
Le capitaine actionne alors la barre (volant) qui est reliée au gouvernail par des chaines qui passent en bas du bastingage et autour de poulies graissées et qui ont pris un peu de jeu avec le temps. Devant la barre un compas magnétique est suspendu contre la paroi de la timonerie. Nous voici à présent dans la zone de pêche, on réduit la vitesse et tout le monde, mis à part l’homme à la barre, aide à mettre le filet à l’eau. Je n’ai pas beaucoup de connaissances dans le domaine de la pêche, mais je vois qu’il s’agit d’un chalut qu’on fait descendre lentement au fur et à mesure que l’embarcation avance, si bien qu’il n’en reste plus que l’ouverture, comme un entonnoir ou une grande gueule d’animal. Sur le haut sont fixés des flotteurs qui ont pour rôle, ensemble avec comme poids une chaine en bas, de lui maintenir la gueule ouverte. Une fois celle-ci relâchée avec précaution, les câbles ou ‘funes’ du chalut sont arrimés de chaque côté à la bonne longueur. Entretemps le chalut s’est bien rempli d’eau, les câbles se tendent et freinent l’embarcation. On met alors du jus dans le moteur qui a du boulot, pendant que l’équipage à son tour se repose à l’ombre pendant quelques heures, joue aux cartes et s’assoupit, adossé contre le bastingage penché et élevé de la proue du bateau.
Pour ma part je reste avec le capitaine dans l’étroite cabine de la timonerie et le regarde faire dans les moindres détails. Je lui fais signe si je peux prendre le bateau en main, et après m’avoir montré sur le compas le cap à suivre et indiqué le nombre en degrés, il me cède sa place avec scepticisme. Je répète ce nombre qui m’est incompréhensible, comme il est obligatoire de le faire sur tous les bateaux quand on prend la barre, et me concentre alors sur le compas et le gouvernail. Bientôt le capitaine qui s’est un peu détendu va fumer une cigarette avec les autres. Le temps a passé et c’est déjà tard dans l’après-midi, on n’aperçoit plus en guise de bateaux que des points sur la mer, et la terre ferme n’est plus qu’une étroite bande de terre que nous semblons longer parallèlement.
A un moment donné il faut faire une manœuvre, peut-être le capitaine a-t-il entendu au bruit du moteur que le chalut est plein, toujours est-il qu’il reprend le gouvernail en main et stoppe l’hélice. Les câbles du chalut sont alors détachés des bittes d’amarrage et enroulés autour des tambours du treuil. Le treuil est couplé au moteur, ce qui le fait tourner en continu. Par simple relâchement du câble on peut le faire tourner à vide, en le tirant, le câble s’agrippe à la ‘poupée’ et rétracte le chalut. Le moment le plus délicat est quand l’ouverture et le ventre du chalut arrivent à bord à la poupe en passant par-dessus un rouleau. Une fois le chalut sur le pont, il ne reste plus que le cul de chalut, l’extrémité fine dans laquelle les poissons sont rassemblés. Quelqu’un passe alors rapidement un nœud coulant autour, et par une petite ‘potence’ on hisse le cul à bord. Pour finir, la corde qui tient ce dernier fermé, est lâchée et le butin se déverse sur le pont arrière. Tout le monde a un visage radieux, c’est le moment le plus envoutant de la soirée : voir combien et de quelles espèces sont les poissons qui sont dans les chaluts et se déversent sur le pont, retenus seulement par les surbaux (encadrements des écoutilles) et les parois de la coque. Tout le monde est alors occupé à fond avec les montagnes de poissons du chalut. Pour ne pas gêner je me rends sur la proue, (à l’avant), d’où j’observe les opérations. Il y a quelques crabes qui se promènent en voulant se libérer de la ‘salade de poissons’ et qui sont ramassés avec adresse puis jetés dans des seaux, avant qu’ils ne prennent le large. Quelques poissons qui se sont pris dans les mailles du chalut, sont libérés de leur situation fâcheuse et jetés avec les autres, tout le reste qui est encore accroché, est enlevé et repart à la mer. Les pêcheurs doivent alors repréparer et remettre à l’eau le chalut, tout en pataugeant véritablement au milieu des poissons.
A présent il faut faire le tri. Dès le début j’avais remarqué de nombreux paniers plats entassés les uns dans les autres, et que l’on va récupérer pour les poser directement sur les poissons. J’essaye tant bien que mal de me rendre utile, tandis que des mains adroites trient les poissons qui atterrissent dans les différents paniers, et extraient précautionneusement les méduses pour les déposer dans des seaux. On ne les jette par-dessus bord que lorsque l’on récupère le chalut, pour qu’elles ne rentrent pas à nouveau là-dedans. Tout ce qui est irrécupérable est balancé loin dans l’eau depuis l’embarcation, à la grande joie des mouettes. Malgré mes efforts, je vois qu’il faut du temps, avant que l’on m’ait montré quels poissons vont dans tel ou tel panier, ce qui va par-dessus bord et comment trier par taille. Le skipper qui l’a remarqué m’appelle à la barre, allume les feux de position, des loupiotes à pétrole qui n’éclairent pas loin. Les gros navires dont nous apercevons parfois les lumières passent plus au large. Ensuite il se met lui aussi au tri. La lampe de la poupe sert aussi d’éclairage du pont, et je m’étonne que les pêcheurs arrivent à reconnaitre les poissons avec un si faible éclairage. A force de manipuler les poissons ils semblent avoir repris à leur propre compte la sensibilité de la ligne médiane de ces derniers. Un petit requin qui tente de se libérer avec de violents mouvements de la queue, est tué avec la pointe d’une gaffe et disparait dans une écoutille, avant qu’il ne fasse des dégâts. Deux heures se sont bien passées et le pont s’est lentement vidé du flot de poissons, tandis que les paniers disparaissent les uns après les autres dans les différents compartiments sous le pont, bien recouverts de glace. Avant la fin des opérations, quelqu’un avait mis de l’eau à chauffer sur un réchaud à essence et mit dedans les trois plus beaux crabes de la pêche du jour que nous nous partageâmes.
Ensuite nous fîmes tous, hormis le capitaine qui resta à la barre, une pause-cigarette suivie d’un petit dodo, en attendant de ramener une fois de plus le chalut. Après avoir récupéré le deuxième chalut, le moteur se mit à tousser. Pendant que les autres se mirent au tri, le capitaine donna quelques tours de vis et quelques coups sur le moteur. Cela n’était pas simple du tout à cause du tas de poissons sur le pont. Heureusement j’avais ma lampe de poche sur moi. Sans doute y avait-il de l’eau ou une cochonnerie dans le carburant. Et oh ! Miracle, le moteur redémarra après quelques tours de manivelle laborieux. Ainsi le chalut put à nouveau être mis à l’eau par-dessus la poupe. Avant que tout le butin ait pu être entièrement traité, l’horizon se teinta d’une légère couleur pourpre. Au lever du soleil, nous étions si épuisés qu’au lieu de contempler le spectacle, nous allâmes nous allonger pendant une heure là où on se trouvait.
Plus tard quelqu’un nous fit frire quelques-uns des plus beaux poissons que nous dégustâmes tous dans la même casserole avec les mains, accompagnés d’un peu de riz froid précuit certainement à terre. Un bon thé fort accompagna le tout et nous remit sur nos jambes, et l’on continua ainsi jusque dans l’après-midi. Depuis un moment nous avions remis le cap sur l’île, et nous remarquâmes que les autres navires avaient également changé de cap. La pêche avait été fructueuse et nous étions la première embarcation à rentrer. Tout cela me semblait être comme une sorte de compétition, dans laquelle les meilleurs prix sont pour ceux qui ramènent le plus de poissons et arrivent les premiers ! Après avoir extrait les méduses et le rebut de la dernière prise, nous jetâmes celle-ci à coups de pelle et sans les trier dans des paniers. Ces derniers, une fois le bateau amarré, quittèrent le bord en premier, furent triés à terre et vendus à de petits commerçants. La partie refroidie de la pêche fut transférée dans ses paniers depuis la cale sur le pont, puis de là sur l’appontement et ensuite aussitôt à terre, et enfin alignée à l’ombre d’un arbre. Nous n’eûmes alors plus rien à faire sur l’embarcation.
Sur l’appontement les premiers commerçants, des Chinois bien en chair aux cheveux huileux tirés vers l’arrière, fouillaient dans la glace pour inspecter la marchandise. Ils accompagnaient les paniers jusqu’à terre, posaient dessus des étiquettes de différentes couleurs extraites d’un bloc et sur lesquelles ils avaient noté quelque chose, puis les chargeaient dans un camion. J’avais l’impression que les pêcheurs travaillaient tous dans une coopérative, car c’était toujours la même personne qui négociait avec les acheteurs. Entretemps les autres bateaux arrivèrent au fur et à mesure, et des enfants accoururent en bandes sur l’appontement avec des seaux, tout en riant et en se bousculant. S’agissait-il des enfants des pêcheurs? Toujours est-il qu’ils sautaient dans les barques et récupéraient tous les invendables qui trainaient par-là, et même dans les paniers déjà triés ils arrivaient à trouver encore quelque chose qui n’était pas à sa place ou qui était trop petit. Ils partaient alors en courant avec leur seau ou leur petit panier chez eux sans payer, et parfois revenaient! Le reste de la pêche semblait appartenir à tout le monde, on ne se disputait pas les poissons, on se contentait de rire et de plaisanter beaucoup. En quoi pouvais-je bien être encore utile, j’étais trop novice dans le métier ! Je remerciai alors les pêcheurs pour la sortie en mer et les laissai à l’examen de leur bateau.
Pendant les jours qui suivirent, j’attendais leur retour avec les autres du village sur l’appontement. Nous nous retrouvions au troquet du village pour boire un Fanta ou faire une partie de baby-foot. J’essayais de leur montrer comment on jouait chez nous sans faire tourner en permanence les barres avec les figurines, mais ça les amusait davantage de les faire tourner rapidement quand la balle se rapprochait. Et quand la balle s’envolait, traversait la moitié de la cabane et atterrissait sur la table de billard, on entendait leur rire résonner jusque dans la plantation de cocotiers.
Lorsque je partis, le père du jeune Rafi, celui qui avait cueilli les noix de coco pour moi, me donna son adresse, car il voulait que je lui trouve pour son fils une place à l’école en Allemagne, afin de le sortir de la misère et lui permettre un meilleur avenir. Je n’ai pas accompli son vœu, car on n’éloigne pas un ange du paradis…
*
Le bac me déposa sur la terre ferme. J’avais récupéré mon billet et mon argent dans le coffre-fort et bu encore une bière avec les deux Allemands, qui étaient enthousiasmés par l’île mais voulaient bientôt rentrer pour éviter que leur billet de retour de Bangkok ne se périme. J’avais bien 700 kilomètres devant moi et cinq jours pour les parcourir, et en cas de nécessité il y aurait toujours le bus. Je me sentais le cœur un peu lourd en me retrouvant assis au bord de la route avec mon sac à dos, et en pensant à la communauté de pêcheurs dont j’avais partagé la vie un court instant. Leur mode de vie et de travail me paraissait idéal et leur univers sacré ! Toutefois ma soif de voyager était au moins aussi forte que ma nostalgie de les quitter. De temps en temps, je levais la main pour faire comprendre aux quelques voitures qui passaient que j’aimerais bien que quelqu’un me prenne. A mon sac à dos était accrochée la petite poupée de feutre que Marion m’avait bricolée pour mon départ et qui me riait au nez. Quelqu’un finit par me prendre pendant quelques kilomètres et me déposa dans une ville. Je continuais un peu à pied jusqu’à ce qu’elle fut derrière moi, car il n’y avait que du trafic urbain, et je préférais patienter dans un joli endroit où il y aurait de belles choses à voir, plutôt que de respirer les gaz d’échappement. Je sortis le livre de Steve et me mis à en méditer le contenu. D’après l’auteur, tous les chemins sont permis pour accéder à la découverte de soi, qu’ils soient naturels ou artificiels, qu’il s’agisse de médiation ou de yoga, ou de drogues comme le LSD. Mais dans quelle catégorie fallait-il ranger la marihuana, appelée aussi ‘herbe de Bouddha’ ou ‘ganga’ après le fleuve sacré ou la déesse? C’étaient pourtant des herbes naturelles aussi bien que la menthe poivrée ou la camomille ! Certains Sadhus se prenaient une bonne dégelée avec, et à ce que j’en avais vu, avaient déjà bien progressé sur le chemin de la réalisation de soi ! Ce n’est pas parce qu’ils dormaient sur des lits de clous, mais beaucoup étaient honorés en tant que maitres et enseignants réputés en spiritualité. Je trouve personnellement que c’est à chacun de trouver sa propre voie pour devenir un homme meilleur…
Soudain, une voiture qui s’arrêta dix mètres derrière moi, vint me tirer de mes pensées. C’était une Holden grise, une sorte d’Opel asiatique conduite par un visage pâle plutôt corpulent, aux cheveux en brosse, avec des taches de rousseur partout, à tel point que je le pris pour un Irlandais, alors qu’il s’agissait d’un Américain. Il s’appelait Terry Holmes et nous engageâmes de suite une grande conversation. En stop on se retrouve face à toutes sortes de gens très différents: certains conducteurs ne disent que trois mots et sont presque renfrognés, ce qui te fait te demander pourquoi ils t’ont pris, d’autres sont distrayants et tout se passe à merveille, et puis il y a les hyper-bavards qui te confondent avec leur psychothérapeute, et enfin les importuns pour lesquels on se demande également leur motivation à te récupérer au passage.
Au début je rangeais Terry dans ce dernier groupe, en me disant que ça faisait une éternité qu’il n’avait pas rencontré de blanc. Cela faisait toutefois déjà six mois qu’il était en Malaisie où il travaillait pour une compagnie pétrolière américaine. Il avait aussi fait beaucoup d’auto-stop dans sa jeunesse et s’était promis de prendre tout auto-stoppeur, à partir du jour où il pourrait s’échapper enfin d’un coin paumé et abandonné des dieux où il s’était échoué. Vu son âge, il faisait plutôt partie de l’époque de Jack Kerouac et des Beatniks, le mouvement qui avait précédé la vague hippie dans les années 60. A présent il avait une famille et ce job qui lui permettait aussi de voyager, mais d’une autre façon. Comme il aimerait refaire le chemin en arrière, faire comme moi, comme autrefois…! A midi il m’invita à déjeuner, et comme j’avais accepté, je voulus prendre un plat bon marché. En riant il me dit que je n’avais qu’à profiter de l’occasion, car c’était aux frais de la ‘Pacific Oil’ ! Ses enfants voyageaient aussi en stop en ce moment, sûrement quelque part dans les États Unis, et il leur souhaitait un accueil comparable à celui qu’il m’avait réservé de la part des autres automobilistes. « A Kuala Lumpur il y a la plus grande mosquée du monde, il te faudrait absolument aller la voir! », me conseilla-t-il, tout en conduisant. Nous nous trouvions à présent dans les faubourgs où une sorte d’autoroute de ville contournait le centre. En voyant l’édifice de loin, je lui dis : « Je ne veux pas m’enfoncer dans cette ville géante, toutes les grandes villes se ressemblent trop, elles sont bruyantes et la vie y est chère, je préfère aller plus loin ! » Il comprit et me fit descendre sur une voie de dégagement. Voilà une bonne distance parcourue aujourd’hui, me dis-je. Peu après, le conducteur d’un vieux pick-up me prit. Il ne parlait pas anglais, me déposa au bout de trente kilomètres et bifurqua en direction d’une plantation. Comme il allait faire nuit, je quittai la route et pris la direction d’un bosquet que je voyais pas loin sur l’autre côté de la route. J’avais bien mangé à midi, et vu l’heure pas tardive je me fis un thé, plus par tradition que par envie. Je m’allongeai ensuite sous mon drap indien, entouré par le chant strident des moustiques.
Les gens disent souvent qu’ils n’ont pas le courage de voyager ! N’est-ce pas le premier pas qui coûte? Et n’est-il pas lui-même la plupart du temps la conséquence d’une idée loufoque ou d’un rêve ? On se retrouve soudain dans un engrenage qui s’est mis en marche de lui-même, où l’on fait peut-être le premier pas sous la contrainte pour ne pas tomber, ou bien où l’on éprouve de la joie, et que l’on accomplit presque comme une danse. Le courage c’est l’acceptation du quotidien, mais son contraire est-il la peur ? La peur, c’est ce sentiment qui te taraude et te fait dresser les cheveux sur la nuque, qui te coupe la respiration et te fait devenir ‘un’ avec ta propre ombre. Ton cœur bat plus vite, tu attends là prêt à partir en courant, à te battre ou à rester caché. La peur et le courage vont souvent de pair, car l’absence de peur te rend trop audacieux, et celle du courage te fait trembler et rester assis paralysé. Quand je dors à la belle étoile, ce n’est pas nécessairement un signe de courage, c’est une forme de romantisme ou par manque d’argent. Combien de pauvres dorment à la belle étoile sans pour autant qu’on les traite de courageux! La peur surgit tout à coup, déclenchée par un bruit ou par un instinct, elle a de bons côtés dans le sens où elle incite à la prudence ! Quand j’ai mon couteau dans mon sac de couchage, ça peut-être pour les deux raisons. Cela ne doit pas pour autant pousser à se méfier de tout le monde!
Qui est l’ennemi du pauvre ? Le riche ou l’autre pauvre? Vu sous un autre angle, qui est l’ami du pauvre? Est-ce le riche ? N’est-ce pas plutôt, comme je le pense, l’autre pauvre ? Entre pauvres j’ai remarqué une grande solidarité, ils sont habitués à avoir peu et savent ce que partager veut dire. Certes, la pauvreté trop manifeste peut conduire à des actions impulsives, sans parler de la trop grande richesse… Mais jusqu’à présent jamais un pauvre n’a déclenché de guerre ! Pauvreté, richesse… Des antonymes naturels comme le froid et le chaud ou bien crées par l’homme ? Le riche n’est-il devenu riche à l’origine que par peur d’être pauvre ? Mais même si l’on examinait les origines de nos conditions de vie, cela ne changerait rien au fait que la majorité des êtres humains sont pauvres, voire très pauvres! Le système politique ou économique qui abolirait la pauvreté entrerait dans l’histoire, et son exemple servirait à l’édification de la paix mondiale. Les religions qui ne servent souvent qu’à justifier l’état présent, deviendraient superflues, et les conflits pourraient être résolus dans des manifestations sportives ! On s’interpellerait d’un « bonjour Frère! » ou « bonjour Sœur ! », et non plus d’un « bonjour Monsieur! » ou « bonjour Madame! »
On a quand même le droit de rêver, même avec un couteau sous la couverture…