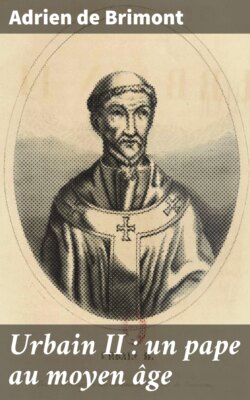Читать книгу Urbain II : un pape au moyen âge - Adrien de Brimont - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCTION
ОглавлениеTable des matières
Au moment où ce livre paraît, l’Église vient d’ajouter au triomphe de tous les siècles un nouveau triomphe de puissance, alors qu’on croyait son pouvoir anéanti; et le pontife-roi continue à dominer le monde de cette hauteur où la tiare resplendit toujours.
Rien ne démontre plus éloquemment la vitalité et l’action universelle de l’Église que la présence de ces trois cents évêques accourus à Rome, des points les plus extrêmes du globe, sur un seul désir du Souverain Pontife. Rien aussi ne fait mieux ressortir la nécessité d’une solution conforme aux vœux des catholiques que l’immense retentissement produit par tout ce qui s’est passé à Rome.
Cependant cette pacifique démonstration qui n’ébranlait aucun pouvoir, qui n’attentait à aucune liberté, semble redoubler la haine de la révolution. Impatiente et pressée, elle sonne dans son camp le glas funèbre de la papauté ; aujourd’hui comme hier, elle compte publiquement les jours qui lui restent à vivre; elle aligne les forces sous lesquelles elle espère l’écraser malgré le veto des hommes religieux; enfin elle s’apprête à entrer au Vatican, à faire défiler sous les yeux du Pape un autre cortège, d’autres images, d’autres martyrs, afin de lui donner l’avant-goût du dernier sacrifice. Le vénérable Pontife voit et pardonne, tandis que le monde entier considère avec un sentiment où l’admiration se mêle à la stupeur tant de douce résignation à côté de violences si hardies.
De tous les différents points du globe les regards sont dirigés vers Rome. L’antique cité de Romulus, la ville des Césars, purifiée et rajeunie par le catholicisme, semble porter encore une fois dans son sein l’avenir de l’humanité. Là, comme au moyen âge, se trouve encore la clef de voûte de l’édifice social; là, comme toujours, doit se trancher le nœud de toutes ces formidables difficultés amoncelées sur la tête des sociétés modernes. La révolution réclame impérieusement Rome afin de réaliser son menaçant programme, de substituer la force au droit, le fait à la tradition. De leur côté, les catholiques défendent avec ardeur le Vatican, comme le dernier boulevard de l’indépendance de leur foi et de leurs consciences. En effet, cette colline imprégnée des premières gouttes du sang chrétien, saluée par tant de générations qui sont venues courber leur tête devant ses mystérieuses destinées, est aujourd’hui l’unique abri laissé au successeur de deux cent cinquante-sept pontifes.
En dépit des clameurs de l’impiété, Rome est restée le champ d’asile de la justice bannie; c’est le port où abordent les illustres victimes renversées du trône pour avoir défendu les droits de l’Église et de leurs peuples. Autour du tombeau de saint Pierre se pressent toutes les grandes infortunes, tous les nobles dévouements, toutes les âmes d’élite qui confondent la cause de la papauté avec celle de la civilisation.
Un pressentiment universel dit aux hommes de toutes les croyances que le jour où tombera ce rempart séculaire, le torrent démagogique se répandra à travers l’Europe, jetant bas, dans sa course effrénée, religion et liberté, trônes et dynasties; mais, quel que soit le résultat de la lutte engagée, l’histoire du passé est pour nous la garantie de l’avenir. Dût la révolution s’asseoir, dans ses hideuses saturnales, jusque sur la sede santa, dût-elle partager les dernières dépouilles du souverain pontificat, la papauté trompera ses gardiens et ne semblera mourir que pour ressusciter plus glorieuse.
Ces grandes tourmentes ne sont pas nouvelles. La papauté, qu’on cherche inutilement à séparer de l’Église, dont elle est la tête, les connaît et ne les redoute pas. Oublierait-on qu’elle est l’enclume qui use tous les marteaux? Elle supportera donc le souffle des temps nouveaux comme elle a traversé les orages qui ont assailli son berceau: en parcourant ces pages on verra qu’à huit siècles de nous elle était déjà façonnée aux combats et habituée au triomphe. Aux prises avec les tyrans les plus féroces, avec ceux dont le nom retentit encore à nos oreilles comme une injure sanglante, elle a donné le sang de ses pontifes, quand d’autres persécuteurs ont préféré pour la réduire, l’exil au glaive, d’autres Papes ont porté leur vieillesse et leurs malheurs sur le sol étranger sans rien céder des principes immuables dont ils sont les dépositaires.
La papauté a donc toujours lutté contre les institutions quand elles étaient vicieuses, contre les rois quand ils opprimaient la liberté des peuples, contre les peuples quand ils sapaient les bases fondamentales de l’autotorité. Elle a lutté contre le temps, le plus impitoyable des ennemis. En un mot elle a toujours lutté, elle est toujours debout, et semble jeter un éternel défi aux passions humaines déchaînées contre une œuvre divine.
Dans ce combat permanent de la justice contre l’arbitraire, de la patience contre la force, la papauté offre un des côtés les plus saillants de sa providentielle mission: aussi préfère-t-elle des ennemis déclarés à ces pâles défenseurs du droit qui, sous le manteau d’un attachement de circonstance, cachent des animosités profondes, des rancunes implacables. Mieux vaut une guerre ouverte et acharnée; semblable au feu, la persécution retrempe les courages défaillants, réveille des sentiments de foi assoupis et fait surgir d’intrépides défenseurs en imprimant un sceau ineffaçable de gloire à l’héroïsme de leurs luttes, à l’inflexibilité de leurs convictions.
Qu’on le sache bien, le danger le plus grand n’est pas dans les agressions violentes, dans les annexions mensongères et les vols de territoire. Une répulsion naturelle aux âmes généreuses flétrit toujours le succès du. plus fort écrasant le plus faible. Mais les doctrines qui distillent le poison sous des fleurs séduisantes produisent d’effrayants désordres. Les générations qu’on abreuve aux sources corrompues du mensonge historique en conservent des traces indélébiles. Le mal pénètre les plus secrets replis du cœur, le gâte, et descend dans les profondeurs de l’intelligence, où il se développe et grandit à l’ombre des passions.
C’est à l’aide de ces perfides manœuvres qu’on désaffectionne de l’Église et de son chef tant d’esprits superficiels. Au nom de l’Évangile on demande la suppression du pouvoir temporel; au nom de la liberté on applaudit les populations des États pontificaux de s’être insurgés contre un pouvoir légitime. Partout on s’autorise des plus indignes calomnies pour attaquer la souveraineté du Pape. Cependant, en vertu de quels principes, les sociétés modernes si chancelantes sur leurs bases convulsionnées osent-elles condamner ainsi la seule institution qui soit le soutien de leur décrépitude? Pourquoi notre siècle s’est-il donné la triste mission de déclamer contre la papauté avec plus de partialité et de violence qu’aucun autre?
Un peu moins de passion, un peu plus de mémoire suffirait pour rappeler qu’aucun souverain ne s’était montré mieux disposé que Pie IX à accepter la théorie et les bases des réformes nouvelles dans la limite infranchissable de ses devoirs et de ses forces.
Que reproche-t-on aujourd’hui aux papes du moyen âge? Tyrans inflexibles, ils ont jeté, dit-on, sur tous les peuples le manteau de leur lourd despotisme, ils ont coupé les ailes à la pensée pour l’empêcher de prendre trop tôt son essor à travers les masses et retenu la liberté dans une étroite prison. Les plus hardis disent hautement «que la théorie papale est la plaie la plus horrible qui ait affligé l’Italie et le monde. Dix-huit siècles de mensonge, de persécution et de bûcher la désignent à la vindicte publique.» Voilà le bilan de la papauté dans les temps anciens.
Passons aux temps modernes. De nos jours, la papauté n’est plus qu’une vieillerie, bonne tout au plus à reléguer à Jérusalem dans un musée spécial, sous la garde de quelques vétérans, où les très-vieux et les enthousiastes seront admis à la voir s’éteindre de vieillesse et d’épuisement. Institution imbue d’idées rétrogrades, elle n’a aucune des aptitudes nécessaires pour gouverner les peuples dans les voies nouvelles de la liberté ; c’est une machine usée et sans ressorts. «Quant aux cardinaux, ils vivent au dix-neuvième siècle dans un fanatisme mystique sans songer à l’avenir, et par leur candeur ils produisent un effet de stupéfaction sur les hommes qui les entretiennent.»
Tel est l’abîme qui sépare aujourd’hui les défenseurs et les ennemis de l’Église, que les mots, en changeant de parti, s’altèrent dans leur signification: ce qu’ils appellent fanatisme mystique et insouciance coupable de l’avenir, nous l’appelons, nous, foi dans les solennelles promesses faites à l’Église. La démagogie prend pour de la candeur la noble tranquillité de cette cour pontificale, calme devant les orages qui ne peuvent atteindre ni la durée de l’Église, ni l’intégrité de ses croyances.
Pourquoi retracer davantage toutes ces diatribes impies écrites par des plumes haineuses pour des intelligences sceptiques? Qu’importent les froids sarcasmes de la presse révolutionnaire, railleuse ou courroucée, elle n’étouffera jamais le catholicisme.
Aux écrivains modernes qui usent leurs forces pour renverser la souveraineté pontificale sur laquelle pèse tout le poids de dix-huit cents ans de vie et de gloire; à ces modernes agitateurs, dont toute la renommée repose sur les menaces qu’ils ont proférées et qu’ils n’ont jamais pu réaliser, à tous ces hommes iniques nous leur dirons: Hâtez-vous, vous n’avez qu’une heure à peine pour injurier la papauté, mais elle a des siècles pour vous oublier.
Remontons donc vers les régions supérieures de l’histoire et recherchons dans la vie d’un des papes qui ont le plus énergiquement combattu pour la liberté et la justice, le gage et la préparation des futures victoires de la papauté. Mais avant, il est nécessaire de montrer comment ces immenses résultats se rattachent à la double souveraineté des pontifes romains. En les défendant au onzième siècle, nous croyons les servir au dix-neuvième siècle; ce sont les anneaux d’une même chaîne.
Pour étudier dans leur ensemble la mission et l’influence de la papauté dans le cours du moyen âge, il faut d’abord envisager l’alliance étroite de la souveraineté spirituelle et temporelle dans les mains de deux chefs suprêmes, le pape et l’empereur; puis examiner la rupture de cette alliance, les causes qui l’ont amenée, la nécessité imposée au pouvoir des papes de s’affranchir du joug impérial devenu tyrannique.
A la tête de cette mémorable époque qu’ils semblent personnifier, apparaissent deux grands hommes, Charlemagne et Grégoire VII. Considérons leurs rôles dans cette grande période historique. Après la chute de la race mérovingienne et avant le douloureux enfantement de la féodalité, la société était en proie aux secousses les plus violentes. Tout chancelait, tout s’écroulait, et la nuit la plus épaisse étendait ses ombres sur toutes les ruines, lorsque le génie civilisateur de Charlemagne se lève comme un météore lumineux. A l’Église il emprunte ses Missi dominici, dont il fait les agents de sa haute prévoyance, les exécuteurs des lois et les réformateurs des abus. Les plaids généraux, c’est encore dans les conciles qu’il en trouve la pensée première. Enfin ses Capitulaires offrent tant d’analogie avec les lois canoniques de l’Église, que quelques-uns d’entre eux ressemblent davantage, par l’esprit et par le style, à des lettres épiscopales qu’à des édits impériaux.
Charlemagne ne s’arrêta pas dans cette voie inexplorée, au-dessus de laquelle se levait un horizon radieux pour l’humanité ; il voulut cimenter plus intimemen encore l’étroite alliance de l’Église avec le pouvoir civil. On sait comment les Lombards le forcèrent de protéger le Saint-Siège en descendant dans les plaines de la haute Italie, où semblent s’être donné rendez-vous tous les grands conquérants. On connaît l’accueil qui lui fut fait dans la capitale du monde chrétien.
Le pape Adrien, entouré des cardinaux, le reçut sur les degrés de Saint-Pierre; les deux princes s’embrassèrent, et, se tenant par la main, s’avancèrent jusqu’au pied de l’autel au milieu des acclamations de la multitude. Le premier soin de Charlemagne fut de restituer au pape l’exarchat de Ravenne, Parme, Mantoue, qu’Astolphe, roi des Lombards, avait violemment arraché au domaine de saint Pierre. A son tour, le Pontife souverain conféra à l’empereur le titre de Patrice, qui était alors la plus haute dignité dont un homme pût jouir sous un maître. Enfin Charles, s’étant lié, vis-à-vis de l’Église romaine, par un serment de fidélité, reçut aussitôt le manteau royal avec le diadème: il devint ainsi roi d’Italie, mais non pas le maître de Rome, ni le régulateur de la papauté. En effet, si l’empereur, satisfait de porter le glaive pour défendre et protéger le Saint-Siége, ne prétendit jamais faire sortir de ces titres les prérogatives de la suzeraineté, c’est qu’indépendamment de son respect pour la tiare, il savait que le pape Adrien et son successeur Léon III ne pouvaient se dépouiller de leurs droits sur la ville éternelle, pour faire de leur cession volontaire la récompense d’un service.
Il n’y eut donc aucun marché, comme on s’est plu à le répéter, entre l’empereur et le Pape, disposant de ce qui ne leur appartenait pas. Aussi, lorsqu’on examine attentivement cette fameuse donation, si souvent attaquée, si souvent défendue, on n’y découvre qu’une simple restitution, faite par un prince puissant au chef de l’Église.
Rome reste donc au Pape, et Charlemagne ne fonde pas la souveraineté pontificale, qu’il savait exister avant lui. Les deux pouvoirs se donnent seulement la main et scellent dans un pacte intime l’alliance de la papauté et de la royauté. Ce pacte, qui ne semble plus qu’une lettre morte pour les écrivains superficiels ou hostiles, ouvrait une ère de repos et de bien-être pour ces peuples à peine échappés aux convulsions des guerres de conquête; il leur permettait enfin de goûter sans amertume ces fruits qu’enfante l’harmonie des pouvoirs à l’ombre de la religion et sous la protection d’une épée vigilante et chrétienne.
Laissons le maréchal du royaume d’Arles nous redire comment il comprenait le gouvernement fondé sur ces bases: «Au prêtre la prière, au roi le commandement; le prêtre remet les péchés, le roi punit les prévaricateurs; le prêtre lie et délie l’âme, le roi châtie et tue le corps. L’un et l’autre réalisent la loi divine et protègent les droits de l’humanité. Mais la royauté doit reconnaître qu’elle est coordonnée et non supérieure au sacerdoce, elle doit l’aider et non le dominer.» N’est-ce pas, en quelques mots, le seul remède efficace à opposer à nos déchirements actuels? Yves de Chartres, l’un des prélats les plus illustres du onzième siècle, s’écriait à son tour, avec un charme exquis de langage: «Le monde sera bien gouverné et l’on verra des fleurs et des fruits dans l’Église, quand l’empire et le sacerdoce se donneront la main; tant qu’ils seront divisés, ni ce qui est petit ne peut croître, ni ce qui est grand ne peut durer.
Ne voit-on pas revivre dans ce tableau poétique la pensée de Charlemagne, la conception de son génie, le désir caressé de toute sa vie? Mais le mystère se retrouve ici-bas dans tous les événements, et quand l’institution la plus robuste résiste aux orages et aux passions, elle est condamnée à périr par l’impéritie des hommes. Ce fut le sort réservé à l’œuvre de Charlemagne.
Au géant succédèrent des pygmées; la tâche parut trop lourde à ces caractères trop faibles et sans vertu; la main du pouvoir n’était plus assez ferme pour soutenir la voûte hardie élevée par l’audacieux architecte. La création du grand empereur n’avait pas besoin de génie pour se soutenir, elle n’avait aucun des caractères de ces œuvres chancelantes édifiées sur le sable et qu’un souffle peut renverser. Seulement l’édifice avait trop d’ampleur et ne pouvait se soutenir sans vertu, toujours rare, surtout parmi les souverains. Telle fut la cause de sa chute.
Bientôt une des colonnes du temple chancela, ce fut celle du pouvoir impérial. Sa chute couvrit le inonde occidental de débris: dans cette sanglante dislocation d’un vaste empire, les institutions de Charlemagne furent anéanties. L’autre colonne, représentée par la papauté, resta debout sur sa base éternelle, mais la ligue d’amour était dissoute, et avec elle s’évanouissait le symbole de cette résurrection inattendue que les peuples avaient saluée comme une ancre de salut jetée dans l’avenir.
A la lumière du neuvième siècle ont succédé les ténèbres du dixième. Comment la papauté, privée désormais de ce bras impérial, toujours armé à l’heure du péril, traversera-t-elle cette période de tempêtes? Dieu pour elle remplacera l’empereur. S’il l’éprouve par le sentiment de sa faiblesse, il lui donnera des chefs de génie pour la guider avec fermeté dans les voies de réparation.
Derrière les Alpes, ce fut fête dans le palais des Césars allemands, le jour où s’écroula l’empire carlovingien. Tendre la main à la papauté pour la débarrasser du joug des petits tyrans qui se partagèrent les peuples de l’Italie comme un vil troupeau; offrir d’être protecteur pour devenir ensuite le maître; se faire le courtisan des Papes pour les rendre plus tard esclaves; asservir la race latine au profit de la nationalité germaine; enfin gouverner Rome, et avec Rome le monde; telle fut la pensée des empereurs allemands: ils mirent une ténacité inflexible à l’exécuter, une lenteur calculée à l’entreprendre. D’abord impassibles et silencieux, ils laisseront l’Italie se déchirer pendant un siècle, s’affaiblir, s’user dans des guerres intestines et brutales; puis, quand le moment sera venu de saisir leur proie, les aigles rapaces descendront des Alpes.
Quelles sont les forces qui vont se jeter dans l’arène? On rencontre d’abord les chefs des Marches, marquis de Toscane, d’Ivrée, les ducs de Spolète et de Frioul; tous veulent jouer le rôle d’empereur; mais aucun n’a sa puissance. Paraissent ensuite les rois de Provence et de la Bourgogne transjurane; ils viennent chercher une couronne éphémère que la main de la multitude leur arrachera dans un jour de réaction.
Tous ces prétendants se haïssent entre eux, tous écrasent le peuple, qui leur sert de marchepied pour atteindre le pouvoir. Le peuple, de son côté, terne et indifférent au début de cette révolution, ne veut d’aucun maître, parce qu’il les craint tous; aucun pacte ne le lie, il reste libre de son action et s’arme contre tous. Les évêques préfèrent l’alliance des contadini à celle des nobles, tant ils redoutent leur humeur fantasque et leurs prétentions arbitraires.
Un instant les papes s’efforcent de régulariser la révolution nationale dont les tendances sont contraires à l’aristocratie arrogante, ils cherchent à discipliner le désordre; mais leur politique ne trouve pas d’écho, ils deviennent eux-mêmes les jouets des prétendants, selon qu’ils les reconnaissent ou qu’ils les repoussent.
Le lendemain de la mêlée, l’obscurité reste la même. Aucune idée n’a jailli dans ce milieu bouleversé où se précipite tout un peuple pris de vertige. L’horizon se rétrécit, la lutte s’éparpille. Toute ville devient une forteresse, toute commune s’entoure de remparts. Des piques dans toutes les mains, la haine dans tous les cœurs.
Bérenger, Gui, Lambert, Hugo, Louis de Provence et Rodolphe d’Aragon, jetés un instant sur la scène, passent et disparaissent eomme des ombres. Vainement ils font d’étranges efforts pour établir, chacun à son profit, un pouvoir condamné à périr avant d’être né. Les villes qui leur ouvrent leurs portes les chassent le lendemain. Rien ne se fonde, tout est renversé ; on n’a pas même le prétexte qu’invoqueront les siècles suivants. On n’est pas encore Guelfes ou Gibelins, mais on apprend à le devenir; on se prépare à ces luttes héroïques du douzième siècle dans un sanglant tournoi.
Au plus fort de la mêlée se présentent tout à coup de nouveaux champions; ceux-ci ne sont pas Italiens, ce ne sont pas encore les Allemands, mais ils les précédent comme des éclaireurs. Ces ennemis nouveaux, Hongrois, au nord, Musulmans, au sud, ravagent par amour de la dévastation et entassent les ruines dans des flots de sang.
En s’avançant à travers l’Italie brisée, sur ce sol divisé en fragments, d’où s’élèvent les rires implacables de la victoire, les sourdes imprécations des vaincus, où tout ce qui a vie s’agite, se tue, s’entre-choque, on rencontre les crimes les plus extravagants, on saisit les contrastes les plus étranges, les dualités les plus opposées.
Partout le crime appelle une vengeance. Dans un jour de suprême colère, Arduin, marquis d’Ivrée, traîne les évêques par les cheveux. A Pavie, les bandes hongroises, ivres de carnage, détruisent par un satanique effort quarante-trois églises, œuvres de plusieurs siècles. A côté de Marozie et de Théodora, les insolentes courtisanes, les maîtresses d’une Rome bâtarde, qui vendent leurs faveurs et le pouvoir, les yeux se reposent sur la douce et angélique figure d’Adélaïde de Bourgogne, jetée d’un trône dans un cachot, qu’elle refuse de quitter au prix de son honneur menacé.
Ne voit-on pas un antipape insulter Benoît V, lui arracher. le pallium, le dépouiller des ornements pontificaux et briser dans les mains du Vicaire de Jésus-Christ le bâton pastoral sur lequel il appuyait sa vieillesse et ses infirmités. Ici c’est Jean XI expiant dans les fers une tache indélébile et la coupable protection d’une mère trop célèbre.
Les victimes sont nombreuses: Étienne VI est étranglé, Jean VIII empoisonné, Léon V meurt de privations dans une prison, Jean X est étouffé, Bérenger poignardé, Lothaire poignardé, Lambert aveuglé par son propre frère.
«Ne semble-t-il pas, s’écrie Baronius en retraçant cette douloureuse période, que Dieu eut oublié son Église?»
Cependant l’épreuve de la papauté va changer de forme, de l’anarchie elle passera à l’avilissement. Un jour Jean XII, exténué d’une lutte sans issue, épouvanté de désastres sans cesse renaissants, demande à Otton 1er de le secourir. La prière est entendue: on n’attendait que le signal. L’empereur descend en courant dans les plaines de Lombardie, ses légions allemandes balayent devant elles tout ce qu’elles rencontrent. D’abord les Italiens tentent de résistera l’orage germanique, puis avec leur mobilité habituelle, toujours admirateurs des nouveautés, ils tournent leur colère contre Bérenger II. Cette dernière expression de la royauté dans la péninsule fuit bientôt devant la colère de ses concitoyens.
Après une agitation sans trêve de soixante-quatre années, engloutissant quatorze gouvernements et royautés, il se fait une sorte de lassitude. L’anarchie a servi à la fois à l’influence des évêques et à l’émancipation du peuple. Otton saisit ce mouvement et s’attache à l’exploiter. Au peuple, il montre l’affranchissement des communes et des cités, forme empruntée aux anciens municipes, où l’esprit républicain ne tardera pas à implanter ses agitations et ses tumultes; aux évêques, il prodigue la richesse qui corrompt et l’attache féodale qui asservit, il les enchaîne à la fortune du char impérial. Système habile et perfide qui mène à poser la doctrine des Investitures, si contraire à l’intégrité du souverain pontificat. Quant au Pape, il ne lui épargnera pas les prodigalités, instruments futurs de son machiavélisme. Soixante-quatre villes, de vastes domaines dans les Marches constituent d’un trait de plume le nouvel apanage du saint-siége.
En apposant le sceau du pêcheur sur cette charte, Jean XII signa, sans en calculer la portée, la déchéance politique des papes, et livra la papauté sans défense aux caprices d’un maître brutal. L’Église devient la propriété de la maison de Saxe et va passer, si l’on n’y met obstacle, avec la couronne impériale, aux maisons de Franconie et de Souabe.
Mais l’heure des illusions s’éloigne et le bandeau tombe enfin des yeux du Pape. Il voit la situation dans toute sa hideuse réalité. L’Église et l’Italie sont enveloppées de chaînes mystérieuses et invisibles; tous leurs mouvements sont épiés, tous les battements de leur cœur sont comptés; il s’aperçoit que lui-même il est lié sur ce trône pontifical où il se croyait encore libre. Alors son âme s’émeut, les remords l’oppressent. Il veut reconquérir cette liberté qu’il ne pouvait aliéner. Mais où est la route? toutes les issues sont fermées; une révolution profonde, radicale, s’est accomplie à son insu dans les idées; les sourdes manœuvres de la diplomatie impériale ont déjà porté leurs fruits. L’épiscopat n’est plus à lui, les évêques marchent à la suite de l’Empereur. Qu’importe, aidé de quelques nobles Romains, il secouera des chaînes devenues trop pesantes.
Alors Otton se redresse; la loi qu’il a imposée, il entend la maintenir; et pour le bien prouver, d’une main, il renverse du trône pontifical Jean XII pour y placer l’antipape Léon VIII; de l’autre, il décime par le glaive les patriciens romains et noie dans le sang leur courageuse tentative. En vain, une réaction ouvre à Jean les portes de Rome; un revers l’éloigne bientôt et la mort le saisit dans un lâche guet-apens.
Désormais le pouvoir est au chef de la fédération germanique. Mais à mesure que l’Empire grandit en Italie, l’Église captive s’arrête dans son mouvement ascensionnel, elle assiste aux guerres fratricides qui se rallument de toutes parts.
La lutte prend un caractère sauvage mêlé d’éclats sataniques et de sourds gémissements qu’elle n’avait jamais eus. Le poignard, le poison deviennent l’ultima ratio de ce siècle de fer. Les papes allemands, les papes italiens, gravissent tour à tour le siége pontifical et en tombent aussitôt. Benoît V est chassé après dix-huit jours de règne; Jean XIII, exilé ; Benoît VI, étranglé ; Jean XIV, empoisonné ; Jean XVI, chassé ; Jean XVIII a les mains coupées et les yeux arrachés. Rome est toujours le point où la lutte est la plus acharnée; c’est aux pieds de la ville éternelle que se dénouent ces drames sinistres, nés de la fureur des réactions. «0 Rome, s’écrie à cette vue un chroniqueur contemporain, Rome, combien de fois n’as-tu pas été opprimée et foulée aux pieds! Tu as été prise par le roi de Saxe, et tes peuples ont été transpercés; ta puissance est détruite; ton or et ton argent s’envolent dans la bourse des barbares; tu étais mère et maintenant tu es fille; tu as perdu tes trésors; on t’a spoliée, on t’a violée, toi qui avais trois cent quatre-vingts tours et quarante-six châteaux, quinze portes et un immense territoire. Malheureuse la cité Léonine!»
Ce récit peint l’époque; un mot d’une effrayante énergie la résume. Le genre humain, dit de Maistre, était devenu fou. L’Église, le symbole de la liberté, de la rédemption, nage dans le sang. Si, par le phénomène le plus humainement inexplicable, elle résiste à d’aussi rudes épreuves, sa chaleur ne rayonne plus, son influence est étouffée, elle est esclave avec ses évêques, esclave avec son pontife, aussi, «rien de ce qui est petit ne peut croître, rien de ce qui est grand ne peut vivre.»
C’est, entouré de ce cortège d’inénarrables misères que la société arrivait à l’an mil. Douloureuse étape dans la marche de l’humanité que ce premier millénaire! D’après une croyance fondée sur l’interprétation dés livres saints, adoptée sans contrôle par la superstition, le monde devait finir avec cette année mémorable. Il semblait en effet que la société fût à l’agonie: «la férocité et l’anarchie, la débauche et la misère étaient dans tous les États.» A ce spectacle déjà si sombre se mêlaient d’autres pronostics plus terribles encore. Au-dessus des déchaînements humains, les éléments agités dans les sphères célestes par des causes inconnues, étaient eux-mêmes en révolution. Au choc des armées, au bruit des guerres civiles, la nature irritée mêlait les plaintes de sa voix majestueuse et l’éclat de la foudre. La terre tremblait jusque dans ses entrailles les plus profondes et secouait rudement l’humanité en proie à tous les genres de délire. Partout le frisson était général.
Cependant cette universelle terreur fut salutaire, et l’humanité se prit à réfléchir. Beaucoup d’hommes, dégoûtés de ces voluptés farouches, de cette vie aux habitudes sanglantes où l’intelligence n’avait aucune part, l’âme aucun repos, jetèrent les yeux vers les cloîtres, les seules oasis de paix que les orages eussent respectées.
Les monastères vont devenir le foyer où se tremperont, pour régénérer le monde, les grands caractères et les grandes vertus.
Entre tous ces pieux asiles, Cluny commençait à jeter le plus vif éclat. Une organisation puissante, une séve. riche et jeune, une direction habile,. présageait de. grandes destinées à cet institut nouveau.
Chaque jour les portes du monastère s’ouvraient à des hommes venus des contrées les plus éloignées de l’Europe, appartenant aux classes sociales les plus opposées. Le fier chevalier, le pauvre plébéien se rencontraient sur le même seuil, dans la même prière, pour demander le froc des moines. Et ces hommes séparés par l’abîme des conditions et des préjugés, apprenaient au milieu des plus humbles travaux et dans la pratique d’une étroite charité, l’oubli des, distinctions du siècle.
Tous ces éléments différents, poussés par une force invisible vers ce camp retranché de l’Église élevé au sein d’une forêt de Bourgogne, venaient se discipliner au contact d’une règle austère et se fondre dans une puissante et indissoluble unité.
Là vivaient, à quelques années de distance, deux hommes partis des pôles les plus opposés de la société.
L’un est Hildebrand, fils d’un charpentier toscan; l’autre, Otton de Châtillon, deviendra Urbain II. Or la Providence ayant conduit Hildebrand à Rome avec le pape Léon IX, ce moine, témoin des défaillances de la papauté sous les pontifes allemands, ne songe plus qu’aux moyens de la délivrer de ses chaînes. Cette pensée le poursuit sans cesse, elle s’incarne en quelque sorte en lui; elle devient le but de tous ses travaux, le mobile de toutes ses actions; l’énergie de son caractère se mesure à l’œuvre gigantesque dont sa foi rêve l’accomplissement.
Les traités sont dénaturés, les promesses oubliées; déjà le vasselage de la papauté est une réalité ; il en résulte que l’Église est à la remorque de l’Empire. On lui retire le droit de parler dans les assemblées, elle est impuissante pour les réformes. On la traite comme une mercenaire, on l’outrage comme une captive.
Qui nomme aux évêchés, qui les vend surtout? Qui accorde l’investiture par le sceptre et par l’anneau? l’Empereur. A qui appartiennent les donations, les domaines des fidèles, les abbayes, les bénéfices et toute l’administration spirituelle? à l’Empereur. De qui dépendent l’Italie, ses peuples, ses villes, ses libertés? De qui relève enfin la papauté et le représentant du Christ? de l’Empereur. Le voilà ce fantôme qui consume la vie d’Hildebrand; il l’a reconnu, ce mauvais génie de la Péninsule et de l’Église. Alors il se lève, une voix inconnue l’inspire, une force supérieure le pousse en avant.
Tribun, il remue les passions patriotiques, il montre aux Italiens l’ennemi de leur patrie, l’oppresseur de leurs croyances religieuses. Moraliste inexorable, dur et implacable pour lui-même, il poursuit tous les actes d’iniquité. Enfin diplomate patient et habile, il conduit les affaires publiques sous cinq pontifes; par sa pénétration il soulève le voile qui couvre la politique allemande, bientôt il lui arrachera son masque.
D’un autre côté il a remarqué que plus les Romains sont impuissants et faibles, plus ils se montrent jaloux de leurs antiques prérogatives; il n’ignore pas que, pour se faire illusion sur leur véritable asservissement, ils prétendent encore nommer les souverains pontifes quand ils tremblent eux-mêmes sous le glaive impérial.
Deux papes perdirent la vie pour avoir méconnu ces étranges caprices, «N’entrez pas à Rome, avait-il écrit à Léon IX, comme l’élu de l’empereur. Présentez-vous en pèlerin désireux de visiter les lieux saints. Demandez à être nommé par le peuple et par le clergé, sinon vous périrez comme Clément II et Damase.» L’avis fut suivi, c’est là le point de départ de la réaction pontificale contre le despotisme allemand.
Cependant on approchait insensiblement d’une rupture profonde et radicale. Qui osera la tenter? L’entreprise est presque surhumaine. Quel sera le champion assez audacieux pour conduire une telle révolution? Le peuple et le clergé romain le savent, et leurs suffrages acclament Hildebrand. Le moine monte les degrés du trône pontifical encore teints du sang des pontifes martyrs; il s’asseoit enfin sur cette chaire qui ne laisse pas de repos à celui qui l’occupe.
Le pouvoir, est-il besoin de le dire, n’ajouta rien au plan de Grégoire VII; il écarta seulement les barrières et agrandit les moyens d’action.
A cette époque deux axiomes semblaient prescrire contre le droit. On croyait la force supérieure aux traités; on considérait que le pouvoir impérial était placé au-dessus de tous les autres pouvoirs. Le nouveau pape s’approche et mesure ces statues aux pieds d’argile, qu’il veut renverser. Il dégage des ombres qui les voilaient, ces idoles, l’Empire maître de l’Église, la féodalité dominant par la force. Puis aussitôt il les attaque résolûment. Sa mission consiste à arracher et à détruire pour planter et édifier de nouveau. Son but est d’émanciper le pouvoir pontifical du pouvoir impérial, de faire triompher le spiritualisme chrétien sur le matérialisme féodal, de substituer le droit à la force brutale, l’intelligence à l’arbitraire. Un étrange cartel adressé à l’empereur Henri IV inaugure le règne de Grégoire VII; il le menace de ne pas laisser impunis ses crimes et ses violences, quelque complaisance qu’il mette à reconnaître son élection.
Ce cartel renferme le cri d’affranchissement de l’Église et de la pensée; il inaugure une ère nouvelle et plus que jamais militante. Alors commence le duel entre la papauté et l’Empire avec cette solennité que l’histoire lui a conservée. Dans les camps rivaux qui vont se former, quels seront les auxiliaires de Grégoire VII? Au début de la lutte on n’aperçoit que lui-même; mais il a pris soin de nous indiquer la source où il puisait sa bouillante et indomptable ardeur, élevée à la hauteur du sacrifice.
«Il ne nous est pas permis, s’écrie-t-il, de sacrifier la loi de Dieu à des affections personnelles, et de déserter le chemin de la justice et de la vérité pour les faveurs de ce monde.» On le voit «la cause de l’Église était, à ses yeux, celle de l’humanité, de la justice sociale, comme de la foi .»
Dans l’autre camp apparaît l’Empereur avec ses puissants moyens d’action, les évêques allemands et lombards avec leur influence, l’aristocratie féodale avec son humeur turbulente; tous ces éléments s’unissent dans un pacte de colère contre l’audacieux réformateur qui brise d’un mot toutes les traditions consacrées pendant la servitude de l’Église.
Au début de la guerre, la démocratie se rangea du côté de Grégoire VII. Les peuples aiment toujours ce qui est grand et hardi, ce qui s’élève au-dessus des défaillances humaines; ils admirèrent donc instinctivement ce moine sorti de la plus humble des positions, frappant sans crainte et sans hésitation les rois prévaricateurs.
Toutefois, le caractère italien, aussi mobile qu’il est enthousiaste, rendit cet appui des masses souvent précaire. On vit les cités les plus populeuses se jeter tour à tour dans les deux camps et tourner leurs forces contre l’Empereur ou contre le Pape, suivant que l’un des deux adversaires allait l’emporter sur son rival. Là germe pour la première fois cette mystérieuse politique qui a enfanté tant de révolutions dans la péninsule, fait naître tant de héros, tant de figures bizarres et inexplicables. Luitprand, dès le dixième siècle, saisissait bien cette étrange anomalie, lorsqu’il disait du plus ingouvernable des peuples: «Les Italiens, veulent toujours deux maîtres, un roi et un prétendant, pour supplanter l’un par l’autre.»
Jamais peinture ne fut plus vraie ni plus profonde, et sous ce rapport le présent n’a pas encore donné de démenti au passé. Telle est la clef de toutes les intrigues qui se sont déroulées durant tant de siècles en Italie; telle est aussi l’explication des alternatives de succès et de revers éprouvés par Grégoire VII et par ses successeurs.
Que la politique d’Hildebrand impliquât dans son extrême développement l’idée d’une théocratie universelle, pourquoi le nier? Il n’y a rien qui surprenne dans cette réaction forcée du spiritualisme asservi contre le matérialisme; dans ce but, sans doute exagéré, il faut voir avant tout la morale du christianisme, corrigeant, en faveur des peuples, les excès du pouvoir.
Si les papes furent persévérants, les empereurs de Germanie ne se montrèrent pas moins obstinés dans leur ambition héréditaire. Vingt-neuf expéditions se succèdent en Italie; un million d’Allemands s’abattent sur ce malheureux pays, d’Otton le Grand à Conradin,
Tous ces souverains épuisèrent le sang et les trésors de leurs peuples et succombèrent eux-mêmes, avec trois dynasties impériales dans ce duel gigantesque, sans jamais modifier leurs prétentions, sans rien fonder de stable en Italie. Vingt-cinq pontifes, vieillards débiles, privés le plus souvent d’alliés, manquant toujours de ressources, déjouèrent leurs projets et sauvèrent l’Église d’un nouvel asservissement, l’Italie d’une entière servitude.
A ceux qui ne voient dans Grégoire VII et dans tous les papes du moyen âge que des despotes inflexibles, insatiables de pouvoir, s’arrogeant, comme le dit un publiciste , le droit d’ébranler et de tourmenter les peuples opposons le jugement d’un éminent écrivain: «On s’est étrangement trompé, dit M. Guizot, en représentant Grégoire VII comme un homme qui a voulu rendre toutes choses immobiles, comme un adversaire du développement intellectuel, du progrès social, comme un homme enfin qui prétendait retenir le monde dans un système stationnaire et rétrograde.» Vraies, quand il s’agit d’Hildebrand, ces paroles peuvent s’appliquer à tous ses successeurs. Citons des faits.
Lorsque régnait en France, en Italie, en Allemagne l’atroce coutume de dépouiller les malheureux naufragés rejetés par la mer, lorsqu’on osait attirer, par des feux trompeurs, sur lès récifs des côtes les navires égarés dans les nuits sombres; qui protesta contre une telle barbarie? Grégoire VII.
Qui recommanda avec une extrême sollicitude au roi de Dalmatie de protéger les orphelins, les veuves, et tous les faibles? Qui le pressa de poursuivre sans pitié l’odieux trafic des esclaves? Grégoire VII.
Quand on persécutait en Danemark de pauvres femmes, accusées de sorcellerie, qu’une grossière superstition rendait responsables des orages et de toutes les épidémies qui désolaient la contrée, c’est encore Grégoire VII qui arracha ces malheureuses victimes aux flammes du bûcher.
C’est à Grégoire VII qu’appartient la première pensée des Croisades; en quelques mots sublimes il offre spontanément son sang pour sauver les chrétiens d’Orient. «Je suis prêt à exposer ma vie pour eux plutôt que de commander à toute la terre, en négligeant de les secourir, écrit-il à Henri IV» . C’est Urbain Il qui oppose la trêve de Dieu aux crimes, aux vengeances, aux feuda meurtrières qui moissonnent la chrétienté. C’est lui qui prend sous la protection de l’Église les moines, les clercs qui se rendent aux temples. C’est lui qui abrite sous son manteau paternel les femmes, les pâtres et les laboureurs . C’est lui qui élève ces hôpitaux destinés à recevoir les infortunés atteints du mal des ardents, que repousse une société sans entrailles.
Faut-il encore citer Grégoire IX, rappelant à des sentiments d’humanité les seigneurs polonais qui faisaient garder par leurs esclaves les nids de faucons et punissaient avec cruauté les malheureux, quand les jeunes oiseaux s’échappaient.
Les voilà ces pontifes sanglants du moyen âge qu’il fallait diffamer pour n’être pas contraints de les admirer. Les voilà ces hommes si austères pour eux-mêmes, se refusant à toutes les joies matérielles de la vie, mais dont les bras étaient ouverts à tous les persécutés, dont les cœurs battaient pour toutes les douleurs humaines: d’une main ils pansaient les blessures ouvertes par les barbares, de l’autre ils signaient des édits empreints d’une exquise charité, destinés à mettre fin aux plus odieuses coutumes.
En est-il de même de nos modernes philanthropes, de ces hommes qui appellent les peuples à la régénération, en déchaînant leurs passions brutales contre toutes les institutions catholiques, contre tous les pouvoirs légitiment établis. Nous leur souhaitons de produire un jour de pareils titres à la reconnaissance de l’humanité.
Rendre à l’Église sa consistance propre et indépendante en la délivrant des tyrannies qui voulaient l’asservir, arrêter le char de la papauté, avant qu’il ne fût tombé dans l’abîme. Ce n’était pas assez pour Hildebrand. Sa mission s’étendait plus loin; il fallait encore arracher avec le feu et la flamme l’ivraie qui étouffait les vertus de l’Évangile dans le champ de l’Église, et vivifier les germes qu’elle renfermait dans son sein, en la purifiant de ses souillures. C’est à ce point de vue nouveau qu’il faut étudier les réformes sociales et religieuses, entreprises par saint Grégoire et continuées par Urbain II, pour le maintien des mœurs sacerdotales et des lois du mariage.
Pour quiconque saisit le but que s’était proposé le pontife réformateur, il est aisé de comprendre la politique persévérante, invariablement suivie par la cour romaine jusqu’au pontificat d’Innocent III; il ne fut rien changé à l’œuvre du maître; on n’eut garde de toucher aux bases sur lesquelles il l’avait fondé ; le plan tracé fut fidèlement suivi. Le temps lui donna seulement la flexibilité dont il manquait, les papes le modifièrent sans l’altérer, selon les nécessités des esprits et des mœurs.
On a attaqué avec violence les pontifes du moyen âge pour avoir heurté de front les deux pôles de la société, le sacerdoce et la famille, en défendant la loi du célibat contre un clergé corrompu, la sainteté de l’union chrétienne contre les excès scandaleux des rois et des grands. Mais avant de les condamner, il faut examiner l’état social de l’Europe, découvrir sans pitié les plus tristes plaies et sonder le mal dans toute sa profondeur.
Le clergé des dixième et onzième siècles avait singulièrement dégénéré. «Ils n’étaient plus ces évêques à qui s’adressaient les provinces, les cités, toute la population romaine, pour traiter avec les barbares; ils n’étaient plus ces hommes qui passaient leur vie à correspondre, à négocier, à voyager, seuls actifs et capables de se faire entendre dans les intérêts soit de l’Église, soit du pays». Oubliant la plus belle de leur prérogative, il arrivait que les ministres des autels ne se montraient pas toujours les défenseurs des pauvres, des veuves, des orphelins; un trop grand nombre négligeait ses nobles fonctions pour se livrer à tous les entraînements d’une vie aussi mondaine que dissolue. Au fond, il n’y a rien qui puisse surprendre dans ces tristes défaillances. Au sein d’une société procédant par bonds et par saccades, se laissant emporter à toutes les explosions d’une nature jeune et insoumise, déchirée par des passions brutales et par des guerres sanguinaires; comment le clergé aurait-il échappé, dans tous ses membres, à tant de souillures; comment se serait-il soustrait aux exemples corrupteurs qui l’enveloppaient de toute part? Le mal avait deux causes, le relâchement des mœurs et la simonie.
De tout temps le célibat avait imprimé aux ministres de l’Église, un caractère particulier, une supériorité immense. Au milieu de la société, le prêtre vivait seul parce qu’il se devait également à tous; il n’avait donc pas charge de perpétuer les races, de transmettre la fortune et ses distinctions. Sa mission était plus haut: il devait consacrer son intelligence à enseigner les dogmes, à combattre l’erreur, ses forces et sa vie à secourir, à fortifier les pauvres et les malheureux.
Veut-on savoir ce que pouvait un clergé pénétré de ce mandat divin? Aux plus mauvais jours de la barbarie, alors que la société épuisée, ne trouvait plus de soldats à envoyer contre les Huns, les Goths et les Vandales, l’Église leur avait opposé une armée de prêtres, phalange désarmée, il est vrai, mais invincible parce qu’elle était libre. Cette poignée d’hommes évangéliques marchait résolûment au-devant de l’ennemi commun; tous sacrifiaient en souriant leur vie aux farouches conquérants pour leur faire accepter la loi du Christ, pour assurer la liberté de leurs frères. On avait vu saint Loup arrêter Attila devant les portes de Troyes. Le même dévouement chez saint Aignan avait sauvé la cité d’Orléans des horreurs d’un sac. Enfin le fléau de Dieu reculait une troisième fois devant la majesté de saint Léon, couvrant Rome de son manteau sacré. Le secret de leur force se trouvait dans une vie pure et sans tache, dans l’absence de tous les liens qui enchaînent si étroitement l’homme à la terre. Au milieu d’un cataclysme général des jours de gloire brillaient encore pour l’Église.
Mais au onzième siècle tout change. Le prêtre oublie peu à peu que sa seule et unique compagne doit être la charité, que les pauvres sont ses enfants, que son existence tout entière est un sacrifice perpétuel. A dater de cet instant, son cœur, rivé à la créature par des attaches funestes, se ferme aux misères, sa main s’éloigne de la main du malheureux, son courage faiblit quand il faudrait savoir payer de sa vie la foi et la vérité que l’on défend. Aucun scandale ne fut oublié. On voyait alors des évêques, manquant des qualités du cœur et de l’esprit, acheter des évêchés; des pasteurs, devenus des loups dévorants, jeter la mitre pour se couvrir du heaume, courir la vie aventureuse des camps, spolier l’Eglise et piller les brebis du Christ. La vue de tant de dissolutions arracha un cri de douleur aux âmes restées pures. Pierre Damien apparut; censeur acerbe, mordant, impitoyable, sa plume ne recula devant aucune des turpitudes de son temps, et, nouveau Juvénal, il promena le fer rouge sur des plaies gangrenées. D’autres voix dénoncèrent le dan ger en invoquant du secours. «Rarement on trouvait un prêtre qui ne fût pas marié ou qui ne vécût pas dans le dérèglement,» s’écrie un saint moine du temps.
De tous côtés le torrent de la corruption roulait ses flots fangeux et impurs, le désordre s’élevait jusqu’aux degrés de l’autel, il était déjà monté sur le siège apostolique avec les coupables amants de Marozie. Le mal était donc au cœur de l’Église; mais le remède se trouvait aussi sous la main de la Providence. Comme on le sait, à la contagion les moines avaient opposé une vigilance active, un travail opiniâtre, une obéissance aveugle: aussi des monastères restés purs devaient sortir les réformateurs.
Mais avant d’ouvrir la croisade contre la dissolution des mœurs sacerdotales, avant de ramener le clergé à la continence que l’Eglise avait invariablement imposée à ses ministres, il devenait urgent de rendre à l’épiscopat son antique éclat en mettant un terme au trafic honteux que les rois et les hauts seigneurs féodaux faisaient des évêchés. De pareilles ventes ouvraient la porte des grandes dignités ecclésiastiques à une foule d’hommes sans considération et sans vertu. Ceux-ci, à peine revêtus de la pourpre, jetaient promptement le masque, et l’Église devenait ainsi responsable du scandale de ses ministres, alors même qu’on lui avait enlevé le droit de les élire. L’expérience avait démontré maintes fois, dit Hurter, encore protestant, «que l’Église était beaucoup mieux gouvernée lorsque les élections étaient laissées au clergé, à l’exclusion des rois et des barons.»
A différentes époques les pontifes avaient protesté contre ces scandaleux abus, les armes de l’excommunication arrêtèrent même quelques-uns des princes les plus audacieux. Mais l’organisation féodale amena la question des investitures sur un terrain fertile en controverse, rempli d’arguties et d’obscurité. L’équivoque provenait d’ailleurs de la double attribution des évêques, chefs spirituels dans l’Église et chefs temporels dans l’État.
Quoique libre en apparence, le sol au moyen âge était enveloppé de liens étroits. Héritait-on d’un fief, on était tenu de certaines charges dont nul ne pouvait se libérer, fût-on même suzerain. Les évêques n’échappaient pas à la loi commune, ils ne pouvaient tenir en fief les villes, les châteaux, les domaines attachés à leur Église, qu’en se soumettant à un symbole extérieur emprunté aux coutumes romaines ou barbares; c’est par la réception de ce symbole que la tradition se trouvait consommée. La forme la plus habituelle de l’investiture, la plus goûtée surtout par les suzerains, était la remise de la crosse et de l’anneau. Ces ornements étant regardés comme des marques du pouvoir ecclésiastique, il s’ensuivait que le prince, en les remettant à l’évêque, semblait lui conférer la puissance spirituelle. Or, si l’on considère que cette prétention avait pour conséquence immédiate d’absorber toute suprématie religieuse au profit des pouvoirs séculiers, on pardonnera sans doute à Grégoire VII et à Urbain II de s’être refusés d’inféoder l’Église à l’État. Certes, ils avaient le droit de ne pas souscrire à des exigences qui les auraient rendus nécessairement «les chapelains des rois .» Le moindre résultat de cet empiètement était de soumettre le choix des évêques au bon plaisir des souverains, qui ne manquaient guère d’annuler les élections canoniques au profit de leurs créatures.
Pendant le schisme on s’était emparé des élections à l’exclusion de l’Église; si plus tard on lui avait rendu la liberté d’élire, ce n’était qu’une vaine forme laissant subsister la contrainte de conférer la consécration épiscopale à des sujets qui avaient reçu d’avance les insignes de l’épiscopat.
Le désir de ramener aux traditions primitives l’investiture ecclésiastique ne doit pas paraître une mesure excessive de la part des papes; il ne s’agissait pas d’une vaine jalousie entre deux pouvoirs rivaux, mais d’une revendication légitime, d’une loi d’équilibre violée: en effet, les rois voulaient l’Église asservie dans l’état libre; à leur tour les souverains pontifes réclamaient la liberté dans l’État pour tous les sujets et pour tous les actes dépendant ou ressortissant de l’Église. Tout en permettant aux possesseurs de bénéfices ecclésiastiques de prêter aux princes le serment qu’ils leur devaient comme sujets, les papes étaient bien autorisés, ce semble, à revendiquer pour eux l’investiture canonique. L’exercice de ce droit si légitime leur permettait de régénérer l’épiscopat, de raviver la discipline en éloignant les mercenaires et les pasteurs indignes.
Arrivons à l’autre plaie que les papes entreprirent de cicatriser au moyen âge. Il s’agit des désordres qui auraient amené infailliblement la polygamie sans leur énergique intervention et leur inflexible rigueur. La femme une première fois réhabilitée par le christianisme, allait retomber de nouveau dans l’état d’abjection où le monde païen l’avait reléguée. Pouvait-il en être différemment alors que la force et l’arbitraire régnaient tête levée? De quelle importance sociale pouvait jouir un être faible que les lois ne protégeaient pas, que les mœurs ne respectaient plus? Considérée comme un instrument de plaisir ou un marchepied offert à l’ambition, la femme était condamnée à redescendre à la servitude, quand elle ne voulait pas jouer un de ces rôles honteux et servir aux caprices coupables des hommes. Tant que l’Eglise, gardienne des lois morales, avait été maîtresse de réfréner les dérèglements les plus licencieux, l’épouse et la mère avaient trouvé une place respectée au foyer de la famille. Mais aussi, quand l’Église fut asservie, l’abaissement de la femme devint inévitable; elle ressentit cruellement le coup qui avait atteint sa protectrice; car on la renversa aussitôt du trône que la délicatesse des mœurs chrétiennes lui avaient élevé. Le sentiment religieux n’opposant qu’une digue trop faible aux désirs qui font éclore les passions, la législation étant impuissante à frapper des actes déréglés, les rois se crurent tout permis et brisèrent les liens indissolubles du mariage.
Trop de souverains, au onzième siècle, attachèrent cette triste célébrité à leur nom, tandis que, par la plus étrange des oppositions, leurs pères avaient montré une pureté de mœurs qui contrastait avec la dépravation de leur temps. En effet, Otton le Grand et saint Henri II en Allemagne, Ladislas Ier et l’illustre saint Étienne en Hongrie, saint Canut en Danemark, saint Édouard le Confesseur en Angleterre; en Écosse, sainte Marguerite, et le pieux Robert en France, forment une pléiade incomparable et telle qu’on n’en rencontra jamais à aucune époque: chez tous ces rois, le nimbe radieux de la sainteté fait pâlir l’éclat de la couronne; ils apparaissent comme autant de colonnes mystérieuses chargées de soutenir l’édifice chrétien, alors que les pontifes romains s’endorment dans une coupable inertie sur la chaire de saint Pierre. Avec la génération suivante, une révolution étrange s’opère: l’axe de l’Église semble reporté de nouveau sur le siège apostolique; mais si les papes se relèvent à la hauteur de leur mission, les princes deviennent à leur tour les contempteurs de toutes les lois divines et humaines. Que dire du roi de Hongrie Boleslas Il, poignardant un saint évêque qui lui reprochait le scandale de ses adultères , enlevant les plus nobles femmes de son royaume pour assouvir sa luxure? Quelle excuse invoquera-t-on en faveur de l’empereur Henri IV, lorsqu’il soumettait l’impératrice Praxede aux traitements les plus inouïs , lorsqu’il faisait traîner de vive force dans son palais des jeunes filles ou des femmes célèbres par leur beauté? Et Philippe Ier, avec moins de violence, mettait-il plus de retenue dans ses désordres? Le divorce qui suivit la captivité de la reine Berthe et l’enlèvement de la trop fameuse Bertrade de Montfort parlent assez haut.
En face de pareilles turpitudes comment oserait-on reprocher aux papes leur sévérité ? Cette fois encore n’ont-ils pas rempli une noble tâche en rappelant aux rois que les privilèges de la grandeur laissent tous les hommes égaux devant les lois imprescriptibles de la morale? N’avaient-ils pas raison de protester hautement contre les outrages qu’on infligeait à la famille et aux mœurs? Le divorce laissé aux caprices des princes aurait conduit les nations septentrionales à la dégradation des institutions et des races par la polygamie; les peuples à des révolutions sanglantes par des guerres successives soulevées entre des prétendants rivaux. On le voit, c’était éviter au peuple bien des crises, bien des secousses à une époque où elles n’étaient que trop nombreuses. Répétons avec de Maistre «qu’aucun œil ne saurait apercevoir les bornes où se serait arrêté un tel débordement.»
Au début de ces réformes, les âmes élevées qui avaient échappé aux souffles délétères des vices sociaux, les intelligences dont le matérialisme n’avait pas terni l’éclat, applaudirent aux courageux efforts des souverains pontifes. Parmi ces contemporains si rares, on aime à rencontrer des femmes supérieures à leur siècle: il semble que leur nature pénétrante, si pleine de compassion et de douceur ait mieux senti les généreuses aspirations de Grégoire VII et d’Urbain II, mieux compris l’élévation de leurs vues, l’héroïsme de leur entreprise, tout au profit de l’humanité faible et opprimée.
L’histoire nous montre la Jeanne d’Arc de la papauté, Mathilde de Toscane, vouant son influence, sa vie, son épée au soutien des idées rénovatrices, dépensant tout le zèle de sa belle âme, toute l’ardeur de ses convictions, à la défense d’une cause qui était celle de la civilisation. Grégoire VII trouva dans cette femme supérieure des trésors d’affection et de confiance qui réparent les fatigues du génie; «une de ces amitiés pures où l’âme des grands lutteurs aime à se reposer.» A côté de cette fidèle alliée des papes, apparaît une autre figure non moins touchante; c’est une autre Mathilde, elle est reine d’Angleterre, épouse d’un illustre conquérant: s’il ne lui est pas permis d’offrir ses domaines et son sang à l’Église, elle propose spontanément à son chef toutes les pierreries de ses écrins, tous les joyaux que le pouvoir lui a donnés. Le noble désintéressement de saint Grégoire refusa les trésors de la reine, il n’accepta que les prières de la chrétienne.
Dans les annales de la papauté il existe encore une page sublime que les ennemis du saint-siége voudraient arracher, parce qu’elle proteste éloquemment contre la destruction de la souveraineté pontificale. Il s’agit des pontifes romains défendant l’Italie dans sa nationalité et dans son indépendance. Pour mieux ternir leur noble patriotisme, pour décrier plus sûrement leur politique si paternelle, on a dit «que les papes n’avaient jamais combattu que pour assurer leur domination religieuse ou pour satisfaire leur ambition personnelle .» A entendre ces accusations, ne semble-t-il pas que le flambeau des dissensions civiles n’ait jamais emprunté son sinistre éclat qu’aux incendies allumés par les haines et les vengeances de la cour romaine.
Rétablissons les faits dénaturés par les passions. Quelle pensée poussait vers la Péninsule ce million d’Allemands armés de fer? Avaient-ils pour but exclusif de combattre l’autorité spirituelle des papes? Il semble cependant que l’Italie, pour elle-même, entrait quelque peu dans leurs convoitises, qu’ils n’allaient pas guerroyer seulement pour une idée, mais bien pour asservir et dominer une contrée belle, riche et productive.
Pourquoi reculer devant la vérité ? Ne vaut-il pas mieux avouer «que si l’autorité des empereurs avait duré, l’Italie eût été réduite à l’esclavage?» rien n’est plus exact, et l’on peut en croire pour cette fois M. de Voltaire, à qui de tels aveux échappent rarement.
Mais où cherchera-t-on l’élément de résistance contre l’étranger? D’où jaillira l’étincelle qui allumera dans les cœurs ces nobles dévouements à la patrie que l’Église a toujours respectés? En dépit de toutes les calomnies, il faut encore rencontrer ici, sur le chemin si étroit du dévouement patriotique, les souverains pontifes; les premiers ils protestèrent, au nom de l’Évangile, contre une oppression injuste; ils revendiquèrent pour l’Italie et pour l’Église les gages de paix et de sécurité auxquels a droit toute société ; enfin, chefs suprêmes d’une religion qui avait jeté chez tous les peuples les germes du droit et de la justice, ils adjurèrent les envahisseurs d’abandonner leur proie. La résistance des papes révélait une pensée trop généreuse pour être méconnue. Aussi tous les amis sincères de la liberté, tous les Italiens qui voulaient sincèrement que leur patrie fût forte, leurs cités indépendantes, se groupèrent-ils autour du Saint-Siège: là il n’y avait pas de mécomptes à redouter, mais tout à espérer de l’Église, qui aime la liberté. Ils avaient compris cette généreuse pensée, les Guelfes, ces libéraux du moyen âge qui ne cessèrent d’être les alliés du Vatican.
Le comte de Maistre, qu’on retrouve partout où il s’agit de défendre la papauté, affirme que dans les guerres soulevées entre l’Italie et l’Allemagne, les papes firent leur devoir de princes italiens et de politiques sages en prenant parti pour la Péninsule. Ajoutons que les luttes célèbres de Grégoire VII, de Paul III, de Jules II prouvent assez haut qu’on peut être pape et rester Italien.
La haine des ennemis de l’Église a pu seule représenter la souveraineté pontificale comme une arme dangereuse. Aux neutres elle offrait une sécurité profonde, aux faibles une protection efficace; elle intimidait seulement les ennemis de la religion par le respect et la majesté dont elle entourait le chef de la catholicité. En un mot, jamais pouvoir, comme l’a dit si judicieusement une grande autorité, ne fut plus humain, plus honnête et plus fort avec moins de désir de le paraître. Si la reconnaissance tenait une place plus large dans la mémoire des peuples, les Italiens se rappelleraient que leur patrie ne fut pas germanisée grâce à l’intervention énergique des papes.
Sans doute à ce tableau de la souveraineté temporelle on trouvera des ombres, peut-être même des taches. Mais où n’y en a-t-il pas? Si quelques papes ont trop aimé le pouvoir pour le faste qu’il procure, si quelques autres ont préféré les qualités du capitaine à celles du pontife, ils ont expié durement ces rares faiblesses. Ce qui a mérité à tant d’autres souverains le titre pompeux de conquérant, leur a valu les implacables sévérités des partis. Ces exceptions, nous les déplorons, mais sans songer à les voiler, car elles portent un enseignement profond pour la fragilité humaine, en même temps elles font rejaillir un merveilleux éclat sur toute la série si longue des papes irréprochables. Qu’on établisse un parallèle entre les souverains pontifes et tous les princes qui ont réuni comme eux dans leurs mains cette double puissance théocratique et monarchique, en trouvera-t-on beaucoup, en Russie ou en Angleterre, qui se soient montrés aussi pénétrés de la grandeur de leur mission, aussi modérés, aussi humains dans l’exercice de leur redoutable pouvoir que les souverains de la Rome catholique!
Mais quelle était donc cette souveraineté si forte de sa faiblesse? d’où venait cette royauté qui n’avait pas la conquête pour base? disons-le en deux mots: au sortir des catacombes on sait comment Rome éleva d’elle-même un trône à la nouvelle religion; on se rappelle qu’elle lui donna droit de cité dans ses murs, qu’elle compta ses plus nobles citoyens parmi les chrétiens; en un mot l’Église siégea à côté des Césars ses persécuteurs, et malgré eux. Lassés un jour de frapper cette religion étrange sans jamais la détruire, ils finirent par l’accepter. Mais, à peine converti, Constantin transporta brusquement le siège de l’empire à Byzance. Un secret pressentiment l’avertit sans doute que l’heure était venue pour Rome de séparer sa fortune de celle des empereurs. La Rome païenne, écrasée sous le fardeau de sa gloire et sous le poids de ses vices, la ville éternelle, devenue le centre du monde, le gouffre hideux d’une dissolution sans nom, avait besoin d’une régénération complète pour grandir et monter vers les destinées immortelles où l’appelait le christianisme. Effrayé de cette tâche surhumaine, Constantin la laissa tout entière aux souverains pontifes. Tel est le point de départ de la suprématie temporelle: «seuls gardiens de Rome, les papes en sont demeurés les seuls maîtres.»
Sous la domination des empereurs de Byzance, la situation devint plus précaire encore. Ces maîtres de l’Italie qui la laissaient déchirer, ces princes qui voulaient tous les bénéfices du pouvoir, mais qui en repoussaient toutes les charges, abandonnèrent les papes sans ressources, sans secours, au milieu des peuples aux abois.
Sait-on ce que souffrirent les souverains pontifes en voyant ces longues colonnes d’Italiens entraînés en exil? Loin de cette Rome exposée à toutes les violences, ces malheureuses victimes pouvaient leur redire, avec l’accent de la résignation chrétienne, ces mots prononcés naguère avec tant d’amère ironie: morituri te salutant. Les papes ouvrirent les trésors de l’Église pour racheter leurs concitoyens. Lorsqu’ils furent vides, saint Grégoire, déchiré de douleur, fit un suprême appel aux empereurs de Byzance. «Il a fallu que je visse de mes yeux, s’écrie-t-il, les Romains la corde au cou comme des chiens de meute, conduits en France pour être vendus au marché.» Voilà quel était le doux protectorat des Maurice et des Phocas pour leurs sujets italiens.
Quand vinrent les Lombards, puis Charlemagne, puis les Hongrois et les Allemands, toute trace de l’autorité des souverains du bas empire avait disparu. Déjà les bastions de la féodalité s’élevaient de tous côtés; une ceinture de petits tyrans enveloppait la ville éternelle, et s’arrachaient les lambeaux du domaine de saint Pierre. Les populations brisées virent dans les évêques de Rome le seul pouvoir encore debout pour défendre leurs droits. A leurs yeux, le représentant du Christ était le champion le plus ferme de la liberté, l’espérance la plus solide de l’avenir, le seul sanctuaire où la justice, traquée partout, pouvait chercher un asile.
La force même des choses avait conduit l’Église à s’emparer de la direction morale des peuples de la Péninsule. Pour continuer son rôle pondérateur entre les différents pouvoirs sortis graduellement de cet amas de ruines, il fallait à l’Église un rempart sacré, aux souverains pontifes une demeure inviolable. Le vicaire de Jésus-Christ pouvait-il devenir le sujet d’un prince? Quel État aurait pu compter le pontife-roi au nombre de ses citoyens? Le bon sens et l’histoire démontrent donc que la souveraineté temporelle n’est pas née d’une révolte victorieuse. N’est-il pas évident qu’elle est l’expression la plus éclatante de la volonté des peuples, «le résultat d’une de ces nécessités impérieuses devant lesquelles se brisent tous les obstacles, parce que le doigt de la Providence s’y montre à côté de la libre action des hommes?»
On a dit que toutes les grandes pensées du moyen âge datent du règne de Grégoire VII ou en sont les émanations. Rien n’est plus juste. Ce sont ces germes laissés sans vie au milieu d’un chaos immense que nous verrons se développer par les efforts persévérants d’Urbain II. C’est l’œuvre du réformateur chrétien, ramenée à de justes proportions et dégagée de cette exagération inhérente à toute réaction vigoureuse, que l’on étudiera sous le pontificat de son successeur. Toutefois, avant de montrer Urbain II aux prises avec les plus redoutables difficultés, poursuivant la noble tâche que lui avait laissée saint Grégoire; avant de présenter les travaux du disciple, il fallait, on le comprend, connaître la vie du maître. L’un et l’autre se tenaient par des liens trop étroits pour les séparer.
Sans doute Urbain, à huit siècles de distance, passe inaperçu à côté de la grande figure de Grégoire VII, qui éclaire tout son temps. La raison en est fort naturelle. Il est difficile, on le sait, de succéder à un grand homme, plus difficile encore de supporter le lourd fardeau qu’il laisse en mourant. Urbain II a eu l’habileté de triompher de quelques-uns des obstacles qui avaient signalé le règne précédent, et la modestie bien rare de ne jamais revendiquer aucune part des succès dus à ses persévérants efforts.
Pontife suprême, placé entre deux papes martyrs du droit et de la justice, Urbain leur servit de trait d’union. Considéré comme un des anneaux de cette chaîne qui part du pêcheur de Galilée et remonte à travers les temps, et malgré les révolutions et les tempêtes humaines, jusqu’ au vénérable Pie IX, il est digne d’appartenir à cette dynastie pontificale dont chaque règne ajoute à l’édifice catholique une pierre où brille un nom glorieux par son génie ou par sa sainteté.
Otton de Châtillon apparaît encore comme une des illustrations les plus pures dont la France puisse justement s’enorgueillir. Au milieu de la pléiade si nombreuse de célébrités qui se sont élevées sur notre sol, on ne saurait oublier que la Champagne a donné à l’Église un illustre pontife, à l’humanité un de ses bienfaiteurs les plus généreux, en établissant la trêve de Dieu, celle muraille de justice élevée entre la faiblesse et la force, entre les agresseurs et leurs victimes. Enfin la France, en cédant aux paroles entraînantes d’un de ses enfants qui lui demandait sa foi et sa bravoure pour reconquérir le tombeau du Christ, s’est placée depuis ce jour à la tête de toutes les grandes nations chrétiennes.
Ce qui caractérise Urbain, ce n’est pas le génie qui crée, mais la patience qui attend, et la volonté qui exécute. Nature moins ardente que Grégoire VII, il plie la tête sous les flots de l’adversité sans se roidir contre ses coups mais, la bourrasque passée, il reparaît avec calme et sérénité, le gouvernail à la main, conduisant le vaisseau de l’Église vers ses immortelles destinées. Sans connaître ni fatigue ni repos, il creuse à travers, mille obstacles ce chemin tracé par Grégoire VII, qui devait mener la papauté au siècle de Léon X, en traversant les pontificats d’Innocent III, de Boniface VIII et de Jules II.
En grandissant les papes comme ils le méritent, nous n’entendons pas diminuer la gloire de l’Italie dans ces siècles éloignés; sans doute, l’impétuosité de ses passions, le farouche éclat de ses excès, méritent le blâme le plus sévère. Mais comment résister au charme infini qui entraîne vers cette terre magique, où toutes les causes généreuses trouvaient des poètes, toutes les idées, des défenseurs, toutes les luttes, des héros, toutes les théories, des champions, et toutes les folies, des admirateurs? Comment se défendre d’aimer cette terre prédestinée aux gloires les plus étonnantes, aux catastrophes les plus lugubres? Comment rester froid et indifférent devant l’Italie de la décadence, courbant sa tête sous le flot sans cesse montant des invasions; expiant ses siècles de grandeur par des siècles d’abaissement, comptant ses désastres et ses douleurs par tant de ruines superposées?. Qu’on ne l’oublie pas, il n’est pas une ville d’Italie, pas un monument, pas une pierre qui n’aient porté l’empreinte du fer ou du marteau de ses conquérants, date impérissable de leur sanglant passage.
Au sortir de tant de convulsions, on s’attend à trouver l’Italie épuisée, agonisante. Par le plus étrange des prodiges, il n’en est rien. A l’aurore du moyen âge, elle apparaît, au contraire, forte, robuste, vivace, amoureuse des arts, folle des nouveautés; on la voit tout accueillir avec passion, tout détruire avec frénésie. En lisant son histoire, on sent comme un souffle brûlant s’élever de cette terre volcanique; il semble qu’elle renferme en elle une source de vie éternellement féconde. Quelle chaleur de sang, quel débordement de séve chez ce peuple qui compta sept mille guerres intestines en cinq siècles! Quelle singulière énergie n’avaient-ils pas, ces hommes qui saisissaient l’arc et la pique pour se faire Gibelins parce qu’ils comptaient des ennemis parmi les Guelfes! Avec quelle stupeur profonde ne voit-on pas Orvieto sonner l’insurrection du haut de ses beffrois par lassitude du bien-être, Florence par excès d’embonpoint ! Jamais sol n’entassa plus de grandeur, plus de décombres, plus de poussière humaine. Jamais nation n’eut une exubérance de vie plus intense, plus exagérée.
O Italie, patrie de Grégoire VII et du Dante, ton origine illustre était écrite sur ton front! dans tes veines coulaient le sang des maîtres du monde; ta race était la plus ardente des races: Rome la tête de l’univers, le foyer de chaleur qui réchauffait les génies les plus vastes. Quel était le secret de cette étrange destinée? Ne faut-il pas le chercher dans le dessein mystérieux de la Providence, qui avait préparé ce sol pour y faire croître le grand arbre du Christianisme?
Lorsque, arrivé sur le seuil du moyen âge, on soulève le voile qui cache les siècles nouveaux; quand on descend avec la rapidité de la pensée le fleuve du temps jusqu’ à nos jours, avec quelle religieuse terreur ne voit-on pas les empires, les royaumes, les dynasties s’écrouler; les institutions, les lois, les races entières périr et disparaître, entraînées dans le mouvement du grand cycle humain! Au milieu de ce champ de ruines immenses où sont entassés les œuvres et le souvenir de tant de générations, l’œil s’arrête et se repose sur ces antiques cathédrales que le fer des niveleurs n’a pas su détruire. Ces monuments gigantesques d’une foi robuste, ces témoins du passé, les seuls debout pour le faire revivre à nos yeux, nous représentent l’Église. Comme ces temples, l’Église a entendu gronder les orages les plus formidables comme eux, elle a traversé les crises les plus effrayantes; autour d’elle se sont élevés aussi les cris sauvages de ses ennemis, dont la haine s’accroissait de toute leur, impuissance à la détruire. Mais elle a vaincu tous les oppresseurs, bravé toutes les attaques, déjoué tous les complots. Elle a même épuisé la série si longue des persécutions, enfantées par le délire des passions humaines. Aussi, de nos jours, les ennemis de l’Église et de la papauté sont-ils condamnés à chercher leurs armes dans les arsenaux de l’impiété passée. Voilà pourquoi les annales de l’histoire nous offrent souvent un décalque fidèle des événements modernes.
Qu’on nous permette en finissant d’en citer un exemple; il ranimera les courages défaillants, il convainquera les antagonistes de la souveraineté pontificale de l’impuissance de leurs attaques.
Au commencement du douzième siècle parut en Italie un homme aux passions ardentes: on le nommait Arnaldo de Brescia; tribun éloquent, rationaliste habile, démagogue fougueux, il se fit le défenseur et l’apologiste des idées républicaines; les remit en honneur par ses déclamations brûlantes, en réveillant dans les masses les souvenirs de l’ancienne Rome. A sa voix un parti puissant, dont il était l’âme, se soulève contre les pouvoirs établis et les renverse. Le flot populaire, à peine sorti de son lit, roula bientôt contre le Vatican, où le poussait des influences occultes. L’esprit d’indépendance et de vertige qui régnait alors à Rome fit ouvrir les portes de la ville éternelle. On proclama la république sous la suzeraineté de l’empereur d’Allemagne. Le pape Eugène III, mis en fuite, transporta son siège à Viterbe. Le premier acte des révolutionnaires romains fut de supprimer la puissance temporelle des souverains pontifes et de les réduire aux aumônes volontaires des fidèles. On ne s’arrêta pas à ce premier succès. Conrad III fut invité, au nom des agitateurs, à venir résider à Rome, pour en faire le siége du nouveau pouvoir. On prétendait de la sorte appliquer la parole du Christ: «Mon royaume n’est pas de ce monde; rendez à César ce qui est à César. » Qui ne connaît la suite? L’orage passé, les papes rentrèrent dans la capitale du monde catholique. Les criminelles utopies vinrent se briser contre la souveraineté pontificale qu’elles prétendaient abattre. Les doctrines d’Arnaldo furent dispersées comme ses cendres: au lieu d’un échec on avait ménagé un nouveau triomphe à la papauté.
A voir ce tableau, ne semble-t-il pas qu’il porte le millésime de 1849, à moins qu’on ne préfère y voir une esquisse contemporaine sous des noms d’un autre âge? On y retrouve non-seulement les grands traits, mais jusqu’aux moindres détails du drame qu’on espère jouer à Rome. Mêmes menées, mêmes moyens, même but. Tout est semblable. Les hommes seuls ont changé, mais les révolutionnaires de nos jours ne renieraient pas les agitateurs du douzième siècle. Du côté des victimes les ressemblances ne sont pas moins frappantes. Comme Eugène III, Pie IX a défendu le patrimoine de saint Pierre contre les attaques impies; comme lui la tourmente révolutionnaire l’a contraint de fuir; il est enfin rentré avec une armée alliée dans la ville éternelle, comme Adrien IV.
Toutefois ce parallèle ne serait pas exact, si on l’arrêtait aussi brusquement. Quel œil ne voit pas sans épouvante le chef actuel de la catholicité aux prises de nouveau avec les éléments de désordre qui ont fait flétrir le moyen âge du nom de barbare? Certes, il faut bien l’avouer: aujourd’hui Pie IX est le champion de la force morale contre la doctrine du fait accompli, du droit contre la violence, de la liberté contre l’oppression. Sans doute les adversaires de la civilisation par le Christianisme, ne sont pas de nos jours les Césars allemands. Ce ne sont plus les prétentions des maisons de Souabe qui jettent le deuil dans l’Église. Au dix-neuvième siècle, c’est une idée subversive de toute morale, de tout principe, de toute autorité ; elle s’appelle la Révolution; elle a pris les oripeaux du pouvoir, le langage de la diplomatie, l’épée des capitaines, la voix même des théologiens; elle a revêtu tous les masques pour mieux dissimuler toutes les turpitudes. Protée insaisissable, elle a parcouru triomphalement l’Europe. Rome est aujourd’ hui l’objet de ses convoitises sacriléges. C’est sur les ruines fumantes de la dernière souveraineté qu’elle prétend planter le drapeau de l’indépendance des peuples. Voilà l’ennemi. En face de lui se dresse l’Église. L’enjeu est Rome, ou mieux la papauté ; car lorsque la révolution aura fait le Pape sujet, elle espère bien le faire esclave, oubliant sans doute que les papes envoyés et assistés par Dieu vivent libres ou meurent martyrs. Chaque heure, chaque minute rendent plus solennel ce duel entre la vérité et l’erreur, entre l’ordre et l’anarchie. Le pontificat de Pie IX semble réservé, comme celui de Grégoire VII, à une lutte gigantesque; tous deux paraissent marqués au cachet des grandes épreuves, parce que tous deux sont destinés à une mission régénératrice dans l’ordre providentiel. Si l’avenir se cache derrière un horizon obscur, au moins l’espérance dans des promesses inaltérables nous reste. D’ailleurs, quand une cause compte un passé de dix-huit siècles, quand elle fait battre deux cents millions de cœurs, lorsqu’elle trouve du sang pour défendre ses principes, de l’or pour subvenir au luxe de ses charités, quand enfin cette cause a un saint pour chef, un habile ministre pour défenseur, et par-dessus tout la main de Dieu pour bouclier, elle n’a rien à redouter du temps et des révolutions, des orages et des persécuteurs.
En résistant aux séductions et aux menaces, en pardonnant les calomnies, Pie IX a prouvé qu’il était digne des pontifes martyrs dont l’Église a conservé le nom vénéré à travers les âges. Grégoire VII, exilé à Salerne, disait au nom de la papauté ces sublimes paroles que répétait Pie IX à Gaëte: «J’ai aimé la justice, j’ai haï l’iniquité.» Ainsi se résume la vie de tous les papes; c’est l’explication de leurs épreuves et la garantie de leur triomphe.
Paris, le 8 juin 1862.