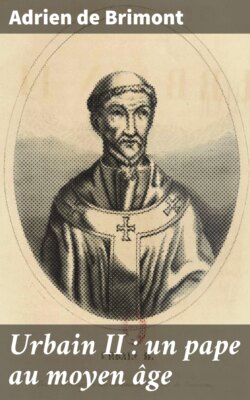Читать книгу Urbain II : un pape au moyen âge - Adrien de Brimont - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеTable des matières
A Cluny, une prudente sévérité présidait à l’admission des novices. L’habit monastique ne se donnait jamais avant vingt ans, et le consentement de l’abbé était toujours indispensable. De son côté le novice devait justifier qu’il était issu d’un légitime mariage. On exigeait encore de lui qu’il fût robuste et assez instruit pour remplir convenablement le service de Dieu. Après la réception il était aussitôt confié à la direction d’un religeux grave, doux et parfaitement au fait de la constitution de l’ordre. Ce maître initiait le novice aux devoirs du chœur, aux règles de la communauté.
L’étude des livres saints était l’objet d’un soin tout particulier. On lisait l’Ancien et le Nouveau Testament tout entier dans le cours d’une année; la lecture commencée à l’église se continuait au réfectoire, de telle sorte que le livre de la Genèse devait être terminé pendant la semaine de la septuagésime; le Pentateuque et les trois livres suivants à l’entrée du carême. Le dimanche de la Passion on récitait la prophétie de Jérémie jusqu’au jeudi saint, puis venaient, à Pâques, les Actes des apôtres, l’Apocalypse et les épîtres catholiques. Enfin les livres des Rois, de Salomon, de Job, de Judith, d’Esther, d’Esdras et des Machabées servaient uniquement de lecture pendant le repas.
La psalmodie prescrite par les usages de Cluny était beaucoup plus longue que celle des Bénédictins. Depuis le 1er novembre jusqu’à la semaine sainte, on disait tous les jours de férie avant les nocturnes, trente psaumes, quatre à laudes et à vêpres, deux à complies et cinq à prime. Enfin, lorsque les moines avaient ajouté les sept psaumes de la pénitence avec les litanies et quatre psaumes pour les défunts, ils avaient satisfait aux exigences de la règle. La récitation du psautier prenait un temps si considérable, qu’il restait à peine une demi-heure pour parler aux jours où il était permis de le faire.
On accordait une attention particulière à la célébration des offices du dimanche. Trois messes se succédaient: la première dite Messe matutinale, la seconde en l’honneur de la Trinité, enfin la troisième, la plus solennelle, où se consommaient les hosties conservées dans un ciboire suspendu au-dessus de l’autel; puis on en consacrait de nouvelles destinées aux malades et aux mourants.
Aux grandes fêtes la pompe déployée était extrême: de somptueux tapis de Turquie couvraient le chœur et les stalles, les religieux se revêtaient d’aubes, enfin l’église resplendissait du feu de mille lumières.
La nuit du jeudi saint et les deux nuits suivantes, au lieu de chanter les quinze psaumes graduels et les leçons de Jérémie, on prononçait les lettres de l’alphabet hébraïque; puis les psaumes étaient récités à voix basse, et à mesure qu’ils s’achevaient on éteignait successivement tous les cierges de l’autel. Ensuite on bénissait le feu nouveau qu’on tirait d’une variété d’éméraudes nommées. béryl. C’était en outre l’usage, ce jour-là, de laver les pieds à autant de pauvres qu’il se trouvait de religieux dans la maison; l’abbé en choisissait d’autres pour remplacer les amis et les bienfaiteurs absents du monastère. La cérémonie se faisait dans le cloître: on donnait à chaque pauvre une oublie en signe de communion; ensuite on leur servait deux mets, un de fèves, l’autre de millet; puis on leur distribuait une ration de vin.
Le vendredi saint tous les moines se rendaient nu-pieds à prime. A ces paroles de la Passion: «ils ont partagé mes vêtements,» deux religieux déchiraient des pièces. d’étoffe étendues sur l’autel. L’office terminé, tous se réunissaient dans le cloître pour y chanter le psautier tout entier. Le repas des frères se composait de pain et d’herbes crues, auxquelles on ajoutait, à la collation, un peu de vin.
La règle n’oubliait jamais de montrer les liens qui rattachent les choses de ce monde à celles du ciel: aussi était-ce toujours fête à Cluny le sixième jour d’août, époque à laquelle les raisins commencent à mûrir en Bourgogne. Les plus belles grappes de ces fruits étaient portées à l’église, où un prêtre les bénissait pendant le canon de la messe: ensuite elles étaient distribuées aux frères. Les fèves, le pain et le vin nouvellement récoltés devenaient l’objet d’une bénédiction analogue. Cependant la vie de la communauté était fort austère. Outre des jeûnes fréquents, pendant les soixante-dix jours qui précédaient la fête pascale, tous les mets étaient accommodés au maigre; à partir de la quinquagésime, les moines commençaient à s’abstenir de fromages et d’œufs. Un trait remarquable prouve à quel point la sobriété leur était familière. Une fois, les vendanges furent mauvaises et ne fournirent que huit tonneaux de vin. L’abbé ne diminua pas la ration journalière des religieux, mais chacun se fit une règle de n’y pas toucher, de telle sorte qu’à la fin de l’année il restait encore les trois quarts des tonneaux.
L’obéissance était considérée comme la base fondamentale de la vie monastique. L’abnégation imposée aux moines allait si loin, qu’il ne leur était pas permis d’examiner l’intention ni les défauts du supérieur qui commandait. «Si par hasard, est-il dit dans la règle, quelque chose de difficile ou d’impossible est ordonné à un frère, qu’il reçoive en toute douceur et obéissance le commandement qui le lui ordonne; que, s’il voit que la chose passe tout à fait la mesure de ses forces, il explique convenablement et patiemment la raison de l’impossibilité à celui qui est au-dessus de lui, ne s’enflant pas d’orgueil, ne résistant pas, ne contredisant jamais; que si, après son observation, le prieur persiste dans son avis et dans son commandement, que le disciple sache qu’il doit en être ainsi, et que, se confiant à l’aide du ciel, il obéisse.»
Le silence passait également à Cluny pour un des moyens les plus efficaces pour atteindre la perfection. On l’observait avec une rigueur si scrupuleuse, que les religieux auraient pu se passer complètement de l’usage de la parole, tant ils avaient acquis la facilité de s’exprimer par signes. On raconte à ce sujet que deux moines, faits prisonniers par les Normands qui ravageaient Poitiers et Tours, gardèrent la sévérité de la règle au milieu des coups et des blessures, et restèrent silencieux, au risque d’irriter davantage leurs ennemis.
Quant au travail manuel, il avait subi de graves modifications depuis le concile d’Aix-la-Chapelle. En effet, les évêques avaient ordonné que les religieux remplaceraient par certains psaumes les travaux agricoles dont ils étaient dispensés à cause du sacerdoce. Cette mesure, empreinte d’une haute sagesse, avait été adoptée à Cluny; elle tourna l’esprit et l’activité des moines vers les lettres et les sciences, développa chez eux le goût de la littérature ancienne. Or, les livres étant fort rares, ils se mirent à copier les manuscrits de l’antiquité avec une patience qui fait encore aujourd’hui notre admiration. Pour la bien comprendre, il faut se rappeler qu’à leurs yeux chaque lettre tracée sur le parchemin devait effacer une faute devant le Juge suprême. Consolante pensée qui permettait d’affronter le labeur le plus ingrat. Au commencement du carême on lisait devant la communauté le catalogue des livres du monastère, puis on les distribuait aux moines pour le reste de l’année.
La règle s’appliquait à tout, elle veillait à tout et ne laissait rien à l’imprévu: toutes les actions, même les plus indifférentes, devaient se faire dans un ordre déterminé. En un mot, la vie du moine de Cluny était si bien enveloppée par cette règle, qu’en la suivant pas à pas, elle le menait à la perfection.
Le soin apporté à la fabrication des hosties montre quel esprit religieux y présidait. Le blé qui servait à composer ces pains azymes était choisi parmi le plus beau de la récolte; chaque grain était trié avec attention, puis placé en réserve. Lorsque le moment de moudre était arrivé, le frère qui avait cette charge couvrait les meules soigneusement, se revêtait lui-même d’une aube et d’un amict, et s’enveloppait la tête et le visage au-dessous des yeux. Ensuite il moulait le blé et sassait la farine dans un crible neuf. Cette opération terminée, deux prêtres et deux diacres pétrissaient la pâte dans de l’eau froide afin qu’elle gagnât en blancheur, et formaient les hosties. Enfin, pour les cuire, on les plaçait sous des fers gravés, tenus par un frère dont les mains devaient être gantées.
Après le service du culte, rien n’était fait avec plus de sollicitude que le service des malades. Quelqu’un des moines était-il indisposé, il restait en dehors du chœur afin de s’asseoir; au réfectoire, il recevait des mets plus délicats; on l’autorisait à se couvrir la tête et à s’appuyer sur un bâton. Six frères étaient spécialement consacrés aux soins que réclamaient les malades. Il était ordonné à l’inspecteur de l’infirmerie d’avoir toujours une provision suffisante de poivre, de gingembre, d’épices et de racines salutaires, afin de rendre la nourriture des convalescents plus fortifiante. L’abbé et le grand prieur visitaient souvent les malades. Le sommelier devait leur faire connaître chaque jour le menu de l’infirmerie. Quand un religieux était guéri, il se présentait au prieur en lui disant: «J’ai été à l’infirmerie, je n’ai pas observé comme je l’aurais dû les règles de l’ordre.» A quoi le prieur répondait: «Que Dieu te pardonne.» Alors le convalescent se rendait à la place des pénitents, où il récitait les psaumes de la pénitence avant de reprendre la vie commune.
Que dirons-nous de la charité envers les pauvres, les malheureux, les voyageurs et les pèlerins? Nulle part et dans aucun pays elle ne fut exercée avec plus de grandeur, de délicatesse et d’humilité qu’à Cluny. L’abbaye avait toute l’année dix-huit pensionnaires pauvres qu’elle nourrissait et vêtissait. Six frères servants se consacraient à leur service. L’un d’eux les servait, un second remplissait les fonctions de portier de l’hospice; deux allaient chercher le bois dans la forêt, et les deux derniers veillaient au four, dont le produit était dépensé en aumônes. Tout ce qui sortait du réfectoire revenait toujours aux pauvres; en outre, une pensée de pieuse reconnaissance ayant fait établir la coutume de dresser sur la table du réfectoire le couvert des bienfaiteurs les plus illustres du monastère, quoique morts depuis longtemps; on distribuait leur portion aux veuves, aux orphelins et aux vieillards. A toutes ces distributions quotidiennes on ajoutait encore douze gâteaux du poids de trente-six livres. Là ne se bornait pas l’assistance: toutes les semaines l’aumônier était obligé de parcourir les villages voisins, afin de s’enquérir des malades, auxquels il envoyait du pain, du vin et des épices fortifiantes .
Enfin, la charité avait pris des proportions si vastes, que le nombre des malheureux secourus par l’abbaye, au temps de saint Hugues, s’élevait, d’après les calculs les plus modérés, à dix-sept mille. Pendant une famine affreuse, survenue en Bourgogne vers 1030, l’abbé, ayant épuisé les dernières ressources de la communauté, vendit généreusement les ornements de l’Église et une couronne d’or d’un grand prix que lui avait envoyée l’empereur Henri II. En retour, il eut le bonheur de sauver la vie à des bandes nombreuses d’hommes que la faim moissonnait.
A l’égard de l’hospitalité, la règle prescrivait d’accueillir les étrangers avec bienveillance et toujours conformément à leur rang. La porte du monastère était donc toujours ouverte aux pèlerins et aux voyageurs. Tous ceux qui la franchissaient étaient reçus avec un sourire de bienveillance. Les personnes arrivant à pied recevaient une livre de pain, une demi-mesure de vin, et le lendemain l’aumônier veillait à ce qu’elles ne partissent pas à jeûn. Le grand sommelier était chargé des hôtes de distinction, tandis que l’inspecteur des écuries prenait soin de leurs montures. Lorsqu’il remarquait qu’un cheval était mal ferré, il devait donner des instructions pour qu’il fût ferré à neuf; la prévoyance allait si loin sur ce point, qu’un marteau restait toujours suspendu afin de pouvoir au besoin raffermir les clous. En un mot, quand il s’agissait d’exercer l’hospitalité, on ne calculait jamais à Cluny ce qu’il était possible de faire; aussi arrivait-il souvent que, toutes les provisions étant épuisées, les moines étaient forcés de jeûner en attendant qu’il arrivât un secours inattendu, envoyé par les rois ou les seigneurs puissants.
L’ordre le plus parfait ne cessait de régner dans toutes les parties de cette immense administration. Des frères, nommés circateurs, faisaient plusieurs fois par jour le tour du couvent, en notant toutes les infractions à la règle qu’ils avaient remarquées; ils proclamaient ensuite au chapitre ceux qu’ils avaient trouvés en faute. Le nombre des domestiques qu’il était permis aux dignitaires d’emmener en voyage, et la tenue de ces serviteurs, étaient fixés par des règlements spéciaux. Personne ne pouvait quitter Cluny sans l’agrément du supérieur; encore fallait-il lui faire connaître le but et la durée de l’absence. En modifiant l’itinéraire indiqué, on encourait une punition. Tout prieur des couvents réformés qui rencontrait un moine de l’ordre, était en droit d’exiger qu’il lui exhibât la permission de son supérieur. Dans le cas où elle n’était pas régulière, il le faisait arrêter.
Tels étaient les usages en vigueur à Cluny sous saint Hugues. L’ensemble de cette règle, tout à la fois sévère et douce, tempérait la rudesse des caractères, sans altérer leur cachet particulier. Les aptitudes de chacun étaient respectées sans que la loi générale souffrît la moindre infraction. Le silence presque continuel développait singulièrement l’ampleur et la rectitude du jugement, en mûrissant l’esprit, par l’habitude de la méditation. D’un autre côté, la vie commune habituait les religieux à connaître les hommes, leurs imperfections comme leurs qualités. Enfin le cœur trouvait un aliment précieux et solide dans la lecture assidue des livres saints: aussi l’homme qui avait longtemps pratiqué cette règle si remplie de sagesse devenait-il propre au commandement.
Peut-être trouvera-t-on la discipline de Cluny trop rigoureuse. Mais, lorsqu’il s’agit de conduire une grande réunion d’hommes, n’est-il pas nécessaire que chaque individu se soumette sans discussion à tous les statuts, alors même que leur raison d’être lui échappe? Les reproches d’exagérations minutieuses adressés aux règlements, ne sont pas mieux fondés. Si quelques-uns s’attachent à d’infimes détails, ils prouvent combien la vie conventuelle était répandue au moyen âge, puisqu’on avait dû en codifier jusqu’aux moindres actions. Pourquoi a-t-on adopté de nos jours la même ponctualité à l’égard des hommes soumis au régime militaire? C’est qu’il se trouve plus d’une analogie entre le gouvernement d’une maison de moines et les règlements qui assurent aujourd’hui le maintien de la discipline au sein d’un régiment. Ce que les moines faisaient librement pour le service de Dieu, les sociétés modernes l’imposent au soldat, pour assurer la sécurité de l’État. Mais il serait inexact de croire que le soldat ait plus la libre disposition de sa volonté que le religieux.
En somme, la vie d’un moine au moyen âge était assurément fort heureuse. Dans la généralité des cas, en restant seul au milieu de la société, il eût été la victime ou la proie d’un voisin puissant; agrégé à un monastère, il devenait une fraction d’un tout inexpugnable. Vivant dans le monde féodal, il aurait eu un maître dont les caprices et les passions eussent été souvent la seule loi; moine, il suivait une règle chaque jour semblable, mais exempte d’arbitraire et obligatoire pour ses supérieurs eux-mêmes. Enfin, matériellement, les austérités monacales, sagement réglées, ne sont rien auprès des privations imprévues de la misère dans les temps de guerre civile et d’anarchie.
Cette douce sécurité, unie à un sentiment de foi profonde qui dominait alors fortement les âmes, explique le développement prodigieux de la vie monastique et la multiplicité des monastères .
Des faits qui précèdent il ressort nettement que le maintien de la discipline et les charges élevées étaient toujours confiées, à Cluny, à des religieux d’une vertu et d’un mérite incontestés. Après l’abbé, la part d’autorité la plus étendue était dévolue au grand prieur. Sa nomination appartenait au chef du monastère. Mais il était nécessaire, pour valider son choix, de consulter le chapitre. Au grand prieur était confiée l’administration des intérêts spirituels et temporels; tous les ans il inspectait les propriétés, décrétait les améliorations, veillait aux approvisionnements déposés dans les granges et les celliers, déterminait ce qu’il convenait de garder pour l’entretien des religieux, ce qu’il fallait vendre. La pauvreté lui était imposée comme à tous les autres moines; aussi n’avait-il aucun argent pendant qu’il se trouvait dans le monastère. Mais, quand il se mettait en voyage, il recevait du trésorier des fonds dont il rendait compte à son retour. Pendant l’absence de l’abbé, il le remplaçait dans toutes ses fonctions. Il avait encore sous ses ordres le grand sommelier chargé de régler le détail des subsistances, le garde-magasin du blé, l’inspecteur des boulangers, le chambrier attaché à la garde du vestiaire, les foulons qui nettoyaient les vêtements des moines. Pour l’aider dans cette administration si vaste, on lui accordait à l’intérieur un prieur claustral, dont le devoir consistait à ne jamais quitter le monastère, afin d’y maintenir le bon ordre et la régularité ; à l’extérieur, quelques aides et un lieutenant pour les cas d’absence.
Tel était l’office du grand prieur. Saint Hugues avait appelé à ce poste difficile un religieux encore jeune. Mais son zèle à remplir les obligations de sa charge, l’affabilité de son caractère, l’austérité de sa vie, lui avaient mérité toutes les sympathies de ses frères: à leur tour, les étrangers qui passaient à Cluny reconnaissaient l’habileté du prieur, dont ils aimaient les manières nobles et ouvertes.
D’où venait ce religieux? Quel était son nom et sa patrie? On le disait originaire du diocèse de Reims et issu de haut lignage; le bruit courait que ses ancêtres s’étaient couverts de gloire dans maints combats. A Cluny, sous sa cape de couleur noire, on le nommait Otton, mais en Champagne on l’aurait salué seigneur de Châtillon; plus tard sur le siège apostolique il s’appellera Urbain II.