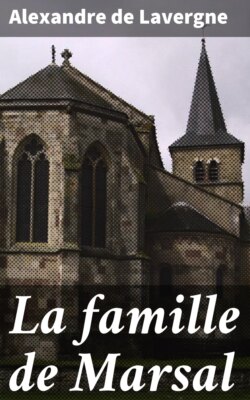Читать книгу La famille de Marsal - Alexandre de Lavergne - Страница 17
UN BAL DE MINISTRE
ОглавлениеAu mois de décembre 1853 et par conséquent trois mois environ après les événemens dont le recit précède, il y avait un grand bal chez le ministre de la marine. C’était la première fête de la saison. Maxime de Saint-Pons, que nous avons un peu perdu de vue pendant quelque temps, après avoir rempli la mission dont il avait été chargé en Morée, était revenu à Paris depuis peu de jours, pour rendre compte de cette mission; et naturellement, en sa qualité d’officier de la marine impériale, il avait reçu une invitation pour le bal de son ministre. Comme on pense bien, il n’eut garde d’y manquer.
Ce n’est pas qu’il eût un goût bien prononcé pour la danse ni même pour les plaisirs mondains, dans l’acception vulgaire de ce mot. Le spectacle ondoyant et divers de la création, dans toutes ses merveilles comme dans toutes ses horreurs, spectacle incessamment ouvert devant les yeux d’un marin, rend d’ordinaire bien pâles pour lui les jouissances souvent toutes factices et toutes conventionnelles par lesquelles les habitans des capitales cherchent à tromper les ennuis de leur oisiveté. Mais Maxime avait conservé au fond du cœur un souvenir plein d’un charme pénétrant, un souvenir avec lequel il avait vécu depuis trois mois, sur les flots de la Méditerranée comme sur les rivages de l’Attique, au milieu du pèle-mêle et du tumulte de la vie de bord sur les grands navires de l’État comme à l’ombre des oliviers et des massifs de lauriers roses. C’était le souvenir des quelques heures qu’il avait passées en tête à tête avec Mlle Emmeline de Marsal, dans l’humble maisonnette de la vieille Madeleine.
Un épisode de ce genre eût à peine laissé une trace dans la mémoire d’un néophyte de nos salons parisiens, habitué à des aventures de plus haut goût; mais l’isolement même dans lequel Maxime avait vécu depuis son plus jeune âge, au moins en ce qui touche le sexe féminin, une certaine impressionnabilité nerveuse, une sensibilité même qui sont plus souvent qu’on ne pense l’apanage de ces natures vouées à une existence de fatigues, de périls, et endurcies seulement à la surface, toutes ces causes réunies avaient prédisposé presque fatalement le jeune lientenant de vais seau à abandonner sans défense aucune son âme à la plus absorbante des passions.
Maxime était donc venu au bal du ministre de la marine avec le ferme espoir de retrouver sa compagne de quarantaine dans une fête où le grade et la position du contre-amiral de Marsal l’appelaient naturellement ainsi que toute sa famille. Il avait appris d’ailleurs au cabinet du ministre, en venant rendre compte de sa mission, que M, de Marsal était de retour à Paris, après avoir passé l’été et une bonne partie de l’automme à sa maison de campagne en Provence, et qu’il avait été compris ainsi que sa femme et ses deux filles, sur la liste des invitations.
Ce ne fut pas sans émotion que, introduit dans les appartemens du ministre, Maxime se mit en devoir d’inspecter chaque salon, chaque galerie, interrogeant d’un œil avide les cohortes féminines qui s’épanouissaient devant lui dans tout l’éclat de leurs fraîches toilettes, et cherchant incessamment à découvrir entre leurs rangs pressés une tête blonde et charmante qu’il n’avait vue qu’une seule fois dans sa vie mais qui depuis lors l’avait visité bien souvent dans ses rêves. En proie à une préoccupation absolue, exclusive dont se rendront compte aisément tous ceux qui ont aimé, c’est à peine si Maxime répondait en passant au salut de ses camarades, sourd à toutes les conversations comme aux retentissemens même d’un formidable orchestre et poursuivant en vain obstinément un fantôme qui fuyait toujours devant lui
La foule était d’ailleurs considérable, circonstance peu propice à une semblable recherche. On était pressé, heurté, comme on l’est généralement de onze heures, du soir à minuit, dans ces cohues splendides tout étincelantes de diamans, de broderies, de lumières, qui constituent ce qu’on appelle un bal officiel. Toutes les investigations du jeune lieutenant de vaisseau avaient été sans résultat, lorsqu’il se sentit soudain frapper familièrement sur l’épaule. En même temps, une voix stridente s’écria:
— Tribord, bâbord et la farine! je ne me trompe pas, c’est Maxime de Saint-Pons!
En entendant retentir cette évocation nautique, bien connue de tous les anciens élèves de l’école navale de Brest, Maxime se retourna et se trouva face à face avec un petit homme de vingt-huit à trente ans, dont le front chauve et basané et le visage, presque entièrement enseveli sous une paire de larges favoris taillés en nageoires de phoque, accusaient sinon la profession, tout au moins les habitudes de marin. Comme le lieutenant de vaisseau, contemplant, d’un air un peu distrait son interlocuteur, qu’il n’avait pas reconnu tout d’abord, semblait interroger ses souvenirs, le nouveau venu reprit familièrement et avec une grande volubilité,
— Eh quoi! tu ne reconnais pas ton ancien camarade de la pension Loriol et du Borda, Anatole Châteaugodard?
— Ah! si fait! repartit Maxime, parfaitement, moins la barbe... Excuse-moi.
— A la bonne heure! quel heureux abordage, vieux, bein! n’est-ce pas? Jetons l’ancre ici de conserve, et causons comme deux loups de mer qui se rencontrent après une longue séparation. Sais-tu qu’il a diablement venté depuis que nous nous sommes quittés sur le Borda, toi pour naviguer sur l’eau salée et moi sur l’eau douce?
— En effet, je me souviens que tu n’avais pas réussi dans tes examens de sortie.
— Ta mémoire est bonne, vieux! j’avais chaviré. Mais c’est égal, j’avais mis dans ma tête que j’entrerais dans la marine et j’y suis entré.
— En quelle qualité ?
— Eh mais, d’abord en qualité d’employé dans les bureaux du ministère, pour te servir, si j’en suis capable.
— Ce n’est nullement de refus, mon bon Châteaugodard, et je suis aise de savoir que j’ai ici un ancien camarade du temps passé.
— Passé et présent, vieux! ne sommes-nous pas tous ici de la même famille, la grande famille des marins? Oh c’est que je n’ai pas voulu en avoir le démenti, vois-tu? moi aussi, j’ai navigué et je navigue toujours. On n’a pas voulu de moi pour officier sur les bâtiments de l’État; eh bien! j’ai un bâtiment à moi et un joli bâtiment, je m’en vante. Il est amarré tout près d’ici, à Asnières; tu le verras et tu m’en diras des nouvelles. C’est un bateau ponté, gréé, filant également bien à la voile et à la rame. On l’appelle le Cormoran. Il est connu sur toutes les côtes de la Seine, comme son capitaine, car moi aussi je suis capitaine sur mon bord. Sais-tu que le Cormoran a remporté six prix dans les régates?
— C’est superbe! salut au capitaine du Cormoran! Mais, dis-moi mon cher Châteaugodard, toi qui es de la maison, tu dois connaître tout ce qu’il y a dans ce bal d’officiers de marine, d’officiers généraux surtout.
— Parfaitement! parfaitement! D’abord, nous nous connaissons tous dans la marine. Veux-tu que je te montre mon chef de bureau?
— Si tu y tiens; mais, dis-moi, as-tu vu l’amiral de Marsal, ce soir?
— L’amiral de Marsal! Oh! certaine ment. Un vieux loup de mer, celui-ià ! C’est un de mes amis intimes.
— Et... sa famille?...
— Ah! il a une famille?
— Ne viens-tu pas de me dire que l’amiral était ton ami intime?
Oui, au bureau; quand il y a du monde dans le cabinet de mon chef, il vient causer avec moi... oh! très amicalement; mais j’ignorais qu’il eût une famille. Mon chef ne m’en a jamais rien dit, C’est un vieux marsouin que mon chef de bureau.
— Ainsi tu ne sais pas si sa femme et ses deux filles l’ont accompagné au bal?
— Allons donc! il n’a pas la moindre progéniture. que je sache; et, quant à sa femme, elle court les mers chavirant avec le tiers et le quart. Je suppose que c’est pour se faire des compagnons de naufrage conjugal qu’il a la rage de marier tout le monde.
— Mon pauvre Anatole, fais-moi grâce de ton chef de bureau; je te parle de l’amiral de Marsal.
— Attends donc! Je me souviens que je l’ai aperçu tout à l’heure ici près, arrimé dans une embrasure de fenêtre et hélant une charmante petite corvette... je veux dire une jeune fille, qui retournait à sa place après avoir dansé la polka.
— Une jeune fille blonde, n’est-ce pas? Oh que ne me le disais-tu plus tôt? C’est elle, c’est elle!
— Elle?... Qui donc?
— Conduis-moi bien vite auprès d’elle... auprès de l’amiral, mon bon Châteaugodard.
— Diable! tu es donc bien pressé ! C’est dommage, moi qui voulais te demander un conseil pour la mâture du Cormoran!
— Plus tard! plus tard! C’est la famille de Marsal que je veux voir.
— Qui parle ici de la famille de Marsal? articula à cet instant une voix sonore dans l’accentuation de laquelle je ne sais quel ton de bonhomie se fondait avec les notes énergiques du commandement. Puis la même voix ajouta: «Ah! l’on vous retrouve enfin, monsieur le déserteur! Savez-vous que c’est fort mal d’avoir manqué à mon appel? Aussi apprêtez-vous à être fusillé par mes filles, qui sont furieuses contre vous!»
Au son de cette voix, qui venait de retentir dans le tumulte de la fête, le visage de Maxime s’était illuminé de bonheur, car, avant même de pouvoir faire volte face au milieu de la foule, il avait reconnu le contre-amiral de Marsal: Emmeline ne pouvait être loin.
L’amiral donnait le bras familièrement à un personnage d’un âge assez mûr, remarquable par une obésité très prononcée et un air des plus solennels, le front chauve et le nez surmonté d’une paire de bésicles en or, qui semblaient le complément obligé du costume administratif dont il était revêtu. On eût cru voir Joseph Prudhomme, ce type immortalisé par Henri Monnier, transformé en fonctionnaire public et décoré.
A l’aspect de ce personnage, Châteaugodard avait tressailli et s’était incliné avec une respectueuse mauvaise humeur.
— Mon cher Gaudibert, dit l’amiral en se penchant vers son accolyte, je te présente un de tes administrés, M. de Saint-Pons, que j’ai eu sous mes ordres quand il n’était encore que simple aspirant, et qui n’est pas fait pour rester lieutenant de vaisseau, surtout si tu lui accordes ta protection au ministère.
— Monsieur est-il marié ? murmura le personnage aux besicles d’or.
— Non pas que je sache, répondit l’amiral.
— Qu’est-ce que ce monsieur Gaudibert? reprit Maxime à voix basse, en se penchant à l’oreille de son camarade Châteaugodard.
C’est mon chef de bureau, repartit le bureaucrate en fronçant le sourcil; c’est ce vieux marsouin dont je te parlais tout à l’heure, qui me refuse de l’avancement sous prétexte que je ne suis pas marié, et qui ne veut pas comprendre les devoirs que m’impose le commandement du Cormoran.
En toute autre circonstance, Maxime de Saint-Pons eût prêté sans doute une oreille complaisante aux incriminations plus ou moins légitimes dirigées par son ancien condisciple contre son chef de bureau; mais il se trouvait alors sous l’influence d’une préoccupation trop exclusive pour pouvoir donner la moindre part de son attention à tout autre objet.
Aussi, saisissant vivement la main que lui tendait son ancien chef et la pressant affectueusement dans la sienne, il s’écria:
— Combien je suis heureux de vous retrouver ici, amiral! mais n’avez-vous pas reçu la lettre dans laquelle je m’excusais auprès de vous de ne pouvoir...?
— Si fait, parbleu! si fait!
— Eh bien! vous savez sans doute qu’un devoir impérieux m’a forcé de prendre congé brusquement de mon oncle et de venir sans délai à Paris pour y recevoir les instructions du ministère au sujet d’une mission qui m’était confiée, et que je viens de remplir au Pirée et sur les côtes de Morée. Je suis arrivé seulement il y a cinq jours.
— A la bonne heure! Eh bien! voilà des circonstances atténuantes, et je suis prêt à les plaider avec vous mon cher camarade; mais je vous préviens que nous allons avoir affaire à un conseil de guerre des plus redoutables, ma fille cadette surtout. Venez bien vîte avec moi solliciter la clémence de vos juges.
En parlant ainsi, le comte de Marsal avait pris le bras de son interlocuteur et l’entraînait en fendant non sans peine les flots d’une foule compacte, dans la direction du grand salon, où l’orchestre venait de faire entendre les préludes d’une polka-mazurka.
Déjà les danseurs et les danseuses avaient pris place.
Entre tous ces couples qui commençaient à se mouvoir en cadence au son des instruments, il y en avait un plus jeune, plus beau, plus élégant peut-être que tous les autres, et sur lequel les regards mêmes de la galerie semblaient s’attacher de préférence.
C’était un jeune homme blond, d’une taille avantageuse et bien prise, portant la moustache en croc, et soutenant de son bras voluptueusement arrondi la taille d’une adorable jeune fille qui, la tête doucement inclinée sur l’épaule de son danseur, semblait en même temps y appuyer sa main avec complaisance et lui souriait du plus gracieux sourire.
La jeune fille était blonde aussi et son opulente chevelure, qui attirait tout d’abord les regards, bien qu’elle fut coiffée avec une simple couronne de fleurs aquatiques, avait, sous l’éclat des bougies répercuté par les cristaux des lustres et des girandoles, ces reflets magiques qu’on admire dans certains tableaux de Titien. A peine décolletée, son corsage laissait voir des épaules d’un blanc lacté et du plus harmonieux contour; sa taillé était svelte et pleine de souplesse; mais on oubliait volontiers tout ce qu’il y avait de séductions dans cet ensemble jeune et charmant, à l’aspect de deux grands yeux d’un bleu d’azur, frangés d’un double rang de cils recourbés et qui sous l’arc si fin et si pur des sourcils dont ils étaient couronnés, rayonnaient à la fois de tendresse et de douceur.
Pour un jeune lieutenant de vaisseau tout frais débarqué des mythologiques rivages de l’Attique, c’était la personnification vivante d’une néreide, descendue en plein dix-neuvième siècle dans le grand salon du ministère de la marine pour y danser la polka-mazurka
Tout à coup un nuage passa sur les yeux de Maxime, son front pâlit, et il se sentit froid au cœur. Dans cette adorable jeune fille sur laquelle tous les regards étaient concentrés, il venait de reconnaître mademoiselle Emmeline de Marsal; mais l’élégant danseur sur le bras duquel sa taille était inclinée presque amoureusement n’était autre qu’Horace Guidai.
Horace était, lui aussi, de retour à Paris; Horace avait vu ses prévisions en partie réalisées: il avait amplement profité de la hausse persistante de la Bourse et il était là plus superbe et plus triomphant que jamais.