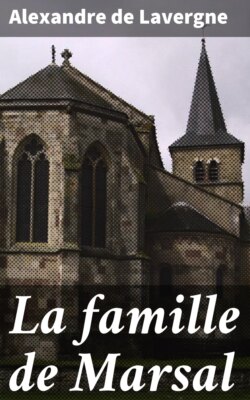Читать книгу La famille de Marsal - Alexandre de Lavergne - Страница 7
LE CHOLÉRA EN PROVENCE
ОглавлениеC’est par une nuit orageuse de l’été de 1835 qu’a commencé l’histoire dont nous avons entrepris le récit. Usant de notre privilège de romancier, nous demanderons au lecteur la permission de laisser s’écouler entre cette nuit mémorable et les événemens dont elle devait être le prologue, un entr’acte de dix-huit ans. C’est, en conséquence, seulement en 1853 que nous reprenons notre tâche de narrateur. Maintenant examinons les changemens qn’un laps de temps aussi prolongé avait pu amener dans les hôtes habituels de la villa ou bastide du comte de Marsal, entre Toulon et les îles d’Hyères.
Si la nature est immuable dans ses enchantemens au fond de ce petit coin de la Provence, qui rappelle les plus poétiques paysages des rives de l’Asie-Mineure, si le grand pavillon se dégage toujours coquettement avec ses blanches façades et ses persiennes peintes en vert au milieu des plantations qui lui servent d’encadrement comme les flots bleus de la Méditerranée d’horizon, il ne faut pas s’attendre à retrouver, après dix-huit ans, les habitans du domaine dans ce merveilleux état d’identité et de conservation consacré par la baguette des fées pour les hôtes du palais de la Belle au bois dormant.
Quatre personnes sont assises autour d’une table sur laquelle apparaissent encore les reliefs d’un déjeuner de famille: un homme et trois femmes. Le repas est terminé et, seul entre les convives, l’homme tient encore à la main une tasse de thé que sa voisine vient de lui verser et dont il semble aspirer l’arôme bienfaisant. Cet homme est le seigneur châtelain, M. le comte de Marsal attendu en 1835 par la dame châtelaine. M. de Marsal n’était alors que capitaine de vaisseau; il est devenu contre-amiral. Mais, hélas! il n’avait en ce temps-là que quarante-trois ans, et maintenant il a dépassé la soixantaine. La force et la maturité de l’âge ont fait place à la vieillesse qui vient si vite, surtout pour les marins; si sa taille a conservé un reste d’élégance, il ne le doit qu’à sa haute stature et à sa maigreur. Ses sourcils sont demeurés noirs et épais, comme au temps où leur simple froncement faisait trembler tout un équipage; mais les boucles de ses cheveux, en se raréfiant sur son front, se sont argentées comme pour offrir un bizarre symbole de nos jours parfois plus brillans à mesure qu’ils sont moins nombreux.
La comtesse de Marsal, placée à table à la droite de son mari, quoique jeune encore, a subi les injures du temps, ce tyran, le seul peut-être en ce monde dont le joug n’a point connu d’insurrections. Sa blonde et ondoyante chevelure s’est massée de teintes grises. Ses traits amaigris, en conservant leur finesse, ont perdu la fermeté de leurs contours. Le cercle brun qui encadre ses yeux bleus, jadis si pleins de douceur et maintenant voilés par la mélancolie, accuse les traces de longues insomnies; on dirait qu’une lutte intérieure contre une souffrance injurieuse qu’elle cherche en vain à repousser a épuisé les forces de la comtesse, et que la victoire peut-être lui a coûté plus cher qu’une défaite.
Si le comte et la comtesse de Marsal, déjà engagés l’un et l’autre sur le versant opposé de la montagne, dans le sentier glissant qui regarde le tombeau, personnifient assez justement l’hiver et l’automne, nous retrouvons heureusement aussitôt la loi consolante du renouvellement de l’humanité, de cette adolescence éternelle de la création, dans deux jeunes filles assises à côté de leur père et de leur mère au repas du matin, et l’on sent l’œuvre de la mort déjà conjurée par ces gracieuses créatures, toutes deux fraîches et rayonnantes comme une matinée de printemps.
Les deux sœurs forment les deux types les plus opposés. L’aînée, Georgina, qui est apparue un instant au commencement de ce récit, enfant au fond de son berceau, est devenue une grande belle fille à la taille élancée, aux yeux bruns, aux sourcils noirs; elle rappelle toujours le contre-amiral et la fière puissance de sa jeunesse. Sa sœur cadette, dont les traits pleins de finesse et d’expression ont peut-être moins de régularité, est tout le portrait de sa mère, à qui elle a emprunté ses cheveux blond cendré, le tissu transparent de sa peau, ses yeux du gris-bleu le plus doux, et jusqu’ à ses dents d’un blanc lacté. Comme sa mère aussi Emmeline (c’est le nom qu’on lui a donné,) est d’une stature un peu au-dessous de la moyenne.
En résumé, des deux sœurs, l’une est la beauté, peut-être un peu plastique et sensuelle dans tout son épanouissement; l’autre est la grâce dans toute sa pudique candeur. Maintenant que nous avons dépeint, tant bien que mal, les quatre personnages dont se compose la famille de Marsal, il est temps de leur donner la parole.
Il y a généralement dans la vie de campagne, à l’issue du déjeuner, deux graves occupations: c’est d’abord la lecture du journal, puis le soin de dresser le bilan de la journée. L’amiral, dont l’âge et les fatigues du métier de marin avaient quelque peu affaibli les jarrets, n’intervenait guère qu’à titre consultatif en ce qui touche le second point, du moment où il s’agissait d’excursions pédestres, de courses à ânes, de chasse aux papillons et de tout ce qui constitue ordinairement, dans la villégiature, les passe-temps des jeunes filles. En revanche, il savourait avec avidité les nouvelles que lui apportait son journal, sauf à s’endormir ensuite, par mesure d’hygiène digestive, quand il entreprenait de lire ce qu’on appelle les premiers-Paris.
Il en était arrivé là sans doute, car déjà ses paupières commençaient à s’allourdir et son menton s’inclinait mollement sur sa poitrine, lorsqu’il se redressa soudain sur son siège, en poussant une exclamation de surprise et de chagrin.
— Qu’est-ce donc? s’écrièrent à la fois les trois femmes.
— En voici bien d’une autre! reprit le comte en se levant et en marchant à grands pas autour de la table avec une vive agitation. Il ressuscite cet hydre maudit? Il n’a donc pas fait encore assez de victimes?
— De qui parlez-vous? repartit la comtesse de Marsal.
— De qui je parle, morbleu! Est-il besoin de le demander? Je parle du choléra, mes enfans, qui, à l’heure qu’il est, est bien décidément déclaré à Paris et dans une bonne partie de la France. Le gouvernement avait cru devoir, pour ne point exciter d’inquiétudes dans la population, dissimuler l’invasion de ce terrible fléau; mais il pense aujourd’hui qu’il vaut mieux proclamer nettement ce qui en est que d’entretenir plus longtemps les exagérations de la peur, accrues par le mystère même. Le gouvernement a raison, sacrebleu! La France est l’empire des braves; mais on a oublié d’en chasser les poltrons.
— Le choléra! murmura naïvement Emmeline, il ne me fait pas peur à moi!
— C’est que tu es la digne fille de ton père, toi, chère enfant, reprit l’amiral en la baisant au front.
— Et moi, repartit Georgina, avec un mélange de fierté et de dépit, je ne me crois pas moins que ma sœur votre digne fille, cher bon père, et de plus je suis l’aînée. Eh bien! j’avoue que j’ai peur du choléra. D’abord, je n’aime pas les maladies qui arrivent comme la foudre.
— Qu’importe, dit l’amiral, si elles s’en vont de même?
— Eh mais, reprit Georgina, si l’on s’en va aussi avec elles?
— Ma foi! repartit l’amiral, c’est quelquefois un malheur; souvent un bonheur.
— Le choléra est-il décidément contagieux? fit la comtesse, qui avait, à l’issue du déjeuner, pris un ouvrage de broderie, sorte d’amortissement pour ces activités fébriles et dévorantes qu’aiguillonne l’importunité de quelque intime douleur.
— Allons donc! s’écria le comte, il est contagieux comme la goutte et le rhumatisme, voilà tout. Épidémique, je ne dis pas; mais moi qui vous parle, à mon dernier voyage dans l’Inde, j’ai vu mourir sous mes yeux, à mes côtés, la moitié de mon équipage et de mon état-major, sans que ma santé ait eu à souffrir la moindre atteinte de cette horrible maladie.
— C’est vrai, dit la comtesse, et je me rappelle encore toutes les inquiétudes que j’ai éprouvées à cette occasion.
— C’est que tu t’inquiètes aisément, ma pauvre femme, aussi, comme je t’ai grondée au retour! Il est vrai que mes reproches n’ont pas servi à grand’-chose. C’est un fâcheux exemple que tu donnes là à tes filles. Je desire qu’elles t’imitent sous tous les rapports, excepté sous celui-là.
— Eh bien! interrompit Emmeline, puisqu’il en est ainsi, je veux, si le choléra vient à se déclarer dans nos environs, aller soigner les malades pour leur inspirer du courage.
— Tu feras bien alors de t’y rendre seule, reprit Georgina; quant à moi, je n’ai pas le moindre goût pour le métier de sœur de charité.
— Eh quoi! répartit la jeune fille, ne viendras-tu pas aujourd’hui avec moi voir notre bonne nourrice cette pauvre Madeleine, qui est si joyeuse quand nous venons la visiter? Marius va cueillir un panier de fruits à son intention, et si tu veux, ma sœur, que nous allions le lui porter ensemble, cela nous fera une charmante promenade, sans parler de toutes les histoires que Marius nous contera pendant le chemin sur ses campagnes de mer, au temps où il était matelot sous les ordres de notre bon père.
La grande et belle Georgina fit une moue pleine de dédain en écoutant cette naïve proposition.
— Je sais par cœur, dit-elle, toutes les histoires de Marius, que je trouve un peu trop poltron pour un matelot et beaucoup trop bavard pour un jardinier. Quant à la pauvre Madeleine, bien qu’elle commence à radoter un peu, j’ai vraiment de l’affection pour-elle; mais je ne me sens point en humeur de marcher aujourd’hui. J’ai mal aux nerfs et je suis sûre que je vais avoir la migraine.
— En effet, ma fille, repartit la comtesse d’un ton d’affectueux reproche, toutes tes paroles depuis quelques instants annoncent une prédisposition maladive qui m’inquiète.
— Oh! pour le coup, s’écria le comte en riant aux éclats, je te préviens, ma bonne amie, que je ne saurais partager cette inquiétude-là, à propos des nerfs de notre chère Georgina... Les nerfs! les nerfs! moi, je n’y crois pas d’abord aux nerfs, surtout pour la fille d’un marin.
— Méchant père! balbutia Georgina avec un peu de confusion.
— Veux-tu, Georgina, continua l’amiral, que je t’explique ton mal de nerfs, moi qui ne suis pas médecin, pourtant? D’abord, tu es fort contrariée d’apprendre l’invasion du choléra, non pas tant parce que tu as peur du fléau que parce que tu pressens instinctivement que son invasion va être un temps d’arrêt pour toute espèce de plaisirs, ce qui est très-maussade assurément pour une jeune fille de vingt ans. Ensuite... faut-il tout te dire?
— Dites, dites, mon père.
— Ensuite... tu ne m’en voudras point, n’est-ce pas, de ma franchise de marin?
— Au contraire.
— A la bonne heure! Eh bien! tu es pleine de qualités, tu as de la beauté... d’abord, tu es tout mon portrait, quand jétais jeune s’entend, et que j’étais la coqueluche des belles dames de Toulon. Je n’étais pas marié dans ce temps-là, et c’est tout au plus si vous étiez née, madame la comtesse de Marsal; donc j’étais dans mon droit.
Mais enfin, mon père?
— Enfin... enfin, mon enfant, le soleil lui même a des taches; eh bien! tu as une tache aussi, toi, mon cher soleil, oh! rien qu’une toute petite.
— Laquelle?
—Tu es jalouse.
— Jalouse, moi! oh! quelle plaisanterie! Et de qui donc, mon bon père?
— De ta sœur.
— Tu le vois, Georgina, s’écria la comtesse de Marsal, qui n’avait point levé les yeux de sa broderie pendant la durée de ce colloque, ton père pense absolument comme moi, et pourtant il ne pouvait se douter que moi-même...
— Pensez tout ce que vous voudrez, mon cher papa et ma chère maman, interrompit gracieusement Emmeline; quant à moi, qui suis naturellement fort intéressée dans la question, je vous demande la permission de ne pas partager votre sentiment et de vous dire qu’il ne repose que sur des chimères, n’est-pas, ma chère et bonne sœur?
En parlant ainsi la jeune fille se leva précipitamment de table et courut se jeter dans les bras de Georgina qu’elle couvrit de ses baisers.
— Parbleu! s’écria le comte de Marsal en essuyant une larme, je me confesse vaincu et je renonce à entendre la justification de l’accusée.
— Il est heureux pour l’accusée, reprit Georgina, qu’elle ait trouvé un avocat.
— Un avocat! soit, repartit l’amiral, et un charmant petit avocat par-dessus le marché ! Allons, mes enfans, venez m’embrasser toutes les deux; je lirai mon journal plus tard.
Quelques instants s’écoulèrent dans ces doux épanchements de famille, puis le comte de Marsal dit à ses filles:
— La journée s’avance et si vous voulez aller visiter votre nourrice, il est temps de faire vos préparatifs de départ et de prévenir Marius qui vous accompagnera. Je suppose, ma chère Georgina, que tu es toute disposée maintenant à t’associer au pélerinage de ta sœur?
— Veuillez m’en dispenser mon père.
— Mais, quel motif?
— Le motif, je vous l’ai dit, et puis j’ai entrepris la lecture d’un feuilleton fort intéressant.
— C’est possible, mais le pèlerinage projeté par Emmeline, s’il n’est pas plus intéressant est, ce me semble, plus utile et plus méritoire que la lecture de tous les feuilletons du monde.
— Comme il vous plaira, mon père. Je sais que toutes les idées de ma sœur sont toujours excellentes; c’est pour cela que j’appréhendais d’en gâter une en m’y associant; mais du moment que vous en jugez autrement...
— Allons! dit l’amiral en se levant avec mauvaise humeur, Il paraît que c’est un parti pris pour aujourd’hui, et comme je veux éviter à ma chère Emmeline une compagnie aussi maussade que celle de sa sœur aînée, c’est moi qui décide maintenant que sa sœur aînée restera au logis. Je regrette, ma pauvre enfant continua M. de Marsal en baisant sa fille cadette, que mes mauvaises jambes ne me permettent pas de t’accompagner. Je vois que tu seras réduite pour toute société à ce butor de Marius, qui portera le panier de provisions.
— J’ai peur que Marius ne soit pas de meilleure composition que ma sœur, répondit Emmeline en soupirant; il n’aime pas beaucoup à se déranger.
— Que cela soit de son goût ou non répliqua l’amiral du ton qu’il avait à son bord, il sait que je veux de la discipline ici; d’ailleurs il est payé pour obéir, et bien payé.
— Il me semble, dit Georgina, que ce n’est pas là son sentiment, car il demande sans cesse de l’argent à maman.
— Et pas toujours aussi respectueusement qu’il le devrait, ajouta Emmeline.
— Hein? Est-ce que le drôle se serait permis de te manquer, ma bonne amie? fit le comte de Marsal dont l’œil s’enflamma.
— Non... non, mon ami, reprit la comtesse avec un trouble évident, je n’ai rien à reprocher à Marius.... mais, vous savez, il a le ton un peu brusque, il est intéressé.
— Intéressé, soit, reprit l’amiral. Il faut bien que les subalternes aient un vice; autant celui-là qu’un autre, c’est encore ce qu’il y a de meilleur marché, car ils nous épargnent ainsi le soin de songer à leur avenir... mais qu’il ne s’avise pas d’être insolent! je sais qu’il a rendu sa femme très malheureuse... cette pauvre Miette, que nous n’aurions jamais dû lui laisser épouser. J’ai toujours eu idée que cette fille était morte de chagrin.
— Vous vous trompez, je crois, mon ami, reprit Madame de Marsal; le chagrin ne tue pas.....
— Enfin... après tout, reprit le comte, Marius est un serviteur attentif, soigneux; il a le plus grand soin de ses fruits et de ses légumes et son jardin est toujours convenablement tenu; nous n’avons pas à lui demander davantage. Ma chère Emmeline, va dire à la femme de chambre d’aller le prévenir de se préparer et de cueillir les fruits.
— Oh! je veux les cueillir moi-même, dit Emmeline; je serai bien sûre qu’ils sont les plus beaux.
A ces mots, la comtesse de Marsal, comme par un mouvement instinctif, attira sa fille sur son cœur et l’embrassa tendrement. Mais la jeune fille, se dégageant avec vivacité de cette douce étreinte, s’écria:
— A présent, chère maman, c’est le tour de ma sœur, et il faut qu’il dure longtemps; moi, je vais faire ma cueillette.
En parlant ainsi, Emmeline, plus légère qu’un oiseau, se sauva en courant.
Deux heures après cette scène de famille, mademoiselle Emmeline de Marsal, accompagnée de Marius le jardinier, arrivait dans un de ces pittoresques hameaux qui jalonnent de distance en distance la côte de la Méditerranée entre Toulon, et le gros bourg d’Hyères, et qui s’épanouissent si joyeusement au milieu des vignes, à l’ombre des massifs de lentisques et d’oliviers.
Comme c’était un jour de semaine, elle s’imaginait qu’à cette heure de la journée le hameau serait presque désert, chacun étant occupé aux travaux des champs. Cependant, à mesure qu’elle venait de s’approcher du but de son pèlerinage, des clameurs confuses étaient parvenues jusqu’à ses oreilles. Il se passait à coup sûr quelque chose d’extraordinaire dans l’enceinte même du hameau.
Emmeline ne s’en occupait pas autrement tout d’abord; elle attribuait à quelque incident de localité ces symptômes étranges et, tout entière à la pensée du plaisir que sa visite allait causer à sa nourrice, elle se dirigeait vers la maisonnette habitée par Madeleine, Tout à coup, parvenue devant cette rustique demeure, la jeune fille se trouve en présence d’un attroupement qui semble précisément en garder l’entrée.
Un homme, qui reconnait mademoiselle de Marsal, se détache d’un groupe et court au-devant d’elle.
— N’approchez pas, mademoiselle... n’approchez pas!... s’écrie cet homme; si vous saviez... la Madeleine...
Et il s’arrrête au moment de prononcer un mot terrible que ses lèvres ont peine à articuler.
— Mon Dieu... ma pauvre Madeleine, est-elle morte! balbutia Emmeline pâlissant.
— Ah! c’est tout comme, reprend d’une voix rude le paysan dont la basse vigoureuse est soutenue par un chœur non moins puissant de tous les indigènes attroupés, y compris les commères de l’endroit.
— Mais qu’est-ce qu’elle a donc? parlez! s’écrie Emmeline avec une impatience fébrile.
— Elle a, reprend le paysan en retenant et en baissant la voix, comme si le mot seul eût été un danger... elle a le choléra!...
Un indescriptible frémissement accompagna cette révélation, rendue plus terrible encore en Provence surtout par l’impression ineffaçable des traditions du fléau qui, en 1720, a fait de Marseille un vaste cimetière. Dans de pareils moments, au milieu de toutes les alarmes superstitieuses qu’enfante l’ignorance au sein des masses populaires, il n’y avait plus de différence entre le choléra et la peste. Peu s’en était fallu qu’on arborât le drapeau noir sur la chaumière de Madeleine. Ainsi se trouvait confirmée presque instantanément la fatale nouvelle que les feuilles publiques parvenues le matin même dans le département du Var avaient enregistrée, et que le comte de Marsal n’avait pu lire sans effroi.
Emmeline tressaillit, et son premier mouvement ne fut pas exempt de quelque trouble en apprenant que ce seuil qu’elle se disposait à franchir allait l’exposer aux atteintes d’une contagion peut-être inévitable; mais le sentiment d’hésitation qu’elle éprouva fut de bien courte durée, et, presque honteuse de ce qu’il eût pu trouver place dans son âme, elle demanda mentalement pardon à Dieu de sa faiblesse, et, disposée désormais à ne plus suivre que l’élan de son cœur charitable, elle fit quelques pas pour entrer dans la chaumière.
— N’entrez pas, mademoiselle, lui cria-t-on en se plaçant devant elle, n’entrez pas ou vous êtes morte... Le médecin lui-même a dit qu’il ne reviendrait pas.
— Mais alors, s’écria Emmeline, qui est-ce qui soigne cette pauvre Madeleine?
—Qui est-ce qui la soigne? eh! personne donc, reprit l’orateur de l’attroupement; et à quoi ça servirait de la soigner, puisqu’elle n’en peut pas réchapper? Si elle pouvait seulement mourir assez vite, pendant qu’il n’y a qu’elle de malade, pour que le mauvais air ne se répande pas dans le pays!
— Oh! oui! oh! oui! répéta le même chœur de terreurs ignorantes et implacables.
— Nous voulions l’étouffer entre deux matelas. reprit le même orateur, exalté par l’approbation de ces grossiers tribuns.
— Malheureux! s’écria Emmeline avec un mouvement d’horreur,
— Oh! soyez tranquille, mademoiselle, reprit naïvement le paysan, nous ne le ferons pas; nous gagnerions peut-être son mal.
Si la résolution d’Emmeline avait eu besoin d’être fortifiée, elle l’eût été à coup sûr par tant de barbarie et par la pensée de l’abandon auquel la pauvre Madeleine était livrée...
— J’entrerai, dit-elle d’un ton plein de fermeté. Viens, Marius.
Elle se tourna vers le jardinier, qui, debout derrière elle et son panier sur le bras, avait assisté muet et atterré à la scène dont on vient de lire le récit.
Le hâle épais empreint sur le visage de l’ancien matelot ne dissimulait qu’en partie la profonde frayeur à laquelle il était en proie: son attitude seule indiquait qu’il était fort peu disposé à obéir à Emmeline. Seulement, cherchant à dissimuler sa couardise sous l’intérêt qu’il portait à sa jeune maîtresse:
— Oh! mademoiselle... n’entrez pas! dit-il; si monsieur l’amiral savait...
— Mon père m’approuverait, reprit Emmeline... Ce n’est jamais lui qui s’est informé du danger quand il s’agit d’un devoir.
Et se tournant vers la foule, elle réclama le passage, cette fois avec tout ce que son indignation pour tant de lâcheté ajoutait encore de force impérative à ses paroles.
— Vous le voulez, mam’zelle! reprit le chœur implacable de paysans terrifiés. Mais, si vous entrez, dame! tant pis pour vous, vous ne sortirez plus; nous ne voulons pas que vous veniez rapporter ce poison-là à nos femmes et à nos enfans.
Emmeline ne répondit à cette menace et aux cris féroces qui l’accompagnaient qu’en ordonnant de nouveau à Marius de la suivre, et, saisissant entre les mains du jardinier le panier de fruits qu’il avait apporté, elle pénétra résolument dans la chaumière de Madeleine.
Marius, ainsi qu’on l’a vu, paraissait très peu décidé déjà à suivre sa jeune maîtresse dans l’accomplissement de sa tâche charitable; mais il se sentit tout à fait entraîné à la défection sous l’influence du terrible avertissement dont Emmeline avait tenu si peu de compte; aussi, lorsque la jeune fille, à peine entrée dans la chaumière se retourna pour parler à son lâche acolyte, il avait déjà disparu.
Sans se préocuper autrement de cet incident, Emmeline courut au lit de douleur de la pauvre Madeleine.
Pendant ce temps-là les paysans attroupés ne trouvaient encore que des malédictions contre le généreux dévouement de mademoiselle de Marsal. Tout à coup à l’extrémité du village, ou pour mieux parler, du hameau (car on ne pouvait donner un autre nom à un assemblage de chaumières dissemblables dans leur misère comme dans leur structure même, et irrégulièrement espacées), à l’extrémité du hameau, disons-nous, parut un cavalier en petite tenue d’officier de marine; monté sur un cheval du pays et portant en croupe une valise de voyage. Il était suivi d’un grand gaillard à teint jaune et cuivré, en costume de matelot, qui semblait plutôt lui servir de guide que d’escorte et dont les jambes, agiles et nerveuses, menaçaient constamment de devancer celles du cheval.
Le cavalier, indécis sur la route, venait de pénétrer dans l’intérieur du hameau, précisément pour se procurer les renseignements qui lui manquaient.
Un mouvement de défiance et d’effroi se manifesta dans les groupes à l’aspect du nouveau venu. Pour les terreurs stupides des paysans, un étranger ne pouvait surgir sans apporter dans les plis de son vêtement et jusque dans son haleine quelque émanation des miasmes empoisonnés du choléra.
— Eh! camarades, dit l’officier d’une voix affable et ferme à la fois, pouvez-vous nous indiquer le chemin pour aller au château du général de Saint Pons?
— Vous n’en êtes pas loin, répondit d’une voix hâtive le plus hardi de la bande, le seul peut-être qui ne crut pas qu’en entrant en colloque avec le nouveau venu il s’exposait à une sorte de contagion. Écoutez, monsieur l’officier: en sortant du village, reprenez la route, et ensuite tournez à droite à la première croix... c’est au bout. Vous en avez à peine pour une demi-heure mais dépêchez-vous! ajouta-t-il rudement en voyant que l’officier, surpris à la vue de l’attroupement et de l’excitation visible de tous les-gens qui le composaient, ne se pressait pas de continuer sa route.
En ce moment, comme pour expliquer à l’étranger la cause qu’il cherchait, des cris d’effroi retentirent dans les groupes, et le cercle s’élargit subitement autour de la chaumière de Madeleine.
Emmeline venait de reparaître sur le seuil.
— Oh! mes amis... mes amis... par grâce... quelqu’un pour m’aider, et je le récompenserai bien. Cette pauvre Madeleine se débat dans les crampes et je ne suis pas assez forte pour la retenir.
— Oui, c’est ça, pour gagner le choléra! reprit l’un des meneurs de l’émeute. Ah! vous offririez bien tout ce que vous voudriez! Mamzelle, rentrez bien vite, ou tant pis pour vous!
Et aux imprécations se joignirent les menaces. Un jeune gars à l’œil hébété, aux bras bruns et nerveux, ne craignit même pas de croiser sa fourche contre la douce et inoffensive Emmeline.
Celle-ci se tordait les mains avec désolation, sans s’apercevoir même des périls qu’elle courait, uniquement préoccupée de se voir seule, réduite à l’impuissance pour son œuvre d’humanité.
Emmeline dans sa douleur était plus charmante encore. Pour prodiguer ses soins à Madeleine avec plus de liberté, elle avait ôté le grand chapeau de paille qui, pendant la route, protégeait son front contre les ardeurs du soleil, ainsi que la pèlerine qui couvrait ses épaules et sa poitrine dont les contours harmonieux se devinaient sous son corsage de mousseline. Les boucles de ses cheveux flottaient au vent comme sous un souffle divin, ses joues étaient colorées, ses yeux brillaient du saint enthousiasme de la charité. Au milieu de cette populace sauvage et idolâtre qui n’avait plus qu’un seul culte: le grossier instinct de la conversation, Emmeline rappelait ces vierges sublimes qui ont confessé les premières la foi du christianisme devant les préteurs et les bourreaux, sous le bec de ces vautours dégénérés, issus de l’aigle romaine, avant de monter au ciel pour y recevoir la palme du martyre.
La requête suppliante d’Emmeline, la brutale et menaçante réponse des paysans avaient sufi pour mettre en un moment l’officier de marine au fait de tout ce qui se passait.
Est-ce le désir chevaleresque de participer à une bonne action ou bien simplement la tentation de mieux connaitre une gracieuse personnification de la bienfaisance qui dicta sa détermination? Nous ne voulons ici ni calomnier ni surfaire le nouveau personnage qui vient d’entrer en scène; toujours est-il qu’il s’écria résolument:
— Mademoiselle, on m’attendait pour dîner chez mon oncle; ma foi... on se mettra à table sans moi... Ce n’est certes pas moi qui vous abandonnerai dans la bonne œuvre que vous avez entreprise.
En même temps, se tournant vers l’homme qui l’accompagnait, il lui adressa quelques paroles dans une langue étrangère, à la fois toute syllabyque et toute pleine de sonorité, mais qui ne rappelait à coup sûr aucun des idiômes de notre vieille Europe. Cet homme baissa la tête sur sa poitrine, et, sans prononcer une parole, il aida l’officier à descendre de cheval au milieu de la foule stupéfaite et se mit en devoir d’attacher l’animal à un barreau d’une fenêtre basse, puis il s’éloigna rapidement dans la direction indiquée du château de Saint-Pons. Toutefois, ce ne fut pas sans jeter sur celui qu’il quittait un long regard où l’on pouvait lire l’expression d’un regret et presque d’une douleur.
Les paysans avaient contemplé avec une curiosité évidemment empreinte d’inquiétude l’homme au teint jaune et cuivré, et dans la disposition d’esprit où ils se trouvaient, une même pensée leur vint à tous: c’est que cet homme par la couleur de sa peau, par celle même de ses yeux, d’un vert profond comme celui des eaux de la mer, devait être atteint du choléra; aussi ils s’écartèrent avec terreur de son passage. Mais l’officier de marine, qui avait deviné leurs appréhensions, s’empressa de les calmer.
— Camarades, s’écria-t-il en riant, n’ayez nulle peur de mon domestique, il n’est atteint ni de la rage ni du choléra. C’est un naturel de l’Océanie, et il a la couleur de son pays, voilà tout!
— C’est égal, reprit en hochant la tête le paysan qui paraissait jouir d’une certaine autorité sur cette foule ameutée, qu’il s’en aille bien vite!... Quant à vous, monsieur l’officier, entrez chez la Madeleine si ça vous va; mais, une fois entré, vous ne sortirez plus!
— Oh! non, vous ne sortirez plus! répéta le chœur.
— Une quarantaine! reprit l’officier; oh! en ma qualité de marin, j’y suis accoutumé, ça ne m’effraye pas, et je n’en aurai jamais fait une en plus agréable compagnie. Vous voulez m’empêcher de sortir, c’est ce que nous verrons; mais pour le moment, l’important c’est d’entrer, et j’entre!
Et il franchit le seuil de la maison de Madeleine.
Mlle de Marsal venait, de son côté, de rentrer subitement dans l’intérieur dès qu’elle eut compris, au premier mot de l’officier de marine, qu’elle avait un compagnon de dévouement, après avoir remercié vaguement, d’un signe de tête, l’inconnu que, dans son trouble et ses préoccupations, elle avait paru à peine distinguer.