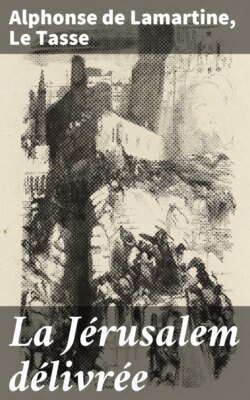Читать книгу La Jérusalem délivrée - Alphonse de Lamartine - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
NOTICE SUR LE TASSE,
1544-1595.
ОглавлениеTable des matières
Torquato Tasso, que nous nommons ordinairement le Tasse, naquit le Il mars1544, à Sorrento, dans le royaume de Naples, de Bernardo Tasso et de Porcia de Rossi. Sa famille était ancienne et illustre; son père, un des meilleurs poètes de l’Italie, eut avec Boyardo et l’Arioste la gloire défaire triompher la langue nationale, créée par le Dante et Pétrarque, des préjugés que la cour de Rome et la superstition des savants se plaisaient à entretenir en faveur du latin. Bernardo a composé une foule de pastorales et de poésies légères; mais son poème d’ Amadiji, imité du roman espagnol d’ Amadis des Gaules, lui assure un titre sérieux au souvenir de la postérité. Le jeune Torquato commença, dès le berceau, à bégayer les vers de son père, et à former son oreille à l’harmonie poétique. Les premiers développements de son esprit furent extraordinaires, et les historiens de sa vie se plaisent à nous en raconter des prodiges. A peine âgé d’un an il prononçait exactement sa langue, et répondait avec bon sens aux questions qu’on lui adressait; il n’y avait dans ses discours rien d’enfantin que le son de sa voix, et il donnait déjà des marques de la force de caractère qu’il a montrée depuis dans ses malheurs. A neuf ans il savait le grec et le latin, il écrivait en prose et en vers; et l’on cite une pièce de vers fort touchante qu’il adressa à sa mère lorsqu’il la laissa à Naples, pour suivre son père. L’infortune commença de bonne heure pour lui. Bernardo, qui s’était attaché à San Severino, prince de Salerne, avait été obligé de s’expatrier. Il eut ses biens confisqués comme rebelle; et les frères de sa femme, profitant de sa disgrâce, refusèrent de lui payer la dot de leur soeur, qui mourut de chagrin. Elle laissait à son mari deux enfants, Cornelia et Torquato. La misère le poursuivit en France, où il s’était retiré, et il fut obligé de revenir en Italie. Il revit à Rome le jeune Torquato, et le trouva familiarisé avec les philosophes et les poètes de l’antiquité. Alors il l’envoya à Padoue pour y étudier le droit. Torquato y forma avec le jeune Scipion de Gonzague une liaison qui dura jusqu’à la mort. Après cinq années d’études sérieuses, il soutint avec éclat des thèses sur la théologie, la philosophie et la jurisprudence, et reçut le bonnet de docteur dans ces différentes facultés.
Son amour pour la poésie s’était déjà révélé; et il composait, à l’âge de dix-sept ans, Rinaldo, qu’il publiait à Venise (1562) sous les auspices du cardinal d’Esté. Le succès de cet ouvrage ne fit qu’accroître les alarmes de Bernardo Tasso sur l’avenir de son fils: il avait dû aux lettres une partie des chagrins et des misères de sa vie, et il voulut, mais en vain, que Torquato suivît une carrière plus sévère et plus heureuse.
Il y avait à Padoue une académie qui avait pris le nom d’Etherei. Scipion de Gonzague y fit recevoir le jeune poète, qui prit le nom de Pentito (repentant): pour exprimer peut-être son regret d’avoir dérobé aux lettres les années qu’il avait consacrées à la jurisprudence.
C’était alors l’époque des romans de chevalerie, des contes de sorciers et de magiciens, des nouvelles galantes et licencieuses. Boyardo venait de publier X Orlando inamorato, dont le succès fut bientôt effacé par celui de l’Orlando furioso. Les vers de l’Arioste excitèrent dans toute l’Italie une sorte d’ivresse. Bientôt, retenus, répétés, chantés dans les campagnes comme dans les villes, ces vers ne purent garantir le poème de reproches fondés sur le désordre, sur la bizarrerie des incidents, les combats sans objet, les aventures sans vraisemblance et souvent sans décence. Le Tasse, en écrivant son Rinaldo, sacrifia au goût général; mais ce qui prouve la supériorité de son esprit et la maturité de sa raison, c’est que les éloges qu’il avait reçus de toutes parts ne purent l’aveugler sur les défauts de cet heureux essai. Il conçut le plan d’un nouvel ouvrage et jugea qu’il fallait attacher l’action épique à un événement important de l’histoire, si on voulait lui donner une véritable grandeur et un intérêt solide. Il crut trouver dans la conquête de la Terre-Sainte par Godefroi de Bouillon un sujet tout palpitant et qui offrait les éléments les plus propres à échauffer et à étonner les esprits préoccupés des luttes dont l’Orient était alors le théâtre et des entreprises de Soliman contre les descendants des anciens Croisés. Mais, au moment où il abordait un sujet si noble et si splendide, il dut s’arracher aux loisirs de la vie studieuse pour se jeter au milieu du tumulte d’une cour également renommée par le luxe de ses fêtes, par le mérite de ses poètes et de ses savants.
Le cardinal Louis d’Este, frere d Alfonse, duc de Ferrare, le reçut au milieu de ses gentilshommes; et les deux princesses Lucrèce et Léonore d’Este, à qui leur mère, Renée de France, fille de Louis XII, avait inspiré l’amour des sciences et des lettres, accueillirent avec faveur l’auteur de Rinaldo.
Peu de temps après, le cardinal fit un voyage en France. Il mena avec lui le Tasse, qui y avait été précédé par sa réputation. Charles IX, dont le nom a été flétri par l’horrible massacre de la Saint-Barthélemy, aimait et protégeait les lettres. Versé dans la littérature italienne, il avait goûté le poème de Rinaldo, et connaissait quelques fragments de la Jérusalem. Ce poème, où les Français jouent un rôle si important, ne pouvait manquer de plaire à Charles IX. Le roi aimait a causer avec le Tasse, et lui accordait des grâces qu’il refusait à toutes les autres sollicitations; mais il paraît que la faveur dont il jouissait se bornait à de simples démonstrations d’estime: car, la franchise de ses discours sur les affaires politiques de religion ayant déplu au cardinal-ambassadeur, il fut privé de son traitement, et réduit à un tel dénument qu’il emprunta un écu. Il dut alors retourner en Italie; et il ne paraît pas avoir rapporté de la France une idée bien avantageuse. Dans ses lettres, il critique les moeurs, les habitations, les monuments et jusqu’aux produits de notre sol; mais il ajoute que Venise était peut-être la seule ville d’Italie qui fût digne d’être comparée à Paris. Il admire Ronsard; et un tel témoignage relève aux yeux de la postérité ce poète, qui, adulé de son vivant, retomba après sa mort dans un injuste oubli.
De retour à Ferrare (1571), il y fut reçu par le duc avec la même bienveillance. Il s’occupa à finir sa Jérusalem sans renoncer pour cela a d’autres ouvrages en prose et en vers, moins considérables et moins difficiles. Alors parut l ’Aminta, poème charmant qu’imitèrent Guarini et Bonarelli.
La manière dont il avait peint l’amour dans son Aminia, des pièces de vers dans lesquelles il exprimait des sentiments tendres pour une beauté qu’il n’osait pas faire connaître, enfin un sonnet où il donne le nom d’Eléonore à l’objet de sa flamme, firent soupçonner qu’une intrigue secrète existait entre lui et Léonore d’Esté alors âgée de trente-trois ans. La plupart des historiens du Tasse n’élèvent aucun doute sur la vraisemblance de cette passion, que les moeurs du temps, la gloire du poète, sa bonne mine et l’âge même de la princesse rendent assez probable. Cependant, en la désignant sous le personnage de Sophronie, il la représente comme une vierge fière et réservée, inculta e sola, se dérobant aux louanges et aux hommages; et il laisse supposer que ses voeux ne furent jamais connus de l’objet de sa flamme téméraire. Batista Guarini, qui s’était déclaré, ainsi que lui, l’adorateur de la belle comtesse de Scandiano, publia un sonnet où il accuse son rival de brûler de deux flammes à la fois, de former et rompre tour à tour le même lien, et d’attirer sur lui (qui le croirait?), par un semblable manège, la faveur des dieux! La comtesse de Scandiano s’appelait aussi Léonore, ainsi qu’une autre beauté de Ferrare à laquelle le poète adressa des vers de galanterie. Cette intrigue, sur laquelle se sont épuisées toutes les conjectures, ne mériterait pas d’arrêter l’attention si long-temps, sans les conséquences qu’on lui a attribuées.
Ces succès ne ralentissaient pas l’application sérieuse qu’il mettait à la composition de sa Jérusalem. Aux difficultés que lui présentait ce grand ouvrage se joignait celle de balancer la réputation de l’Arioste et l’admiration qu’avait excitée l’Orlando furioso. Ce fut au commencement de l’année1575qu’il termina enfin son poème; mais, avant de le publier, il voulut le soumettre à Scipion de Gonzague, qui était alors à Rome. Celui-ci s’associa quatre hommes de lettres estimés; ils firent de concert un examen détaillé de l’ouvrage, en analysèrent le plan et les détails, et, après de longues conférences, Scipion en renvoya au Tasse le résultat. Les critiques portaient sur le rôle trop prépondérant attribué à Godefroi, sur l’épisode d’Olinde et Sophronie comme trop peu lié à l’action, sur le caractère romanesque d’Herminie, enfin sur les détails voluptueux des amours d’Armide et de Renaud. Le Tasse écouta ces conseils; mais il ne se soumit qu’à ceux qui lui parurent fondés sur le gout et la raison. Il se livra à la correction de son poème avec une nouvelle ardeur; et, constamment occupé de son travail, il se réveillait souvent la nuit pour corriger ses vers et en faire de nouveaux. Cet excès d’application échauffa son sang. Il était d’un caractère mélancolique et sérieux. Dégoûté depuis long-temps du métier de courtisan et de son esclavage, il ne savait comment s’en affranchir. Traité avec distinction par le duc de Ferrare, il ne pouvait s’empêcher de désirer que les marques de considération dont il était entouré ne fussent accompagnées de dons honorables qui eussent assuré son indépendance. Vorreo, disait-il, vorreo frutti e non fiori. Ce sentiment d’ennui, ce désir de secouer un joug trop pesant, étaient contrariés par un autre sentiment, celui de la reconnaissance pour son souverain. Cet état de trouble et d’agitation augmenta son inquiétude naturelle, et donna à la disposition triste de son caractère un degré d’activité funeste qui empoisonna le reste de sa vie. Son imagination se remplit de vaines terreurs et d’injustes défiances: il se crut entouré d’ennemis et d’envieux; il s’imagina que l’on interceptait ses lettres, et que l’on s’introduisait chez lui à l’aide de fausses clefs pour y dérober ses papiers. Tout à coup il apprend que sa Jérusalem s’imprime sans son aveu dans une cour d’Italie. Son désespoir est au comble. Il implore le duc Alfonse; il va jusqu’à solliciter du pape lui-même un bref d’excommunication contre ceux qui lui ont dérobé le manuscrit fruit de tant de labeurs, et sur lequel il fondait toutes ses espérances de gloire et de fortune. A ces justes douleurs se mêlent d’autres terreurs, il se persuade qu’on l’avait déféré à l’inquisition; et il court à Bologne se jeter aux pieds du grand-inquisiteur, qui le rassure, l’absout, et ne parvient pas à le calmer.
Inquiet et violent, il rencontre un jour un homme qu’il soupçonnait de lui avoir rendu de mauvais offices; il le frappe. Celui-ci s’éloigne sans proférer un seul mot; mais, quelques jours après, accompagné de ses frères, il attend le poète au moment où il sortait de la ville: tous trois fondent sur lui, l’épée à la main Le Tasse se défend avec un tel succès qu’il blesse deux de ses assassins, et les force à s’enfuir. Ils furent obligés de sortir de Ferrare. Cette aventure fit un grand bruit, et on répéta long-temps, comme une phrase proverbiale, que le Tasse, avec son épée, comme avec sa plume, était au-dessus des autres hommes.
Depuis lors il se persuada qu’on en voulait à sa vie et qu’on emploierait contre lui le fer et le poison; il ne goûta plus de repos. Il entra dans une sombre méfiance même de ses domestiques. Son état était vraiment digne de pitié. Un soir, étant chez la duchesse d’Urbin, il voulut tuer d’un coup de couteau un des serviteurs de cette princesse. On prévint ce malheur; on se saisit du Tasse, que l’on enferma dans une prison. Alfonse, touché de compassion, le fit, au bout de deux jours, ramener dans sa maison; puis il le conduisit dans son palais de Bel riguardo, où il mit tous ses soins à le distraire et à calmer des terreurs que le grand-inquisiteur n’avait pu faire cesser. Enfin on le conduisit à Ferrare chez les moines de Saint-François. Là, il ne voulut jamais consentir à faire les remèdes qu’on lui prescrivait. Le duc, fatigué des lettres dont il l’accablait, offensé peut-être aussi des expressions inconvenantes qui lui échappaient, lui fit défendre de lui écrire davantage, ainsi qu’aux princesses. Cette sévérité acheva d’aliéner tout à fait un esprit malade; de sorte que le Tasse, ne se croyant plus en sûreté dans le couvent, s’échappa et sortit de Ferrare, le20juin1577. Il partit sans argent et sans guide, et arriva sur les confins du royaume de Naples. Caché sous les habits d’un pâtre, il se présente chez sa sœur Cornélia qui ne le reconnaît pas. Il lui remet une lettre où il lui annonce que son frère est dans une position cruelle et en danger de perdre la vie. Cornélia, à la lecture de ces effrayantes nouvelles, témoigne une si vive douleur, que le Tasse ne peut garder son déguisement et se hâte de la consoler en se jetant dans ses bras.
Le repos dont il jouissait chez sa soeur, les caresses et les soins dont elle le combla, le beau climat de Naples, calmèrent pendant quelque temps son humeur mélancolique, mais ce calme ne fut pas de longue durée. Il s’ennuya de cette vie tranquille et monotone, et le désir de retourner à Ferrare devint plus fort que tous les motifs qui avaient pu l’en éloigner. Il écrivit au duc pour obtenir la permission de revenir, et, sans attendre sa réponse, il quitta Naples malgré sa sœur et ses amis qui redoutaient quelque imprudence de sa part. Il revit Ferrare après un an d’absence, et fut reçu avec les marques de faveur les plus distinguées: mais l’enthousiasme n’existait plus. Il sentit bientôt qu’il n’obtenait plus la considération dont il avait été si long-temps entouré. Il crut s’apercevoir que le duc cherchait à l’éloigner des travaux de la littérature; on ne lui avait pas rendu ses papiers, qu’on avait saisis après sa fuite, et on lui refusait le manuscrit de son poème. Comme tout aigrissait son humeur mélancolique et le rendait chaque jour plus insociable, on avait fini par lui interdire l’entrée de l’appartement des princesses: dans son désespoir, ne pouvant plus supporter le séjour de Ferrare, il en partit secrètement une seconde fois.
Il se dirigea vers Mantoue: il pensait que son père ayant été long-temps au service du duc, ce prince l’accueillerait avec bienveillance; mais il n’en éprouva que froideur et dédain. Alors il se rendit dans les états du duc d’Urbin, mari de Lucrèce d’Esté, qui le reçut comme un ancien ami. Ces procédés généreux relevèrent l’esprit abattu d’un homme que tant de malheurs réels ou imaginaires avaient tout à fait découragé. Il passa soudain à des espérances immodérées. Puis ses terreurs reparurent bientôt, et, sans avoir essuyé aucun dégoût à la cour d’Urbin, il s’enfuit brusquement, une nuit, pour aller implorer la protection du duc de Savoie contre des ennemis qui n’existaient que dans ses rêves. Il arriva aux portes de Turin dans un état si misérable que les sentinelles lui refusèrent le passage. Un homme de lettres protégea son entrée dans la ville, et, après lui avoir donné les secours dont il avait besoin, le présenta au prince de Piémont qui l’accueillit avec distinction. Charles-Emmanuel lui fit les offres les plus avantageuses pour le retenir à son service. Le Tasse jouit un moment de cet état prospère, mais il retomba bientôt dans les mêmes inquiétudes. Le souvenir de la perte de ses papiers le reportait sans cesse vers Ferrare; et au milieu des tristes chimères qui avaient égaré sa raison, on voit, par ses lettres, que l’amour de la gloire était sa passion dominante.
Alfonse avait perdu sa seconde femme et venait de se remarier avec la fille du duc de Mantoue. Malgré les conseils et les instances des amis qu’il avait trouvés à Turin, le Tasse retourna à Ferrare où il arriva le21février1579. Le duc et ses soeurs ne voulurent pas le voir; les courtisans l’évitèrent: rebuté même des domestiques du prince, il eut beaucoup de peine à obtenir un asile obscur. Dans ses fureurs, il ne garda aucune mesure; il éclatait en injures contre toute la maison d’Esté, contre le duc, contre toute sa cour. Ces violences furent regardées comme l’effet d’une entière aliénation d’esprit: Alfonse le fit arrêter et conduire à l’hôpital de Sainte-Anne, où l’on enfermait les fous. Les excès où il était tombé étaient évidemment l’effet d’une véritable aliénation et devaient inspirer à un souverain généreux de la pitié, non de la colère; c était dans l’hôpital des malades, non dans la maison des fous, qu’il fallait placer cet infortuné, et lui prodiguer les soins de la médecine, non des humiliations aussi déraisonnables que cruelles. Ainsi, tout en reconnaissant qu’Alfonse avait d’abord montré beaucoup d’indulgence, on ne peut point expliquer, encore moins justifier, les indignités qu’un grand homme eut à souffrir dans cette humiliante détention. Sa situation était d’autant plus intolérable que l’espèce de manie dont il était atteint ne troublait son esprit que sur certains points. S’il obtint quelque adoucissement à sa captivité, il ne le dut qu’à l’ intérêt qu il inspira à un jeune homme, nommé Mosti, neveu du prieur de l’hôpital. Ce jeune homme venait tous les jours le voir, entendre ses vers et surtout l’entretenir de littérature et de poésie.
Après deux années de dure captivité, le Tasse obtint (1581) un logement plus commode avec la permission de recevoir quelques personnes et même de sortir de sa chambre pour entendre la messe et se confesser. Les sentiments de religion qu’il avait toujours professés s’étaient encore exaltés par suite de ses malheurs et des hallucinations de son cerveau malade. Il voyait la vierge Marie lui apparaître; et il se croyait en butte à la haine d’un magicien qui le faisait tourmenter sans cesse par un esprit follet, acharné a lui îavir les mets de sa table et ses manuscrits.
Ainsi, c’est à trente ans, après avoir produit le plus bel ouvrage qui ait signalé la renaissance des lettres, que l’infortuné Torquato fut choisi pour donner le plus déplorable exemple de la faiblesse de l’esprit humain! Il y eut dans sa destinée un contraste d’abaissement et de gloire dont on trouverait difficilement un autre exemple dans l’histoire. Son poème n’avait pas encore été publié; ce fut seulement en1581que parut la première édition bientôt suivie de quatre autres en Italie et en France, toutes tronquées et à l’insu de l’auteur. Cependant le succès de la Jérusalem fut universel. Parmi les admirateurs passionnés de ce poème, il s’en trouva qui, empressés du désir de connaître le Tasse, se rendirent à Ferrare et furent surpris de trouver dans l’hôpital des fous celui dont le génie et le nom remplissaient l’Europe.
Ces témoignages d’admiration et d’intérêt suspendirent en lui le sentiment de son humiliation; mais sa gloire éveilla l’envie, et ses malheurs ne purent la désarmer. Les partisans de l’Arioste publièrent contre son poème une foule d’écrits auxquels les admirateurs de la Jérusalem répondirent. Cette querelle occupa toute l’Italie. L’Académie de la Crusca, qui venait de s’établir, signala son existence nouvelle par une critique de la Jérusalem qui manque à la fois de justice et degards pour l’auteur. Cependant le mérite éclatant du poème attira l’attention universelle sur l’infortuné captif. Le duc de Ferrare, cédant à des sollicitations puissantes, promit de lui rendre la liberté, si le prince de Mantoue, son beau-frère, consentait à garder le poète près de lui et à répondre en quelque sorte de sa personne et de ses écrits. Les craintes du duc sur le ressentiment du Tasse étaient peu fondées; car ce qui agitait le plus Torquato c’était de n’avoir pu saluer Allonse d’un adieu, et, pendant tout le temps qu’il avait passé dans l’hôpital de Sainte-Anne, il s’était imaginé que c’ était a son insu et contre sa volonté qu il avait été si malheureux.
Sa captivité avait dure sept ans et deux mois. Il se rendit aussitôt a Mantoue, et il y termina le poeme de Floridant que son père avait laissé imparfait; il y finit aussi sa tragédie de Torrismond, commencée long-temps avant sa maladie. Puis, entraîné par son inquiétude ordinaire, il voulut quitter Mantoue et en obtint facilement la permission. Il nourrissait le désir de se fixer à Rome, il y arriva rempli d’espérance et s’en éloigna bientôt plein de découragement. Il alla à Naples, revint à Rome et passa le reste de sa vie à errer de l’une à l’autre de ces villes sans trouver jamais ce repos de l’âme dont il sentait le besoin. Flatté d’abord des prévevances de ses amis, il était effrayé de leurs soins même; et, soupçonnant leurs intentions, il rebutait leur zèle et les fatiguait de ses plaintes. La faiblesse de son âme le soumettait aux volontés des derniers des hommes; tantôt comblé de présents, tantôt privé du nécessaire, il se voyait alternativement servi dans les maisons des princes, ou au moment de périr de misère et de se réfugier dans un hôpital.
Après avoir reçu l’hospitalité du prince de Conca, il alla loger chez son ami Manso, marquis de Villa. C’est là qu’il acheva et publia sa Jérusalem conquise, qui n’est qu’une refonte de la Jérusalem délivrée.
Pendant qu’il menait chez Manso une vie doucement remplie par ses travaux littéraires et les soins de l’amitié, le cardinal Cinthio Aldobrandini, neveu du pape Clément VIII, lui écrivit pour le presser de revenir à Rome. Le Tasse ne put résister à ses instances, mais en se séparant de Manso il eut un triste pressentiment de sa fin et lui dit un adieu qu’il regardait comme éternel.
Arrivé sur les confins de Mola, petite ville voisine de Gaëte, il eut avis que Sciarra, chef de bandits, était près de ces lieux avec une troupe nombreuse. Ses compagnons de voyage ne voulurent point affronter les périls d’une rencontre avec les brigands et préférèrent rester bloqués dans Mola. Mais Sciarra, ayant appris que le Tasse était un des voyageurs, lui envoya un message pour lui dire que, par égard pour lui, il se retirait avec sa troupe et laissait libre le chemin de Rome. Le Tasse était devenu insensible à la gloire, et il fut peu touché de cet hommage qu’un chef de bandits rendait à ses talents et à sa renommée.
La fortune commençait à lui sourire; il obtint une pension de200 ducats sur l’héritage de sa mère, et une autre de200écus que le cardinal de Saint-George avait sollicitée pour lui. Il trouvait à Rome ce qui était propre à le dédommager de ses souffrances; mais tout était fini pour lui, et son imagination même n’était plus susceptible d’illusions.
Ce fut alors que le cardinal Cinthio résolut de lui faire décerner un honneur que personne n’avait obtenu depuis Pétrarque. Il espérait ranimer dans cette âme découragée le sentiment de la gloire par une distinction éclatante, et la rappeler ainsi à l’amour et au sentiment de la vie; mais il n’était plus temps. Le Tasse, frappé de l’idée de sa mort prochaine, ne songeait plus qu’à s’y préparer, et ses principes religieux lui laissaient apercevoir cet instant avec calme et résignation. Il refusa d’abord la proposition de son couronnement au Capitole: «C’est un cercueil, disait-il, qu’il me faut, et non un char de triomphe; si vous me destinez une couronne, réservez-la pour orner ma tombe. Toute cette pompe n’ajoutera rien au mérite de mes ouvrages, et ne peut m’apporter le bonheur. Elle a empoisonné les derniers jours de Pétrarque.» Cependant il céda aux instances de ses amis, et le cardinal Cinthio le présenta au pape. Tous les préparatifs de la cérémonie se pressaient avec activité. Lorsqu’ils furent achevés, le mauvais temps en fit suspendre l’exécution. Mais la nouvelle secousse que ces apprêts donnèrent à ses organes affaiblis acheva d’épuiser ses forces. Une fièvre violente le saisit; il se fit transporter dans le couvent de Saint-Onuphre, où il succomba à ses maux après quatorze jours de maladie. .
Sa mort (25avril1595) remplit de consternation Rome et l’Italie; ses obsèques se firent avec une grande pompe, et une foule immense accompagna le convoi funéraire. On composa en son honneur des épitaphes et des oraisons funèbres. Cependant, malgré le voeu manifesté par le cardinal Cinthio, sa sépulture resta sans monument jusqu’en1608, où le cardinal Bevilacqua fit construire celui qu’on voit dans l’église de Saint-Onuphre.
Le Tasse avait laissé tous ses manuscrits à Cinthio, mais en exprimant le désir qu’ils fussent brûlés après sa mort. C’est ce qui explique le peu d’empressement que mit le cardinal à les publier. Le poème de la Création du monde et un grand nombre d’autres ouvrages en prose et en vers ne furent imprimés que long-temps après.
Torquato était grand et bien fait, ses traits avaient de la noblesse et de la beauté; mais il était un peu louche, et manquait de grâce dans son maintien. Il parlait avec élégance, mais avec une gravité qui touchait à la pédanterie. Un bégayement naturel lui donnait dans la conversation de l’embarras et de la gêne. Son âme était sensible, généreuse et reconnaissante; il s’irritait aisément et s’apaisait de même: il allait au-devant de ses ennemis les plus acharnés, lorsqu’il les voyait malheureux. Une imagination trop mobile et trop active le rendit sombre et défiant; elle l’obséda de fantômes et de chimères que sa raison ne pouvait pas dissiper. Cette disposition tenait sans doute à son organisation, et fut la cause de la cruelle maladie qui a flétri une existence que tout devait rendre si brillante et si fortunée.
On ne connaît ordinairement du Tasse que deux poèmes, la Jérusalem et l’Aminte; mais il composa une foule d’ouvrages, parmi les quels on distingue les Dialoghi discorsi, les Lagrime di Maria virgine, il Rinaldo, il Gonzaga, il Romeo, le Sette giornate del mondo creato, il Forno, il Padre di Famiglia, la Cavaletta, la Molza, il Segretario, il Montoliveto, et beaucoup d’autres pièces plus ou moins importantes.
Toutes les formes de l’éloge ont été employées pour louer la Jérusalem. Voltaire dit du Tasse qu’il avait autant de feu qu’Homère dans les batailles, avec plus de variété. M. de Lamartine, poète comme le Tasse et brave comme lui, a écrit: «Le Tasse a » toujours été mon poète, parce qu’il était en même temps un homme » de coeur et un homme d’épée; c’est le seul Homère de la che-» valerie.»
Des critiques, partisans de l’Arioste, ont avancé que la Jérusalem était un meilleur poème que le Roland, mais que l’Arioste était un plus grand poète que leTasse. Ils plaçaient ainsi la méthode, le bon goût, la régularité et la précision au-dessous des excès brillants d’une imagination féconde. Toutefois on ne saurait comprendre que si l’on doit assigner un rang à deux écrivains d’après le mérite de leurs ouvrages, il faille donner la préférence à celui qui n’a pas produit le meilleur. Nous pensons, avec Métastase, qu’avant de se prononcer sur les deux poètes on doit beaucoup hésiter. L’Arioste aurait pour lui les femmes et les adolescents; le Tasse obtiendrait le suffrage de la jeunesse instruite et des hommes éclairés. Tous deux sont admirables, mais l’un intéresse et fait réfléchir tandis que l’autre plaît et amuse.
La Jérusalem a été traduite dans toutes les langues. Les traductions françaises les plus répandues sont celles de Lebrun et de M. Baour-Lormian. L’oeuvre remarquable de ce dernier doit faire le désespoir de tous ceux qui entreprendront jamais une traduction en vers. Les éditions, depuis1580, ont été très-nombreuses. Enfin la vie ou l’éloge du Tasse ont été faits par une foule d’écrivains distingués, parmi lesquels on peut citer MM. Mazuy, Auguste Desplaces et Suard. C’est du travail de ce dernier que sont extraits les détails qui précèdent.