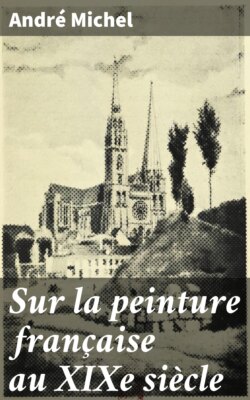Читать книгу Sur la peinture française au XIXe siècle - André Michel - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ANDRÉ MICHEL 1853-1925
ОглавлениеTable des matières
André Michel était né à Montpellier le 7 novembre 1853. Il y avait poursuivi ses études de lettres et d’histoire jusqu’à la licence. Il vint les achever à Paris, où il suivit les cours de l’École des Hautes Études, ceux notamment de Giry et de Gabriel Monod. Déjà orienté vers l’histoire de l’art, il songeait à une thèse de doctorat sur Poussin. L’Université ne s’était pas encore ouverte alors à cette science dont il constatait lui-même, aux premières lignes de son Histoire de l’Art depuis les premiers temps chrétiens jusqu’à nos jour, qu’elle est «la dernière instituée parmi les sciences historiques», et le sujet fut rejeté.
Mais l’art vivant l’attirait également, et la presse parisienne accueillit de bonne heure ses essais de critique d’art, qu’il devait poursuivre, de 1886 jusqu’à ses derniers jours, au Journal des Débats, avec une indépendance, une ouverture d’esprit, une faculté d’attention sympathique qui lui firent jusqu’au bout une place éminente et hors de pair parmi ses confrères. L’enseignement, qu’il n’avait pas abordé par la voie officielle, mais pour lequel il était fait, prit aussi une part importante de son activité. Ses cours privés, ses conférences à Paris, en province, à l’étranger témoignèrent de la chaleur communicative de sa parole, de ses dons de généralisation et de mise au point des sujets les plus divers. Émile Boutmy le chargea, en 1884, de le suppléer dans sa chaire d’Histoire de l’Art de l’École spéciale d’architecture, qu’il occupa ensuite comme titulaire jusqu’en 1893.
A cette date, bien qu’il n’eût jamais songé jusque-là à entrer dans l’administration et qu’il y parût assez peu disposé, Louis Courajod, qu’il avait connu à la Gazelle des Beaux-Arts, dont il était l’un des collaborateurs les plus brillants depuis 1884 et dans les jurys de l’Exposition de 1889, Louis Courajod lui proposa, par sympathie d’idées, de sentiments et de caractère, de devenir au Louvre son adjoint dans la conservation du département de la Sculpture du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes, qui venait de recevoir une existence autonome. Cette collaboration affectueuse et féconde ne dura que trois ans. En 1896, Courajod était enlevé prématurément, et André Michel recueillit la conservation du département. On sait assez ce qu’il en a fait, continuant avec passion et souvent avec bonheur, non sans orages parfois, dans les services administratifs ou dans les conseils trop lents à son gré à suivre ses impulsions, l’œuvre d’enrichissement et de classement de notre musée de la sculpture française. Ses articles aux Débats, dont il tenait volontiers les lecteurs au courant de ses travaux et de ses achats, ses revues périodiques à la Gazette des Beaux-Arts, ses études aux «Monuments Piot» sur les morceaux les plus importants qu’il avait pu recueillir, son petit livre, publié chez Laurens, sur Le Département des Sculptures dit Moyen Age, de la Renaissance el des Temps modernes au Louvre, en ont laissé le témoignage, s’il ne lui a pas été donné d’en dresser lui-même un inventaire complet. Mais, de même que son premier soin avait été, en 1897, de mettre au point et de publier le catalogue préparé par Courajod, qui comprenait alors 867 numéros, nous avons pu, après son départ du Louvre, publier en 1922 un nouveau catalogue qui en comprend 1551.
Mais, pendant ces vingt-cinq ans de soins, de soucis, d’émotions, dont peut témoigner ici celui qui fut durant tout ce temps son élève et son collaborateur constant, son enseignement à l’École du Louvre s’était développé parallèlement. Il avait pris l’histoire de la sculpture moderne à son origine et l’avait conduite, sans jamais revenir en arrière, jusque vers la fin du XVIIe siècle: ce fut pour lui-même une école et une discipline toute nouvelle que cette enquête menée pas à pas avec un souci minutieux de l’exact et du complet, auquel il astreignit un esprit habitué aux généralisations brillantes et aux divinations instinctives du critique et du conférencier. Ses élèves, qui furent nombreux et assidus, n’en ont pas perdu la mémoire, pas plus que des lueurs éclatantes dont, au milieu d’une discussion critique ou d’une énumération aride, sa sensibilité toujours en éveil savait illuminer tel essai balbutiant d’un imagier roman ou tel chef-d’œuvre classique d’un Puget ou d’un Coysevox.
Quelle magnifique histoire de la sculpture française il eût pu écrire, s’il avait pris le temps de tenir mainte promesse faite à droite ou à gauche, s’il n’avait préféré surtout faire passer la substance de cet enseignement analytique dans les chapitres qu’il se réserva de cette Histoire de L’Art à laquelle il allait consacrer, à partir de 1903, ses dons d’écrivain, ses vues larges et généreuses et sa puissance de synthèse.
Les Expositions universelles de 1889 et de 1900 lui avaient été déjà l’occasion de tracer, pour la Gazelle des Beaux-Arts, de vastes tableaux de l’art sculptural ou pictural du XIXe siècle. Après un Boucher, daté de 1886, il avait, en 1890, écrit une histoire de L’École française de David à Delacroix. Mais c’était surtout ses remarquables chapitres sur l’histoire de l’art depuis le XVIe siècle, parus dans l’Histoire générale de Lavisse et Rambaud, qui avaient mis en lumière ses qualités d’historien et l’étendue compréhensive de ses vues d’ensemble. Quand, après cette Histoire générale, M. Max Leclerc, directeur de la Librairie Armand Colin, eut l’idée d’entreprendre une Histoire de l’Art, cette idée aussitôt s’identifia dans son esprit avec André Michel, qu’il avait appris à connaître et à aimer aux Débats. Lui seul pouvait être l’âme de cette vaste entreprise. Mais la matière se trouva si riche que les huit tomes prévus durent se dédoubler en dix-sept volumes dont on sait aujourd’hui ce qu’ils représentent de notions, de faits et d’idées accumulés.
André Michel ne se borna pas, du reste, à distribuer la tâche entre les collaborateurs dont les compétences diverses et les manières parfois divergentes lui étaient connues et qu’il savait prêts à accepter ses suggestions amicales. Par des discussions, souvent délicates, malgré tout, par un travail personnel sur les manuscrits et les épreuves, par les conclusions et les avertissements qu’il tint à rédiger lui-même pour «lier la gerbe», comme il disait, il s’efforça de maintenir autant que possible l’unité de l’œuvre, et il y réussit non sans peine, non sans inquiétudes et sans troubles de conscience parfois, souhaitant souvent d’arriver vers la fin du cycle pour assumer une part personnelle de plus en plus grande de la besogne, afin de réaliser, par l’intervention de sa propre vision, si large et si humaine, des manifestations de l’art moderne, le tableau d’ensemble qu’il rêvait comme la conclusion de l’ouvrage.
Ce fut, hélas! le contraire qui arriva. On sait combien la période de la guerre, qui interrompit la publication de l’Histoire de l’Art, lui fut cruelle à lui-même par les angoisses et les deuils multipliés autour de lui. Son activité apparente n’en fut pas diminuée. Il se raidit au contraire et se multiplia pour «servir» quand même. Mais il nous disait fréquemment sa lassitude extrême, son cœur surmené, ses nerfs usés. Les honneurs lui étaient venus tardivement. Il avait remplacé, en 1917, à l’Académie des Beaux-Arts, son ami Louis de Fourcaud. Deux fois président de la Société de L’Histoire de l’Art français, il avait eu la charge de présider en 1921 le Congrès de Histoire de l’Art tenu à Paris, et nul n’était certes mieux qualifié que lui pour représenter la science et l’esprit français devant les délégués des vingt-six nations amies ou alliées qui vinrent se grouper à la Sorbonne et affirmer, comme il le leur disait en un magnifique langage, que, «en dépit de tant de réalités décevantes et cruelles, de destructions et d’hécatombes, l’homme n’est pas voué aux œuvres de haine et de mort». Mais, de la période terrible qu’il venait de traverser, un nuage restait sur sa pensée, un voile sur sa parole jadis si vibrante, même lorsqu’il nous disait encore cette fois que «ce qui fait le prix de la vie, après la bonté, c’est la beauté », lorsqu’il vantait à cette assemblée d’érudits «le rôle initiateur et révélateur de la sensibilité et du sentiment».
Il venait de quitter le Louvre, non sans mélancolie, pour se consacrer à l’enseignement au Collège de France, où la mort de Georges Lafenestre lui avait permis d’entrer. Il ne put y donner toute sa mesure. Deux ans après, il était obligé de renoncer au professorat. L’Histoire de l’Art restait sa préoccupation essentielle, et s’il dut, au cours de l’année qui suivit, renoncer à écrire «son chapitre» sur la Sculpture de la seconde moitié du XVIIIe siècle, toutes les épreuves du volume lui passèrent encore par les mains et retinrent son attention défaillante, son esprit terrassé par un mal implacable. 11 succomba le 12 octobre 1925.
Il ne nous appartient ici que de rappeler ce qu’avait été, chez André Michel, le savant, l’écrivain, le professeur. Comment cependant ne pas évoquer d’un mot, en terminant, et la chaleur de son amitié, et ses vertus familiales qui lui faisaient, à son foyer si durement frappé, un cercle d’affections si puissantes, et cette conscience enfin où, comme le disait admirablement M. le Pasteur Westphal, au jour de ses obsèques, «la notion du devoir, marquée au coin de l’intransigeance huguenote, s’unissait à une compréhension chevaleresque de la conscience d’autrui» ?
PAUL VITRY.