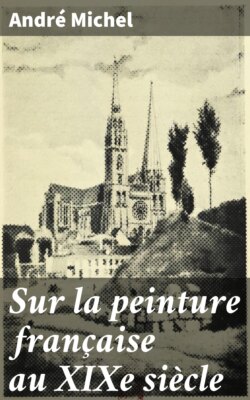Читать книгу Sur la peinture française au XIXe siècle - André Michel - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III. — GRANET ET GROS
ОглавлениеTable des matières
A ceux qui ne connaissent pas le beau musée d’Aixen-Provence, la salle occupée par Granet réserve de charmantes surprises. Voici le plus aimable représentant de ce groupe provençal qui, de Chardigny aux Giraud, est si vivant et si original et dont je voudrais bien qu’un homme de goût et de savoir nous écrivît enfin l’histoire. Quel beau livre à faire! Il s’appelait Marius, et ce prénom déjà nous avertit sympathiquement; mais ce n’était pas un de ces Marius sonores et hâbleurs, comme les gens du Nord, pleins de naturelle malveillance, sont trop enclins à dire qu’on en rencontre un peu trop entre Tarascon et les Martigues. Il appartenait à l’espèce des Provençaux sérieux et réfléchis, capables même de se taire, d’observer, de penser et de sentir avec discrétion et profondeur. Il ne faudrait pourtant pas que les Tartarins fissent oublier les Fabri de Peiresc....
Granet, dans l’atelier de David, appartenait à la génération intermédiaire entre Drouais et Ingres; il était un peu plus jeune que Girodet, Gros et Gérard, et de cinq ans l’aîné d’Ingres. Il fut son voisin dans le couvent des Capucines, dont les bâtiments et les jardins occupaient à peu près ce qui est aujourd’hui la rue de la Paix, entre la rue des Petits-Champs et les boulevards, et où toute une colonie d’artistes avait établi ses ateliers dans les cellules désaffectées. Ingres et Bartolini y travaillaient ensemble et s’enfermaient jalousement pour parler des primitifs florentins, des «gothiques», tandis que, à l’autre bout du couvent, Girodet peignait dans le plus grand mystère son Ossian et son Atala. A deux ou trois cellules d’Ingres et de Bartolini, Granet avait son atelier. Il avait pris, dès son entrée chez David, une attitude très nette. Aimable, spirituel, modeste, de visage pâle, avec l’air bon et fin, de maintien discret, il ressemblait à un «habitant des cloîtres», et, dès le premier jour, ses camarades l’avaient surnommé le moine. Il avait, avec le Lyonnais Révoil, Auguste de Saint-Aignan, Forbin et Richard Fleury, assidûment visité le musée des Petits-Augustins, «dont l’influence contrebalançait, observait Delécluze, celle du musée des antiques » et contribuait à développer le genre anecdotique qui devait «détourner l’attention du public, dirigée presque exclusivement jusque-là sur la peinture de haut style».
Vers ce «haut style», Granet ne s’était jamais senti attiré et il avait eu la sagesse de ne pas forcer sa nature. «Celui-là a ses idées, il a son genre. Ce sera un coloriste; il aime le clair obscur et les beaux effets de lumière, disait David. Tâchez de dessiner, mon cher Granet, mais suivez votre idée. Bon courage, votre carrière est ouverte!» Tandis que plusieurs de ses camarades s’évadèrent plus tard bruyamment de la discipline et de «l’idéal» classiques, en criant du haut de leur tête, sur l’air des lampions: «A bas les Grecs, à bas les Romains», il suivit tout naturellement son inclination, et les querelles esthétiques se déchaînèrent autour de lui sans l’émouvoir. On le voyait régulièrement établi dans un coin du cloître des Capucines, avec sa toile et son chevalet, ou bien occupé à peindre les longs et obscurs corridors où s’alignaient les cellules, observant à toutes les heures du jour et jusqu’au crépuscule «les effets variés de la lumière», causant amicalement avec tous ceux qui l’abordaient et, à l’occasion, sachant donner aux camarades dans l’embarras de très avisés et efficaces conseils.
Un petit tableau, exposé au Petit Palais sous le numéro 156, me semble prendre, dans cette évocation de David el ses élèves, la valeur d’un symbole. Le jeune dessinater (c’est le titre du tableau) est assis à son chevalet; devant lui, le modèle, l’auguste modèle de plâtre, est dressé contre la muraille; mais, en réalité, le peintre s’est arrangé pour l’escamoter à peu près complètement. On en aperçoit assez cependant pour reconnaître l’Apollon du Belvédère. Le jeune dessinateur a tout l’air de faire un pensum. Cependant, au fond de la pièce, à sa gauche, la fenêtre est grand’ouverte et, dans l’encadrement de la large baie, la campagne apparaît; le ciel lumineux, mais un peu voilé, emplit doucement l’horizon; les frondaisons automnales, à peine dorées, moutonnent au loin, les fabriques s’étagent dans la perspective et «se composent» plus encore par leurs valeurs que par leurs lignes; une fine harmonie enveloppe toutes choses et, bien plus que le plâtre vénérable, c’est la nature qui se charge de donner discrètement et tendrement au jeune dessinateur une grande leçon. Et il semble qu’on entende le bon Granet dire à sa manière, pendant que les anciens et les modernes, les classiques et les romantiques, les homéristes et les shakespeariens apprêtent leurs armes et leurs invectives pour la bataille prochaine: «Laissez raisonner et divaguer les théoriciens; apprenez votre métier et abandonnez-vous à la nature qui est éternelle. Sachez peindre et peignez ce que vous aimez. C’est encore la bonne tradition française. Chardin l’a maintenue à travers toutes les fantaisies de ce XVIIIe siècle que l’on nous apprend à exécrer et à mépriser. Le savant Joseph Vernet, que nous avons perdu en 1789, en a condensé le plus délicat enseignement dans ses petits paysages qu’on admire moins que ses grands tableaux, mais que je connais bien et voici, autour de moi, des jeunes gens qui, déjà, me font signe qu’ils ont compris. Dieu, que j’ai défendu contre les blasphémateurs dans l’atelier de David, me fera la grâce de vivre assez longtemps pour voir s’épanouir le génie de Corot....»
Il alla en Italie, comme tous les jeunes gens de son temps, et comme Géricault lui-même, et c’est à Rome qu’Ingres fit de lui, en 1807, l’admirable portrait que les administrateurs du musée d’Aix ont bien voulu nous donner la joie de revoir en le prêtant à cette exposition. On dirait que, en le peignant, Ingres, tout plein alors des primitifs, pensa aussi à l’art et aux prédilections les plus intimes de son ami. Un grand nuage plombé emplit tout l’horizon, dégageant seulement à droite un triangle de ciel où se dressent, dans la lumière, les nobles architectures de la Villa Médicis et de la Trinité des Monts; les verdures graves des jardins alternent avec les fabriques, qu’un pin parasol, au fond. domine et couronne. C’est Rome, son rythme, sa grandeur, résumés et évoqués avec je ne sais quelle fervente austérité, quel religieux enthousiasme. Et, sur la grande teinte plate du sombre nuage, s’enlève vivement la tête pensive de Granet, encadrée dans les notes vives d’un immense faux-col blanc triangulaire, qui serait ridicule si l’audace géniale du peintre n’avait su l’imposer avec une impérieuse et subtile autorité. Il est enveloppé d’un grand manteau brun; il tient à la main son album de croquis. Or nous pouvons feuilleter ici un de ces précieux albums; nous pouvons voir réunis en de grands cadres quelques-unes des études qu’il y recueillait. Coins des jardins de la villa d’Esté ou de la villa Falconieri, campagne romaine, vues des monts Albains, Tivoli, Subiaco, Città di Castello, bords du Tibre, église San Francesco du Campo Vaccino, — avec quel amour, quelle intelligence il a vu, observé et peint cette Rome alors toute bruissante de discussions esthétiques et où il ne demandait, lui, qu’à la nature, à la lumière modelant les grandes étendues, aux nobles architectures mêlées à cette nature éternelle et incorporées à l’œuvre de la création, de quoi alimenter son art et sa rêverie, maintenir en état de grâce son esprit et son cœur bien équilibrés, délicats et sincères.
Dans ce même couvent des Capucines d’où Granet était parti pour Rome, Gros était aussi venu chercher un gîte. C’est là qu’il peignit ou ébaucha plusieurs portraits du Premier Consul, et ses merveilleuses esquisses des batailles du Mont-Thabor et d’Aboukir. Sa vocation s’était révélée avec une étonnante précocité et une singulière évidence dans un tableau d’école qu’il fit à dix-sept ans, en 1788, et que le musée de Saint-Lô a prêté à l’exposition. Je n’ose en recommencer l’analyse, mais je ne saurais trop engager ceux que ces choses intéressent à le regarder de près. Une destinée de peintre semble y prendre un joyeux essor; une composition pittoresque, expressive et vivante, un bouquet de couleurs claires et chantantes épanouies dans la lumière montrent quels dons révélait cet enfant à l’heure même où David, dont il était depuis deux ans l’élève, ramenait à l’abstraction de plus en plus froide et à la grisaille de plus en plus monochrome les conditions et les lois du style, du «haut style». Certes, il conviendra volontiers, avec Forbin, avec Granet, que tous les genres ont du bon; il accusera même quelques-uns de ses disciples, plus zélés qu’intelligents, d’être plus rigoureux qu’un tribunal révolutionnaire de l’art. Il oubliait alors son propre jacobinisme, qu’un caricaturiste de la fin du XVIIIe siècle exprimait plaisamment dans une lithographie où il est représenté, dans l’attitude du Tatius des Sabines, tenant sa palette comme un bouclier, brandissant son appuie-main comme une lance, tandis que ses élèves, à grands renforts de bustes et de torses antiques, font assaut — et qu’un moulage en plâtre lève lui-même un bras menaçant — contre une figure falote de marquis, symbole de l’Académie royale, de l’art monarchique impur et proscrit!
Et le malheureux Gros, impérieusement ramené à Plutarque et au grand art toutes les fois qu’il tentait de s’évader du côté de la vie, succomba sous le poids des remords que lui avait imposés l’implacable rigueur de son maître. Delécluze, sur ce point, est le témoin le plus sûr, d’autant plus sûr qu’il inclinerait plutôt du côté de David. Ecoutez-le: «Le coloris brillant, la hardiesse du pinceau et jusqu’à l’espèce de désordre qui régnait dans ces compositions faites avec tant d’aisance et d’audace..., ces habitudes et ces qualités si différentes de celles qui régnaient depuis dix ans dans les écoles de Paris parurent tout à coup à un grand nombre d’artistes celles qui devaient être préférées et dont les résultats seraient les plus satisfaisants pour l’exercice de l’art. Il est donc certain que la manière aisée et quelque peu cavalière de Gros porta aussi atteinte aux doctrines sévères que David avait enseignées et que, après l’exil de son maître, et à la mort de Girodet (1824), lorsque la nouvelle école romantique avait déjà fait des progrès si rapides, Gros ne s’accusait peut-être pas sans raison d’avoir contribué à ébranler les principes de son maître....»
Regardez surtout ses œuvres; avec quelle évidence, tragique souvent, elles témoignent de cette lutte entre ses profonds instincts, les vraies aspirations de sa nature et l’idéal de convention qu’il a reçu d’autorité. La vie le reprend tant qu’elle peut: il assiste en Italie aux grandes batailles; il retrouve à Gênes Rubens, sa chère hérésie, son culte d’autant plus ardent qu’il doit être secret, et sa joie de peindre, ses dons de coloriste éclatent dans de simples petits portraits, comme cette tête de jeune garçon sur fond de ciel azuré, ou ce charmant portrait de jeune femme qui a toute la plénitude et la fraîcheur des plus jolis morceaux de l’école anglaise, avec des dessous plus solides, ou encore dans ce vigoureux portrait du comte Chaptal.... Mais, de plus en plus, il se surveillera, il se contiendra, il se matera jusqu’au tragique dénouement, au navrant suicide du 26 juin 1835....