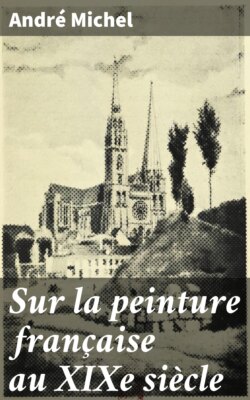Читать книгу Sur la peinture française au XIXe siècle - André Michel - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. — DAVID ET LE TABLEAU DU SACRE
ОглавлениеTable des matières
Quand David reçut la commande du tableau du Sacre, il en était à sa troisième conversion. Je n’entends pas seulement par là que, de bon royaliste, il s’était fait terroriste et régicide, et que, depuis 1798, il était fervent bonapartiste. C’est de ses conversions esthétiques que je veux parler.... Quand il était entré pour sa part de Créateur, comme on dit aujourd’hui, dans le monde de l’art, il avait trouvé la peinture française florissante, mais sous les «petits maîtres»; Boucher — Watteau étant mort trop tôt — en était encore le représentant le mieux achalandé ; mais déjà il avait rencontré, dans l’opinion des lettrés, des philosophes, un commencement de résistance et provoqué une sensible réaction.
Quand on regarde d’un peu près dans l’histoire des idées et de l’art au XVIIIe siècle, on est frappé de voir comment, au moment même où, avec la faveur de la Pompadour et de Marigny, Boucher semble le maître absolu des ateliers et de la mode, une tendance se marque de plus en plus, dans une partie de l’opinion, à remettre en honneur, ainsi que s’exprimaient les circulaires de Marigny lui-même avant celles de M. d’Angiviller, la «peinture d’histoire», et ce que Diderot appellera bientôt le grand art sévère et antique, qu’il opposera, avec une âpreté croissante, bientôt même avec des injures, à ce malheureux Boucher qui restait, lui, le défenseur ou le représentant de cet art «tout de grâce et de volupté » que la majorité du public aimait toujours et encourageait encore. Mais, tout de même, cet «air de négligence qui est une des plus agréables séductions de l’art», ce dessin, «du plus beau coulant dans ses carnations fraîches, touchées de grandes lumières», étaient de plus en plus critiqués, et surtout la tendance de la pédagogie, — depuis la création de l’École Royale des Élèves protégés, qui date, remarquez-le, de 1748, — affirmée dans les textes officiels; sinon encore dans les œuvres, la tendance de la pédagogie était de réformer cet art. Lectures quotidiennes de Tite-Live et des historiens et poètes propres à fournir de beaux sujets pour des tableaux d’histoire, exercices théoriques et pratiques, etc., etc. Que de Manlius Torquatus, Horaces, Stratonices, Andromaques et Brutus furent peints avant ceux de David! Ceux même qui défendaient, avec le plus de zèle, le pauvre Boucher et ses congénères, n’en parlaient plus qu’avec une certaine réserve. Écoutez, par exemple, Gresset:
Si dans cette illustre carrière
La peinture sur ses autels
De Rigaud et de Largillière
N’offre plus les traits immortels,
A juste titre elle a pu croire
Que c’était assez pour sa gloire,
Assez pour enseigner ses lois
D’offrir des Coypels, des De Troys,
Et de conduire sur ces traces
Van Loo, le fils de la gaîté,
Boucher, peintre des voluptés,
Et Nattier, l’élève des grâces.
C’est ce qu’on appelle plaider les circonstances atténuantes.
Quand Piron demande, pour son ami Boucher qui commence à vieillir, la faveur d’un logement au Louvre, voici comment il s’y prend:
Boucher ne tire de sa cervelle
Qu’objets fripons, jolis minois,
Qu’amour et tout ce qu’il inspire:
Une bergère qui se mire
Dans l’onde, un bouquet sur le sein,
De nymphes un folâtre essaim
Que, l’œil en feu, lorgne un satyre....
Je ne recherche, pour tout dire,
Qu’élégance, grâce, beauté,
En un mot que ce qui respire
Ou gentillesse, ou volupté.
Le tout, sans trop de liberté,
Drapé du voile que désire
La scrupuleuse honnêteté.
Voile mince, à la vérité,
Et qu’avec facilité
L’imagination déchire.
Tel est le genre accrédité
Où le goût régnant me condamne.
J’ai des enfants et des besoins
Et l’on court moins
A Michel-Ange qu’à l’Albane.
Et il ajoute que:
Sous l’antique toit de Louis.
si l’on accorde à son ami Boucher ce logement au Louvre, peut-être une manière «plus grande, plus mâle et plus fière» naîtra peu à peu sous ses pinceaux réformes.
Voici donc quel était, au moment des débuts de David, l’état de l’opinion et ce que l’on pourrait appeler le milieu moral.
Eh bien! David, quand il débute, est tout entier du côté de Boucher. Vous n’avez, pour vous en rendre compte, qu’à aller au Louvre et à l’École des Beaux-Arts voir les différents morceaux de concours qu’il peignit entre les années 1771 et 1774, alors qu’il était candidat au Grand Prix de Rome. En 1771, c’est le Combat de Minerve contre Mars. Il est au Louvre, près du tableau du Sacre; allez le voir et vous constaterez que cette Vénus, qui intervient, mollement couchée sur les nuages, dans le combat de Minerve contre Mars, cette Vénus aux molles nudités, avec ses touches de rose posées dans les plis de sa peau et sur les boutons de ses seins, que ce Mars, avec les verts céladon de son costume et ses roses tendres d’opéra, sont tout à fait dans la manière et dans le goût de Boucher.
En 1772, quand il peint Apollon et Diane perçant de leurs flèches les enfants de Niobé ; en 1773, quand il peint La mort de Sénèque dans une claire et soyeuse harmonie où sont prodiguées les notes les plus gaies et les plus chatoyantes de la palette de Boucher, David est bien loin de penser à réformer quoi que ce soit dans l’art et la mode de son temps. Et c’est la même année que, — Fragonard ayant laissé inachevée la décoration de l’hôtel de la Guimard, — David est choisi pour continuer le travail interrompu, — et, bien entendu, dans le goût de son prédécesseur.
C’est en 1774 qu’il obtint le prix avec le tableau d’Antiochus, fils de Séleucus, malade de l’amour qu’il avait conçu pour Stratonice, sa belle-mère. Ce sujet de la Stratonice était inscrit depuis des années dans le programme courant de la peinture d’histoire, — et bien avant, comme vous voyez, qu’Ingres pensât à s’en inspirer.
Dans ce tableau, pour la première fois, on peut commencer de constater un revirement, ou plutôt une atténuation dans la manière de David. Les influences de Boucher sont remplacées par les influences très reconnaissables de Greuze et, dans certaines figures, même, la préoccupation de Poussin, que Diderot, depuis des années, ne se lassait pas de rappeler aux peintres «dégénérés» de l’École Française.
Et voilà David prix de Rome.
Son succès coïncida avec la nomination d’un nouveau directeur. Ce nouveau directeur, c’est son maître Joseph-Marie Vien, venu de sa ville natale, Montpellier, à Paris, qui, sur ses vieux jours, aimait à s’appeler, non sans quelque complaisance, le «régénérateur de l’École et le sectateur des Grecs».
Vien emmène David avec lui. Avant de partir, celui-ci est allé prendre congé de Boucher et de Cochin, qui l’avaient paternellement engagé à ne pas laisser se «refroidir» à Rome la palette dont il avait peint son joli tableau de Sénèque! Et David protestait: «L’Antique ne me touche pas, l’Antique ne me remue pas.»
On s’arrête à Parme et on voit Corrège. Corrège l’enthousiasme et le sage Vien lui dit: «Attendez, mon ami, attendez que nous soyons à Rome! C’est là que vous verrez la véritable Italie, le grand art italien.»
On arrive à Rome au moment où il n’est question que de Pompéï, d’Herculanum, des fouilles qui sont en train de remettre à jour cette Antiquité que de génération en génération on croit découvrir et que l’on ne connaissait en réalité encore qu’assez mal. C’était surtout le moment où, depuis sept ou huit ans, s’était institué au Vatican même, sous les auspices du pape Benoît XIV, un enseignement de l’histoire de l’art et de l’esthétique, confié d’abord à un peintre allemand, théoricien implacable, Raphaël Mengs, qui avait inauguré un cours: «Contre le goût français.»
A mesure que j’étudie de plus près cette intervention, à cette heure, dans la pédagogie de l’esthétique néo-classique allemande, je me convaincs davantage qu’il y eut là, dans cette capitale du monde civilisé, un centre, un foyer d’influences désastreuses. Tout ce qui s’est glissé, tout ce qui s’est enfoncé dans les cervelles de métaphysique absconse, tout le «bourrage de crânes» qui a affolé toute une génération d’esthéticiens et de docteurs de l’idéal, tout ce que la chimera bombynans in vacuo, comme disait Rabelais, a pu susciter de définitions, de formules vides et d’autant plus tyranniques..., c’est à l’enseignement des esthéticiens de Rome qu’il faut en faire remonter la cause première et la responsabilité. C’est Raphaël Mengs, c’est Winckelmann, — qui le «renforça» et le compléta, — qui furent les auteurs responsables du pseudo-classicisme de la Révolution et du Premier Empire, qui imposèrent à l’imagination de nos artistes français ce manteau lourd et glacé, que le romantisme allait quelques années plus tard secouer frénétiquement. «Qui nous délivrera des Grecs et des Romains?» C’est contre les Grecs et les Romains, drapés selon les théories de Winckelmann, que protesta bientôt toute la jeunesse.
C’est au cours d’un voyage avec Quatremère de Quincy à Pompéï, que David commença de prêter l’oreille aux discours des théoriciens, et c’est au retour de ce voyage qu’il déclara: «Je viens d’être opéré de la cataracte, j’ai compris l’Antiquité !»
11 a vu l’Antiquité et il se met à l’œuvre.... D’abord son Andromaque, pleine encore d’influences de Greuze, son Bétisaire, plus «poussinesque», marquent les étapes de la conversion qui le conduira bientôt au Serment des Horaces.
Il y aurait beaucoup à dire sur l’exécution, la conception, le succès — en un mot l’histoire — de ce tableau. Ce n’est pas aujourd’hui mon sujet, mais il me semble que je devais vous rappeler ces «antécédents» pour vous faire mieux comprendre où en était David quand il se trouva devant l’immense toile, encore blanche, où il devra représenter le Sacre de Napoléon.
Les Horaces avaient produit à Rome un effet qui peut nous étonner aujourd’hui; mais les témoignages sont unanimes. Ce fut comme l’accomplissement, la révélation de ce qu’attendait toute une génération! Et quand, de Rome, les Horaces, arrivent à Paris et sont exposés au Salon de 1785, depuis le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette jusqu’au dernier critique du Mercure de France, du Journal de Paris, ou du Pausanias français, c’est une acclamation unanime: «Un grand peintre nous est né !» Les commentaires jaillissent de tous côtés. Les uns admirent surtout le vieil Horace tenant de la main gauche les trois glaives qu’il va distribuer à ses fils, qu’il bénit de la main droite; les autres s’extasient sur ce groupe des trois frères, aux jambes robustes et bien musclées, — contrastant avec les vieilles jambes fléchissantes et tremblantes du vieillard, — sur le geste de leurs bras tendus, alignés comme à la parade, pour un serment solennel...: c’est Rome, c’est l’héroïsme pathétique et sentimental conforme au goût du temps.... Mais bientôt David sent s’éveiller en lui des scrupules et un autre idéal.... Il a voulu retourner à Rome pour finir les Horaces. Mais il ne suffira plus d’être «Romain» : il faut être «Grec». Pâris et Hélène, qu’il peint en 1788 pour le comte d’Artois, est un premier essai, un premier effort dans cette voie nouvelle, qui doit le conduire, — mais après et à travers quelles tourmentes! — aux Sabines, qui ne seront achevées qu’en 1799.
Au cours de ces dix années, 1789-1799, vous savez ce qui se passe: la Révolution, le délire jacobin, David pris, roulé par les événements, entraîné dans le Robespierrisme le plus fanatique, après avoir été proclamé, dès 1791, le «peintre de la Révolution»....
Le premier tableau, qu’il ne devait jamais finir, dans lequel il se révèle sous cet aspect nouveau, c’est le Serment du Jeu de Paume.
Dubois-Crancé était monté, le 20 octobre 1790, à la Tribune de la Société des Jacobins et y avait déclaré qu’il était temps d’effacer de notre chronologie tant de siècles d’erreur, d’oublier les tyrans et de déclarer que la France régénérée «datait du 20 juin 1789», jour du Serment du Jeu de Paume. André Chénier, qui donnait de tout son cœur et de toute sa foi dans les idées nouvelles, publiait son ode sur le Serment du Jeu de Paume, dédiée à son ami Louis David...:
Reprends ta robe d’or, ceins ton riche bandeau,
Jeune et divine poésie,
Quoique ces temps d’orage éclipsent ton flambeau...,
Aux lèvres de David, roi du savant pinceau,
Porte la coupe d’ambroisie...
Il rappelait les œuvres du peintre depuis le
Mâle serment des trois Frères sauveurs de Rome
et l’invitait à peindre
Un plus noble serment digne de son pinceau.
Les choses, vous le savez, allèrent plus vite que les prévisions humaines. La plupart des héros du Jeu de Paume furent bientôt des proscrits, et même Chénier, qui avait dédié à David l’ode du Serment, en venait moins de deux ans après à flétrir:
Le stupide David qu autrefois j’ai chanté.
David, emporté par la terrible logique des «journées» révolutionnaires, était devenu pour son malheur un pauvre homme politique. Il n’avait peint qu’à la sollicitation des événements. Et ce fut l’apothéose de Le Pelletier de Saint-Fargeau; ce fut Maral dans sa baignoire, ce fut le petit Bara, l’organisation des grandes fêtes, des «pompes», des cortèges solennels, jusqu’à celui de l’Être Suprême.
Mais, pendant ce temps, les dogmes artistiques se formulaient en aphorismes de plus en plus impérieux, où le jacobinisme intellectuel se confond avec les élucubrations d’une «idéologie» exaspérée. «L’accident ne doit jamais altérer l’unité du caractère, de la forme. Le type du beau n’existe que dans la nature collective et, pour le retrouver, on n’a d’autre ressource que les écrits des anciens... Toute figure qui ne serait pas étudiée et méditée dans un esprit philosophique serait un ouvrage indigne de la haute science de l’art... Les traits d’un beau visage sont simples, aussi peu multipliés que possible. Une figure, où le trait qui descend du front à l’extrémité du nez, l’arc du sourcil et ceux décrits par les paupières sont rompus, a moins de beauté que la figure dans laquelle chacune de ces parties est formée d’une seule ligne. La «difformité » augmentera à mesure que les lignes se multiplieront par la cavité des yeux, le renflement des narines, l’exubérance des lèvres et la saillie des os.»
Et vous voyez, à mesure que je vous lis ces textes, se dessiner devant vos yeux, se dresser devant vous, rigides, immobiles, glacées, toutes ces figures «idéales», que la peinture et la sculpture du temps, en Allemagne comme en France, multiplièrent sur tous les chevalets et sur toutes les selles dans presque tous les ateliers.
Quand il dut renoncer à la politique, quand, au lendemain de la chute de Robespierre, son grand ami, il se vit accuser à son tour, traduit devant la Convention, poussé à la tribune, balbutiant, lamentable, pâle, la sueur dégouttant de son front, décrété d’accusation, incarcéré, David passe successivement cinq mois, puis trois mois, en prison, et c’est dans sa cellule du Luxembourg que, reprenant une pensée déjà caressée, il revient au projet des Sabines. Ses élèves, ses amis, obtiennent sa liberté provisoire; on l’autorise à rentrer chez lui, sous la surveillance d’un garde, et c’est seulement à l’amnistie du 4 Brumaire, qu’il se sent définitivement libéré.
Le temps me manque pour vous conduire au Louvre, dans cet atelier des Sabines où il mit en train ce tableau, qui devait être comme le manifeste-de son idéal «épuré ». Il y travaillait avec un enthousiasme croissant, enlevant l’une après l’autre les draperies qu’il avait d’abord laissées sur le corps de Tatius et de Romulus, faisant flotter celles d’Hersilie, de façon à mettre en évidence la nudité, la beauté de son corps et à se rapprocher ainsi du pur idéal grec, car, d’après la formule désormais triomphante: græcum est nibil velare....
Mais le tableau ne devait être fini qu’en 1799, et, entre temps, des événements imprévus, foudroyants, allaient une fois de plus saisir, entraîner le Jacobin converti.
Le général Bonaparte était arrivé à Paris le 17 octobre 1797, apportant le traité de Campo Formio dont il venait demander la ratification. Il avait déjà remarqué ce David, que, peut-être, dans ses rêves d’avenir, il avait associé à son destin. Pendant la réaction fructidorienne, qui avait inquiété les anciens régicides, il lui avait fait offrir un asile dans son camp, lui garantissant, au milieu de son armée, une protection qui le mettrait à l’abri de toutes les menaces, et David ne l’avait pas oublié. Aussi, comme la France tout entière, attendait-il avec une impatience et une curiosité frémissante, le héros qu’il ne connaissait pas encore. Le désir de le peindre le hante désormais. Bonaparte accepte, mais oublie successivement plusieurs rendez-vous qu’il avait accordés. Enfin, il finit par arriver à l’atelier du Louvre.
Il faut lire dans Delécluze, l’élève, le confident, l’ami de David, le récit de cette visite. Le petit escalier malodorant qui conduisait à «l’atelier des Horaces», dans les combles du palais, du côté de ce qui sera un peu plus tard la rue de Rivoli, l’attente enfiévrée des élèves, la rumeur des voix, l’ardeur allumée des regards....
David avait fait préparer une estrade et une toile sur laquelle il avait sommairement esquissé une grande composition qui représentait un épisode des campagnes d’Italie; il y avait ménagé une place pour Bonaparte qu’il voulait représenter descendant de cheval. Le général était arrivé vêtu d’une redingote bleu foncé, le cou enveloppé d’une large cravate noire d’où son maigre visage, sa pâleur ambrée et ses yeux, pareils à de noirs diamants, émergeaient et semblaient fulgurer....
Il y eut un tête-à-tête de trois heures entre le peintre et son modèle, et c’est dans cette unique séance que fut ébauché l’admirable, l’incomparable portrait dont la tête seule est peinte, avec le col bleu de l’habit et la haute cravate noire, le reste étant simplement crayonné, indiqué de quelques traits sommaires. Jamais portrait plus évocateur, plus décisif du héros ne fut peint.
Bonaparte à peine parti, les élèves se précipitent: «Vous l’avez vu? Qu’a-t-il dit? — Vous êtes impatients de savoir ce qui s’est passé ? Eh bien! mes amis, je crois vraiment que ce que je viens de faire n’est pas indigne de mon modèle. Il est beau comme l’antique! L’antique lui eût élevé des autels.» Et, prenant un crayon de la main d’un de ses élèves, David dessine sur le mur un profil de Bonaparte, devant lequel tout «l’atelier», bouche béante, reste muet d’admiration.
Pendant la «pose», Bonaparte, impatient, avait regardé l’atelier, il avait vu Brutus, il avait vu les Horaces, mais il n’avait rien manifesté qu’une grande hâte d’en finir. Dès lors, la connaissance était faite; Bonaparte avait même proposé à son peintre, si, par hasard, une promenade en Égypte l’intéressait, de le prendre avec lui. David avait hésité. Il pensait encore aux Sabines. Il voulait les finir. Il s’était enfoncé dans des lectures savantes; il piochait Pausanias, pour essayer de reconstituer les tableaux de Polygnote et de se faire de plus en plus «grec»! Il copiait les dessins des vases «étrusques», de toute sa volonté il s’efforçait «d’épurer» son dessin.... Mais les événements allaient encore le prendre et lui imposer des œuvres imprévues.
D’abord, le 18 Brumaire. Un de ses élèves vient annoncer à David le coup d’état. David est en train de fumer sa pipe. «Victrix causa...» dit-il..., et il lâche une bouffée en demandant: «Quelle est donc la fin? — Sed victa Caloni, souffle son élève. — Oui, oui, sed victa Caloni!....» Il lâche une dernière bouffée. Ce fut toute l’oraison funèbre que l’ancien révolutionnaire accorda à la défunte liberté.
Bonaparte, premier consul, demanda à David un autre portrait. Il lui avait dit: «Je voudrais être représenté calme sur un cheval fougueux.» Et ce fut l’origine du tableau que l’on peut voir à Versailles, du Bonaparte franchissant le Saint-Bernard, qui n’est certes pas du meilleur David! Il fut fait à peu près «de chic», hors de la présence réelle du modèle, le fils du peintre tenant «la pose», un mannequin portant l’habit, le chapeau et les bottes que Bonaparte avait à Marengo. Comme David avait les mains fines et les pieds particulièrement petits et élégants, ses élèves ne manquèrent pas de remarquer que les bottes de Bonaparte le chausseraient très bien, et quelqu’un ajouta: «Les grands hommes ont toujours eu le pied petit et la tête forte.» Là-dessus David prend le chapeau de Marengo, le met sur sa tête... et le chapeau descend jusqu’au cou.
18 Brumaire! L’Empire, le Sacre n’étaient pas loin. La question n’était plus que de savoir si Bonaparte serait roi ou empereur. Il décida d’être empereur. En même temps que Napoléon commandait à David le tableau du sacre, le Corps législatif avait commandé à Canova une statue du héros «pour consacrer les bienfaits que la nation venait de recevoir de lui par l’organisation du nouveau Code». Ce fut alors, dans le public et l’opinion (les journaux du temps en sont pleins, et la collection du Journal des Débats en particulier), de longues et vives discussions sur le costume qu’il convenait d’adopter pour les effigies triomphales du Maître.
Parmi beaucoup d’autres lettres ou articles publiés à ce propos, voici une lettre de Vivant-Denon: «A cette époque où les destinées de la France se présentent sous un aspect si grand, pourquoi ne redonnerait-on pas aux arts toute cette grandiosité (sic) qui les rendait si recommandables dans les beaux siècles de la Grèce et de Rome? Pourquoi ne les débarrasserait-on pas de ces entraves du costume qui arrêtèrent leurs progrès sous le règne de Louis XIV... et pensèrent les anéantir sous ceux de Louis XV et de Louis XVI?»
C’est le moment où les théoriciens de l’Institut impérial, après ceux de la Convention, instituaient le procès de l’art du XVIIIe siècle, déclaraient que Pigalle et Lemoyne avaient complètement «perdu l’art», que, depuis Watteau jusqu’à Van Loo, il n’y avait eu que des «corrupteurs» du goût public. Houdon lui-même (Houdon qui, heureusement pour lui, était encore vivant et qui, jusqu’en 1828, ne manqua jamais une séance à l’Institut) était compromis dans ce procès. Si on ne le condamnait pas tout à fait, c’est qu’il était présent à son banc. On lui reprochait tout de même, discrètement, d’avoir, quand il sculptait Mirabeau ou Glück, trop accordé à la simple vérité et à la nature, jusqu’au point de marquer dans le marbre les cicatrices de la petite vérole, que Glück et Mirabeau avaient gardées sur leur visage. Il y a là-dessus des textes qui sont bien significatifs de l’état des esprits.
Canova donc persuada à Napoléon, non sans quelques résistances de la part de celui-ci, qu’un «seul costume était digne de lui, de sa gloire et de l’art: c’était la nudité héroïque et mythologique». Vous savez que le résultat fut la statue qui est dans la cour du Musée Brera à Milan, et ce que vaut cette statue inspirée de l’Apollon du Belvédère que les rapins appelleront bientôt «un navet ratissé ».
De la même esthétique naquirent les lamentables théories de héros nus qui, de Londres à Rome, se morfondent encore sur leurs socles. Et c’est ainsi que les dames anglaises (les dames anglaises!), après Waterloo, ayant ouvert une souscription pour élever une statue au vainqueur de Napoléon, à Wellington, commandèrent la statue qui est aujourd’hui à Hyde-Park, aussi nue qu’un héros «mythologique et héroïque» peut se permettre de l’être....
Quand David se trouva devant la commande du Sacre, on a dit et on répète partout qu’il l’accueillit avec joie. Cela n’est pas exact. Il y a des témoignages formels, venant, en particulier, de celui que nos lointains prédécesseurs des Débats appelaient l’oncle Boutard, qui montrent que David éprouva un moment de trouble et d’hésitation. Certes, on ne repousse pas de telles commandes, et, pour le premier peintre de Sa Majesté l’Empereur, il n’en fut pas question. Mais elle l’intimidait, elle le troublait. Elle le ramenait, dans sa recherche du «Beau absolu» et de l’idéal grec, à des problèmes plus réalistes.
Comment s’y prendrait-il?... Après des délibérations assez longues, il décida avec une sorte de brusquerie: «Ce sera de la peinture portrait.»
C’était certes le bon parti! Il se fût perdu, refroidi, certainement gâté en des allégories plus ou moins mythologiques. Mais des portraits, une réunion de portraits, c’était son affaire!
Quand je vous ai parlé de l’évolution de ses idées, de ses goûts et de ses doctrines, c’est à dessein que je n’ai rien dit de ses admirables portraits. Depuis 1766, depuis les portraits de ces vieux parents si bienfaisants pour lui, qui s’appelaient les Buron, ceux de Demaison, du comte Potocky, du médecin Leroy, des Pécout (allez voir au Louvre ces portraits des Pécout!), il s’était révélé, sans s’en douter certes, le vrai David, le grand peintre qui apportait à l’école française le renfort d’un génie réaliste de premier plan. Il avait, dans le bienfait de la présence réelle de la nature, trouvé toutes ses forces, et, avec une verve, une abondance dignes des grands ancêtres du XVIIe et du XVIIIe siècles, confirmé, renouvelé, élargi encore la tradition qui fut, à travers les âges et les révolutions du goût, le terrain solide où notre école retrouva toujours toutes ses forces et alimenta son génie. Aussi fut-il bien inspiré quand il décida de faire du Sacre une peinture portrait.
On avait chargé Percier d’aménager Notre-Dame pour le jour de la cérémonie. L’architecte avait conduit David dans le chœur de la cathédrale et avait choisi, d’accord avec lui, la place d’où il pourrait le plus commodément embrasser l’ensemble du spectacle.... C’était du côté de l’Évangile et dominant l’autel, une tribune qui devait lui être réservée. Tout le détail de la cérémonie avait été réglé par M. de Ségur avec la minutie la plus protocolaire, mais au prix de quelles peines! Il s’agissait de ménager tant d’amours-propres exigeants! On avait remis à David un plan indiquant la place et le nom de tous les personnages officiels.... Le jour venu, il s’était installé avec sa famille et quelques amis dans sa tribune qu’il avait fallu, au dernier moment, défendre contre les prétentions de quelques courtisans! Et ce jour-là, il arrêta définitivement dans son esprit le futur tableau du Sacre.
Comme pour l’encourager à entreprendre ce prodigieux travail, qui allait encore l’écarter de la peinture d’histoire et de ce Léonidas où il rêvait de s’élever plus haut encore vers l’Idéal que dans les Sabines, Vivant - Denon lui écrivait: «De semblables spectacles sont dignes d’inspirer, par leur splendeur et leur rareté, le pinceau d’un artiste.»
Il se mit au travail le 21 décembre 1806 seulement, quand sa toile fut prête.
Une lettre du 19 juillet 1806 (le tableau ne fut fini qu’à la fin de 1807) nous renseigne sur ce qu’il voulait encore faire à cette date:
«Après la bénédiction des ornements de l’Empereur
«par le Pape, Sa Majesté, montée à l’autel, prend la
«couronne, la place de sa main Droite sur sa tête, puis,
«de la gauche, il serre étroitement son épée sur son cœur.
«Ce grand mouvement rappellera au spectateur
«étonné cette vérité que celui «qui a su la conquérir
«saura bien la défendre». L’attitude, les gestes, les
«regards de la foule attendrie, tout indiquera le senti-
«ment dont chacun est pénétré.
«L’impératrice, à gauche, au pied de l’autel, les
«mains jointes, attend la couronne que son auguste
«époux va lui placer sur la tête. Son Altesse Impériale,
«Madame (Madame Mère), dans une tribune à part,
«avec le cortège qui lui convient, est présente à un
«événement aussi glorieux qu’attendrissant pour son
«cœur de mère.
«Les princes ses frères, les grands dignitaires, les
«maréchaux de l’Empire occupent les places qui leur
«sont désignées, remplissent les fonctions qui leur sont
«attribuées.
«Ce tableau est plus qu’à moitié fait, continue-t-il,
«et sera terminé en six mois....»
Nous sommes au mois de juillet 1806. Ce n’est qu’un an et demi après qu’il le termina, «ne l’ayant commencé que le 21 décembre 1805, parce qu’il fallut aménager mon atelier, faire les machines propres à ce genre d’ouvrage, mise au carreau, etc.».
L’atelier! Il avait été très diffficile de le trouver. Il fallait un atelier de dimensions tout à fait exceptionnelles, et ils étaient rares à Paris. Il y en avait de très bons dans cet ancien couvent désaffecté des Capucines, qui était devenu une colonie de peintres.... Et, pour le dire en passant, l’histoire de ce couvent des Capucines, pendant les années de la fin de la Révolution et les premières années du XIXe siècle, serait bien amusante à écrire. C’est là que Girodet, que Prud’hon, que Gros, Ingres, tous les peintres dont le nom montait ou allait grandir, travaillèrent. C’est là que se livrèrent des combats d’ambition et des combats de doctrine qui mirent toutes les imaginations et tous les esprits en branle. C’est là que le Déluge de Girodet, c’est là que son Alala furent peints; c’est là qu’arrivait l’écho de toutes les discussions qui, de plus en plus ardentes, remplissaient les ateliers, et que retentissaient déjà contre David des critiques et des récriminations de plus en plus hardies.
C’est dans l’église désaffectée de Cluny, aujourd’hui démolie, place de la Sorbonne, qu’on finit par trouver l’atelier du Sacre.
«On m’a prévenu, écrit le Ministre de l’Instruction publique à David, premier peintre de Sa Majesté, le 17 Pluviôse an XIII, on m’a prévenu que, après bien des recherches, on avait découvert un emplacement qui, au moyen de quelques réparations et de constructions nouvelles, pourrait vous servir d’atelier pour l’exécution du tableau du Couronnement, que cet emplacement était l’ancienne église de Cluny, place de la Sorbonne, qu’il faudrait la louer 500 francs par an et, de plus, donner au locataire actuel 1200 francs d’indemnité pour qu’il renonce à son bail. J’accède, Monsieur, aux conditions imposées par le locataire.»
Le gouvernement impérial payait le loyer et les indemnités.
«M. de Gisors, architecte, est chargé des travaux. Je ne puis que vous inviter à travailler avec le plus grand zèle à un ouvrage qui, je n’en doute pas, deviendra, tant par le sujet que par l’exécution, le plus durable monument de la gloire que vous vous êtes acquise dans votre art.»
Signé : CHAMPAGNY.»
En attendant de se mettre à son tableau, David commence un portrait de Pie VII.
L’histoire de ce portrait de Pie VII vaudrait d’être contée. Le Pape Pie VII, par sa bonté, par sa dignité, par sa tristesse, toucha infiniment David. Il s’était attaché avec une véritable affection et un grand respect à cette figure. Il disait: «Mon Pape!» comme il avait dit: «Mon Bonaparte!» «Mon Empereur!». Et, en attendant le chef-d’œuvre des chefs-d’œuvre, qui est le portrait du Pape dans le tableau du Sacre, il avait fait deux portraits du pontife: l’un avec le cardinal Caprara, debout à ses côtés; l’autre, qui est au Louvre. Et ce sont certes d’admirables choses.
Il se mit donc au travail, assisté d’un élève qui s’appelait Rouget. C’est ce Rouget qui avait fait la mise au carreau c’est lui qui l’aida pour l’exécution du tableau et en peignit même ou, du moins, en «prépara » d’importantes parties, presque tout le côté gauche. Ce n’est certes pas Rouget qui l’a peint complètement, mais c’est lui qui l’a «mis en place». David, assis dans un fauteuil, le regardait faire: «Bien! bien! ça va! Maintenant arrête-toi!» Et il se levait pour aller poser lui même les touches décisives. A mesure qu’il avance dans ce travail, à mesure que les témoins et acteurs de la solennité dont il va dresser le procès-verbal épique défilent devant lui, il s’étonne lui-même, — c’est Boutard qui nous le dit pour l’avoir entendu dire à David — de l’intérêt croissant qu’il prend à cette peinture.
Le peintre en lui s’excite, s’exalte. Il n’est pas un des ornements dont on a porté le modèle dans son atelier, depuis le manteau impérial jusqu’au costume du dernier des clercs et des officiers, qui ne soient pour lui une occasion de «peindre» avec allégresse et enthousiasme. C’est une poussée de joie créatrice!
Regardez le tableau. Au centre, dans un grand plan de lumière, l’Empereur; derrière lui, le Pape, le cardinal Caprara, le cardinal Brachi, neveu du Pape, un évêque grec. David avait d’abord représenté le Pape mitré, puis il enleva la mitre pour maintenir la figure dégagée dans toute son austère beauté. Quant à la tiare, il la plaça, presque cachée, sur un coin de l’autel.
Devant l’Empereur que, d’abord, il avait peint — conformément au dessin que nous avons au Louvre et conformément au programme qu’il avait lui-même rédigé dans la lettre que j’ai citée, — en train d’élever lui-même la couronne au-dessus de sa tête, il eut, après l’avoir complètement achevé, un doute. D’abord, ce geste le gênait; il était mal venu et ne lui plaisait pas. Il fit venir un homme en qui il avait grande confiance, malgré de nombreux démêlés et déjà bien des rivalités suscitées entre eux, Gérard.
«Oui, il faut chercher autre chose.» Et c’est Gérard qui aurait suggéré, avec l’approbation de l’Empereur, bien entendu, le geste de Napoléon élevant des deux mains la couronne au-dessus de la tête de Joséphine agenouillée devant lui. David fit racler au couteau, par Rouget, toute la figure déjà entièrement peinte, et la remplaça lui-même par la figure que l’on voit aujourd’hui.
Joséphine est agenouillée; derrière elle, sa dame d’honneur et sa dame d’atours, Mme la comtesse de la Rochefoucauld et Mme de Lafayette. Derrière celles-ci, plus au fond, le cardinal du Belloy, archevêque de Paris, avec son grand vicaire, et, se déroulant de la droite à la gauche, Berthier, Murat, Serrurier, Moncey, Bessière et M. de Ségur, grand-maître des cérémonies.
Au premier plan à droite, devant l’autel, Lebrun, archi-trésorier, avec le long bâton de commandement à la main. Et ce bâton, qu’il tient de sa main gantée de noir, a dû bien gêner David, mais il voulait peindre les choses comme elles s’étaient passées. Cette main de Lebrun avec l’insigne protocolaire qu’elle porte malencontreusement coupe, tout juste devant le Pape et l’Empereur, le tableau, et n’est d’ailleurs pas dans une perspective tout à fait exacte.
A côté de Lebrun, Cambacérès avec la main de justice, puis Berthier, et enfin, debout, souriant d’un inexprimable sourire d’ironie et de scepticisme, Talleyrand, qui avait vu tant de choses et devait en voir tant d’autres encore, Talleyrand dans son manteau de velours rouge, admirable portrait, le plus beau qui soit de lui s’il n’y avait pas celui de Prud’hon. Puis, autour de l’autel, Eugène de Beauharnais, Caulaincourt, le cardinal Fesch, oncle de l’Empereur, dont il faut regarder le profil et tout ce que David y a mis!
Dans la tribune, son Altesse Impériale Mme Mère, entre Mme de Fontanes et la Maréchale Soult, ses dames d’honneur et d’atours. Derrière, M. de Cossé-Brissac, son grand chambellan; le maréchal de Beaumont, son grand écuyer. Et, dans la tribune au-dessus, réservée à David, au premier rang Grétry, le poète Lebrun, Vien, son maître, introduit là par reconnaissance...: «Tiens! le bon M. Vien!» dit Napoléon en le reconnaissant. Et David de répondre: «Oui, Sire, c’est un hommage que j’ai voulu rendre à mon maître!...» Mme David et ses filles, et ses chers amis Nougès.... Tout au fond enfin, debout et regardant, un peu penché, David lui-même qui ne perdit rien de la cérémonie, par son génie à jamais vivante dans la mémoire des hommes.
A l’extrême droite, la tribune diplomatique: l’amiral Ravignan, ambassadeur d’Espagne, l’ambassadeur d’Autriche, l’ambassadeur d’Italie et même celui de la Porte qui assista à la cérémonie et qui, pour obtenir l’autorisation de se laisser peindre, dut en référer au Grand Sultan. Pour finir, M. Armstrong, ambassadeur des États- Unis.
Sur la gauche du tableau, le général Junot sert de transition, comme de trait d’union, entre le cardinal du Belloy et la reine de Naples, femme de Joseph; à côté, la reine Hortense qui tient par la main et surveille un petit garçon vêtu de velours rouge, qui n’est autre que le petit prince Louis. Il viendra lui aussi, un jour, à la même place, se faire couronner. Puis les trois sœurs de l’Empereur, la princesse de Piombino, la princesse Borghèse et la grande duchesse de Berg; ses frères, Louis, roi de Hollande, Joseph roi de Naples; puis les maréchaux Lefèvre, Kellerman et Duroc.
C’est la scène telle qu’elle s’est passée, telle que David l’a vue. Il n’y a rien ajouté que l’évidence de son génie.
Jamais certes le grand portraitiste ne trouva d’occasion plus magnifique, — mais dans quelles conditions écrasantes par l’amoncellement des figures dans cet immense cadre! Il disciplina tout, ordonna tout, mit et maintint tout en place. La façon dont chaque tête s’enlève, se détache et s’harmonise dans l’ensemble, vivante, expressive, individuelle, gardant sa valeur et son importance dans ce déploiement de velours, de soies, de dorures, d’uniformes, de chasubles, de mitres et de panaches! Il fallait une volonté égale à la puissance du talent pour ne pas faiblir un moment d’un bout à l’autre. Et si quelques morceaux ne sont pas dignes du chef-d’œuvre central, c’est que David passa la main à Rouget. Mais qui peignit jamais figures plus évocatrices que celle du Pape résigné, bénissant comme passivement de sa main à peine soulevée? David l’avait d’abord représenté les deux mains à plat sur les genoux. Il corrigea et reprit le morceau: «Napoléon ne l’a pas fait venir de si loin pour ne rien faire!» — Et la large tête, puissante, pensive, du cardinal Caprara! Il n’est pas jusqu’au tapis jeté sur les marches de l’autel, — tapis non cloué et qu’on enlèvera et roulera après la cérémonie (comparez-le à celui que Rubens peignit ou fit peindre pour le sacre de Marie de Médicis à Saint-Denis), — qui ne soit un «morceau» étonnant.
DAVID: LE SACRE DE NAPOLÉON 1er.
(Musée du Louvre)
PL. J.
Peinture française au XIXe siècle.
Quand, après Austerlitz, après Eylau, à la fin de 1807, Napoléon revint à Paris, il s’informa du tableau du Sacre, depuis si longtemps commencé, et déclara qu’il voulait le voir.
Ce fut une journée mouvementée, qui mit tout Paris «en l’air». Au son des trompettes, un cortège magnifique partit des Tuileries et s’achemina vers la place de la Sorbonne. Pendant trois quarts l’heure, raconte Delécluze, témoin de la scène, l’Empereur, sans prononcer un mot, la tête couverte, la main passée dans le pan de son habit, ou derrière le dos, se promena silencieusement, de long en large, devant la toile. Chacun regardait, attendait anxieux le verdict du Maître. On n’avait pas manqué déjà de critiquer ou de discuter plus d’un détail. Il y avait d’abord ceux qui n’étaient pas contents de leur place, ceux qui approuvaient ou n’approuvaient pas le «parti» général; ceux qui, dans la jeune école, tenaient déjà pour une autre «peinture».... Lui, s’arrêtant enfin devant le peintre, porta la main à son chapeau et dit: «David, je vous salue!» A partir de ce moment-là, le Sacre fut sacré chef-d’œuvre.
Et pourtant! la tyrannie des idées régnantes était telle, la conception de la «peinture d’histoire» et la «doctrine» était si impérieuses que, lorsque, en 1810, s’ouvrit l’exposition des fameux concours pour «les prix décennaux» institués par Napoléon, comme des revues solennelles de l’état des lettres, sciences, arts et industries de son Empire, le Sacre de David ne put être considéré comme «un tableau d’histoire» puisqu’il n’y avait pas de nudités! Il fallut créer une section spéciale, celle des tableaux représentant des faits honorables pour le caractère national pour pouvoir attribuer à l’auteur une première médaille.
Et même dans la classe des «tableaux d’histoire», ce ne furent pas les Sabines qui obtinrent la récompense suprême: le premier prix fut donné au Déluge de Girodet, élève et déjà rival de David, Girodet qui avait fait un Ossian, acclamé par la jeunesse, une Alala inspirée de M. Chateaubriand et qui, dans son néo-classicisme figé, portait déjà comme un vague pressentiment du prochain romantisme.... Le groupe des «primitifs », auquel Ingres fut affilié, avait déjà déclaré le Maître trop «Pompadour!» encore, comme M. de Voltaire, et rococo! Quant à prétendre être grec, comment l’eût-il osé ?...
1810 marqua en même temps l’apothéose et le déclin de l’école Davidienne, qui voyait déjà monter de tous côtés, autour d’elle, les premiers bruissements avant-coureurs des «révolutions» prochaines. Géricault, Gros lui-même les annonçaient. Douze ans après, Delacroix entrait en scène! Mais ceci n’est plus mon sujet. Le Sacre, — à présent qu’est tombé le vain bruit des disputes, — reste pour la postérité le vrai, le grand, l’inattaquable chef-d’œuvre de David.
En vain dans son exil de Bruxelles, quand la Restauration eut chassé de France l’ancien ami de Robespierre et le régicide, en vain le peintre des Sabines et du Léonidas s’efforce-t-il de reprendre, — par quelques tableaux mythologiques où se marquent de plus en plus les défaillances de sa main vieillie, — le «sceptre du grand art»; en vain gourmande-t-il son élève Gros: «Que faites-vous, mon bon Gros, reprenez votre Plutarque! »... c’est encore dans ses derniers portraits (voyez Les Trois Dames du Louvre) que se réveillera la flamme de son génie.