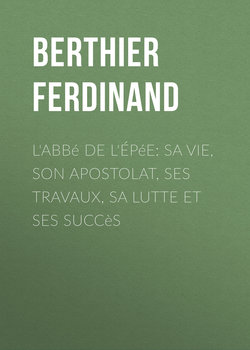Читать книгу L'Abbé de l'Épée: sa vie, son apostolat, ses travaux, sa lutte et ses succès - Berthier Ferdinand - Страница 12
XI
ОглавлениеVertus et bienfaits de l'abbé de l'Épée. – Sa soutane usée. – Presque octogénaire, il se prive de feu pour ses enfants, durant un hiver rigoureux. – Projet d'un tableau de l'abbé de l'Épée par le sourd-muet Léopold Loustau. – Il refuse un évêché en France et une abbaye en Allemagne. – Belles réponses à Joseph II et à Catherine de Russie. – Paroles mémorables. – Il ne demande qu'à instruire des sourds-muets pauvres et à apprendre pour eux les langues de tous les pays. – Son désintéressement, ses sacrifices. – Louis XVI redoute d'abord son jansénisme. – Plus tard, il accepte le patronage de son école, en autorise le transfert à l'ancien couvent des Célestins et lui assigne une rente annuelle sur sa cassette. – La mort ne permet pas à l'abbé de l'Épée de voir ses élèves installés dans ce nouveau local. – Statistique des pensions de sourds-muets et de sourdes-muettes, existantes à cette époque à Paris. – Son école à un second étage de la rue des Moulins. – Sa maison de campagne à loyer, rue des Martyrs. – Scènes attendrissantes.
Si le génie de l'abbé de l'Épée était immense, ses bienfaits ne le furent pas moins. Pas un jour de sa vie ne s'écoula sans qu'un nouveau sacrifice de sa part vint adoucir la triste destinée de ceux qu'il regardait comme ses fils adoptifs. Le bon pasteur s'obstinait à traîner une soutane usée, à garder la plus stricte économie dans ses repas, dans son entretien, et, quoique presque octogénaire et assiégé par les infirmités irréparables de ce grand âge, à se priver de feu pendant un hiver des plus rigoureux (1788), pour ne pas faire tort, disait-il, au patrimoine sacré de ses enfants. Un matin, la nouvelle de cette privation secrète est révélée par sa gouvernante; elle jette leur âme dans le désespoir, et, joignant leurs instances à celles de cette excellente femme, ils le supplient, les larmes aux yeux, dans leur langage empreint de la plus naïve éloquence, de se conserver pour ses fils adoptifs.
Peu lui importait, d'ailleurs, que son indigence scandalisât un monde raffiné, quand il se contentait de sa seule parure, la vertu; ce n'était point toutefois chez lui une vertu rude, sauvage, repoussante, mais une vertu bienfaisante qui s'insinuait doucement dans les esprits. Au milieu de ses mortifications, il avait soin de se dérober à l'admiration de ceux qui l'approchaient. Il cherchait à se cacher à lui-même. Son âme, d'une rare trempe, s'était si bien endurcie à ses combats intérieurs de chaque jour, qu'on le voyait partager tout son temps entre le travail et la charité ou la prière. A le voir réciter les offices de l'Église à certaines heures fixes, on l'eût pris pour un fervent cénobite qui prie sur les tombeaux.
Jusqu'à présent, ô surprise! pas un grand maître n'a confié à la toile une scène aussi touchante! Eh bien! c'est pour nous un grand bonheur d'avoir à annoncer ici qu'un jeune artiste de talent, un sourd-muet, M. Léopold Loustau42, ancien élève de l'Institution de Nancy, songe à réparer cette injure, trop prolongée, à la mémoire de notre saint Vincent de Paule.
Sans doute, il est présent encore au souvenir de nos lecteurs ce désintéressement trop rare, hélas! dans notre siècle d'égoïsme, dont l'humble apôtre fit preuve dans une circonstance antérieure, lorsqu'atteignant à peine sa vingt-sixième année, il refusa un évêché que le cardinal de Fleury lui offrait en reconnaissance d'un service personnel que son père lui avait rendu. A l'empereur Joseph II, qui lui proposait une abbaye dans ses États, il répondait ainsi: «Je suis confus, sire, de vos bontés; si, à l'époque où mon entreprise n'offrait encore aucune chance de succès, quelque médiateur puissant eût sollicité et obtenu pour moi un riche bénéfice, je l'aurais accepté pour en faire servir les ressources au profit de l'institution. Mais je suis déjà vieux; si Votre Majesté veut du bien aux sourds-muets, ce n'est pas sur ma tête déjà courbée vers la tombe qu'il faut le placer, c'est sur l'œuvre elle-même. Il est digne d'un grand prince de la perpétuer pour le bien de l'humanité.»
Pas moins grande ne fut la surprise de Catherine II, la célèbre impératrice, toujours si empressée à accorder sa protection à tout ce qui était grand et populaire, en recueillant la réponse de l'abbé de l'Épée à son ambassadeur, chargé de lui offrir en 1780 de riches présents en son nom: «Monseigneur, lui avait-il dit, je ne reçois jamais d'or, mais dites à Sa Majesté que, si mes travaux lui ont paru dignes de quelque estime, je ne lui demande pour toute faveur que de m'envoyer un sourd-muet de naissance que j'instruirai.»
– «Les riches, dit-il quelque part, ne viennent chez moi que par tolérance; ce n'est point à eux que je me suis consacré, c'est aux pauvres: sans ces derniers, je n'aurais pas entrepris l'éducation des sourds-muets. Les riches ont le moyen de chercher et de payer quelqu'un pour les instruire.»
Ce fut toujours dans l'intérêt des sourds-muets de toutes les nations que l'abbé de l'Épée apprit seul, dans la maturité de l'âge, l'italien, l'espagnol, l'anglais et l'allemand. «Je suis, disait-il, à l'âge de plus de soixante ans, je suis prêt à étudier toute autre langue dans laquelle il faudrait instruire un sourd-muet qui me sera envoyé par la Providence, car je ne regarde pas avec indifférence les sourds-muets des nations qui nous environnent.»
Aux amis qui lui demandaient: «A quoi tant d'idiomes peuvent-ils vous servir quand il ne s'agit que de sourds-muets français? – A rien, répondait le bon abbé. – Alors pourquoi les leur faire apprendre? – Pourquoi? C'est que je suis mortel. Une partie très-considérable de ma carrière est déjà fournie. – Et qui instruira les sourds-muets après moi? Ce travail est pénible; il engage à des dépenses et il ne rapporte rien; trois pierres d'achoppement pour bien des gens. Je me suis donc imaginé qu'en faisant faire à mes élèves un exercice où chacun serait libre de les interroger en différentes langues, il en résulterait une évidente preuve que les sourds-muets sont aussi susceptibles d'instruction que les autres enfants. Qui sait si quelque puissance ne voudra pas former dans ses États une maison de sourds-muets? Et, dès lors, il y aura quelqu'un après moi, n'importe en quel pays, qui continuera mon œuvre.»
Seul, sans autre ressource qu'une modeste fortune de 12,000 livres de rente environ43, il soutint une école nombreuse dont il payait les maîtres, les maîtresses, ainsi que la nourriture et l'entretien des élèves. Sa dépense personnelle ne s'éleva jamais à plus de 2,000 fr. Son frère, architecte du roi, dont les qualités personnelles le rendaient digne d'une telle parenté, s'empressait d'ouvrir sa bourse à sa première réquisition, lorsqu'il s'agissait de seconder les élans spontanés de son âme, de quelque indifférence que, dans le principe, son école fût l'objet de la part du pouvoir. Souvent même notre charitable instituteur entamait ses capitaux malgré les conseils de la prudence.
Si l'on s'en rapporte à un journal mensuel de l'époque44, Louis XVI aurait dit à l'abbé de Radonvilliers, ex-jésuite, son sous-précepteur: «L'abbé de l'Épée rend un grand service à ses élèves, mais mieux vaudrait pour eux qu'ils restassent sourds-muets que d'ouvrir l'oreille au jansénisme.»
Il n'est plus question depuis longtemps, grâce à Dieu, des querelles du jésuitisme et du jansénisme, et, grâce à Dieu aussi, il n'est sorti de l'école de l'abbé de l'Épée ni jansénistes ni jésuites, mais de bons catholiques, des hommes vertueux et instruits, et des citoyens estimables.
Au surplus, on doit rendre à la bonté naturelle de Louis XVI cette justice, que, plus tard, il ne se contenta pas d'accepter le patronage de l'enseignement de ces pauvres orphelins déshérités, en autorisant le transfert de leur école dans le couvent des Célestins supprimé, sur un vœu formulé par son conseil en date du 25 mars 1785, lequel conseil avait fait espérer cette translation à l'abbé de l'Épée par arrêt du 21 novembre 177845; il fit don encore à cette école d'une rente annuelle de 6,000 livres sur sa cassette. Mais la mort si prompte, si imprévue de l'abbé de l'Épée, ne lui permit pas de goûter la satisfaction de se voir installé avec ses élèves dans ce nouveau local.
Du vivant de ce bienfaiteur de l'humanité, on comptait à Paris trois pensions de sourdes-muettes confiées aux soins de quatre ou cinq dames respectables46, et une de sourds-muets, rue d'Argenteuil, dont M. Chevreau avait la direction. Tout près de là, dans une maison sise rue des Moulins, nº 14, à la butte Saint-Roch, dans un humble appartement au second étage, dont le premier était occupé par son frère, l'abbé de l'Épée réunissait tous ces pauvres enfants les mardis et vendredis de chaque semaine, de sept heures du matin à midi. Ils étaient au nombre de soixante-dix ou quatre-vingts, des deux sexes. Telle fut l'obscure origine de la célèbre institution de Paris et de toutes celles de France et de l'étranger.
L'abbé de l'Épée admettait, en outre, le public aux exercices de ses élèves, qui avaient souvent lieu de trois heures à cinq. Son dévouement allait jusqu'à renouveler parfois ses démonstrations de cinq heures à sept.
Les jours de congé, il les conduisait à une petite habitation de Montmartre (rue des Martyrs), qu'il tenait à loyer et qui était voisine de la maison de M. de Malesherbes. Là on le voyait se mêler parfois à leurs jeux et plus souvent encore captiver l'attention de ceux qui faisaient cercle autour de lui, en assaisonnant ses préceptes d'histoires instructives et édifiantes. Puis il partageait et faisait partager leur frugal repas à quelques-uns de ses amis, heureux de leur bonheur et semblable au plus chéri des pères qu'environnerait sa nombreuse famille.
Au milieu de l'allégresse de cet essaim d'âmes innocentes et candides, le vénérable patriarche laisse échapper, un jour, involontairement un geste, leur annonçant sa mort peut-être prochaine. Le désespoir se peint aussitôt sur leur physionomie jusque-là radieuse. Les voilà qui lui font tous, pour ainsi dire, un rempart de leur corps, comme s'ils cherchaient à le dérober au coup qui le menace, ayant peine à croire qu'un si bon père doive être enlevé si tôt à leur amour. Lui, de son côté, s'efforce d'essuyer leurs larmes, sans pouvoir retenir les siennes. Il leur montre le ciel comme le séjour de l'immortalité et de la félicité éternelle, leur donnant à entendre que là il ira les attendre. Alors une douce tristesse prend la place du désespoir dans cette intéressante famille; et tous lui promettent de ne rien épargner pour l'aller rejoindre un jour là haut, au sortir de cette vallée de larmes.
Cependant un coup affreux devait venir bientôt briser l'âme du saint prêtre.
42
Léopold Loustau a exposé au salon de 1839 un grand tableau qui représente saint Pierre guérissant un boiteux; – en 1840, le Sermon de Jésus-Christ sur la Montagne, dont le ministre de l'intérieur a fait l'acquisition; – en 1844, Jésus enfant parmi les docteurs de la loi, tableau donné par le ministre à la chapelle du lycée de Strasbourg et pour lequel le jeune artiste a obtenu une médaille d'or; – en 1842, Jésus-Christ bénissant les petits enfants, tableau commandé par le ministre pour servir de pendant à ce dernier; – en 1845, l'Apparition de Saint-Nicolas devant Constantin le Grand, tableau placé par ordre du ministre dans la cathédrale de Haguenau (département du Bas-Rhin), dont le saint est le patron; – en 1846, Bonaparte quittant l'Égypte pour venir sauver la France. Il est accompagné des généraux Murat, Lannes, Marmont, Berthier, Andréossy et de deux savants, Monge et Berthollet. Loustau excelle également dans les portraits, dont il reçoit chaque jour de nouvelles commandes.
43
La comtesse de Courcel, sa nièce, ne l'évalue qu'à 7 ou 8,000 fr.
44
Revue ecclésiastique, 33e livraison, février.
45
Voyez la note 1.(44)
46
Mlles Cornu, Trumeau, Vissera, Duhamel et Lefebure.