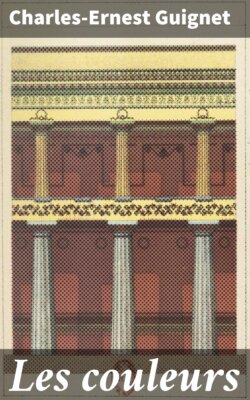Читать книгу Les couleurs - Charles-Ernest Guignet - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVII
Table des matières
VISION DES COULEURS. — LE DALTONISME. — LA VISION CHEZ LES ANIMAUX
Les sensations produites par les objets colorés ne peuvent pas être définies; il est impossible d’en donner une idée quelconque à une personne qui ne les a jamais éprouvées.
Locke, célèbre philosophe anglais, prétendait le contraire. Il voulut faire l’expérience sur un aveugle-né, au milieu d’un petit cercle de savants et d’amis.
Il fit à l’aveugle de fort ingénieuses descriptions des phénomènes lumineux: il parla du plaisir qu’on éprouve quand la lumière pénètre dans l’œil et vous fait percevoir une couleur agréable.
«Avez-vous bien compris? demanda-t-il à l’aveugle, homme d’ailleurs fort intelligent. Quelle idée vous faites-vous de la lumière? — Oui, oui, je comprends très bien, répondit l’aveugle; la lumière ressemble tout à fait à du sucre qui entrerait dans les yeux au lieu de pénétrer dans la bouche!»
Il faut remarquer tout d’abord que les sensations lumineuses dépendent surtout du sujet qui les perçoit, et non pas seulement de l’objet lumineux qui les envoie.
Ce sont des phénomènes subjectifs et non pas objectifs, pour employer le jargon de la philosophie moderne.
Les couleurs sont en nous, disait Newton, l’illustre savant auquel nous devons les premiers travaux scientifiques sur les couleurs.
Ce qui le prouve nettement, c’est que la même couleur est appréciée diversement par plusieurs personnes différentes.
Certains yeux sont frappés d’achromatopsie, c’est-à-dire d’impossibilité de distinguer les couleurs.
Quelquefois ce défaut est tellement développé qu’on ne discerne aucune couleur; on distingue seulement les objets plus éclairés de ceux qui le sont moins: tous les objets paraissent blancs, gris ou noirs. Un tableau peint des couleurs les plus vives produira l’effet d’un lavis à l’encre de Chine. Tel fut le cas d’un cordonnier anglais, Harris célèbre dans les annales de la science.
Mais, le plus souvent, cette incapacité de voir les couleurs s’applique seulement à telle ou telle nuance.
Une personne ne verra pas le rouge sur fond blanc; pour une autre ce sera le jaune, etc.
Un autre défaut de la vue est beaucoup plus commun, car il atteint 5 et même 10 pour 100 de la population adulte: c’est le daltonisme, ainsi nommé parce que Dalton, éminent physicien anglais, était atteint de ce défaut et qu’il en a fait sur lui-même une étude fort complète.
Les femmes sont beaucoup moins sujettes au daltonisme que les hommes, parce que dès l’enfance l’œil féminin s’exerce à comparer les couleurs afin de les assortir heureusement pour la toilette, les ouvrages de tapisserie, etc. C’est une véritable éducation de l’œil, dont l’autre sexe ne profite pas.
Le daltonien complet ne voit dans le spectre que deux régions: l’une (qu’il appelle jaune) comprend le rouge, l’orangé. le jaune, le vert; l’autre (qui est pour lui le bleu) se compose du bleu, de l’indigo, du violet.
Entre ces deux régions se trouve une zone qui lui paraît gris clair, presque blanche; elle correspond à peu près à la raie F (voir pl. I).
Dalton confondait si bien le rouge avec le vert qu’il lui était impossible de trouver un bâton de cire à cacheter rouge au milieu d’un gazon bien vert, nouvellement tondu.
On peut remarquer à ce sujet que les premières couleurs nommées plus haut sont souvent appelées couleurs lumineuses (rouge, orangé, jaune), et les autres couleurs obscures (bleu, indigo, violet). Le vert tient à peu près le milieu entre ces deux catégories.
La personne atteinte assez faiblement de daltonisme confond deux couleurs, vert et bleu, par exemple, ou bien prend une couleur pour une autre, par exemple le vert pour le rouge ou inversement.
Quand on fait passer des examens aux futurs employés des chemins de fer, il est nécessaire de vérifier qu’aucun des candidats n’est atteint de daltonisme.
On présente une lanterne verte à chaque candidat en lui demandant son avis sur la couleur; celui qui la trouverait rouge serait immédiatement refusé, car un tel employé pourrait confondre des signaux et occasionner de terribles accidents.
Ce sont précisément les examens pour les chemins de fer et pour la marine qui ont révélé la fréquence du daltonisme: aussi ne faut-il pas s’étonner outre mesure si tels artistes de talent manquent absolument du sens des couleurs. Pour certains paysagistes tous les verts paraissent bleus ou vert bleu; et réciproquement le bleu sera toujours verdâtre à leurs yeux. Leurs œuvres sont nécessairement poussées au bleu; pour reproduire la verdure naturelle, ils prendront volontiers du bleu de Prusse à peine verdi par un peu de jaune.
Tel artiste (qu’on pourrait nommer) ne voit pas bien le rouge, surtout quand il est mêlé de beaucoup de blanc; ses œuvres sont de vraies grisailles; les chairs des hommes rappellent la brique, celles des femmes sont couleur de plâtre mêlé d’un peu de lie de vin.
Pour apprécier la sensibilité de l’œil au point de vue des couleurs, on peut procéder de la manière suivante:
Fig 4. — Le Caméléon. (Voir p. 2.)
Sur une palette, on mélange intimement avec du blanc de céruse (ou du blanc de zinc) une pointe de bleu de Prusse; on fait la même chose avec un peu de laque de garance, de jaune indien et de vert émeraude.
On a ainsi cinq échantillons: blanc bleuâtre, blanc rosé, blanc jaunâtre, blanc verdâtre; plus le blanc pur.
Si une personne non prévenue ne distingue pas immédiatement ces cinq échantillons, c’est qu’elle n’a pas la vue sensible. Si elle ne désigne pas exactement les cinq nuances, ou si elle confond deux échantillons colorés, c’est qu’elle est daltonienne, à un degré quelconque.
La sensibilité naturelle peut se développer par l’étude, mais le daltonisme est incurable.
Il faut bien se garder de fatiguer la vue des enfants en les habillant de couleurs trop voyantes, de rouge vif, par exemple, dès le premier âge; ou bien en les faisant travailler avec le jour en face, quand ils sont d’âge à étudier. Beaucoup de vues faibles n’ont pas d’autre origine.
Les animaux voient les couleurs à peu près comme nous les voyons; ils peuvent même les comparer et les imiter.
Le caméléon (fig. 4) prend à volonté la feinte des objets qui l’environnent. Sous l’épiderme du caméléon se trouvent des vésicules remplies d’un liquide rouge, jaune ou noir. L’animal peu distendre à volonté ces vésicules. S’il est placé sur un fond vert olive, il arrive (après quelques essais) à donner à sa peau la teinte du fond; en distendant les vésicules jaunes et noires, il fait apparaître en quelque sorte toutes les nuances de brun (Paul Bert).
Quand on place un jeune carrelet sur un fond de sable gris, on le voit prendre au bout de peu de temps exactement la teinte grise du fond. Si on le porte alors sur un fond brun chocolat, il se donnera bientôt cette même teinte par des moyens analogues à ceux qu’emploie le caméléon (Agassiz).
Fig. 5. — Coupe de l’œil humain. — A, cornée transparente. — B, humeur vitrée. — C, pupille. — D, iris ou prunelle. — E, cristallin. — M, nerf optique, dont l’épanouissement à la surface d’une partie du globe de l’oeil constitue la rétine.
Les animaux doués de cette faculté merveilleuse en profitent pour échapper plus facilement à leurs ennemis.