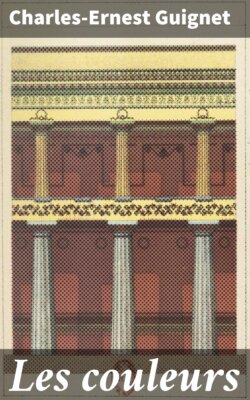Читать книгу Les couleurs - Charles-Ernest Guignet - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVI
Table des matières
LES FARDS. — LA TEINTURE DES CHEVEUX
L’art d’appliquer les fards est une véritable peinture sur le vif, comme le tatouage; mais elle en diffère complètement, parce qu’elle n’est que superficielle; on peut l’enlever par des lavages. Dans certains cas cependant il y a teinture de l’épiderme, et il faut que cet épiderme soit détruit pour que la peinture disparaisse.
Dans un grand nombre de tribus sauvages, les guerriers ont l’habitude de se peindre le visage et même d’autres parties du corps pour se donner un aspect plus terrible. Chez les barbares du Nord, cette coutume n’était pas très rare; on l’attribue aux Pictes qui occupaient l’Écosse avant l’invasion romaine.
Le jour du triomphe, les généraux romains se fardaient avec du vermillon. A Rome, on fardait jusqu’aux statues; les jours de grandes fêtes, les censeurs étaient obligés par leurs fonctions de faire repeindre en rouge la face de la statue de Jupiter.
Chez les peuples civilisés, il n’y a plus guère que les gens de théâtre et un petit nombre de femmes élégantes qui aient conservé l’habitude de se farder régulièrement. C’est d’ailleurs une question de mode; sous Louis XV, aucune femme en toilette n’eût osé se montrer en public sans être artistement peinte, ornée de quelques mouches et bien poudrée à blanc. Les femmes de nos jours usent du fard beaucoup plus discrètement; quelques-unes ont même la prétention de le dissimuler d’une manière complète: mais un œil exercé reconnaît tout de suite les maquillages les plus habiles.
Il n’y a qu’une seule espèce de fard qui puisse à lui seul remplacer tous les autres: c’est le fard de la santé, qui fait circuler sous la peau un sang riche et vermeil, qui donne aux lèvres le véritable ton carminé, aux yeux le brillant et l’éclat velouté absolument inimitable.
Mais à toutes les époques, il a paru nécessaire de venir en aide à la nature.
Dès la plus haute antiquité, les femmes de l’Orient ont fait usage du sulfure d’antimoine en poudre fine pour noircir le bord des paupières et faire paraître les yeux plus grands. On l’appliquait avec une aiguille (à pointe arrondie): on s’en servait aussi pour peindre les sourcils.
L’une des filles de Job est appelée par son père vase d’antimoine, sans doute parce qu’elle faisait grand usage ou même abus de ce fard primitif.
Ayant appris la prochaine arrivée de Jéhu à Samarie, Jézabel se passe les yeux à l’antimoine afin de paraître dans tout l’éclat de sa beauté. C’est ce que Racine a développé dans les vers célèbres:
Même elle avait encore cet éclat emprunté
Dont elle eut soin de peindre et d’orner son image
Pour réparer des ans l’irréparable outrage.
Les dames romaines usaient largement du fard. Elles employaient la céruse (blanc de plomb) dont l’action prolongée sur la peau est extrêmement dangereuse. Il en résultait sans doute un certain nombre de maladies que les médecins du temps attribuaient à toute autre cause, car les anciens ne savaient pas jusqu’à quel point le plomb est vénéneux.
Nos médecins sont beaucoup plus avancés. Quand un malade meurt, on a presque toujours la consolation de savoir quelle est la maladie qui l’a emporté : ce qui est assurément un progrès, en attendant qu’on puisse guérir toutes les maladies.
Les blancs de fard employés actuellement sont généralement inoffensifs.
La poudre de riz n’est autre chose que de l’amidon de riz en poudre impalpable, c’est-à-dire passé au tamis de soie très fin.
Toutefois la poudre de riz destinée à l’exportation pour les pays chauds est souvent mêlée de blanc de plomb. Les parfumeurs coupables de telles fraudes devaient être fort sévèrement condamnés, si nos lois sur les falsifications étaient mieux conçues et surtout mieux exécutées.
La céruse coûte un peu moins cher que l’amidon de riz (qui vaut seulement de 0 fr. 70 à 0 fr. 80 le kilogramme): mais ce n’est point par économie qu’on l’introduit dans la poudre de riz.
Dans les pays chauds, la transpiration est tellement abondante (même chez les personnes oisives), qu’il se forme à la surface de la peau de véritables ruisseaux qui entraînent la poudre de riz et laissent des sillons désagréables à la vue. Au contraire, le blanc de plomb colle à la peau en formant une sorte de mastic, de façon que la transpiration ne marque plus sur la peau.
Cette redoutable falsification a été constatée pour la première fois par un médecin de Paris, dans des circonstances curieuses.
Une dame de la Guadeloupe était venue à Paris avec sa jeune fille pour se faire traiter d’une maladie très douloureuse et impossible à guérir. Le médecin reconnut les symptômes des coliques de plomb, mais ses clientes affirmaient n’avoir jamais absorbé de plomb sous aucune forme. Cependant la jeune fille fut atteinte d’un furoncle à la paupière; on lui appliqua comme cataplasme un oignon cuit à petit feu. Le médecin reconnut que la peau devenait brunâtre par suite de l’action du soufre contenu dans l’oignon, ce qui ne pouvait avoir lieu que si la peau était pénétrée d’un composé de plomb. Ce fut un trait de lumière; on essaya la poudre de riz dont ces dames usaient largement chaque jour; elle contenait le quart de son poids de céruse!
Les deux victimes ne guérirent qu’à la suite d’un traitement longtemps prolongé ; elles avaient subi un véritable empoisonnement par le plomb, d’autant plus dangereux qu’il s’était fait plus lentement.
Conclusion: les dames qui habitent les pays chauds doivent toujours faire essayer leur poudre de riz, afin de s’assurer qu’elle est exempte de plomb.
Les fards de différentes couleurs ont pour base le talc ou craie de Briançon, matière tout à fait inoffensive, très onctueuse au toucher; c’est la poudre de savon qu’on emploie pour faciliter l’essayage des gants ou des chaussures. C’est encore cette poudre qu’on emploie pour le satinage des papiers peints.
Cette poudre ne serait pas assez blanche; on y ajoute du blanc de neige (blanc de zinc) ou du sous-nitrate de bismuth. Ce dernier produit n’est pas sans inconvénients: il attaque la peau et y détermine la formation d’une foule de petites rides.
En ajoutant au talc du rose de carthame, on obtient le fard rouge ordinaire (rouge végétal pour les lèvres). Ce fard est inoffensif, comme le fard au carmin qui donne à peu près le même ton rose vif. Mais le fard rouge au vermillon (sulfure de mercure) ne doit être employé qu’avec précautions, eu l’appliquant sur une première couche de rouge végétal.
Les crayons noirs ou bruns qui servent pour les paupières et les sourcils sont tout à fait sans danger.
Mais il n’en est pas de même pour la plupart des teintures destinées aux cheveux.
Ce qu’il y a de plus inoffensif pour la chevelure, c’est la poudre, qui a régné despotiquement pendant tout le dernier siècle sur les coiffures des deux sexes. La poudre à cheveux n’est autre chose que de l’amidon très fin, comme la poudre de riz. Comme les coiffeurs du temps de Louis XV étaient toujours blancs de poudre, le peuple de Paris les comparait à des merlans apprêtés pour la friture; le surnom est resté, bien que l’usage de la poudre soit devenu très exceptionnel.
C’est la poudre à cheveux qui a été l’occasion de la découverte de la terre à porcelaine en Saxe.
Un spéculateur du pays avait imaginé de vendre comme poudre à cheveux une terre blanche restée jusque-là sans usage.
L’électeur de Saxe retenait en prison un alchimiste nommé Bœttger, jusqu’à ce que celui-ci fût parvenu à faire de l’or.
Le prisonnier se faisait poudrer chaque jour. Il constata que la poudre de son coiffeur était fort lourde, s’enquit de la provenance et reconnut que c’était du véritable kaolin (terre à porcelaine), vainement cherché jusque-là. La fabrication de la porcelaine de Saxe commença aussitôt, dans la forteresse où Bœttger était renfermé (1709). Le secret fut bien gardé : il y avait peine de mort contre l’ouvrier qui aurait fait connaître le moindre secret de fabrication.
Nos élégantes ont abandonné la poudre;- elles ont mis à la mode les cheveux jaunis au moyen de l’eau à blondir.
Cette eau n’est autre chose que de l’eau oxygénée (bioxyde d’hydrogène), composé découvert par Thenard en 1818. L’eau oxygénée attaque les cheveux et altère la matière colorante noire ou brune contenue dans l’intérieur, de manière à lui donner une teinte brun jaune.
C’est encore à l’aide de l’eau oxygénée qu’on amincit et qu’on blanchit les chevelures noires des femmes de la race jaune, employées à Paris en grande quantité pour la fabrication des faux cheveux. On ne pourrait utiliser directement les cheveux asiatiques, qui sont gros comme des crins et manquent absolument de souplesse. Après le traitement, on les teint en diverses couleurs, variant du blond jusqu’au noir, en passant par les bruns châtains.
Mais quand on opère sur le vivant, il n’est pas aussi facile de teindre les cheveux. Supposons un vieillard pourvu d’une belle chevelure blanche: pour la teindre, il faudrait la faire bouillir pendant deux heures avec de l’eau, de l’alun et du bitartrate de potasse (crème de tartre); laver à grande eau; puis faire bouillir à nouveau avec de l’eau, du bois de Campêche et du sulfate de cuivre. Les cheveux deviendraient d’un beau noir à reflets bleus, comme l’aile du corbeau. C’est ainsi qu’on peut teindre la laine ou les cheveux (séparés de la tête).
Pour teindre les cheveux en place, on a essayé un grand nombre de moyens.
Comme les cheveux contiennent du soufre, ils noircissent quand on les imprègne d’une solution de plomb ou d’argent. Mais le noir ainsi obtenu est d’un aspect dur et cru, de sorte que ce genre de teinture ne produit pas la moindre illusion.
On a obtenu de meilleurs résultats en faisant succéder l’action d’un sulfure alcalin très faible à celle de la solution de plomb.
Une des eaux merveilleuses ou féeriques les plus vantées s’obtient au moyen de l’hyposulfite de plomb et de soude préparé en versant peu à peu de. l’acétate de plomb dans de l’hyposulfite de soude. Cette mixture se change peu à peu en sulfure de plomb noir qui reste adhérent aux cheveux.
On a aussi employé l’acide pyrogallique uni à l’ammoniaque ou à la potasse, mais la teinte obtenue n’arrive pas jusqu’au noir: elle ne dépasse guère le brun foncé.
Nos ancêtres les Gaulois se servaient pour leurs belles chevelures blondes d’un cosmétique formé d’un mélange de graisse, de chaux vive et de cendres de bouleau: ce qui revenait à l’emploi d’un savon imparfait, très chargé de potasse caustique. C’était justement cet excès de potasse qui avivait la teinte blonde, mais au détriment des cheveux.
En Orient, les femmes se teignent les ongles en jaune à l’aide du henné : c’est une pâte faite avec les feuilles du Lawsonia inermis réduites en poudre et broyées avec de l’eau. Cet usage remonte à la plus haute antiquité. On se sert aussi du henné pour teindre les crins des chevaux blancs et même les cheveux de couleur claire.