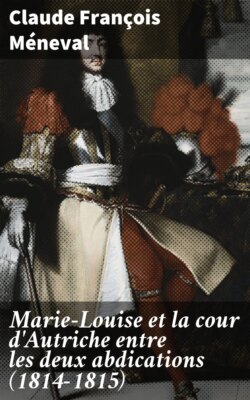Читать книгу Marie-Louise et la cour d'Autriche entre les deux abdications (1814-1815) - Claude Francois Meneval - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE PREMIER
ОглавлениеTable des matières
Caractère de Marie-Louise.—Sa correspondance avec Mme de Crenneville.—Son portrait.—Ce que pensait de sa mère le duc de Reichstadt.
Avant d'entreprendre la relation d'une partie des événements qui se sont déroulés entre 1814 et 1815 dans l'Europe centrale, et de parler de la répercussion qu'ils ont exercée sur le cœur de Marie-Louise, il nous a paru nécessaire de donner à ceux qui liront ces pages quelques éclaircissements préliminaires, destinés à leur faire mieux comprendre la nature d'âme, les tendances, la valeur morale en un mot de la fille de l'empereur François.
Dans ses Mémoires pour servir à l'histoire de Napoléon Ier—dans le troisième volume surtout—mon grand-père a consacré plusieurs chapitres à l'impératrice Marie-Louise, à son caractère, à son genre de vie et même à ses occupations ou à ses habitudes. Le lecteur devra s'y reporter s'il veut connaître, avec des détails plus circonstanciés, les faits et gestes de l'Impératrice depuis son mariage en 1810 jusqu'à la première abdication de Napoléon en 1814 et même jusqu'en 1815. Pour relier avec les années précédentes la période spéciale qui nous occupe, il nous faudra donc emprunter à l'ouvrage précité, et à beaucoup d'autres encore—aussi succinctement toutefois que possible—des appréciations, des anecdotes ou certaines particularités susceptibles de servir à l'intelligence des fluctuations d'âme de cette princesse, et de nous amener enfin à constater, dans cette nature faible et futile, l'abandon regrettable et complet de ses devoirs les plus sacrés.
En revenant à Vienne, en retrouvant le berceau de son enfance et de ses jeunes années, l'impératrice Marie-Louise était encore animée d'intentions droites. Son attachement pour son époux, trahi par la fortune, se trouvait sans doute affaibli; il était loin cependant de paraître éteint. Cédant par faiblesse et un peu par égoïsme à de perfides suggestions, son âme, visitée déjà par de légers remords, avait conservé néanmoins des sentiments de fidélité et de loyauté vis-à-vis de Napoléon.
Marie-Louise se souvenait des constants égards qu'il lui avait témoignés, de ses manières affectueuses et tendres pour elle. Elle n'avait vraisemblablement jamais aimé avec passion le mari que les nécessités de la politique avaient obligé l'Autriche à lui donner, et cependant, pour faire mieux connaître la nature des sentiments de la souveraine détrônée à l'égard de son époux, dès les prémices de l'union qui avait été imposée à l'Archiduchesse, il nous a paru tout à fait opportun de placer sous les yeux du lecteur des extraits de plusieurs lettres adressées par Marie-Louise à son amie la plus intime, Mlle de Poutet, devenue comtesse de Crenneville.
Nous allons citer textuellement ces extraits puisés dans une correspondance publiée à Vienne par Gerold.
Avant le mariage.
A Mlle Victoire de Poutet:
«23 janvier 1810.
»Je sais que l'on me marie déjà à Vienne avec le grand Napoléon; j'espère que cela restera au discours et vous suis bien obligée, chère Victoire, pour votre beau souhait à ce sujet. Je forme des vœux afin qu'il ne s'exécute pas, et, si cela devait se faire, je crois que je serais la seule qui ne s'en réjouirait pas.»
»M.-L.»
Après le mariage.
A Mlle Victoire de Poutet:
«Compiègne, 24 avril 1810.
»Je vous suis bien sincèrement reconnaissante pour les vœux que vous me faites dans votre lettre du 20 mars à l'occasion de mon mariage. Le Ciel les a exaucés; puissiez-vous bientôt jouir d'un bonheur pareil à celui que j'éprouve, et que vous méritez tant. Vous pouvez être persuadée que personne ne le souhaite plus que votre attachée amie.»
»M.-L.»
A Victoire de P..., future comtesse de Crenneville:
«11 mai 1810.
»... Peut-être que dans ce moment vous êtes déjà mariée et goûtez un bonheur aussi inaltérable que le mien...»
»M.-L.»
1er janvier 1811.—Autre extrait de lettre à la même:
«Les moments les plus agréables sont ceux où je suis avec l'Empereur.»
A la comtesse de Crenneville:
«6 mai 1811.
»J'ai été bien touchée des vœux que vous formez à cette occasion pour mon fils; j'espère qu'ils se réaliseront et qu'il fera un jour, comme son père, le bonheur de tous ceux qui l'approcheront et le connaîtront.»
Marie-Louise exprime encore, dans sa correspondance de l'année 1812, ses regrets d'être séparée de Napoléon parti pour la campagne de Russie (lettre à Victoire de Crenneville).
Enfin l'Impératrice écrivait de Prague, le 25 juin 1812, à Mme Mère:
«L'Empereur m'écrit bien souvent; chaque jour où je reçois une lettre est un jour de bonheur pour moi. Rien ne peut me consoler de son absence, pas même la présence de toute ma famille.»
Rien n'obligeait Marie-Louise à écrire de semblables lettres; d'ailleurs la fausseté n'était pas chez elle un vice de nature, et ces confidences adressées, presque toutes, à sa meilleure amie, fille de sa grande maîtresse la comtesse de Colloredo, ne sauraient être suspectées d'hypocrisie par personne. Elles sont l'expression de la vérité du moment. Plus tard les leçons et les enseignements du général Neipperg porteront leurs fruits, et Marie-Louise finira par modifier le fond de sa nature, par devenir trompeuse et dissimulée comme son mentor.
Voici le jugement sévère, mais qui nous semble absolument justifié, porté sur la deuxième femme de Napoléon dans la Revue historique:
«Marie-Louise, archiduchesse d'Autriche, impératrice des Français, fille aînée de François empereur d'Autriche et de Marie-Thérèse de Naples, née à Vienne le 12 décembre 1791, mariée à Napoléon Ier le 2 avril 1810, morte à Vienne le 18 décembre 1847. Personne insignifiante; elle ne pense pas. Femme de Napoléon, elle n'en parle que dans les termes de la plus bourgeoise tendresse. On le lui enlève, elle l'oublie.» La Revue historique trouve en outre d'une banalité attristante toute la correspondance de Marie-Louise avec les comtesses de Colloredo et Crenneville, publiées comme nous l'avons dit, par Gerold, et juge, par endroits, ces lettres «comme un affront à la dignité morale d'une femme et d'une souveraine.»
Marie-Louise ne dit-elle pas en effet dans une des susdites lettres que, si elle songeait un jour à se remarier, elle serait heureuse de rencontrer un autre M. de Crenneville... Quelles que pussent être en réalité les qualités personnelles de ce galant homme, cette réflexion d'une souveraine même déchue, décèle,—suivant nous—un manque absolu de grandeur et même de dignité.
Plus d'un contemporain, plus d'un historien qui ont connu ou étudié Marie-Louise la traitent d'esprit léger et irréfléchi, et constatent en elle l'absence totale de caractère et de tout sens politique.
Il faut en effet quand on étudie de près l'histoire de la deuxième femme de Napoléon (qu'il jugeait lui-même plus tard faible et frivole malgré son extrême indulgence pour elle) reconnaître que cette impératrice était faite pour une existence terre à terre et exempte d'orages, qu'elle était douée par la nature d'un tempérament bourgeois de petite grisette. Née sur les marches d'un des trônes les plus illustres de l'Europe, elle ne se montra, en aucune rencontre, à la hauteur du rôle éminent que les circonstances et l'assentiment de son père l'avaient appelée à jouer sur la scène du monde. Nous dirons plus, les événements dramatiques, survenus pendant la durée si courte de son règne éphémère, ne semblèrent lui laisser plus tard,—après la chute de l'Empire français—que des souvenirs de véritable terreur, en même temps qu'une répugnance invincible à en affronter de nouveau les agitations et les périls.
Nous pourrions nous borner à ces appréciations diverses, recueillies un peu partout et puisées dans les écrits des témoins vivant à la même époque, comme dans les récits des historiens contemporains actuels. Nous choisirons, cependant, pour mieux confirmer la justesse des jugements portés plus haut sur l'impératrice Marie-Louise, deux autres témoignages décisifs, le dernier surtout puisqu'il émane de l'infortuné duc de Reichstadt lui-même!...
Écoutons d'abord celui de Prokesch Osten, ce fidèle et unique ami du fils de Napoléon et de Marie-Louise. S'il cherche d'abord à exonérer cette princesse des griefs articulés contre elle dans le livre de M. de Montbel, il est loin cependant de conclure à son innocence complète et à son irresponsabilité absolue. Voici le langage qu'il tient à son sujet:
«Montbel fait tort à Marie-Louise en ne remarquant pas qu'elle voulait rester (en 1814) à Paris. Elle eût été satisfaite si le peuple l'eût empêchée de partir le 29 mars. Ceux qui lui supposent des arrière-pensées royalistes, etc., qui disent qu'elle vit avec joie la perte de son trône et de son époux, ne connaissent pas cette femme faible, mais capable cependant de sentiments plus élevés. Elle aimait son mari et son fils, et savait que ses devoirs envers eux devaient passer avant ceux qu'elle avait vis-à-vis de son père. La cause de ses égarements postérieurs consiste seulement dans la passivité fatale dans laquelle les jeunes filles (et surtout les princesses) sont élevées à Vienne.»
M. Welschinger, l'historien éminent et bien connu de l'ouvrage si attachant, intitulé le Roi de Rome, a fait paraître récemment une très intéressante brochure qui fait suite à son livre, et pourrait en être considérée en quelque sorte comme l'appendice [5].
Des notes intimes de Prokesch Osten, reproduites en partie dans cette brochure, il résulte qu'au cours d'une de ses conversations avec le duc de Reichstadt, ce prince aborda une seule et unique fois, avec son intime confident, le sujet brûlant d'une appréciation sur la conduite de sa mère, et qu'il le fit avec l'accent de la plus grande émotion. Le duc me dit alors, rapporte Prokesch: «Si Joséphine avait été ma mère, mon père n'aurait pas été à Sainte-Hélène, et moi je ne languirais pas à Vienne. Certainement ma mère est bonne... mais elle est sans force... Elle n'était pas la femme que mon père méritait!» En prononçant ces paroles le duc versait des larmes, se cachant le visage entre ses mains, et le loyal Prokesch, pour le consoler, reprenait: «La femme que méritait votre père n'existait pas!»
De quel intérêt sera pour l'histoire qui le recueillera, ce jugement porté par le fils de Marie-Louise sur sa mère, et qu'un seul témoin a été à même de conserver dans sa mémoire puis de fixer sur le papier dans ses notes manuscrites!
Dans ses intéressants mémoires sur Napoléon et Marie-Louise la veuve du général Durand, dame du Palais de l'impératrice, nous trace un charmant portrait de la seconde femme de Napoléon. Mme Durand restera dans l'histoire de la période impériale comme le type de la fidélité, du dévouement et de la noblesse de sentiments la plus pure. Voici en quels termes elle décrit la personne de Marie-Louise à l'époque de l'arrivée de celle-ci en France:
«Marie-Louise avait alors dix-huit ans et demi, une taille majestueuse, une démarche noble, beaucoup de fraîcheur et d'éclat, des cheveux blonds qui n'avaient rien de fade, des yeux bleus mais animés, une main, un pied qui auraient pu servir de modèles, un peu trop d'embonpoint peut-être, défaut qu'elle ne conserva pas longtemps en France; tels étaient les avantages extérieurs qu'on remarqua tout d'abord en elle. Rien n'était plus aimable, plus gracieux que sa figure quand elle se trouvait à l'aise, soit dans son intérieur, soit au milieu des personnes avec lesquelles elle était particulièrement liée; mais dans le grand monde, et surtout dans les premiers moments de son arrivée en France, sa timidité lui donnait un air d'embarras que bien des gens prenaient à tort pour de la hauteur [6].»
Napoléon, ravi de rencontrer dans cette jeune princesse tous ces avantages réunis, en devint presque aussitôt réellement épris, et lui témoigna, dans les premiers temps de la lune de miel surtout, la plus vive tendresse. Marie-Louise possédait un ensemble de qualités domestiques dont l'Empereur savait apprécier le charme réel.
Continuons d'emprunter aux souvenirs de Mme Durand d'autres particularités intimes qui feront mieux comprendre au lecteur les causes qui motivèrent, dès le début de leur union, l'attachement véritable ressenti par Napoléon pour sa nouvelle femme.
Mme Durand ajoute en effet au séduisant portrait de Marie-Louise, que nous venons de reproduire plus haut, les appréciations suivantes:
«L'archiduchesse Marie-Louise avait reçu une éducation très soignée; ses goûts étaient simples, son esprit cultivé; elle s'exprimait en français avec facilité, avec autant d'aisance que dans sa langue naturelle. Calme, réfléchie, bonne et sensible, quoique peu démonstrative, elle avait tous les talents agréables, aimait à s'occuper et ne connaissait pas l'ennui. Nulle femme n'aurait pu mieux convenir à Napoléon [7]. Douce, paisible, étrangère à toute espèce d'intrigues, jamais elle ne se mêlait des affaires publiques et elle n'en était instruite, le plus souvent, que par la voie des journaux. Pour mettre le comble au bonheur de l'Empereur, la Providence voulut que cette jeune princesse, qui aurait pu ne voir en lui que le persécuteur de sa famille, l'homme qui, deux fois, l'avait obligée de fuir de Vienne, se trouvât flattée de captiver celui que la renommée proclamait le héros de l'Europe, et éprouvât bientôt pour lui le plus tendre attachement.»
D'après tout ce que nous venons de rapporter jusqu'ici l'on voit combien les sentiments de Marie-Louise, si peu bienveillants pour Napoléon avant son mariage avec ce prince, avaient changé depuis qu'il était devenu son mari!... Nous croyons devoir à ce propos reproduire, ci-après, une petite anecdote dont mon grand-père s'est fait l'écho dans ses souvenirs sur la deuxième femme de l'Empereur:
«L'archiduchesse Marie-Louise, dit-il, aux premières paroles qui lui furent portées de son union projetée avec Napoléon, se regarda presque comme une victime sacrifiée au Minotaure. Cette princesse m'a fait l'honneur de me raconter qu'elle avait grandi, sinon dans la haine, au moins dans des sentiments peu favorables à l'homme qui avait mis plusieurs fois la maison de Habsbourg à deux doigts de sa perte, qui avait obligé sa famille à fuir de sa capitale et à errer de ville en ville, au milieu de la confusion et de la consternation inséparables d'une retraite précipitée. Les jeux habituels de son frère et de ses sœurs consistaient à ranger en ligne une troupe de statuettes en bois ou en cire qui représentaient l'armée française, à la tête de laquelle ils avaient soin de mettre la figure la plus noire et la plus rébarbative. Ils la lardaient à coups d'épingle et l'accablaient d'outrages, se vengeant ainsi, sur ce chef inoffensif, des tourments que faisait éprouver, à leur famille, le chef redouté contre lequel les efforts des armées autrichiennes et les foudres du cabinet de Vienne demeuraient impuissants [8].»
16