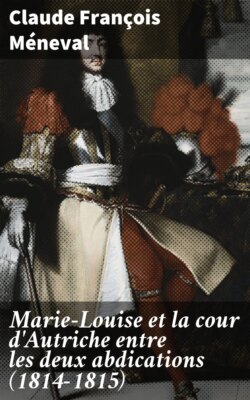Читать книгу Marie-Louise et la cour d'Autriche entre les deux abdications (1814-1815) - Claude Francois Meneval - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE II
ОглавлениеTable des matières
Lettre de l'empereur d'Autriche à Napoléon en date du 16 avril 1814.—Lettre de Metternich à Marie-Louise.—Appréciation du caractère et de la conduite de ce ministre par un contemporain du chancelier autrichien.
Le récit de l'agonie de l'Empire en 1814, après l'immortelle campagne de France, a plusieurs fois été fait, et lu dans un grand nombre de mémoires relatifs à cette dramatique époque. Nous n'avons pas l'intention d'en reproduire, dans cet ouvrage, une nouvelle narration. Nous nous occuperons spécialement de Marie-Louise, la suivant dans ses pérégrinations jusqu'à Vienne et à Schönbrunn, en nous efforçant de tracer une peinture fidèle des impressions et des sentiments divers dont son âme était agitée au début de sa séparation d'avec l'Empereur, séparation qu'elle ne croyait pas alors devenue définitive.
Son père, l'empereur d'Autriche, partageant ou feignant de partager la manière de voir de sa fille dans l'entrevue qu'il avait eue avec elle à Rambouillet, ne lui avait parlé à cette occasion d'aucune résolution semblable. Mon grand-père, en racontant les péripéties de l'entrevue de l'empereur François et de Marie-Louise dans cette résidence impériale, rend témoignage de l'émotion de ce souverain au moment où sa fille désolée le reçut en versant des larmes, et en jetant entre les bras de son grand-père le fils de Napoléon. On trouvera la preuve de l'incertitude où se trouvait alors le monarque autrichien sur la ligne de conduite qu'il aurait à adopter à cet égard, pour l'avenir, dans la lettre suivante adressée par lui de Rambouillet à son gendre détrôné, le 16 avril 1814, lettre insérée dans l'ouvrage de M. de Saint-Amand intitulé: Marie-Louise, l'Ile d'Elbe et les Cent Jours. Voici cette lettre: «Monsieur mon frère et cher beau fils, la tendre sollicitude que je porte à l'impératrice ma fille, m'a engagé à lui donner rendez-vous ici. J'y suis arrivé il y a peu d'heures, et je ne suis que trop convaincu que sa santé a prodigieusement souffert depuis que je l'avais vue. Je me suis décidé à lui proposer de se rendre, pour quelques mois, dans le sein de sa famille. Elle a trop besoin de calme et de repos et Votre Majesté lui a donné trop de preuves de véritable attachement pour que je ne sois pas convaincu qu'Elle partagera mes vœux à cet égard, et qu'Elle approuvera ma détermination. Rendue à la santé, ma fille ira prendre possession de son pays, ce qui la rapprochera tout naturellement du séjour de Votre Majesté. Il serait superflu sans doute que je donnasse à Votre Majesté l'assurance que son fils fera partie de ma famille, et que, pendant son séjour dans mes États, je partagerai les soins que lui voue sa mère. Recevez, Monsieur mon frère, l'assurance de ma considération très distinguée. De Votre Majesté impériale le bon frère et beau-père.—François.»
La franchise n'avait jamais été la qualité maîtresse du Souverain de l'Autriche; sa conduite ultérieure et la suite des événements l'ont surabondamment démontré. Metternich d'ailleurs, son tout-puissant premier Ministre, ne lui aurait pas permis d'adopter, vis-à-vis de Napoléon, une attitude plus en harmonie avec les liens de parenté que le mariage de Marie-Louise avait créés entre le gendre et le beau-père. Mais François, et plus encore Metternich, considéraient Napoléon comme un danger pour l'Europe en général et en particulier pour l'Autriche. La peur qu'il leur inspirait a provoqué la rancune impitoyable avec laquelle ils ont poursuivi l'Empereur des Français et ont fini par consommer sa ruine. Tous les moyens leur étaient bons pour parvenir à ce résultat, même les plus déloyaux et les plus méprisables. L'immoralité des moyens qu'ils ont employés pour atteindre ce but révolterait la conscience d'un simple particulier. L'œuvre de la séduction de Marie-Louise, entreprise par le général Neipperg, armé de tous les pouvoirs et de tous les encouragements du Gouvernement autrichien pour en arriver à ses fins, a quelque chose de plus cynique et de plus odieux, suivant nous, que la chute de l'innocente Marguerite, provoquée par le satanique docteur Faust, dans l'immortel poème de Gœthe.
Avant l'entrevue de Rambouillet Metternich, muni des pleins pouvoirs de son maître, avait déjà sanctionné à Paris, de concert avec les représentants des autres puissances coalisées, la ruine des espérances que la Régente Marie-Louise avait pu conserver pour que les droits de son fils demeurassent sauvegardés, et il écrivait à cette princesse, dont il osait prétendre servir les véritables intérêts, la lettre suivante:
«Madame!
»Messieurs de Bausset et de Sainte-Aulaire m'ont remis les lettres que Votre Majesté impériale a adressées par eux à l'Empereur Son Auguste père. Arrivé ici dans le courant de la journée, je me suis empressé de les expédier à leur haute destination.
»J'aurai l'honneur de fournir demain à Votre Majesté impériale de nouvelles preuves de la sollicitude de l'Empereur pour Elle et son fils. J'ai précédé Sa Majesté impériale ici pour ne pas rester étranger aux arrangements que l'on négocie avec S. M. l'empereur Napoléon. Dès que cet arrangement sera signé, j'aurai l'honneur d'envoyer quelqu'un à Votre Majesté. Je puis toutefois Lui donner d'avance la certitude que l'on réserve à Votre Majesté impériale une existence indépendante qui passera à Son Auguste fils [9].
»Il serait superflu que j'assurasse Votre Majesté que l'Empereur lui voue le plus vif intérêt. Avec quelle satisfaction il la recevrait chez lui! L'arrangement le plus convenable sans doute serait celui qu'Elle se rendît momentanément en Autriche avec Son enfant en attendant qu'Elle ait le choix entre les lieux où se trouve l'empereur Napoléon [10] et son propre établissement. L'Empereur aurait de cette manière le bonheur d'aider de son mieux à sécher les larmes que vous n'avez que trop de motifs de répandre Madame! Votre Majesté serait tranquille pour le moment et libre de sa volonté pour l'avenir [11]. Elle amènerait avec Elle les personnes auxquelles elle voue le plus de confiance. L'Empereur sera ici en deux ou trois jours; ce que je Lui dis sur son voyage en Autriche doit être regardé par Votre Majesté comme entièrement conforme aux intentions paternelles que Lui porte Son Auguste père.
»Je ne puis pas assez supplier Votre Majesté d'être parfaitement tranquille sur sa sûreté et celle de tout ce qui lui appartient. Elle a souvent daigné me vouer de la confiance; qu'Elle ne le fasse pas moins quand, dans l'immense crise du moment, je lui donne une assurance fondée sur la connaissance plénière des choses.
»Agréez l'hommage du profond respect avec lequel je suis, Madame,
»De Votre Majesté impériale,
»Le très humble et très obéissant serviteur.
»Prince DE METTERNICH.
»Paris, le 11 avril 1814.»
Si le mot de Talleyrand qui disait que la parole a été donnée à l'homme pour mieux déguiser sa pensée est souvent malheureusement bien exact, on peut, sans appréhension de tomber dans l'erreur, en faire également l'application aux discours comme aux élucubrations du fameux ministre Metternich. En bernant pendant près d'une année l'infortunée Marie-Louise d'espérances vaines, lui aussi excellait dans l'art de dissimuler sa pensée intime, et de recouvrir une mauvaise foi évidente sous le masque de l'intérêt.
Il est curieux de constater cependant d'après les aveux de Gentz,—âme damnée du premier ministre autrichien,—qu'entre la période de temps comprise entre le 17 février et le 18 mars 1814, Napoléon pouvait encore sauver sa couronne et conserver le trône à sa dynastie. En donnant cette assertion comme absolument fondée, Frédéric de Gentz attribue l'échec des négociations de Châtillon à l'entêtement de Napoléon et à la maladresse de ses plénipotentiaires. L'Empereur n'avait-il pas plutôt raison de l'attribuer à la mauvaise foi de l'Autriche et des alliés? Les mémoires de Mme Durand, que nous aurons encore plusieurs fois l'occasion de citer, se trouvent d'accord avec les affirmations non suspectes de M. de Gentz sur ce point historique.
«L'empereur eut encore, dit la dame du palais, l'occasion de faire une paix sinon glorieuse au moins honorable. Il tint encore une fois, entre les mains, un traité auquel il ne manquait que sa signature. Un succès partiel, qu'il obtint malheureusement en cet instant critique, vint paralyser sa main.»
On trouve également, dans les mémoires du duc de Rovigo [12], la confirmation des appréciations qui précèdent relativement à l'issue des conférences de Châtillon, et une accusation formelle d'impéritie et de maladresse portée par l'ancien Ministre de la police contre le duc de Vicence, négociateur principal du Gouvernement impérial français.
Qui faut-il croire? L'assertion d'un adversaire déclaré tel que Gentz nous paraît cependant d'un grand poids. Quoi qu'il en soit, la mauvaise foi des alliés et en particulier celle de Metternich, âme de la coalition, est, elle aussi, un facteur dont il convient de tenir le plus grand compte. On nous permettra, puisque le nom du chancelier d'Autriche vient d'être encore prononcé, de reproduire ci-dessous le jugement, porté, par un témoin oculaire de ce qui s'est passé en 1814 et en 1815, sur le premier ministre de l'empereur François:
«Jomini [13] prétend que l'oligarchie autrichienne n'a jamais dominé le cabinet de Vienne. Ce n'est vrai que depuis le jour où Metternich est devenu tout-puissant, mais il ne saurait être révoqué en doute que, jusqu'en 1811, une oligarchie souveraine a dirigé les conseils et la politique de ce cabinet. La maison d'Autriche fondée par un simple gentilhomme, qui ne s'est élevée que par des alliances et par le concours de la noblesse, propriétaire des deux tiers des biens territoriaux, a toujours été tenue en tutelle par les grands seigneurs.
»L'empereur François, jusqu'à ce qu'il ait subi l'influence de Metternich, a laissé continuer, par l'indolence et l'incapacité qui lui sont propres, les errements qu'il a trouvés établis. Ce prince a reçu de la nature un esprit de ruse et de finesse, partage des esprits faibles et ignorants. Il est ennemi des lumières et de tout progrès, et cache sous une bonhomie apparente un orgueil excessif; il a une antipathie d'instinct contre toute idée libérale. Ce souverain, rencontrant dans Metternich un esprit qui sympathisait avec le sien, a goûté sa manière de faire et ses agissements, comme si le germe en eût reposé en lui, à son insu, et eût attendu, pour éclore, un homme qui le lui révélât et lui en apprît l'emploi; il s'y est donc fortement attaché. Intrigant politique de premier ordre, Metternich n'eut guère de rival dans les ruses de la diplomatie. Il brillait dans les cercles et avait le talent de s'en rendre l'arbitre par la grâce, l'aisance et les ressources de son esprit. Son tact était merveilleux pour pénétrer les principaux personnages d'une Cour ou d'un Cabinet, capter leur faveur et les faire servir à l'accomplissement de ses desseins. Il mettait une adresse singulière dans le choix de ses instruments, et savait s'entourer d'une troupe de gens dévoués dont il enveloppait, comme d'un filet, les capitales de l'Europe. En Espagne, en Portugal, en Italie, en France, il devint l'ami de l'aristocratie et du haut clergé; en Turquie l'ami du Sultan. Mais où la ruse et l'intrigue demeuraient insuffisantes, là s'arrêtaient sa capacité et son pouvoir. L'événement a prouvé la faiblesse de ses vues et l'égoïsme sans profondeur de ses conceptions. Il a perdu tous ceux auxquels il s'est attaché. Il a même fini par regretter la chute de Napoléon! La politique qu'il a fait adopter à l'Autriche en 1813 est sa condamnation, car le sort de l'Europe était alors dans ses mains. Cette puissance était, à cette époque, l'arbitre de la paix; elle pouvait la dicter également à la Russie et à la Prusse, auxquelles le début de la campagne avait été si défavorable, comme à la France qui lui en aurait su gré. Sous la main haineuse et vénale du ministre autrichien est tombé celui qui avait reconstruit en Europe l'édifice de la haute royauté, raffermi les princes sur leurs trônes, le médiateur puissant entre les peuples et les rois. Metternich, à la remorque de l'Angleterre et de la Russie, leur a vendu l'Europe et l'Autriche. Soutenu par un prince entêté et aveugle, sur le présent comme sur l'avenir, il est devenu le Richelieu de l'Allemagne à la cruauté près. Il a façonné à la corruption la jeune noblesse des premières maisons de la monarchie des Habsbourg, et c'est parmi elles qu'il a choisi ses espions. Des trois cents familles environ qui composaient l'oligarchie autrichienne, cent cinquante, domestiquées par Metternich, rampent présentement à la Cour. Au premier rang de ceux qu'il a dressés à la servitude sont les Liechtenstein, les Schwarzenberg, les Esterhazy, les Lobkowitz, etc.
L'impulsion des esprits vers l'émancipation n'est pas favorable à la résurrection d'une semblable oligarchie, et s'oppose à ce qu'elle ressaisisse son ancienne prépondérance. On peut la considérer maintenant comme détruite.»
Cette digression destinée à mettre en lumière le caractère de l'empereur François, et surtout celui de son célèbre premier ministre, nous a entraîné trop loin de notre sujet; il est temps de revenir à l'impératrice Marie-Louise.
30