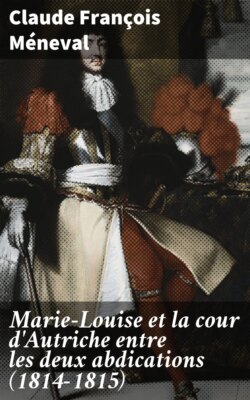Читать книгу Marie-Louise et la cour d'Autriche entre les deux abdications (1814-1815) - Claude Francois Meneval - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE V
ОглавлениеTable des matières
Extraits de correspondances particulières se rapportant à Marie-Louise et rendant compte de sa situation d'esprit.—Mme de Montebello, MM. Corvisart et Caffarelli se séparent de l'Impératrice.—Projet de Marie-Louise d'aller prendre les eaux d'Aix en Savoie. La cour d'Autriche n'y est nullement favorable.—La reine Caroline de Naples, grand'mère de la femme de Napoléon.—Son portrait.—Bons conseils qu'elle donne à Marie-Louise.
La correspondance de mon grand-père avec sa femme, demeurée à Paris avec leurs enfants, se multipliait pendant cette période d'exil. Nous allons y puiser d'assez nombreux extraits qui jetteront quelque lumière sur la situation d'esprit de Marie-Louise et sur son caractère. Dans trois ou quatre lettres qui s'échelonnent du 25 au 31 mai les observations qui la concernent sont nombreuses. Mon grand-père s'y inquiète de ce qu'il appelle à plusieurs reprises sa facilité, ce qui veut dire, probablement, un excès de générosité et de crédulité. Il trouve que l'Impératrice se laisse trop aisément duper par des intrigants envers lesquels elle prend des engagements qu'elle doit être, par la suite, dans l'impossibilité de remplir et il ajoute qu'elle s'en cache de peur qu'on ne cherche à s'opposer à ces actes de munificence, en lui démontrant l'indignité de ceux qui en bénéficient. Il déplore l'éloignement obstiné de Marie-Louise pour tout ce qui est affaire: «Penser à ses intérêts, estime-t-elle, c'est manquer de noblesse; ne pas accueillir les aventuriers qui s'efforcent de s'attacher à elle: c'est manque de générosité.» Malgré le rôle ingrat qu'il croyait de son devoir d'assumer, mon grand-père ne réussit guère, paraît-il, à prémunir sa souveraine contre une façon de penser qu'elle considérait comme louable, et contre des tendances généreuses qui, par leur exagération même, n'étaient susceptibles de produire que des résultats déplorables. Une autre fois c'est à son aveuglement sur ce qui constitue son seul et véritable intérêt qu'il s'en prend, blâmant dans Marie-Louise une fatale disposition à écarter, de ses préoccupations, l'avenir comme une idée importune. Jugeant compromis l'avenir d'une princesse si peu sérieuse, mon grand-père en demeurait profondément affecté, regrettant le sacrifice inutile qu'il avait fait en s'attachant à ses pas. Mais bientôt après il se ressaisit et termine sa lettre par ces mots: «L'Impératrice est touchée de mon attachement. Elle me l'a dit les larmes aux yeux. Je ne la quitterai qu'à la dernière extrémité.»
Une autre des lettres de cette correspondance mérite d'être citée tout entière. Elle porte la date du 31 mai 1814:
De Schönbrunn: «Je n'augure rien de bon de ce qui va se passer ici pendant le mois de juin. Si ce n'était au reste le véritable attachement que je porte à l'Impératrice, cela me serait fort indifférent. Car, pour ce qu'on appelle intérêts, ils ne peuvent pas être plus nuls. Tu sais d'ailleurs que ce n'est pas dans cette vue que je l'ai suivie; je n'ai écouté que mon cœur, et n'ai jamais calculé ce qui fait le but de toutes les ambitions. Je ne m'en repentirai jamais, quoi qu'il puisse arriver, parce que ma conscience me suffit. On dit hautement ici que Sa Majesté est trop jeune pour la laisser se conduire elle-même. Il est probable qu'on m'attribue une partie de l'honneur de la conseiller; mais ce qui lui nuit le plus c'est la légèreté qu'elle a eue de confier ses affaires pécuniaires et les choses d'honneur à Bausset qui, malheureusement, jouit d'une assez mauvaise réputation, qui est bien connue ici, et qui rejaillit sur nous. Ajoute à cela la prochaine arrivée de M. de Cussy que bien tu connais, et tu peux juger si ce n'est pas beaucoup plus qu'il n'en faut pour nous perdre. En vérité tout cela me touche aux larmes, et je suis malheureux d'aimer si tendrement une princesse, digne à tant d'égards du plus profond dévouement.»
Quand Mme Durand, le respectable auteur des Mémoires dont nous avons plus d'une fois eu occasion d'invoquer le témoignage, parle des perfides conseillers de l'impératrice Marie-Louise et de son mauvais entourage, on peut à présent constater qu'elle donne une note juste, et qu'elle a fait preuve non seulement de perspicacité, mais surtout de véracité.
Le 30 mai 1814, jour de la signature à Paris du traité de paix entre la France et les Puissances alliées, le Journal de mon grand-père relate que l'impératrice Marie-Louise, après avoir été rendre visite à sa grand-mère la reine de Naples à l'occasion de la Saint-Ferdinand, patron du roi son mari, se rendit ensuite chez l'impératrice d'Autriche.
Marie-Louise était accompagnée paraît-il de la duchesse de Montebello, de MM. de Bausset et de Saint-Aignan. Mais il arriva que la femme de l'empereur François étant à table, sa belle-fille seule put être introduite auprès de Sa Majesté, et que Mme de Montebello et ces deux messieurs, abandonnés dans une office, furent laissés irrévérencieusement au milieu des domestiques qui servaient le dîner!
Le lendemain, 31 mai, l'impératrice Marie-Louise vit partir avec douleur sa très chère dame d'honneur et amie, la duchesse de Montebello, rentrant en France avec son inséparable docteur Corvisart et M. de Saint-Aignan. Cette séparation fut extrêmement pénible, pour l'impératrice surtout. Le 1er juin, à 10 heures du soir, le brave et loyal général Caffarelli prenait à son tour congé de Marie-Louise, et partait le lendemain à 7 heures du matin. Il avait donné à l'Impératrice, en arrivant à Schönbrunn, les meilleurs conseils sur la ligne de conduite que ses véritables amis auraient voulu lui voir adopter. Elle ne les suivit malheureusement pas, mais elle demeura sincèrement affligée du départ de ce brave officier. On apprit à Vienne, ce même jour, que l'empereur d'Autriche avait dû quitter Paris pour revenir dans sa capitale; les souverains de Russie et de Prusse partaient en même temps pour Londres. Le 6 et le 7 juin, le Journal de mon grand-père signale que Marie-Louise écrit et envoie des lettres en se servant, pour leur transmission, du courrier de la reine de Naples sa grand'mère. Elle avait eu à dîner le 6 juin le prince de Ligne et le prince Clary.
A cette époque on remettait encore à Marie-Louise, sans les ouvrir, les lettres de l'empereur Napoléon, car l'infatigable Journal rapporte qu'elle reçut le 14 juin une lettre de son époux, datée du 9 mai: «Cette lettre était dans son paquet mêlée avec d'autres lettres et des journaux.» Cette lettre, comme toutes celles que Napoléon écrivait à Marie-Louise, devait probablement rappeler à celle-ci la convenance de venir retrouver son mari à l'île d'Elbe ou tout au moins d'aller faire une saison d'eaux en Toscane pour se rapprocher de lui, au lieu de se rendre à Aix comme sa fantaisie le lui conseillait et comme Corvisart l'avait obstinément prescrit. De son côté la cour d'Autriche voyait déjà, d'un œil méfiant, la fugue projetée de Marie-Louise vers les montagnes de la Savoie, et faisait toutes sortes d'objections pour la dissuader de l'entreprendre. Le cabinet de Vienne redoutait que, placée si loin de sa surveillance, Marie-Louise ne lui échappât et ne revînt plus à Schönbrunn. C'est alors que Metternich songea sérieusement à choisir un mentor pour diriger les volontés de la fille de son maître, et lui imposer sa tutelle. L'empereur d'Autriche, de complicité avec son premier ministre, avait d'abord jeté les yeux sur le prince Nicolas Esterhazy, seigneur de la Cour infiniment respectable, mais Metternich le jugea trop âgé pour acquérir, sur l'esprit de Marie-Louise, le genre d'influence qui lui paraissait désirable... et ce fut ainsi que son choix finit par se fixer sur le général Neipperg. Il avait sondé ce dernier, et lui avait reconnu toutes les qualités nécessaires pour jouer, à l'entière satisfaction du gouvernement autrichien, un rôle utile auprès de la femme de l'empereur détrôné. Le principal ministre de l'empereur François était secondé, dans ce plan de corruption déloyal, par l'impératrice d'Autriche dont les vues s'accordaient avec les siennes, et qui affichait la prétention de diriger l'esprit et les actions de sa belle-fille. La belle-mère de Marie-Louise avait toujours été et restait effectivement l'adversaire irréductible de l'Empereur Napoléon.
Plus compatissante et plus équitable pour le mari de sa petite-fille se montrait la vieille reine Marie-Caroline de Naples [23], sœur comme on le sait de la femme de Louis XVI. A travers mille dangers cette reine, réussissant à tromper la surveillance des Anglais, avait trouvé le moyen de s'échapper de Sicile et d'arriver à Vienne en passant par Constantinople. Elle était venue en Autriche pour intéresser au sort de son mari, le roi Ferdinand, son gendre l'empereur François II. Elle voulait obtenir, à tout prix, à l'aide des armées de ce prince, l'expulsion du roi Murat et la restitution intégrale du royaume de Naples à ses légitimes possesseurs. Cette énergique princesse était résolue—dit mon grand-père—à voir chaque souverain en particulier et à ne pas lâcher prise qu'elle n'eût atteint le but qu'elle poursuivait: la chute du roi Joachim. Son caractère entreprenant et sa ténacité donnaient quelque inquiétude au gouvernement autrichien, dont elle accusait de son côté l'égoïsme.
«Cette reine qui dans les temps de prospérité de l'empereur Napoléon—ajoute mon grand-père—avait été son ennemie déclarée, et dont l'opinion ne pouvait être suspecte de partialité, professait une haute estime pour ses grandes qualités. Apprenant que je lui avais été attaché en qualité de secrétaire, elle me rechercha pour me parler de lui. Elle me disait qu'elle avait eu autrefois à s'en plaindre; qu'il l'avait persécutée et blessée dans son amour-propre (car j'avais alors quinze ans de moins, observait-elle); mais qu'aujourd'hui qu'il était malheureux, elle oubliait tout. Elle ne pouvait retenir son indignation devant les manœuvres employées pour arracher sa petite-fille à des liens qui faisaient sa gloire, et pour priver l'Empereur de la plus douce consolation qu'il pût recevoir, après les immenses sacrifices arrachés à son orgueil. Elle ajoutait que si l'on s'opposait à leur réunion, il fallait que Marie-Louise attachât les draps de son lit à sa fenêtre et s'échappât sous un déguisement: Voilà, répétait-elle, ce que je ferais à sa place; car quand on est mariée, c'est pour la vie! Un tel acte de hardiesse, qui souriait à l'esprit entreprenant de la vieille reine, n'était pas dans la mesure du caractère de Marie-Louise, ni dans ses idées de décorum.»
Continuons d'emprunter au livre de M. de Bausset quelques détails complémentaires relatifs à Marie-Caroline de Naples:
«Cette princesse, dit-il [24], était d'une taille au-dessous de la moyenne, avait une démarche sans dignité, mais sa physionomie était vive et spirituelle: ses traits étaient assez réguliers, ses yeux petits, son sourire gracieux; sa voix était dure et son teint sans couleur; la seule chose que l'on pouvait remarquer en elle était l'extrême blancheur et la beauté de ses bras. Elle avait alors 63 ans, et il était facile de juger que, dans sa jeunesse, elle avait dû être jolie, moins pourtant que ne l'était sa sœur, Marie-Antoinette de France.
»Les événements du mois d'avril en France venaient de ramener Marie-Louise dans le sein de sa famille paternelle; la grand'mère et la petite-fille s'y trouvaient dans une situation assez analogue. Cette conformité, dont les causes seules différaient, donna peut-être plus de charme à leur affection que les liens du sang qui les unissaient, et qui, d'ordinaire, sont comptés pour peu de chose dans des rangs aussi élevés. La reine Caroline venait redemander une couronne que des traités récents conservaient à Joachim. Marie-Louise avait été obligée de déposer la sienne. Plus vive, plus ardente, la reine de Sicile paraissait irritée des refus qui lui étaient faits. Je ne sais s'il faut l'attribuer à l'humeur qu'elle éprouvait contre la diplomatie circonspecte du Cabinet de Vienne, ou bien seulement à la politesse naturelle ou aux égards qu'elle croyait devoir à celle qui venait d'être la victime innocente d'une convulsion politique encore plus éclatante que celle dont elle se plaignait... Toujours est-il certain qu'elle eut assez de grandeur d'âme pour savoir apprécier et estimer la fidélité et le dévouement des personnes qui avaient suivi la destinée de sa petite-fille; elle ne parlait même de Napoléon qu'avec la noble franchise d'une ennemie à la vérité, mais d'une ennemie qui ne fermait point les yeux sur les grandes qualités de ce prince. Assurée par tout ce que lui disait l'Impératrice, que jamais Napoléon n'avait cessé d'avoir pour elle les meilleurs procédés, et qu'elle avait été comblée de soins et d'égards les plus touchants, la reine de Sicile l'engagea à se parer du portrait de Napoléon, qu'une réserve timide avait relégué au fond d'un écrin, et elle ne cessa de combler des plus grandes caresses le jeune Napoléon, le fils de son ennemi. Il y avait, dans cette conduite autant d'esprit que de délicatesse. Cette manière d'être et de l'exprimer ne se démentit pas un instant.»
Il faut convenir que la grand'mère de Marie-Louise lui donnait des conseils plus nobles et plus élevés que ceux que M. de Bausset, qui en fait l'éloge, est accusé d'avoir donnés à la femme de Napoléon!...