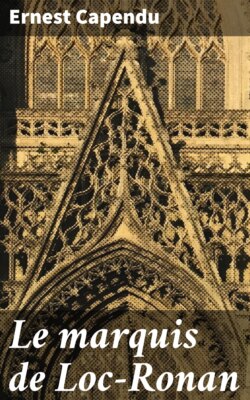Читать книгу Le marquis de Loc-Ronan - Ernest Capendu - Страница 15
LA CONFÉRENCE
ОглавлениеKeinec et son guide traversèrent le placis, et pénétrèrent dans le réduit qui servait d'habitation au chef. Un paysan en gardait l'entrée.
—Attends! fit Fleur-de-Chêne en laissant Keinec sur le seuil, et en disparaissant dans l'intérieur.
Mieux disposée que les autres, la cabane était divisée en deux compartiments. Fleur-de-Chêne reparut promptement dans le premier.
—Faut-il entrer? demanda Keinec.
—Pas encore; dans quelques minutes on t'appellera.
Keinec s'appuya contre le tronc d'un arbre voisin. On entendait confusément un bruit de voix animées s'échapper de l'intérieur.
La demeure du chef n'était pas mieux meublée que celle des soldats. Dans la première pièce, un banc de bois et une petite table. Dans la seconde, celle-ci était la chambre à coucher, une paillasse de fougère étendue dans un angle. Cinq ou six chaises et une vaste table en chêne composaient le reste de l'ameublement. Cinq hommes étaient assis autour de la table sur laquelle était étendue une carte détaillée de la Vendée et de la Bretagne. Quatre d'entre eux portaient un costume à peu près semblable, un peu plus élégant que celui des paysans, mais fort délabré par les fatigues de la guerre et par le séjour dans les bois. Le cinquième seul semblait très soigné dans sa mise. Il portait des bottes molles, une veste brodée, une culotte de peau et un habit de velours cramoisi. Un panache vert s'épanouissait sur son chapeau, et il tenait à la main un mouchoir de fine batiste. Le premier, celui qui tenait le haut bout de la table, était M. de Boishardy. Le second était M. de Cormatin. Le troisième, M. de Chantereau. Le quatrième, l'homme au panache et au mouchoir, était le marquis de Jausset, récemment arrivé de l'émigration, et qui n'avait encore pris aucune part aux affaires actives. Il était envoyé par le comte de Provence. Enfin, en dernier venait Marcof, dont l'œil intelligent échangeait souvent avec celui de Boishardy de nombreux signes qui échappaient à leurs interlocuteurs.
La conférence touchait à son terme. MM. de Cormatin et de Chantereau venaient de se lever. Boishardy leur remit à chacun une feuille de papier sur laquelle se lisaient des caractères d'impression.
—N'oubliez pas, leur dit-il, de faire placarder ce décret partout, c'est un puissant auxiliaire pour notre cause.
—Quel décret, mon très cher? demanda le marquis d'une voix grêle et avec un accent traînard qui contrastait étrangement avec la voix rude et le ton ferme et impératif de Boishardy.
—Le décret de la Convention, dont je vous parlais tout à l'heure.
—Vous plairait-il de le relire?
—Volontiers.
Boishardy ouvrit l'une des feuilles.
—Décret du 31 juillet 1793, dit-il.
—Mais, interrompit Marcof, si ce décret a quatre mois de date, il doit être connu de tous.
—Non pas, capitaine. Ce décret porte la date du 31 juillet, mais il paraît qu'il est resté longtemps en carton à Paris, car il n'est arrivé ici et n'a été placardé qu'il y a quinze jours.
—Continuez alors.
Boishardy reprit:
—Je vous fais grâce des considérants, messieurs. Il y en a deux pages, dans lesquels ces bandits assassins de la Convention nous traitent de brigands, d'aristocrates; j'en arrive aux arrêtés, les voici:
Arrêtons et décrétons ce qui suit:
«1º Tous les bois, taillis et genêts de la Vendée et de la Bretagne seront livrés aux flammes;
«2º Les forêts seront rasées;
«3º Les récoltes coupées et portées sur les derrières de l'armée;
«4º Les bestiaux saisis;
«5º Les femmes et les enfants enlevés et conduits dans l'intérieur;
«6º Les biens des royalistes confisqués pour indemniser les patriotes réfugiés;
«7º Au premier coup du tocsin, tous les hommes, sans distinction, depuis seize ans jusqu'à soixante, devront prendre les armes dans les districts limitrophes, sous peine d'être déclarés traîtres à la patrie et traités comme tels par tous les bons patriotes.»
Boishardy jeta le papier sur la table.
—Qu'en pensez-vous, messieurs? demanda-t-il; la Convention pouvait-elle mieux agir, et nos gars, en lisant ou en écoutant les termes de ces articles, ne se défendront-ils pas jusqu'à la mort?
—Sans doute! répondit Cormatin.
—Permettez, fit le marquis en s'éventant gracieusement avec son mouchoir. Tout cela est bel et bon, mais ce n'est pas suffisant. Il faut écraser la République et remettre sur le trône nos princes légitimes.
—C'est ce à quoi nous tâchons, monsieur, dit Chantereau.
—Et vous n'y parviendrez qu'en suivant une autre marche.
—Laquelle? demanda Boishardy en souriant ironiquement.
—Il faut d'abord élire des chefs.
—Nous en avons.
—Mais j'entends par chefs des hommes de naissance.
—Douteriez-vous de la mienne?
—Dieu m'en garde, monsieur de Boishardy! Seulement, vous reconnaîtrez qu'il y a en France des noms au-dessus du vôtre.
—Où sont-ils, ceux-là?
—A l'étranger.
—Eh bien, qu'ils y restent!
—Sans eux vous ne ferez rien de bon, cependant.
—Qu'ils viennent, alors! s'écria Marcof en frappant sur la table.
—Ils viendront, messieurs, ils viendront!
—Quand il n'y aura plus rien à faire, n'est-ce pas, monsieur le marquis?
—Vous prenez d'étranges libertés, mon cher.
—Marcof a raison, interrompit Boishardy. Nous commençons à être fatigués de cette émigration qui ne fait rien, qui parle sans cesse, et qui, lorsque nous aurons prodigué notre sang pour rétablir la monarchie, viendra, sans nous honorer d'un regard, reprendre les places qu'elle dira lui appartenir! Morbleu! qu'elle les garde donc ces places, ou tout au moins qu'elle les défende! Pourquoi a-t-elle pris la fuite, cette émigration qui doit tout abattre? Est-ce le devoir d'un gentilhomme d'abandonner son roi lorsque le danger menace? Répondez, monsieur le marquis! Vous prétendez que les émigrés veulent venir en Bretagne. Qui les en empêche? qui s'oppose à leur venue parmi nous? qui les retient de l'autre côté du Rhin, où il n'y a rien à faire? Pourquoi ces retards? Est-ce d'aujourd'hui, d'ailleurs, qu'ils devraient songer à combattre dans nos rangs et à donner leur sang comme nous avons donné le nôtre? Leur place n'est-elle pas auprès de nous? Encore une fois, monsieur, répondez!
Boishardy s'arrêta. Cormatin et Chantereau approuvaient tacitement. Marcof reprit la parole sans laisser le temps au marquis d'articuler un mot.
—Quand monsieur de Jausset a parlé d'hommes de naissance pour commander, dit-il, il a dirigé ses regards vers moi.
—Après?... fit dédaigneusement le marquis.
—Je lui demanderai donc ce qu'il avait l'intention de dire.
—C'est fort simple. Il y a ici une confusion de rangs incroyable, vous avez obéi à un Cathelineau. Vous avez pour chefs des gens nés pour pourrir dans les grades inférieurs.
—Comme moi, n'est-ce pas?
—Comme vous, mon cher.
Marcof pâlit. Boishardy voulut s'interposer, le marin l'arrêta.
—Ne craignez rien, dit-il; je traite les hommes suivant leur valeur, et je ne me fâche que contre les gens qui en valent la peine.
Puis, se tournant vers le marquis:
—Monsieur, continua-t-il, vos amis de Gand et de Coblentz nous considèrent, nous, les vrais défenseurs du trône, comme des laquais qui gardent leurs places au spectacle. Si vous leur écrivez, rappelez-leur ce que je vais vous dire; et, si vous ne leur écrivez pas, faites-en votre profit vous-même.
—Qu'est-ce donc, je vous prie?
—C'est que, n'ayant rien fait, ils n'ont droit à rien, et qu'ils ne pourront être désormais quelque chose qu'avec notre permission et notre volonté.
—Très bien! dirent les autres chefs.
—Et quant à vous, monsieur, vous n'aurez le droit de parler ici, devant ces messieurs, devant moi, que quand vous aurez accompli seulement la moitié de ce que chacun de nous a fait. Je ne vous en demande que la moitié, attendu que je vous crois incapable d'en essayer davantage.
—Et moi, répondit le marquis, je vous préviens qu'à partir de ce jour vous n'êtes qu'un simple soldat.
—En vertu de quoi?
—En vertu de ceci.
Et le gentilhomme posa un papier plié sur la table.
—Qu'est-ce que cela? demanda Boishardy.
—Une commission de monseigneur le régent du royaume, Son Altesse Royale le comte de Provence.
—Un brevet de maréchal de camp, fit Boishardy en lisant froidement le papier et en le rendant au marquis.
—Vous comprenez?
—Je comprends que ce grade vous sera accordé quand nous aurons vu si vous en êtes digne.
—En doutez-vous?
—Certainement.
—Vous m'insultez! s'écria le marquis en portant la main à la garde de son épée.
—Il ne peut y avoir de duel ici, répondit Boishardy avec dédain.
—Pardon! je croyais être entre gentilshommes. Mais répondez nettement. Refusez-vous oui, ou non, de m'obéir?
—Oui, mille fois oui!
—Je me plaindrai; j'en appellerai aux royalistes.
—Faites.
—On vous retirera vos troupes, monsieur de Boishardy.
—Si vous demandez cela, priez Dieu de ne pas réussir, monsieur le marquis de Jausset.
—Et pourquoi?
—Parce que, s'écria Boishardy avec véhémence, je vous ferais fusiller avec votre brevet sur la poitrine.
—Vous oseriez?
—N'en doutez pas.
—Et M. de Boishardy a parfaitement raison, ajouta Cormatin. Jusqu'ici, monsieur le marquis, nous nous sommes passés de l'émigration, et nous saurons nous en passer encore. Je vous engage à retourner à Gand: c'est là qu'est votre place. Mais gardez-vous de pareilles rodomontades devant d'autres chefs. Tous n'auraient pas la patience de mon ami, et, tout gentilhomme que vous êtes, vous pourriez bien être accroché à une branche de chêne.
—Messieurs! messieurs! s'écria le marquis blême de colère, il faut que l'un de vous me rende raison de tant d'insolence!
—Assez! fit Boishardy.
Il appela Fleur-de-Chêne en entr'ouvrant la porte. Le paysan accourut.
—Tu vas prendre dix hommes avec toi et escorter monsieur, continua-t-il en désignant le marquis. Tu le mèneras à La Roche-Bernard, et là monsieur s'embarquera pour aller où bon lui semblera.
Le marquis se leva brusquement et sortit sans dire un mot.
—Tonnerre! s'écria Marcof, on ose nous envoyer de pareils hommes avec des brevets dans leur poche.
—Les émigrés sont fous, dit Chantereau.
—Pis que cela, répondit Boishardy, ils sont ridicules! Mais oublions cette scène et reprenons notre conversation au moment où cet imbécile empanaché est venu nous interrompre. Vous, Cormatin, quelles nouvelles de la Vendée?
—Mauvaises, répondit le chouan en s'avançant. Depuis la bataille de Cholet, Charette s'est tenu isolé dans l'île de Noirmoutier, dont il a fait son quartier général. Il y a quelques jours seulement, il apparut dans la haute Vendée pour y recruter des hommes. Un conseil tenu aux Herbiers l'a confirmé dans son commandement en chef.
—Mais, dit Boishardy, n'a-t-il pas vu La Rochejacquelein? Celui-ci est passé ici se rendant en Vendée cependant; et, depuis, je n'en ai pas eu de nouvelles.
—Si; ils se sont vus à Maulevrier.
—L'entrevue a été mauvaise. Ils ne s'aiment pas.
—Oh! s'écria Marcof; toujours la même chose donc; ici comme parmi les bleus! Quoi! Charette et La Rochejacquelein ne réunissent pas leurs forces? Ils font passer l'intérêt personnel avant le salut de la royauté, les causes particulières avant la cause commune? De stupides rancunes, de sots orgueils l'emportent sur le bien de la patrie?
—La Rochejacquelein a repassé la Loire, continua Cormatin.
—Et, ajouta Chantereau, il marche sur le Mans.
—Où il trouvera Marceau, Kléber et Canuel avec des forces triples des siennes! dit Marcof. Enfin, espérons en Dieu, messieurs.
—Et attendons ici les résultats de cette marche nouvelle, ajouta Boishardy. La Rochejacquelein m'a ordonné de garder à tout prix ce placis, qui renferme d'abondantes munitions et offre une retraite sûre en cas de revers. Vous, Cormatin, et vous Chantereau, regagnez vos campements et tenez-vous, prêts à agir et à vous replier sur moi au premier signal. Adieu, messieurs! fidèles toujours et quand même, c'est notre devise. Que personne ne l'oublie!
Les deux chefs prirent congé et s'éloignèrent. Marcof et Boishardy demeurèrent seuls. Il y eut entre eux un court instant de silence. Puis, Boishardy s'approchant vivement du marin:
—Vous avez donc été à Nantes? dit-il.
—Oui, répondit Marcof.
—Si vous aviez été reconnu?
—Eh! il fallait bien que j'y allasse, aurais-je dû affronter des dangers mille fois plus terribles et plus effrayants.
—Vous vouliez tenter de revoir Philippe, n'est-ce pas?
—Oui.
—Avez-vous réussi?
—Malheureusement non.
—Ainsi, il est toujours dans les prisons?
—Toujours.
—Et cet infâme Carrier continue à mettre en pratique son système d'extermination?
—Plus que jamais.
—Philippe est perdu, alors?
—Perdu, si je ne parviens à le sauver avant huit jours.
—Le sauver! Est-ce possible?
—Je n'en sais rien.
—Mais vous le tenterez?
—Je partirai pour Nantes demain même.
—C'est une folie! C'est tenter le ciel par trop d'imprudence.
—Folie ou non, je le ferai. Je sauverai le marquis de Loc-Ronan, ou nous mourrons ensemble.
—Quels sont vos projets?
—Tuer Carrier, répondit Marcof sans la moindre hésitation.
—Mais vous ne parviendrez jamais jusqu'à lui!
—Peut-être.
Boishardy se promena avec agitation dans la chambre, puis revenant se poser en face de Marcof:
—Vous partez demain? dit-il.
—Oui.
—Vous pensez qu'avant huit jours d'ici vous aurez sauvé Philippe?
—Ou que nous serons morts tous deux.
—Bien!
—Vous m'approuvez, n'est-ce pas?
—Je fais mieux.
—Comment cela? dit Marcof étonné.
—Je vous aide.
—Je n'ai pas besoin de monde; j'ai laissé mes hommes à bord de mon lougre.
—Non; mais vous avez besoin d'un bras et d'un cœur dévoués qui vous secondent et agissent comme un autre vous-même si, par malheur, vous succombiez.
—Oui, c'est vrai.
—Avez-vous choisi quelqu'un?
—Personne encore.
—Alors ne choisissez pas!
—Pourquoi?
—Parce que j'irai avec vous.
—Vous, Boishardy?
—Moi-même.
—Mais....
—Ne voulez-vous pas de moi pour compagnon?
—Si fait! tonnerre! à nous deux nous le sauverons.
Et Marcof, prenant Boishardy dans ses bras nerveux, le pressa sur sa poitrine, tandis que des larmes de reconnaissance glissaient sous ses paupières.