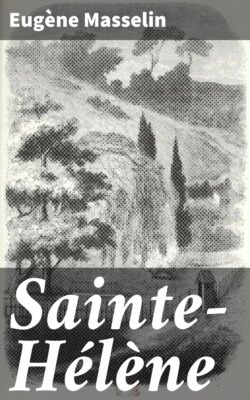Читать книгу Sainte-Hélène - Eugène Masselin - Страница 6
CHAPITRE DEUXIÈME.
ОглавлениеSOMMAIRE.
Débarquement. — Premier gîte de l’Empereur à Sainte-Hélène. — Renseignements géographiques. — Disposition générale des crêtes et des vallées. — Aiguille aimantée. — Température. — Vents, orages et tremblements de terre. — Ressac et ras de marée.
Cependant le service de la santé a autorisé la libre communication du paquebot avec la terre. On descend d’abord dans un canot, et un instant après on se trouve devant un escalier sur lequel on a toutes les peines du monde à prendre pied, à cause d’un ressac permanent qui ballotte sans cesse les embarcations le long de la jetée. Si l’on n’a pas tant soit peu le pied marin, on est obligé de s’y reprendre à plusieurs fois, et de s’aider encore de la main que peut vous tendre un assistant charitable.
Les degrés conduisent à une chaussée de largeur inégale, en partie entaillée dans le roc, et en partie prise sur la mer, qui fut commencée en 1789 et agrandie en 1822, puis en 1852 et en 1860; on n’y trouve que quelques magasins sans importance, un dépôt de charbons, une aiguade. Au bout de 150 mètres environ on se trouve resserré entre un fossé de rempart et une courte plage sur laquelle la mer vient se briser en grondant. Un pont-levis conduit par-dessus le fossé à un long terre-plein, orné d’une profusion de bouches à feu de tout calibre et de toutes sortes de projectiles. Une sentinelle complète cet appareil de guerre, qui repose en paix depuis des années, et qui n’aura jamais sans doute à déployer ses fureurs. Il n’y a plus qu’une voûté à franchir, et l’on se trouve sur une place carrée, dont l’aspect satisfait la vue. A droite on a d’abord deux ou trois maisons, puis l’église, dont on connaît déjà le clocher; à gauche quelques constructions basses et des arbres, puis un jardin, et à la suite la maison dans laquelle l’Empereur passa la première nuit qui suivit son arrivée, du 18 au 19 octobre 1815; en face, une rue large et propre: on est dans James-Town.
La position géographique de Sainte-Hélène est donnée dans l’Annuaire du Bureau des longitudes par la longitude et la latitude de l’observatoire de Ladder-Hill; ces données sont: latitude 15° 55′ sud, et longitude 8° 3′ 13″.
On compte de Sainte-Hélène à la côte d’Afrique 190 myriamètres.
De Sainte-Hélène à la côte d’Amérique, 290 myriamètres.
De Sainte-Hélène à l’Ascension, 96 myriamètres.
La plus grande longueur de l’île est dirigée de l’est à l’ouest; elle est d’un peu moins de 17 kilomètres; sa plus grande largeur est de 11 kilomètres environ. Le périmètre approché est de 45 kilomètres.
Le dessin ci-après indique les points les plus élevés de l’île et les crêtes qui les réunissent. On a ainsi la distribution des différents bassins de l’île. On peut constater l’existence de deux points culminants, reliés à quelques pitons inférieurs par des crêtes généralement étroites, qui finissent toutes par tomber brusquement dans la mer.
Les vallées sont toutes profondes et d’un parcours difficile dans le sens de leur longueur. Elles présentent souvent des ressauts brusques formant des cascades, dont la principale offre une chute d’environ trente mètres; elle est située près de l’habitation de Briars, où Napoléon vint s’établir le lendemain de son débarquement, et où il passa environ trois semaines en attendant que Longwood fût prêt à le recevoir. Les vallées restent étroites jusqu’à la mer: celle de James-Town est la plus large, et elle n’a encore que cent vingt mètres vers son extrémité.
La déclinaison de l’aiguille aimantée était de 24° 20′ en 1860.
La température de Sainte-Hélène reste toujours comprise entre des limites assez rapprochées. Des observations faites tous les jours à Longwood pendant cinq ans ont donné une température moyenne de 16°, 33. On a eu une fois dans cet espace de temps un minimum de 11°, 10, et une fois un maximum de 25°, 33. On restait habituellement entre 16°, 70 et 22°, 20.
A James-Town, qui est le point le plus chaud de l’île, on a une différence presque constante de 5° avec celle de Longwood. Le mois d’octobre est en général le plus froid et mars le plus chaud.
Le vent de sud-est souffle continuellement sur l’île avec de très-faibles écarts vers le sud et vers l’est; son intensité est généralement assez grande; aussi ses effets sont-ils très-sensibles sur les points qui sont exposés en première ligne à son influence, comme, par exemple, Longwood. De temps en temps, mais à d’assez grands intervalles, le vent passe au nord-ouest par le nord-est, mais il ne souffle de cette partie-là que pendant un petit nombre d’heures, et une pluie vient alors ramener le vent au sud-est. Les calmes complets sont fort rares et durent fort peu. En revanche, les tempêtes autour de Sainte-Hélène sont à peu près inconnues, et sur l’île elle-même il n’y a pas d’orages; on n’y voit presque pas d’éclairs; on n’en a pas aperçu un seul pendant l’été de 1859-60, qui a été un des plus chauds et des plus secs de ces dernières années.
On cite un tremblement de terre à Sainte-Hélène le 15 juin 1756, un second en 1780, un troisième le 21 septembre 1817. On a conservé le souvenir d’une trombe qui a éclaté sur l’île en 1719 et occasionné de grands ravages.
Le ressac qui se fait sentir d’une manière continue devant la jetée de James-Town n’atteint jamais une violence dangereuse; mais on n’a pas oublié dans l’île l’impression produite les 16 et 17 février 1846 par un ras de marée qui est venu ravager les travaux de défense de la baie et la jetée, et couler à fond en même temps plusieurs navires qui se trouvaient sur rade, ainsi qu’un bon nombre de petites embarcations appartenant à des pêcheurs ou à des bateliers.