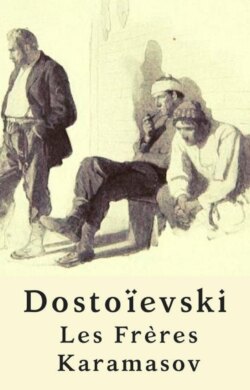Читать книгу Les Frères Karamazov (Édition Intégrale) - Fedor Dostoievski - Страница 35
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Confession d’un cœur ardent. En vers
ОглавлениеEn entendant l’ordre que lui criait son père de la calèche, à son départ du monastère, Aliocha demeura quelque temps immobile et fort perplexe. Enfin, surmontant son trouble, il se rendit aussitôt à la cuisine du Père Abbé, pour tâcher d’apprendre ce qu’avait fait Fiodor Pavlovitch. Puis il se mit en route, espérant résoudre en chemin un problème qui le tourmentait. Disons-le tout de suite : les cris de son père et l’ordre de déménager « avec oreiller et matelas » ne lui inspiraient aucune crainte. Il comprenait parfaitement que cet ordre, crié en gesticulant, avait été donné « par emballement », pour ainsi dire, et même pour la galerie. C’est ainsi que, quelque temps auparavant, un de nos citadins, ayant trop fêté son anniversaire, et furieux de ce qu’on ne lui donnait plus de vodka, s’était mis, devant ses invités, à casser sa propre vaisselle, à déchirer ses vêtements et ceux de sa femme, à briser les meubles et les carreaux – tout cela pour la galerie –, puis le lendemain, une fois dégrisé, avait amèrement regretté les tasses et les assiettes cassées. Aliocha savait que son père le laisserait sûrement retourner au monastère, peut-être dès le jour même. De plus, il était convaincu que le bonhomme ne voudrait jamais l’offenser, que jamais personne au monde, non seulement ne le voudrait, mais ne le pourrait. C’était pour lui un axiome, admis une fois pour toutes, et au sujet duquel il n’avait pas le moindre doute.
Mais à ce moment, une crainte d’un tout autre ordre l’agitait, d’autant plus pénible que lui-même n’eût pu la définir, la crainte d’une femme, de cette Catherine Ivanovna, qui insistait tant, dans sa lettre remise le matin par Mme Khokhlakov, pour qu’il vînt la voir. Cette demande et la nécessité d’y obtempérer lui causaient une impression douloureuse qui, tout l’après-midi, ne fit que s’aggraver, malgré les scènes et les aventures qui s’étaient déroulées au monastère, etc. Sa crainte ne provenait pas de ce qu’il ignorait ce qu’elle pouvait bien lui vouloir. Ce n’était pas non plus la femme en général qu’il redoutait en elle ; certes, il connaissait peu les femmes, mais n’avait pourtant vécu qu’avec elles depuis sa tendre enfance jusqu’à son arrivée au monastère. Mais, dès leur première entrevue, il avait éprouvé précisément pour cette femme-là, une sorte d’épouvante. Il l’avait rencontrée deux ou trois fois au plus, et n’avait échangé que quelques mots avec elle. Il se la rappelait comme une belle jeune fille, fière et impérieuse. Ce n’était pas sa beauté qui le tourmentait, mais quelque chose d’autre, et son impuissance à expliquer la peur qu’elle lui inspirait augmentait cette peur. Le but que poursuivait la jeune fille était à coup sûr des plus nobles : elle s’efforçait de sauver Dmitri coupable envers elle, et cela par pure générosité. Néanmoins, malgré son admiration pour ces nobles sentiments, un frisson le parcourait à mesure qu’il approchait de chez elle.
Il s’avisa qu’il ne trouverait pas en sa compagnie Ivan, son intime, alors retenu certainement par leur père. Dmitri ne pouvait pas davantage être chez Catherine Ivanovna, et il en pressentait la raison. Leur conversation aurait donc lieu en tête à tête ; mais auparavant, Aliocha désirait voir Dmitri et, sans lui montrer la lettre, échanger avec lui quelques mots. Or, Dmitri demeurait loin et n’était sans doute pas chez lui en ce moment. Après une minute de réflexion et un signe de croix hâtif, il eut un sourire mystérieux et se dirigea résolument vers la terrible personne.
Il connaissait sa maison. Mais en passant par la Grand-Rue, puis en traversant la place, etc., il eût mis un certain temps, à l’atteindre. Sans être grande, notre ville est fort dispersée et les distances considérables. De plus, son père se souvenait peut-être de l’ordre qu’il lui avait donné et était capable de faire des siennes. Il fallait donc se hâter. En vertu de ces considérations, Aliocha résolut d’abréger, en prenant par les derrières ; il connaissait tous ces passages comme sa poche. Par les derrières, cela signifiait longer des clôtures désertes, franchir parfois des haies, traverser des cours où d’ailleurs chacun le connaissait et le saluait. Il pouvait ainsi atteindre la Grand-Rue en deux fois moins de temps. À un certain endroit, il dut passer tout près de la maison paternelle, précisément à côté du jardin contigu au leur, qui dépendait d’une petite maison à quatre fenêtres, délabrée et penchée de guingois. Cette masure appartenait à une vieille femme impotente, qui vivait avec sa fille, ancienne femme de chambre dans la capitale, récemment encore en service chez des gens huppés, revenue à la maison depuis un an à cause de la maladie de sa mère, et paradant dans des robes élégantes. Ces deux femmes étaient pourtant tombées dans une profonde misère et allaient même chaque jour, en tant que voisines, chercher du pain et de la soupe à la cuisine de Fiodor Pavlovitch. Marthe Ignatièvna leur faisait bon accueil. Mais la fille, tout en venant chercher de la soupe, n’avait vendu aucune de ses robes ; l’une d’elles avait même une traîne fort longue. Aliocha tenait ce détail de son ami Rakitine, auquel rien n’échappait dans notre petite ville ; bien entendu, il l’avait oublié aussitôt. Arrivé devant le jardin de la voisine, il se rappela cette traîne, releva rapidement sa tête courbée, pensive, et... fit soudain la rencontre la plus inattendue.
Derrière la haie, debout sur un monticule et visible jusqu’à la poitrine, son frère Dmitri l’appelait à grands gestes, tout en évitant, non seulement de crier, mais même de dire un mot, de peur d’être entendu. Aliocha accourut vers la haie.
« Par bonheur, tu as levé les yeux, sinon j’aurais été obligé de crier, chuchota joyeusement Dmitri. Saute-moi cette haie, vivement ! Comme tu arrives à propos ! je pensais à toi... »
Aliocha n’était pas moins content, mais il ne savait trop comment franchir la haie. Dmitri, de sa main d’athlète, le souleva par le coude et l’aida à sauter, ce qu’il fit, le froc retroussé, avec l’agilité d’un gamin.
« Et maintenant, en avant, marche ! murmura Dmitri transporté de joie.
– Mais où ? fit Aliocha, regardant de tous côtés et se voyant dans un jardin désert, où il n’y avait qu’eux. Le jardin était petit, mais la maison se trouvait au moins à cinquante pas. – Il n’y a personne ici, pourquoi parlons-nous à voix basse ?
– Pourquoi ? Et que le diable m’emporte si je le sais ? s’exclama soudain Dmitri à pleine voix. Regarde comme on peut être absurde. Je suis ici pour épier un secret. Les explications viendront après, mais, sous l’impression du mystère, je me suis mis à parler secrètement, à chuchoter comme un sot, sans raison. Allons, viens et tais-toi. Mais je veux t’embrasser.
Gloire à l’Éternel sur la terre.
Gloire à l’Éternel en moi...
Voilà ce que je répétais tout à l’heure, assis à cette place... »
Le jardin, grand d’environ deux arpents, n’était planté d’arbres que sur le pourtour, le long des clôtures ; il y avait là des pommiers, des érables, des tilleuls, des bouleaux, ainsi que des buissons de groseilliers et de framboisiers. Le centre formait comme une petite prairie où l’on récoltait du foin, en été. La propriétaire louait ce jardin, dès le printemps, pour quelques roubles. Le potager, cultivé depuis peu, se trouvait près de la maison. Dmitri conduisit son frère dans le coin le plus reculé du jardin. Là, parmi les tilleuls fort rapprochés et d’anciens massifs de groseilliers, de sureau, de boules-de-neige et de lilas, on découvrait comme les ruines d’un antique pavillon vert, noirci et déjeté, aux murs à claire-voie, mais encore couvert et où l’on pouvait s’abriter de la pluie. D’après la tradition, ce pavillon avait été construit, il y a cinquante ans, par un ancien propriétaire du domaine, Alexandre Karlovitch von Schmidt, lieutenant-colonel en retraite. Tout tombait en poussière, le plancher était pourri, les ais branlaient, le bois sentait l’humidité. Il y avait une table de bois peinte en vert, enfoncée en terre, entourée de bancs qui pouvaient encore servir. Aliocha avait remarqué l’enthousiasme de son frère ; en entrant dans le pavillon, il aperçut sur la table une demi-bouteille et un petit verre.
« C’est du cognac ! dit Mitia avec un éclat de rire. Tu vas penser : « Il continue à boire. » Ne te fie pas aux apparences.
Ne crois pas la foule vaine et menteuse,
Renonce à tes soupçons 1 ...
Je ne m’enivre pas, je « sirote », comme dit ce cochon de Rakitine, ton ami, et il le dira encore, quand il sera devenu conseiller d’État. Assieds-toi, Aliocha ; je voudrais te serrer dans mes bras, à t’écraser, car, dans le monde entier, crois-moi, en vérité, en vé-ri-té, je n’aime que toi ! »
Il prononça les derniers mots dans une sorte de frénésie.
« Toi, et encore une coquine dont je me suis amouraché, pour mon malheur. Mais s’amouracher, ce n’est pas aimer. On peut s’amouracher et haïr. Rappelle-toi cela. Jusqu’à présent, je parle gaiement. Assieds-toi à table, près de moi, que je te voie. Tu m’écouteras en silence, et je te dirai tout, car le moment de parler est arrivé. Mais sais-tu, j’ai réfléchi, il faut vraiment parler bas parce qu’ici... il y a peut-être des oreilles aux écoutes. Tu sauras tout, j’ai dit : la suite viendra. Pourquoi, depuis cinq jours que je suis ici, avais-je une telle envie de te voir ? C’est que tu m’es nécessaire... et qu’à toi seul je dirai tout... c’est que demain une vie finit pour moi, tandis qu’une autre commence. As-tu jamais éprouvé en rêve la sensation de rouler dans un précipice ? Eh bien, moi j’y tombe réellement. Oh ! inutile de t’effrayer, je n’ai pas peur... c’est-à-dire si, j’ai peur, mais c’est une peur douce qui tient de l’ivresse... Et puis, je m’en fiche ! Esprit fort, esprit faible, esprit de femme, qu’importe ? Louons la nature ! Vois quel beau soleil, quel ciel pur, partout de verts feuillages ; c’est vraiment encore l’été. Nous sommes à quatre heures de l’après-midi, il fait calme !... Où allais-tu ?
– J’allais chez mon père et je voulais voir, en passant, Catherine Ivanovna.
– Chez elle et chez le vieux ? Quelle coïncidence ! Car, pourquoi t’ai-je appelé, pourquoi t’ai-je désiré du fond du cœur, de toutes les fibres de mon être ? Précisément pour t’envoyer chez le vieux, puis chez elle, afin d’en finir avec l’une et avec l’autre. Envoyer un ange ! J’aurais pu envoyer n’importe qui, mais il me fallait un ange. Et voilà que tu y allais de toi-même.
– Vraiment ! tu voulais m’y envoyer ?... dit Aliocha avec une expression douloureuse.
– Attends, tu le savais. Je vois que tu as tout compris ; mais tais-toi. Ne me plains pas, ne pleure pas ! »
Dmitri se leva, l’air songeur :
« C’est elle qui t’a appelé ; elle a dû t’écrire, sinon tu n’y serais pas allé...
– Voici son billet, dit Aliocha en le tirant de sa poche. Dmitri le parcourut rapidement.
– Et tu prenais par le plus court ! Ô dieux ! Je vous remercie de l’avoir dirigé de ce côté et amené vers moi, tel le petit poisson d’or qui échut au vieux pêcheur d’après le conte2. Écoute, Aliocha, écoute, mon frère. Maintenant, j’ai résolu de tout te dire. Il faut que je m’épanche, enfin ! Après m’être confessé à un ange du ciel, je vais me confesser à un ange de la terre. Car tu es un ange3. Tu vas m’écouter et me pardonner... J’ai besoin d’être absous par un être plus noble que moi. Écoute donc. Supposons que deux êtres s’affranchissent des servitudes terrestres, et planent dans une région supérieure, l’un d’eux, tout au moins. Que celui-ci, avant de s’envoler ou de disparaître, s’approche de l’autre et lui dise : « fais pour moi ceci ou cela », des choses qu’il n’est jamais d’usage d’exiger, qu’on ne demande que sur le lit de mort. Est-ce que celui qui reste refuserait, si c’est un ami, un frère ?
– Je le ferais, mais dis-moi de quoi il s’agit.
– Vite... Hum ! Ne te dépêche pas, Aliocha ; en se dépêchant, on se tourmente. Inutile de se hâter, maintenant. Le monde entre dans une ère nouvelle. Quel dommage, Aliocha, que tu ne t’enthousiasmes jamais. Mais que dis-je ? C’est moi qui manque d’enthousiasme ! Nigaud que je suis !
Homme, sois noble !
De qui est ce vers4 ? »
Aliocha résolut d’attendre. Il avait compris que peut-être en effet toute son activité se déploierait en ce lieu. Dmitri demeura un moment songeur, accoudé sur la table, le front dans la main. Tous deux se taisaient.
« Aliocha, toi seul m’écouteras sans rire. Je voudrais commencer... ma confession... par un hymne à la joie, comme Schiller, An die Freude ! Mais je ne connais pas l’allemand, je sais seulement que c’est : An die Freude5. Ne va pas t’imaginer que je bavarde sous l’empire de l’ivresse. Il me faut deux bouteilles de cognac pour m’enivrer.
Tel Silène vermeil
Sur son âne trébuchant.
Or, je n’ai pas bu un quart de bouteille, et je ne suis pas Silène. Non, pas Silène, mais Hercule, car j’ai pris une résolution héroïque. Pardonne-moi ce rapprochement de mauvais goût ; tu auras bien d’autres choses à me pardonner aujourd’hui. Ne t’inquiète pas, je ne brode pas, je parle sérieusement et vais droit au fait. Je ne serai pas dur à la détente comme un juif. Attends, comment est-ce donc ? »
Il leva la tête, réfléchit, puis commença avec enthousiasme :
Timide, sauvage et nu se cachait
Le Troglodyte dans les cavernes ;
Le nomade errait dans les champs
Et les ravageait ;
Le chasseur avec sa lance et ses flèches,
Terrible, parcourait les forêts ;
Malheur aux naufragés jetés par les vagues
Sur ces rivages inhospitaliers
Des hauteurs de l’Olympe
Descend une mère, Cérès, à la recherche
De Proserpine à son amour ravie ;
Le monde s’étale dans toute son horreur.
Pas d’asile, nulles offrandes
Ne sont présentées à la déesse.
Ici, le culte des dieux
Est ignoré, point de temple.
Les fruits des champs, les grappes douces
N’embellissent aucun festin ;
Seuls fument les restes des victimes
Sur les autels ensanglantés.
Et n’importe où Cérès
Promène son regard éploré,
Partout elle aperçoit
L’homme dans une humiliation profonde.
Des sanglots s’échappèrent de la poitrine de Mitia, il saisit Aliocha par la main. « Ami, ami, oui, dans l’humiliation, et dans l’humiliation jusqu’à nos jours ! L’homme endure sur la terre des maux sans nombre. Ne pense pas que je sois seulement un fantoche costumé en officier, bon à boire et à faire la noce. L’humiliation, partage de l’homme, voilà, frère, presque l’unique objet de ma pensée. Dieu me préserve de mentir et de me vanter. Je songe à cet homme humilié, car c’est moi-même.
Pour que l’homme puisse sortir de l’abjection
Par la force de son âme,
Il doit conclure une alliance éternelle
Avec l’antique mère, la Terre.
Seulement, voilà, comment conclure cette alliance éternelle ? Je ne féconde pas la terre en ouvrant son sein ; me ferai-je laboureur ou berger ? Je marche sans savoir où je vais, vers la lumière radieuse ou la honte infecte. C’est là le malheur, car tout est énigme en ce monde. Alors que j’étais plongé dans la plus abjecte dégradation (et je l’ai presque toujours été), j’ai toujours relu ces vers sur Cérès et la misère de l’homme. M’ont-ils corrigé ? Non pas ! Parce que je suis un Karamazov. Parce que, quand je roule dans l’abîme, c’est tout droit, la tête la première ; il me plaît même de tomber ainsi, je vois de la beauté dans cette chute. Et du sein de la honte j’entonne un hymne. Je suis maudit, vil et dégradé, mais je baise le bas de la robe où s’enveloppe mon Dieu ; je suis la route diabolique, tout en restant Ton fils, Seigneur, et je T’aime, je ressens la joie sans laquelle le monde ne saurait subsister.
La joie éternelle anime
L’âme de la création.
Transmet la flamme de la vie
Par la force mystérieuse des germes ;
C’est elle qui a fait surgir l’herbe,
Transformé le chaos en soleils
Dispersés dans les espaces
Non soumis à l’astronome.
Tout ce qui respire
Puise la joie au sein de la bonne Nature ;
Elle entraîne à sa suite les êtres et les
/ peuples ;
C’est elle qui nous a donné
Des amis dans l’adversité,
Le jus des grappes, les couronnes des Grâces,
Aux insectes, la sensualité...
Et l’ange se tient devant Dieu.
Mais assez de vers. Laisse-moi pleurer. Que ce soit une niaiserie raillée par tout le monde, excepté par toi. Voilà tes yeux qui brillent. Assez de vers. Je veux maintenant te parler des « insectes », de ceux que Dieu a gratifiés de la sensualité. J’en suis un moi-même, et ceci s’applique à moi. Nous autres, Karamazov, nous sommes tous ainsi ; cet insecte vit en toi, qui es un ange, et y soulève des tempêtes. Car la sensualité est une tempête, et même quelque chose de plus. La beauté, c’est une chose terrible et affreuse. Terrible, parce qu’indéfinissable, et on ne peut la définir, car Dieu n’a créé que des énigmes. Les extrêmes se rejoignent, les contradictions vivent accouplées. Je suis fort peu instruit, frère, mais j’ai beaucoup songé à ces choses. Que de mystères accablent l’homme ! Pénètre-les et reviens intact. Par exemple la beauté. Je ne puis supporter qu’un homme de grand cœur et de haute intelligence commence par l’idéal de la Madone, pour finir par celui de Sodome. Mais le plus affreux, c’est, tout en portant dans son cœur l’idéal de Sodome, de ne pas répudier celui de la Madone, de brûler pour lui comme dans ses jeunes années d’innocence. Non, l’esprit humain est trop vaste ; je voudrais le restreindre. Comment diable s’y reconnaître ? Le cœur trouve la beauté jusque dans ta honte, dans l’idéal de Sodome, celui de l’immense majorité. Connaissais-tu ce mystère ? C’est le duel du diable et de Dieu, le cœur humain étant le champ de bataille. Au reste, on parle de ce qui vous fait souffrir. Arrivons donc au fait. »