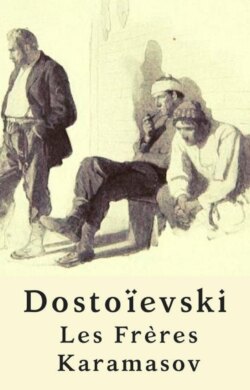Читать книгу Les Frères Karamazov (Édition Intégrale) - Fedor Dostoievski - Страница 39
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Confession d’un cœur ardent. La tête en bas
Оглавление« Eh bien, dit Aliocha, je connais maintenant la première partie de l’affaire.
– C’est-à-dire un drame, qui s’est passé là-bas. La seconde partie sera une tragédie et se déroulera ici.
– Je ne comprends rien à cette seconde partie.
– Et moi, est-ce que j’y comprends quelque chose ?
– Écoute, Dmitri, il y a un point important. Dis-moi, es-tu encore fiancé ?
– Je ne me fiançai pas tout de suite, mais seulement trois mois après cet événement. Le lendemain, je me dis que c’était liquidé, terminé, qu’il n’y aurait pas de suite. Aller la demander en mariage me parut une bassesse. De son côté, elle ne me donna pas signe de vie durant les six semaines qu’elle passa encore dans la ville. À part une exception, cependant : le lendemain de sa visite, leur femme de chambre se glissa chez moi, et, sans dire un mot, me remit une enveloppe à mon adresse. Je l’ouvre, elle contenait le reliquat des cinq mille roubles. Il avait fallu en restituer quatre mille cinq cents, la perte en vendant l’obligation dépassait deux cents roubles. Elle m’en rendait deux cent soixante, je crois – je ne me rappelle pas exactement – et sans un mot d’explication. Je cherchai dans le paquet un signe quelconque au crayon, rien ! Je fis la noce avec ce qui restait de mon argent, si bien que le nouveau major fut obligé de me faire des remontrances. Le lieutenant-colonel avait rendu sa caisse intacte, à l’étonnement général, car on croyait la chose impossible. Après quoi, il tomba malade, resta trois semaines alité et succomba en cinq jours à un ramollissement du cerveau. On l’enterra avec tous les honneurs militaires, car il n’avait pas encore été mis à la retraite. Dix jours après les funérailles, Catherine Ivanovna, sa sœur et leur tante, partirent pour Moscou. Le jour de leur départ seulement (je ne les avais pas revues), je reçus un billet bleu, avec cette seule ligne écrite au crayon : « Je vous écrirai. Attendez. C. »
« À Moscou, leurs affaires s’arrangèrent d’une manière aussi rapide qu’inattendue, comme dans un conte des Mille et Une Nuits. La principale parente de Catherine Ivanovna, une générale, perdit brusquement ses deux nièces, ses plus proches héritières, mortes dans la même semaine de la petite vérole. Bouleversée, elle s’attacha à Katia comme à sa propre fille, voyant en elle son dernier espoir, refit son testament en sa faveur et lui donna de la main à la main quatre-vingt mille roubles comme dot, pour en disposer à sa guise. Elle est hystérique ; j’eus l’occasion plus tard de l’observer à Moscou. Un beau matin, je reçois par la poste quatre mille cinq cents roubles, à mon extrême surprise, bien entendu. Trois jours après arrive la lettre promise. Je l’ai encore, je la conserverai jusqu’à ma mort ; veux-tu que je te la montre ? Ne manque pas de la lire : elle s’offre elle-même à partager ma vie. « Je vous aime follement ; que vous ne m’aimiez pas, cela m’est égal, contentez-vous d’être mon mari. Ne vous effrayez pas, je ne vous gênerai en rien ; je serai un de vos meubles, le tapis sur lequel vous marchez... Je veux vous aimer éternellement, je vous sauverai de vous-même... » Aliocha, je suis indigne même de rapporter ces lignes dans mon vil langage, du ton dont je n’ai jamais pu me corriger ! Jusqu’à maintenant, cette lettre m’a percé le cœur, et crois-tu que je me sente à mon aise, aujourd’hui ? Je lui répondis aussitôt, car il m’était impossible d’aller à Moscou. J’écrivis avec mes larmes. Je rougirai éternellement de lui avoir rappelé qu’elle était maintenant riche et dotée – et moi sans ressources. J’aurais dû me contenir, mais ma plume me trahit. J’écrivis aussi à Ivan, alors à Moscou, et lui expliquai tout ce qu’il était possible, une lettre de six pages ; j’envoyai Ivan chez elle. Qu’as-tu à me regarder ? Oui, Ivan est tombé amoureux de Katia, il est toujours épris d’elle, je le sais. J’ai fait une sottise, au point de vue du monde, mais c’est peut-être cette sottise qui nous sauvera tous. Ne vois-tu pas qu’elle l’honore, qu’elle l’estime ? Peut-elle, après nous avoir comparés, aimer un homme tel que moi, surtout après ce qui s’est passé ici ?
– Je suis persuadé que c’est un homme comme toi qu’elle doit aimer, et non pas un homme comme lui.
– C’est sa propre vertu qu’elle aime, et non pas moi, laissa échapper Dmitri malgré lui, avec irritation. – Il se mit à rire, mais soudain ses yeux étincelèrent ; il devint tout rouge et donna un violent coup de poing sur la table. – Je le jure, Aliocha, s’écria-t-il dans un accès de fureur non jouée contre lui-même, tu peux le croire ou non, aussi vrai que Dieu est saint et que le Christ est Dieu, et, bien que j’aie raillé ses nobles sentiments, je ne doute pas de leur angélique sincérité ; je sais que mon âme est un million de fois plus vile que la sienne. C’est dans cette certitude que consiste la tragédie. Le beau malheur, que l’on déclame quelque peu ! Moi aussi, je déclame et pourtant je suis parfaitement sincère. Quant à Ivan, j’imagine qu’il doit maudire la nature, lui si intelligent ! Qui a eu la préférence ? Un monstre tel que moi, qui n’ai pu m’arracher à la débauche, quand tous m’observaient, et cela sous les yeux de ma fiancée ! Et c’est moi qu’on préfère ! Mais pourquoi ? Parce que cette jeune fille veut, par reconnaissance, se contraindre à une existence malheureuse ! C’est absurde ! Je n’ai jamais parlé à Ivan dans ce sens, et lui, bien entendu, n’y a jamais fait la moindre allusion ; mais le destin s’accomplira ; à chacun selon ses mérites ; le réprouvé s’enfoncera définitivement dans le bourbier qu’il affectionne. Je radote, les mots ne rendent pas ma pensée, mais ce que j’ai fixé se réalisera. Je me noierai dans la fange et elle épousera Ivan.
– Frère, attends, interrompit Aliocha dans une agitation extraordinaire ; il y a un point que tu ne m’as pas encore expliqué. Tu restes son fiancé : comment veux-tu rompre, si elle s’y oppose ?
– Oui, je suis son fiancé, nous avons reçu la bénédiction officielle, à Moscou, en grande cérémonie, avec les icônes. La générale nous bénit ; figure-toi qu’elle félicita même Katia : « Tu as bien choisi, dit-elle, je lis dans son cœur. » Quant à Ivan, il ne lui plut pas ; elle ne lui adressa aucun compliment. À Moscou, j’eus de longues causeries avec Katia ; je me peignis noblement, tel que j’étais, en toute sincérité. Elle écouta tout :
Ce fut un trouble charmant.
Ce furent de tendres paroles...
Il y eut aussi des paroles fières. Elle m’arracha la promesse de me corriger. Je promis. Et voilà où j’en suis.
– Eh bien, quoi ?
– Je t’ai appelé, je t’ai amené ici aujourd’hui, rappelle-toi, pour t’envoyer ce même jour chez Catherine Ivanovna, et...
– Quoi donc ?
– Lui dire que je n’irai plus jamais chez elle, en la saluant de ma part.
– Est-ce possible ?
– Non, c’est impossible, aussi je te prie d’y aller à ma place, je ne pourrais pas lui dire cela moi-même.
– Et toi, où iras-tu ?
– Je retournerai à mon bourbier.
– C’est-à-dire chez Grouchegnka ? s’écria tristement Aliocha en joignant les mains – Rakitine avait donc raison. Et moi qui croyais que c’était seulement une liaison passagère !
– Un fiancé, avoir une liaison ! Est-ce possible, avec une telle fiancée et aux yeux de tous ? Je n’ai pas perdu tout honneur. Du moment où je fréquentai Grouchegnka, je cessai d’être fiancé et honnête homme, je m’en rends compte. Qu’as-tu à me regarder ? La première fois que je suis allé chez elle c’était dans l’intention de la battre. J’avais appris, et je sais maintenant de source sûre, que ce capitaine, délégué par mon père, avait remis à Grouchegnka un billet à ordre signé de moi ; il s’agissait de me poursuivre en justice, dans l’espoir de me mater et d’obtenir mon désistement ; on voulait me faire peur. J’avais déjà eu l’occasion de l’entrevoir : c’est une femme qui ne frappe pas dès l’abord. Je connais l’histoire de ce vieux marchand, son amant, qui n’en a plus pour longtemps, mais qui lui laissera une jolie somme. Je la savais cupide, prêtant à usure, fourbe et coquine, sans pitié ! J’allais donc chez elle pour la corriger et... j’y restai. Cette femme-là, vois-tu, c’est la peste ! Je me suis contaminé, je l’ai dans la peau. Tout est fini désormais, il n’y a plus d’autre perspective. Le cycle des temps est révolu. Voilà où j’en suis. Comme par un fait exprès, j’avais alors trois mille roubles en poche. Nous sommes allés à Mokroïé, à vingt-cinq verstes d’ici, j’ai fait venir des tziganes, j’ai offert le champagne à tous les paysans, aux femmes et aux filles de l’endroit. Trois jours après, j’étais à sec. Tu penses que j’ai obtenu la moindre faveur ? Elle ne m’a rien montré. Elle est toute en replis, je t’assure. La friponne, son corps rappelle une couleuvre, cela se voit à ses jambes, jusqu’au petit doigt de son pied gauche qui en porte la marque. Je l’ai vu et baisé, mais c’est tout, je te le jure. Elle m’a dit : « Veux-tu que je t’épouse, bien que pauvre. Si tu me promets de ne pas me battre et de me laisser faire tout ce que je voudrai, je me marierai peut-être ! » Et elle s’est mise à rire, elle en rit encore maintenant ! »
Dmitri Fiodorovitch se leva en proie à une sorte de fureur. Il avait l’air ivre. Ses yeux étaient injectés de sang.
« Tu comptes sérieusement l’épouser ?
– Si elle consent, je l’épouserai tout de suite ; si elle refuse, je resterai quand même avec elle, je serai son valet. Quant à toi, Aliocha... – Il s’arrêta devant lui et se mit à le secouer violemment par les épaules. – Sais-tu, innocent, que tout ceci est un vrai délire, un délire inconcevable, car il y a là une tragédie ! Apprends, Aliocha, que je puis être un homme perdu, aux passions viles, mais que Dmitri Karamazov ne sera jamais un voleur, un vulgaire filou. Eh bien, apprends maintenant que je suis ce voleur, ce filou ! Comme je me disposais à aller chez Grouchegnka pour la châtier, Catherine Ivanovna me fit venir et me pria en grand secret (j’ignore pour quel motif) d’aller au chef-lieu envoyer trois mille roubles à sa sœur à Moscou. Personne ne devait le savoir en ville. Je me rendis donc chez Grouchegnka avec ces trois mille roubles en poche, et ils servirent à payer notre excursion à Mokroïé. Ensuite je fis semblant d’être allé au chef-lieu, d’avoir envoyé l’argent ; quant au récépissé, j’ai « oublié » de le lui porter malgré ma promesse. Maintenant, qu’en penses-tu ? Tu iras lui dire : « Il vous fait saluer. » Elle te demandera : « Et l’argent ? » Tu lui répondras : « C’est un être bassement sensuel, une créature vile, incapable de se contenir. Au lieu d’envoyer votre argent, il l’a gaspillé, ne pouvant résister à la tentation. » Mais si tu pouvais ajouter : « Dmitri Fiodorovitch n’est pas un voleur, voici vos trois mille roubles qu’il restitue, envoyez-les vous-même à Agathe Ivanovna et recevez ses hommages », il n’y aurait que demi-mal, tandis que si elle te demande : « Où est l’argent ? »
– Dmitri, tu es malheureux, mais moins que tu ne penses ; ne te tue pas de désespoir !
– Penses-tu que je vais me brûler la cervelle, si je n’arrive pas à rembourser ces trois mille roubles ? Pas du tout. Je n’en ai pas la force ; plus tard, peut-être... Mais pour le moment je vais chez Grouchegnka... J’y laisserai ma peau !
– Et alors ?
– Je l’épouserai, si elle veut bien de moi ; quand ses amants viendront, je passerai dans la chambre voisine. Je serai là pour cirer leurs chaussures, préparer le samovar, faire les commissions...
– Catherine Ivanovna comprendra tout, déclara solennellement Aliocha : elle comprendra ton profond chagrin et te pardonnera. Elle a l’esprit élevé, elle verra qu’on ne peut pas être plus malheureux que toi.
– Elle ne pardonnera pas. Il y a là une chose impardonnable aux yeux de toute femme.
– Sais-tu ce qu’il vaut mieux faire ?
– Et quoi ?
– Lui rendre les trois mille roubles.
– Où les prendre ? ...
– Écoute, j’en ai deux mille, Ivan t’en donnera mille, cela fait le compte.
– Quand les aurai-je, tes trois mille roubles ? Tu es encore mineur, au surplus, et il faut absolument que tu rompes avec elle en mon nom aujourd’hui même, en rendant l’argent ou non, car, au point où en sont les choses, je ne puis traîner plus longtemps. Demain, ce serait trop tard. Va chez le vieux.
– Chez notre père ?
– Oui, chez lui d’abord. Demande-lui la somme.
– Dmitri, jamais il ne la donnera.
– Parbleu, je le sais bien ! Alexéi, sais-tu ce que c’est que le désespoir ?
– Oui.
– Écoute : juridiquement il ne me doit rien. J’ai reçu ma part, je le sais ; mais moralement, me doit-il oui ou non quelque chose ? C’est avec les vingt-huit mille roubles de ma mère qu’il en a gagné cent mille. Qu’il me donne seulement trois mille roubles, pas davantage, il aura sauvé mon âme de l’enfer et beaucoup de péchés lui seront pardonnés. Je me contenterai de cette somme, je te le jure, il n’entendra plus parler de moi. Je lui fournis une dernière fois l’occasion d’être un père. Dis-lui que c’est Dieu qui la lui offre.
– Dmitri, il ne les donnera à aucun prix.
– Je le sais bien, j’en suis sûr. Maintenant surtout ! Mais il y a mieux. Ces jours-ci, il a appris pour la première fois sérieusement (remarque cet adverbe) que Grouchegnka ne plaisantait pas et se déciderait peut-être à faire le saut, à m’épouser. Il connaît son caractère, à cette chatte. Eh bien, me donnerait-il de l’argent par-dessus le marché, pour favoriser la chose, alors qu’il est fou d’elle ? Ce n’est pas tout ; écoute ceci : depuis cinq jours déjà, il a mis de côté trois mille roubles en billets de cent, dans une grande enveloppe avec cinq cachets, nouée d’une faveur rose. Tu vois comme je suis au courant ! L’enveloppe porte ceci : « Pour mon ange, Grouchegnka, si elle consent à venir chez moi. » Il a griffonné cela lui-même, à la dérobée, et tout le monde ignore qu’il a cet argent, excepté le valet Smerdiakov dont il est aussi sûr que de lui-même. Voilà trois ou quatre jours, qu’il attend Grouchegnka, dans l’espoir qu’elle viendra chercher l’enveloppe ; elle lui a fait « savoir qu’elle viendrait peut-être ». Si elle va chez le vieux, je ne pourrai plus l’épouser. Comprends-tu maintenant pourquoi je me cache ici et qui je guette ?
– Elle ?
– Oui. Ces garces ont cédé une chambrette à Foma1, un ancien soldat de mon bataillon. Il est à leur service, monte la garde la nuit et tire les coqs de bruyère dans la journée. Je me suis installé chez lui ; ces femmes et lui ignorent mon secret, à savoir que je suis ici pour guetter.
– Smerdiakov seul le sait ?
– Oui. C’est lui qui m’avertira, si Grouchegnka va chez le vieux.
– C’est lui qui t’a parlé du paquet ?
– En effet. C’est un grand secret. Ivan lui-même n’est au courant de rien. Le vieux l’a envoyé promener à Tchermachnia pour deux ou trois jours ; un acheteur s’est présenté, pour le bois, il en offre huit mille roubles ; le vieux a prié Ivan de l’aider, d’y aller à sa place. Il veut l’éloigner pour recevoir Grouchegnka.
– Il l’attend par conséquent aujourd’hui ?
– Non, d’après certains indices, elle ne viendra pas aujourd’hui, sûrement pas ! s’écria Dmitri. C’est aussi le sentiment de Smerdiakov. Le vieux est maintenant attablé avec Ivan, en train de boire. Va donc, Alexéi, demande-lui ces trois mille roubles.
– Mitia, mon cher, qu’as-tu donc ! s’exclama Aliocha en bondissant de sa place pour examiner le visage égaré de Dmitri. Il crut un instant que son frère était devenu fou.
– Eh bien ! quoi ? Je n’ai pas perdu l’esprit, proféra celui-ci, le regard fixe et presque solennel. N’aie crainte. Je sais ce que je dis, je crois aux miracles.
– Aux miracles ?
– Aux miracles de la Providence. Dieu connaît mon cœur. Il voit mon désespoir. Est-ce qu’il laisserait s’accomplir une telle horreur ? Aliocha, je crois aux miracles, va !
– J’irai. Dis-moi, tu m’attendras ici ?
– Bien sûr. Je comprends que ce sera long, on ne peut pas l’aborder carrément. Il est ivre à présent. J’attendrai ici trois, quatre, cinq heures, mais sache qu’aujourd’hui, même à minuit, tu dois aller chez Catherine, avec ou sans argent, et lui dire : « Dmitri Fiodorovitch m’a prié de vous saluer. » Je veux que tu répètes cette phrase exactement.
– Mitia, et si Grouchegnka vient aujourd’hui... ou demain, ou après-demain ?
– Grouchegnka ? Je surveillerai, je forcerai la porte et j’empêcherai.
– Mais si...
– Alors, je tuerai. Je ne le supporterai pas.
– Qui tueras-tu ?
– Le vieux. Elle, je ne la toucherai pas.
– Frère, que dis-tu ?
– Je ne sais pas, je ne sais pas... Peut-être le tuerai-je, peut-être ne le tuerai-je pas. Je crains de ne pouvoir supporter son visage à ce moment-là. Je hais sa pomme d’Adam, son nez, ses yeux, son sourire impudent. Il me dégoûte. Voilà ce qui m’effraie, je ne pourrai pas me contenir.
– Je vais, Mitia. Je crois que Dieu arrangera tout pour le mieux, et nous épargnera ces choses horribles.
– Et moi, j’attendrai le miracle. Mais, s’il ne s’accomplit pas, alors... »
Aliocha, pensif, s’en alla chez son père.