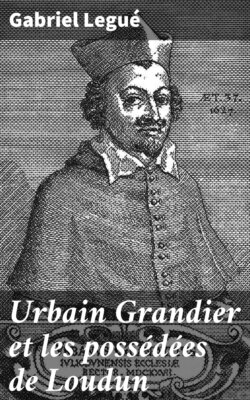Читать книгу Urbain Grandier et les possédées de Loudun - Gabriel Legué - Страница 10
CHAPITRE III
ОглавлениеLa Société Loudunaise chez le procureur du roi. — Danger de ces réunions. — Aventure de Mlle Trincant. — Rupture complète de son père avec Urbain Grandier. — Madeleine de Brou. — Scandale causé à Loudun par ses relations avec le curé. — Le Traité du célibat des prêtres. — L’avocat du roi, Pierre Menuau.
LA mort de Sainte-Marthe n’avait fait que resserrer les liens d’amitié qui unissaient Urbain Grandier au procureur du roi. A partir de ce jour, ces deux hommes devinrent inséparables. Ils résolurent de reconstituer la Société lettrée telle que Sainte-Marthe l’avait laissée et de lui donner tout l’éclat d’autrefois. Mais Trincant, esprit modeste et laborieux, n’avait aucune des brillantes qualités de Scévole son maître. Grandier seul était capable de continuer ces réunions.
La famille du procureur du roi, fort nombreuse, appartenait à toutes les classes de la société. Quelques-uns de ses membres occupaient le premier rang, tandis que les autres n’avaient qu’une place infime. Par suite de cette nombreuse parenté, Trincant dut se montrer peu difficile dans le choix de ses relations et accueillit indistinctement ceux qui se présentaient. Il en résulta que la société se trouva fort mêlée et que le caractère de ces réunions fut singulièrement modifié. Chez Sainte-Marthe, au contraire, les invités étaient choisis avec soin. Il n’était pas donné à tous de franchir le seuil de la maison. Avec Scévole, l’esprit littéraire dominait: c’était un feu de tous les instants qui brillait et pétillait en l’honneur des Grâces, d’Apollon, de Cicéron, de Démosthènes; chez le procureur du roi, la littérature, la poésie, les arts ne furent plus le sujet unique de la conversation; on se livra avec un entrain remarquable aux cancans, aux médisances dont tous ces bourgeois étaient si friands. Malgré tout son esprit, Grandier ne put les ramener au culte des belles choses, il eut beau évoquer le souvenir du grand poète, sa voix ne trouva point d’écho dans l’assistance. Alors il se mit à parler le même langage, il exerça sa verve, son ironie sur toutes ces petites gens et se fit une foule d’ennemis. Certes, les sujets ne manquèrent pas, et dans la famille même de Trincant il eut de quoi satisfaire largement son goût pour la raillerie. Le chirurgien René Mannoury, cousin du maître de la maison, personnage ridicule et fat, devint le point de mire de ses attaques; un autre parent, l’apothicaire Adam, ne fut pas plus épargné. C’était dans l’officine de cet Adam que se fabriquaient tous les méchants propos qui couraient par la ville. Sa maison, rendez-vous ordinaire des désoeuvrés et des mauvaises langues ne désemplissait pas du matin au soir. Cet homme était craint et redouté à Loudun. Grandier l’avait appris à ses dépens; mais il n’en continua pas moins à le traiter avec sa morgue habituelle. Mal lui en prit; car si chez son cousin, l’apothicaire n’osait répondre, sa langue se déliait bien vite une fois rentré dans sa boutique, et le curé pouvait s’apercevoir quel tort causait à sa réputation les médisances de cet homme. Un neveu de Trincant, le chanoine Jean Mignon dont nous aurons tant à parler dans la suite, assistait quelquefois à ces réunions. Mignon semblait alors affecter une hypocrite bienveillance pour son collègue Grandier. Il le savait trop lié avec son oncle pour hasarder quelques calomnies contre lui; aussi, attendait-il patiemment l’occasion de montrer ses véritables sentiments à son égard.
A ces réunions les femmes étaient nombreuses. Elles aimaient à venir le soir causer à la veillée chez le procureur du roi. On y rencontrait quelques douces et touchantes figures; mais ce contact journalier du prêtre avec la société laïque ne pouvait avoir que de tristes résultats. La familiarité n’engendre jamais le respect. Ce que le curé de Loudun gagnait en affection, c’était, on peut le dire, aux dépens de son caractère sacerdotal. Ces fréquentations constituaient donc un véritable danger auquel Grandier ne put se soustraire. Il se laissa aller à son naturel déjà trop porté pour les femmes, et compromit quelques jolies veuves par ses assiduités et ses galants propos.
Ce qui attirait surtout Grandier, c’était la présence des deux charmantes filles de Trincant. Le procureur du roi, veuf depuis quelques années, avait dû laisser à ses filles le soin de faire les honneurs de la maison. Elles s’en acquittaient avec une grâce charmante. Philippe, l’aînée, belle et adorable créature, avait eu le don de passionner le volage curé. Il lui trouvait un sens droit, une âme aimante, un esprit ferme. Tous ses moyens de séduction furent employés pour gagner le cœur de cette jeune fille. La chose ne fut hélas! que trop facile; car Grandier trouvait dans l’aveugle amitié du procureur du roi, un prétexte pour venir chaque jour s’asseoir à son foyer. Quelques mois de ces assiduités suffirent pour rendre Philippe éperduement amoureuse. Le confessionnal fut le lieu où la jeune fille dévoila l’état de son cœur, s’en accusant comme d’un péché ; mais le curé n’eut pas de peine à faire taire les scrupules de Mlle Trincant. Il lui parla de son amour avec une si vive passion, il mit une telle chaleur dans son langage que, fascinée, éblouie, subjuguée par tant d’éloquence, elle finit par succomber. Cette scandaleuse liaison ne tarda pas à être connue, et ainsi que cela arrive d’ordinaire, le malheureux père fut le dernier à s’en apercevoir. Les plaisanteries, les mots à double sens éclatèrent avec une violence inouïe sur Trincant peu aimé des Huguenots. Ses amis eux-mêmes mirent tout en œuvre pour lui faire entrevoir le danger que courait sa fille. Tout fut inutile. Il ne voulut rien entendre, et demeûra inébranlable dans la conviction que l’on calomniait son ami. Il continua donc à voir Grandier comme par le passé. Le curé, de son côté, paya d’audace, et traita avec sa hauteur habituelle les colporteurs de ces propos scandaleux.
Quant à Philippe elle n’osait plus sortir. Ses moindres actions étaient interprétées d’une façon outrageante pour son honneur et celui de son père. Les chuchottements, le regard attentif des commères des environs aiguisé par une curiosité malsaine, et surtout l’abandon de ses plus chères compagnes l’avertirent qu’elle était déchue de sa réputation et que la société la repoussait. Pour comble de malheur, le bruit courut par la ville qu’elle était souffrante. A différentes reprises on avait vu le médecin Fanton se diriger vers la place Sainte-Croix où habitait le procureur du roi. Il n’en avait pas fallu davantage pour attribuer ces visites à la situation dans laquelle devait se trouver Mlle Trincant. Quelques curieux se hasardèrent à interroger le médecin, mais il fut impénétrable. Cet état de choses se prolongea neuf mois, terme ordinaire de ces sortes d’indispositions. Le procureur du roi dut enfin se rendre à l’évidence. Alors sa douleur et son indignation ne connurent plus de bornes. Il fit pitié à tous ceux qui l’entouraient. Il se livra aux plus violents emportements de la colère contre le misérable, auteur de sa honte. Mais Grandier demeurait insouciant et superbe au milieu de cet orage qu’il avait déchaîné. Son attitude fut telle que ses meilleurs amis ne purent croire à sa culpabilité.
Il se rencontra cependant une compagne dévouée qui, avec la plus touchante abnégation et aux dépens de sa propre réputation résolut de sauver Philippe en se chargeant de son enfant. Marthe Le Pelletier, c’était le nom de cette courageuse fille, trouva une nourrice et poussant le dévouement jusqu’à ses dernières limites, n’hésita pas à se déclarer la mère du nouveau né. Les apparences du moins étaient sauvées et Philippe put se croire un instant à l’abri des médisances qui couraient sur son compte. Quelques jours après l’événement, elle reparut dans la ville et à l’église accompagnée de son père. Il lui fut impossible de se soustraire à la curiosité du public, et chacun la dévisagea tout à son aise. Tous remarquèrent que sa physionomie portait encore une étrange expression de souffrance; ses traits fatigués par les veilles et les insomnies n’avaient plus leur régularité d’autrefois et ses beaux yeux rougis par les larmes annonçaient assez sa douleur et sa honte. Pourtant elle fit des efforts surhumains pour dompter la tristesse qui l’accablait. Elle se prodigua avec une grâce charmante; mais ses avances ne firent que confirmer les soupçons. En la voyant, personne ne douta plus. Complètement affolé par cette lamentable aventure, l’infortuné père tenta un dernier effort pour sauver sa fille. Il fit arrêter en plein jour sur la place publique de Sainte-Croix, la pauvre Marthe Le Pelletier, l’obligea à faire baptiser et à enregistrer à l’église sous son nom cet enfant cause de tant de scandale. La jeune fille se prêta à tout ce que voulut le procureur du roi; mais hélas! ce fut peine perdue. La véritable mère aux yeux des habitants était bien Philippe Trincant. Avec une grande habileté les adversaires de Grandier exploitèrent l’aventure, et ce père si lâchement déshonoré dans ce qu’il avait de plus cher au monde devint un des plus implacables ennemis du curé.
Cependant Grandier ne changeait rien à ses habitudes. Cet événement dont l’odieux retombait sur son caractère de prêtre aurait dû le faire réfléchir. Il se plut, au contraire, à braver l’opinion publique et ne tint aucun compte des avertissements de ses amis qui le voyaient avec douleur se fourvoyer de la sorte. Sa vieille mère Jeanne d’Estièvre le conjura de lui épargner le retour de pareils scandales; mais emporté par la violence de ses passions, il resta sourd à toutes les remontrances. A peine le déshonneur de la fille de Trincant était-il consommé qu’il renouvelait avec une autre les même procédés et portait la désolation dans une des meilleures familles du pays.
Malgré sa réputation de galanterie, le curé avait su se conserver de puissants amis dans la haute société Loudunaise. De ce nombre se trouvait René de Brou, conseiller du roi, sieur de Ligueil, homme noble, plein de droiture et recommandable par ses vertus. Allié à toutes les familles les plus honorables de Loudun, les Dreux, les Tabart, les Genebaut, il jouissait de l’estime générale. Par sa femme il avait des liens de parenté avec cette noble et nombreuse famille des Chauvet, magistrats, dont Loudun garde encore aujourd’hui le souvenir; il était en outre le proche parent du premier magistrat de la ville, Guillaume de Cerisay sieur de la Guérinière, bailli du Loudunais.
René de Brou avait trois filles. L’aînée Hélène s’était mariée de bonne heure à un gentilhomme des environs, Louis du Mothey, écuyer, seigneur du May; la cadette Renée avait épousé Daniel Rogier, médecin à Loudun et la troisième, Madeleine, dont l’enfance s’était développée dans cet intérieur calme et patriarcal des Genebaut si estimés à Loudun, n’avait point, voulu quitter ses parents. C’était une belle et timide jeune fille à l’air grave et austère qu’on admirait pour son esprit et ses grâces, qu’on respectait pour sa vertu et sa piété. Elle avait jusqu’à ce jour résisté à toutes les pressantes sollicitations de sa famille et n’avait point voulu se marier. A toutes les avances qu’on lui faisait, Madeleine répondait par un refus formel. Elle voulait, disait-elle, rester cachée aux yeux du monde et remplir exactement ses devoirs religieux. On la voyait à peine au dehors sinon pour aller à l’église où elle passait de longues heures.
Lettre de Dorothée Genebault, mère de Madeleine de Brou, demandant à Urbain Grandier la faveur de lui emprunter quarante-cinq écus.
Lodun, le 18 février 1625.
(Collect. Ch. Barbier. )
Grandier venait souvent dans cette famille dont il avait su gagner les sympathies. On avait en lui la plus entière confiance et il s’en était jusqu’alors montré digne. Le malheur voulut que Madeleine perdit ses parents à l’âge où elle avait encore le plus besoin de leur appui; mais avant de mourir sa mère la recommanda au curé de Saint-Pierre, qui promit de veiller sur elle et de la diriger.
Restée seule à la tête d’une certaine fortune, Madeleine conçut un moment le projet d’entrer au couvent. Elle en fut détournée par son confesseur. Peu de temps après, on la vit tous les jours s’acheminer vers la cure de Saint-Pierre et y rester plus qu’il ne convenait. D’abord on crut que ces visites étaient pour son intime amie, Françoise Grandier qui habitait avec son frère. Mais la malignité publique qui jusque là n’avait osé s’acharner après elle, voulut connaître le but de ces longues stations dans la maison du curé. On espionna Madeleine et au bout de quelque temps ce n’était un mystère pour personne qu’elle était la maîtresse de Grandier. Par quels concours de circonstances cette virginale créature qui passait calme et fière au milieu de la foule, en était-elle arrivée à se perdre ainsi? Il ne nous appartient pas de soulever les voiles qui enveloppent les cœurs féminins. La femme est l’être mystérieux par excellence. Les plus austères vertus, les plus pures innocences ont souvent sombré dans cet abîme sans fonds qu’on appelle l’amour.
Cependant Madeleine avait longtemps combattu avant d’en arriver là. Il avait fallu toute l’habileté de Grandier, toute sa profonde connaissance du cœur féminin pour vaincre les scrupules de cette jeune fille dont il était le confesseur et dont il connaissait les plus secrètes pensées; il savait qu’il était aimé, mais il n’ignorait pas, non plus, que cet amour était un sacrilège aux yeux de Madeleine qui voyait avec horreur le caractère sacerdotal de celui qu’elle aimait, se dresser comme un obstacle insurmontable entre elle et sa passion. A tout prix, Grandier résolut d’avoir raison de ces résistances: en un jour, il oublia les serments prononcés au chevet d’une mère mourante, les promesses solennelles faites au père; il foula aux pieds l’honneur d’une famille dont on l’avait constitué le gardien. Certes, nous n’hésitons pas à dire que cette phase de la vie du curé de Loudun a été des plus criminelles et des plus lâches.
Cette longue résistance de Madeleine de Brou a quelque chose qui attendrit. Le châtiment devait être si affreux qu’on ne doit pas marchander l’indulgence pour la faute. Par ses souffrances, ses tortures morales, elle inspire une sympathie dont on ne saurait se défendre. Lasse de cette lutte implacable, épuisée par l’excès d’émotions violentes se renouvelant chaque jour, vaincue enfin par la passion et le raisonnement de cet homme, elle finit par se donner à lui en y mettant toutefois le mariage pour condition. Elle croyait la chose impossible, et espérait ainsi apaiser le remords qui la tuait lentement. La pauvre enfant connaissait mal le curé de Saint-Pierre. Il n’était pas homme à reculer devant une semblable difficulté. D’ailleurs, sa passion ne faisait que grandir avec la résistance qu’on lui imposait. Dans un pareil moment, on aurait pu demander à Grandier bien d’autres sacrifices, il les eut volontiers acceptés pour satisfaire son irrésistible penchant.
C’est alors que se posant en novateur hardi, il composa ce fameux traité du célibat des prêtres, œuvre de profonde logique, écrite dans ce style clair et concis dont il avait le secret. Les arguments qu’il employa furent si convaincants, si spécieux, d’une si profonde habileté que fatalement ils emportèrent toute velléité d’opposition de la part de celle qui les avait provoqués. Madeleine dévora fiévreusement ces pages écrites pour elle. Elle était du reste à bout de forces. Comment, en effet, résister à une pareille argumentation: «C’est une maxime constante, lui disait
«Grandier, que personne ne se peut obliger à l’impossible, et si l’on
«s’y oblige, l’impuissance en dispense et rend la promesse vaine.
«Le prestre n’embrasse pas le célibat pour l’amour du célibat, mais
«seulement pour être admis aux ordres sacrés.» Ainsi, Grandier en recevant la prêtrise avait fait ses restrictions; d’avance il était décidé à ne tenir aucun compte de ce qu’on lui imposait; «car,
«ajoute-il, le vœu du prestre ne procède pas de sa volonté, mais
«il lui est imposé par l’Église qui l’oblige, bon gré mal gré à cette
«dure condition sans laquelle il ne peut exercer le sacerdoce». Plus loin il démontre qu’il n’y a point de loi de Dieu qui oblige les prêtres à garder le célibat, et il conclud avec l’apostre saint Paul qu’il
«vaut mieux se marier que de brusler et prend pour lui cette
«parole du Sauveur: il n’est pas bon que l’homme soit seul».
C’était donc un véritable mariage que le curé acceptait. Le Traité du Célibat des Prestres ne laisse aucun doute à cet égard; telle est également l’opinion du médecin Séguin, dans une lettre publiée dans le tome XX du Mercure françois. Mais, nous objectera-t-on, comment ce mariage a-t-il été conclu? Par qui a-t-il été célébré ? Nous répondrons qu’il l’a été en dehors de toutes les lois ecclésiastiques. Une nuit, ces deux êtres s’unirent dans l’église Saint-Pierre, devant le Christ muet témoin de ce sacrilège dans lequel Grandier osait tout être à la fois et le prêtre et l’époux.
Dès lors Madeleine eut la folie de croire que cet homme pouvait lui tenir lieu de tout; elle lui sacrifia son bonheur, son repos, sa réputation, se donna entièrement à lui, acceptant toutes les humiliations, tous les outrages avec le calme et la dignité d’une femme dont la conscience n’est point troublée. Il arriva un jour cependant où les calomnies dirigées contre elle furent si grossières que conseillée par sa famille et surtout par Grandier, elle demanda protection à la justice. L’apothicaire Adam, ce cousin de Trincant, qui n’avait pas craint de faire courir les bruits les plus infâmes sur son compte, fut poursuivi devant le Parlement de Paris et condamné à une très forte amende comme diffamateur.
Mais l’apothicaire avait de puissants protecteurs: le marquis de La Mothe-Chandenier le soutint de tout son pouvoir et se porta caution pour lui d’une somme de dix mille écus. Il en appela donc de la sentence qui le frappait et, malgré les efforts de ses amis, perdit de nouveau son procès et en sortit complètement ruiné. Plus tard cet homme se souvint de cet affront et se vengea cruellement de la pauvre fille.
Reçu de six cents livres tournois prêtées à Madeleine de Brou par Urbain Grandier.
(Collect. Ch. Barbier.)
Toutefois le plus implacable ennemi de Madeleine de Brou, fut l’avocat du roi, Pierre Menuau, nature vulgaire, esprit médiocre, mais homme à passions violentes, qui ayant conçu le projet de l’épouser, l’avait longtemps, et toujours sans succès, poursuivie de ses protestations d’amour. Tenace dans ses opinions parce qu’il y trouvait de grands avantages, Menuau ne s’était point découragé et était revenu constamment à la charge, employant tour à tour ses amis et sa famille pour la faire changer de résolution. Tout fut inutile. Il finit par comprendre que Madeleine en aimait un autre. A tout prix il résolut de connaître son rival et d’en tirer vengeance. Aussi, grande fut sa colère quand il apprit que Madeleine était devenue la bonne amie du curé (c’est ainsi qu’on l’appelait à Loudun). A partir de ce jour, une haine violente fit place aux sentiments d’affection qu’il avait pour elle et il devint un des plus lâches persécuteurs de cette jeune fille.