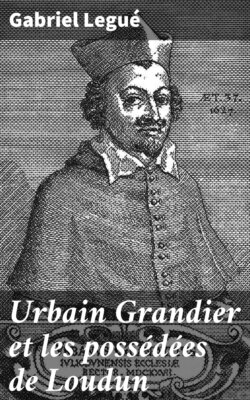Читать книгу Urbain Grandier et les possédées de Loudun - Gabriel Legué - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE PREMIER
ОглавлениеTable des matières
La ville de Loudun en 1617. — Les Catholiques et les Protestants. — État des esprits à cette époque. — Arrivée d’Urbain Grandier à Loudun. — Son portrait. — Origine de la haine des moines contre lui. — Ses démêlés avec les bourgeois de la ville. — Sa conduite envers l’évêque de Luçon.
AU nombre des villes de France qui offrent encore aujourd’hui une fidèle image du passé, se trouve Loudun. Cette ville, restée ce qu’elle était il y a trois cents ans, a conservé le fier et pittoresque caractère d’une cité féodale. Ses murailles toujours debout, ses larges douves, ses créneaux, ses portes où se voit encore la trace des herses, attestent quelle fut jadis sa puissance. Quand on pénètre dans ses rues étroites, tortueuses, mal pavées, on semble égaré dans un autre âge. La plupart de ses maisons accolées sans ordre et sans symétrie n’ont subi aucun changement; mais à côté d’elles se dressent quelques constructions nouvelles, prétentieuses et banales, qui rappellent que la vie moderne a fini par y pénétrer. Sur la place Sainte-Croix l’on voit encore les vieilles masures à piliers de pierre sous lesquelles circulent les passants. Les boutiques des marchands sont petites et basses, la lumière n’y entre que difficilement. Ces boutiques sont encore trop grandes pour le commerce qui se fait à Loudun. Cette ville autrefois si florissante et si peuplée compte à peine quatre mille habitants; maintenant, silencieuse et triste, elle semble abîmée dans le souvenir de son passé. Ses monuments, usés par le temps, témoignent assez du degré de décrépitude dans lequel elle est tombée. Les églises mal entretenues menacent ruine. La population, devenue indifférente, a laissé faire une halle au blé de son plus beau monument: l’église collégiale de Sainte-Croix! Et cependant que de souvenirs dans cette vieille enceinte! Il est impossible de la parcourir sans penser aux usages et aux mœurs d’autrefois, sans évoquer la sombre tragédie dont elle fut le théâtre.
Les annales de Loudun, comme celles de toutes les cités anciennes, offrent le plus grand intérêt. En effet, depuis son origine, qui remonte aux Romains, cette ville, à trois siècles de distance, fut ravagée par les Aquitains et par les bandes anglaises de Jean Chandos. Les ducs d’Anjou et les comtes de Poitou s’en disputèrent longtemps la possession. Mais c’est surtout à l’époque des guerres religieuses que Loudun joua un grand rôle. Peuplée en majeure partie de Réformés, elle offrait par sa position exceptionnelle un sûr asile à ses habitants. Abrités derrière les puissantes murailles de la citadelle, les Huguenots pouvaient tenir longtemps contre les troupes royales. Le château de Loudun passait, en effet, pour une des plus formidables places fortes du royaume. Les Loudunais en étaient fiers, et jamais ils ne pardonnèrent au cardinal de Richelieu le démantèlement de leur vieille forteresse. Détruire le château, n’était-ce pas, aux yeux des habitants, décapitaliser Loudun et lui enlever tout son prestige militaire? Le cardinal l’avait ainsi compris; mais cet acte de haute politique devait avoir de déplorables conséquences; car il ne fit qu’accentuer les haines qui fermentaient entre catholiques et protestants et fut la cause, indirecte il est vrai, du drame auquel cette ville doit surtout sa célébrité.
VEÜE DE LA VILLE ET CHASTEAU DE LOUDUN EN POICTOU
Bibliothèque Nationale (Estampes).
Au temps des guerres religieuses, Loudun eut à subir toutes les horreurs de cette lutte fratricide. Assiégée par les troupes catholiques, elle dut se rendre après une héroïque résistance. Mais les Huguenots, revenus en force, la reprirent et la livrèrent au pillage. Leur fanatisme ne respecta rien. La collégiale de Sainte-Croix, le beau couvent et l’église des Carmes furent incendiés, les statues qui décoraient Saint-Pierre-du-Marché, brisées. Dix ans après, les catholiques prirent une terrible revanche en massacrant les protestants.
L’Édit de Nantes vint enfin mettre un terme à cette malheureuse guerre de religion, en accordant aux Réformés: liberté de conscience et liberté de culte dans l’intérieur des châteaux et dans les villes où ce culte se trouvait établi. En outre, des places de sûreté leur étaient données. Loudun fut du nombre. Henri IV, comme gage de ses bonnes intentions, nomma gouverneur de la ville un de ses plus zélés partisans, Boisguérin, qui, par son attitude à la fois ferme et prudente, sut contenir les esprits.
Dès cette époque, c’est-à-dire au commencement du XVIIe siècle, Loudun était une des villes les plus importantes du Poitou. Capitale du Loudunais, pays de justice royale, elle avait un bailliage, une prévôté, une élection, et un grenier à sel. Quelques années de calme suffirent pour lui faire reprendre son aspect accoutumé. Les familles catholiques ne tardèrent pas à y affluer. Cette ville, alors manufacturière, vit son commerce renaître et sa campagne tant de fois dévastée se couvrit de belles moissons et prouva qu’elle n’avait rien perdu de cette fertilité qui jadis attira dans le Loudunais le conquérant des Gaules.
Henri IV mort, la politique de Marie de Médicis s’accentua davantage dans le sens catholique. Une nouvelle guerre civile sembla dès lors imminente; car le parti protestant entendait faire respecter l’Édit de Nantes que paraissaient oublier les conseillers de la Reine-mère. Toutefois, avant d’en venir à cette extrémité, on chercha des deux côtés à s’entendre. Loudun fut choisi pour le lieu de la conférence. Le prince de Condé et quelques notabilités protestantes s’y réunirent et eurent de nombreuses entrevues avec les délégués de la reine. Après des pourparlers qui durèrent six mois, on finit par conclure la paix sur les bases de l’Édit de Nantes. Il y eut à Loudun de grandes fêtes pour célébrer cet accord si peu sérieux au fond. Les catholiques, une fois les maîtres, ne tinrent point leurs engagements. Loudun perdit bientôt son gouverneur, le protestant Boisguérin, homme d’une haute valeur et d’une grande modération. Son départ fut considéré comme un malheur public. Les habitants, en témoignage de leur estime, l’accompagnèrent jusqu’aux remparts et lui firent de touchants adieux. Tous comprenaient la perte qu’ils faisaient.
Le nouveau gouverneur de Loudun, Jean d’Armagnac, de la branche cadette de cette illustre famille qui joua un si grand rôle en France pendant la guerre de Cent-Ans et sous Louis XI, s’efforça de marcher sur les traces de son prédécesseur. Il devait ce poste à son dévouement pour la cause royale. Le roi Henri, qu’il avait servi avec intelligence, le combla de faveurs et lui accorda, en 1593, la survivance de la charge de son premier valet de chambre. Louis XIII le traitait également en ami. C’est grâce à l’influence de d’Armagnac, comme nous le verrons dans la suite, que le magnifique château de Loudun dut de rester debout dix années de plus.
Le choix de d’Armagnac pouvait à la rigueur contenter tout le monde à Loudun. Ses efforts pour maintenir la bonne intelligence entre les partis ramenèrent le calme, en apparence du moins; car les réformés ne se faisaient pas illusion sur la gravité de leur situation. Ils voyaient avec regret les catholiques multiplier partout les couvents et les carmes, les cordeliers, les frères de saint-Mathurin reprendre possession de leurs monastères. Les capucins, aidés du père Joseph, si connu sous le nom d’Éminence grise, vinrent s’établir dans la ville. De toutes parts et en peu de temps s’élevèrent des communautés d’hommes et de femmes. Cet envahissement d’une ville protestante par l’élément catholique était assurément de nature à semer la division.
Au bout de quelques années la population catholique s’accrut d’une façon remarquable. Le gouvernement royal avait tout employé pour parvenir à ce résultat. Les fonctions publiques furent systématiquement données aux catholiques. On évinça tant qu’on put les Réformés. Tous les magistrats, et ils étaient nombreux à Loudun, furent choisis dans le parti royaliste. La ville, dès l’année 1617, recélait dans son sein quantité d’huissiers, d’avocats, de notaires et de procureurs, tous bien faits pour entretenir la chicane et les dissensions dans une cité qui avait si grand besoin de repos.
La bourgeoisie était nombreuse et composée en grande partie de fonctionnaires, de riches propriétaires et de quelques gentilshommes trop peu favorisés de la fortune pour aller vivre à la cour.
Le clergé séculier, également en grand nombre, avait peu d’influence dans la ville. Cependant on aimait à le recevoir dans les familles et on le considérait comme faisant partie de la bourgeoisie.
Loudun possédait deux paroisses, Saint-Pierre-du-Marché et Saint-Pierre-du-Martrai, une collégiale de chanoines et des prêtres libres. On pourrait supposer qu’avec de pareils éléments religieux les bonnes mœurs étaient en honneur dans la cité. Il n’en était rien. Les Loudunaises du XVIe et du XVIIe siècle, femmes légères et faciles, avaient sur ce point une réputation dès longtemps établie. Rabelais, qui les connaissait bien, a écrit quelque part «que le diable en montrant au fils de Dieu tous les royaumes «du monde se réserva comme son domaine Chatelleraut, Chinon, «Domfront et surtout Loudun».
Ainsi, la population de la ville était, au XVIIe siècle, extrêmement divisée. D’un côté les protestants, de l’autre les catholiques. Les premiers en majorité, mais les seconds ayant pour eux la haute protection du roi et le bénéfice des fonctions publiques. En apparence, les protestants semblaient s’accommoder de ce genre de vie, mais au fond leur haine pour les catholiques était toujours vivace. L’intolérance de leurs adversaires ne contribuait pas peu à entretenir les esprits dans ces haineuses dispositions. Les moines qui se livraient à la prédication faisaient retentir les églises de malédictions contre les Réformés. Leur influence était grande et le clergé séculier se trouvait relégué au second plan. Par les femmes dont ils étaient confesseurs, la domination spirituelle de la vieille cité leur appartenait sans conteste, le clergé n’ayant jamais eu l’habileté de la leur disputer
A cette époque les jésuites commençaient à exercer en France une certaine prépondérance. Soutenus par la Reine-mère, ils avaient créé de nombreux collèges dont la réputation s’était étendue en peu de temps dans tout le royaume. Ils étaient venus s’implanter dans le Poitou, où non seulement ils faisaient une rude guerre aux protestants, mais où ils cherchaient encore à saper l’autorité épiscopale.
Ils s’installèrent également à Loudun; on comprend dès lors de quel œil jaloux ils virent la haute situation acquise par les moines. Leur esprit de domination, déjà si âpre, ne pouvait guère supporter cette suprématie des autres ordres, et ils résolurent d’y mettre un terme. La mort du curé de Saint-Pierre-du-Marché, M. de Laval, homme faible et incapable, survenue sur ces entrefaites, vint seconder leurs desseins. S’appuyant, en effet, d’une part sur une bulle du pape Paul V qui autorisait la réunion de leur collège de Poitiers au prieuré de Notre-Dame du château de Loudun, et d’autre part sur leur privilège de présenter les candidats au poste de curé des deux paroisses de la ville, ils choisirent et firent nommer à la cure vacante de Saint-Pierre-du-Marché un de leurs meilleurs élèves. Avec le nouveau-venu les choses allaient bientôt prendre une autre face. Celui qui devait en peu de temps bouleverser la ville de Loudun et lui donner une si triste célébrité s’appelait Urbain Grandier.
Il était né, en 1590, dans une villa que sa famille possédait à Bouère, bourg important situé près de Sablé, dans le diocèse du Mans. Son père remplissait honorablement à Sablé les fonctions de notaire royal et ses parents du côté maternel appartenaient à la petite noblesse du pays. Jeanne Renée d’Estièvre, sa mère, était fille de Gilles d’Estièvre et de Barbe de la Monnerie. Par elle, Grandier était parent du célèbre théologien Nicolas Gautier et de Gilles Ménage, le savant historien de la ville de Sablé.
Tout enfant il annonçait les plus heureuses dispositions; aussi ses parents, qui étaient dans une situation aisée, ne négligèrent-ils rien pour donner à leur aîné (Urbain avait trois frères et deux sœurs) une brillante éducation. Un de ses oncles, Claude Grandier, docte chanoine de Saintes, étant venu à Sablé, fut frappé de l’intelligence de son neveu et l’emmena en Saintonge pour lui faire faire ses humanités; puis, voulant achever dignement des études brillamment commencées, il le confia aux pères jésuites qui avaient à Bordeaux un collège des plus renommés. — Urbain réalisa toutes les espérances qu’il avait données dans son enfance. Le collège de Bordeaux le compta bientôt au nombre de ses meilleurs élèves. Ses maîtres mirent tout en œuvre pour le décider à entrer dans les ordres. Il fut comblé de bienfaits et s’en montra digne. A vingt-cinq ans, Grandier recevait la prêtrise; mais, désireux de s’instruire, il resta deux ans encore au noviciat des jésuites. Ce fut vers la fin de juillet 1617 que ceux-ci, pour récompenser leur élève et lui prouver toute l’estime que ses talents et ses belles qualités leur avaient inspirés, le désignèrent pour la cure de Saint-Pierre-du-Marché de Loudun: puis, non contents de ce premier témoignage de sympathie, obtinrent encore pour lui le titre de chanoine prébendé dans l’église collégiale de Sainte-Croix.
Le nouveau curé vint au commencement du mois d’août 1617 prendre possession de son poste. Il était accompagné de toute sa famille qu’un deuil récent venait de frapper dans la personne de son chef, Pierre Grandier. Atteinte dans ses plus chères affections, Jeanne d’Estièvre ne voulut point rester à Sablé, qui lui rappelait de trop douloureux souvenirs. Elle suivit à Loudun l’aîné de ses enfants. Grandier, en fils respectueux et reconnaissant, entoura de soins son excellente mère, fit nommer, en qualité de premier vicaire de Saint-Pierre, son frère François, et obtint pour René, jeune homme plein d’intelligence et de talent, une charge de conseiller au bailliage.
Tout semblait sourire à cette famille à son arrivée à Loudun, mais elle avait compté sans les envieux. Tant de faveurs accumulées à la fois sur la tête d’un prêtre jeune et surtout étranger au pays avaient froissé quelques-uns de ses confrères. Il y eut d’abord contre lui une sourde hostilité et on attendit impatiemment l’occasion de lui déclarer la guerre. Elle ne se fit pas longtemps attendre. Dès son arrivée à Loudun, Grandier avait entamé avec les moines cette lutte d’intérêts et d’influence qui devait lui créer d’impitoyables ennemis. Doué d’un extérieur des plus séduisants, grand, bien fait, toujours mis avec élégance, le nouveau curé sut vite conquérir les sympathies de la population féminine. «Il
«avait le port grave, dit un de ses contemporains, et une certaine
«majesté qui le rendoit et sembloit orgueilleux. On l’a toujours
«admiré pour son éloquence et sa doctrine.» Tout, en effet, dans sa personne, respirait un charme inexprimable, et, en le voyant, on ne pouvait s’empêcher d’être séduit. Il avait les yeux noirs, le nez un peu long, mais finement modelé, la bouche bien faite. Suivant la mode du temps, il portait la moustache et la barbe en pointe. La voix était harmonieuse et admirablement timbrée.
«Il avoit de grandes vertus, nous apprend Ismaël Boulliau
«dans une lettre à Gassendi demeurée célèbre, mais accompa-
«gnées de grandz vices, humains néantmoins et naturels à
«l’homme. Il estoit docte, bon prédicateur, bien disant, mais il
«avoit un orgueil et une gloire si grande que ce vice luy a faict
«pour ennemys la pluspart de ses paroissiens et ses vertus lui
«ont accueilly l’envie de ceux qui ne peuvent paroistre vertueux
«si les séculiers ne sont diffamez parmy le peuple».
Jeune et plein d’inexpérience, Grandier fut grisé par le succès. De bonne heure, il se montra récalcitrant à tous les avis, rebelle à toutes les concessions. Il fallait l’entendre, en chaire, cribler de ses sarcasmes les capucins et les cordeliers, railler les carmes au sujet de leur Vierge qui faisait des miracles dont les excellents pères tiraient grand profit. Il fit une guerre acharnée à tous les abus, trouvant matière à critique dans tous les actes de ses prédécesseurs. Dans cette lutte contre les moines, il se montra impitoyable et bientôt son ironie et ses dédains jetèrent l’épouvante au cœur des couvents. Jamais à Loudun la chaire de vérité n’avait retenti d’aussi éloquentes colères. Avec un tel chef, le clergé séculier reprenait le dessus. Grandier résolut de porter un dernier coup à ses adversaires en leur enlevant leurs pénitentes.
Un dimanche, attaquant plus vivement encore les moines que de coutume, il prêcha sur l’obligation de se confesser à son curé. Ce sermon était inutile; car, depuis son arrivée, les Loudunaises avaient déserté le confessionnal des moines et s’en étaient allées confier leurs péchés au beau curé de Saint-Pierre. Bientôt on se disputa l’entrée de son église et de son presbytère, et quelques-unes, dit la chronique scandaleuse, en sortirent avec un péché de plus sur la conscience. Les femmes aimaient ce rude jouteur si hardi à l’attaque et si habile à la riposte. Elles voyaient en lui un maître bien plus qu’un pasteur. Lui, de son côté, ne demandait pas mieux que de les consoler et de les aimer. «On l’accusoit,
«dit Champion, son contemporain, de fréquentation de filles et
«de femmes et de jouyr de quelques veuves d’assez bonne fa-
«mille; et de cela il y avoit de grandes apparences. Toutefois
«il estoit discret en ses actions, sage en compaignie et ses paroles
«ne témoignoient rien de lascif ni d’amoureux.»
Par les femmes Grandier eut accès dans toutes les maisons de la ville. Ce fut un véritable engouement qu’il sut mettre à profit. Comment ne pas aimer un causeur aussi aimable et aussi spirituel? Comment résister à cet éloquent qui savait prendre tous les tons avec une facilité sans égale? De plus, il avait de sérieuses qualités, était bon et charitable et tenait sa bourse toujours ouverte aux pauvres et à ses amis. On y pouvait puiser à discrétion. Autant il mettait d’orgueil, nous dirons même d’insolence, à attaquer ses ennemis, autant il mettait de modestie à rendre service. Son nom, on le comprend, fut bientôt dans toutes les bouches et dans bien des cœurs.
Certes, ce n’est pas impunément que l’on prend, en province, dans l’opinion publique une place exceptionnelle. La célébrité, plus encore que la fortune, a ses détracteurs. Elle place l’homme qui, par ses talents, a su s’élever au-dessus de tout ce monde vulgaire et envieux dont pullulent les petites villes, dans une situation telle, que chacun s’arroge le droit de jeter des regards indiscrets sur sa vie privée. Par son caractère et sa situation, le curé de Saint-Pierre devait, plus que tout autre, devenir la victime d’une telle inquisition. Ne pouvant être attaqué en face, on l’espionna avec une rare ténacité, et, à force de patience, on finit par découvrir ses secrets les plus intimes dont on se fit une arme terrible contre lui. Les femmes, qui avaient tant contribué au succès de Grandier, devinrent l’instrument de sa perte. Avec elles il ne sut malheureusement pas garder la réserve que devait lui inspirer son ministère. On dit qu’il les eut presque toutes à discrétion. Les laides et les vieilles purent seules se vanter de n’avoir pas capitulé. S’il porta réellement la désolation dans un grand nombre de ménages, il est à présumer cependant que jamais il ne ne se rendit coupable de tous les méfaits dont on l’accusait. Tout, d’ailleurs, fut jugé bon par ses ennemis contre lui: son penchant pour les femmes, les lettres anonymes aux maris soi-disant trompés, la calomnie poussée à l’extrême. Les uns s’y laissèrent prendre, les autres déchirèrent avec dégoût les lettres révélatrices.
Parmi ceux qui mirent le plus d’acharnement à poursuivre Grandier se trouvait un homme riche et considéré à Loudun, le sieur Moussaut du Fresne. A lui aussi on avait écrit que sa femme entretenait des relations avec le curé. Le fait était complètement faux; mais Moussaut, homme violent et jaloux, ajouta foi à cette calomnie et une nuit, ayant rencontré Grandier dans la rue, il supposa qu’il sortait de sa propre demeure; dans sa fureur, il fondit sur lui l’épée à la main et lui fit de graves blessures. Grandier fut transporté à son domicile à moitié mort et ne dut qu’aux bons soins de sa mère et de sa sœur de revenir à la santé. Cette affaire fit peu de bruit, parce que des deux côtés on tenait à éviter le scandale. Moussaut fut cependant bien vite détrompé. Ce n’était point pour sa femme, laide et revêche créature, que le curé s’attardait hors de son presbytère. Mais il n’en resta pas moins un de ses adversaires les plus implacables. Quant à Mme Moussaut, elle ne pardonna jamais à Grandier de s’être trompé de porte.
Un magistrat de la ville, René Hervé, lieutenant criminel, manifestait également pour le curé de Loudun une animosité qui ne faisait que grandir chaque jour. Peut-être y avait-il encore là quelque galante histoire; car Hervé possédait, en qualité de gouvernante, une gentille cousine qui était loin de partager pour le curé la répulsion de son parent. Quoi qu’il en soit, le lieutenant criminel, croyant s’apercevoir des sentiments de sa cousine, entreprit contre Grandier une série ininterrompue de tracasseries, ne perdant jamais une occasion de lui être désagréable et même de le froisser publiquement.
Certain dimanche de l’année 1618, le curé de Saint-Pierre avait été chargé par les jésuites de Poitiers d’aller prêcher dans l’église Notre-Dame-du-Château et d’y conduire processionnellement ses paroissiens. Au milieu d’un grand concours de peuple, le cortège arriva à la porte de l’église, où se trouvait une chaire à prêcher. Grandier, jugeant plus convenable de parler à la foule de l’intérieur de l’église donna l’ordre de rentrer cette chaire et de la placer dans la nef. Maisle lieutenant criminel s’y opposa. L’orgueilleux Grandier, devant une pareille prétention, ne peut se contenir, il monte dans la chaire et, en présence de tout le peuple assemblé, adresse à Hervé de violents reproches et lui lance les épithètes les plus caustiques. Celui-ci, dont la fureur ne connaît plus de bornes, répond sur le même ton, injurie grossièrement le curé, lui montre le poing et excite deux misérables, ses créatures, à le jeter hors de la chaire. Grandier put heureusement s’échapper des mains de ces forcenés et se réfugier dans l’église dont il fit fermer les portes.
L’affaire devait avoir des suites. Le curé porta plainte devant le présidial de Loudun qui lui donna gain de cause. Le lieutenant criminel fut sévèrement blâmé de son algarade et menacé de peines plus rigoureuses, si, à l’avenir, pareil fait se renouvelait.
Telle était la situation que s’était créée Grandier à Loudun, quand un événement vint prouver à quel point son orgueil était parvenu. On devait célébrer à Sainte-Croix une grande fête religieuse suivie d’une procession solennelle à travers la ville. Tous les dignitaires ecclésiastiques du Loudunais furent convoqués pour cette circonstance. Le prieur de l’abbaye de Coussay, qui n’était autre que le fameux évêque de Luçon, alors en disgrâce s’y trouva. Malheureusement, le rang qu’avait pris M. de Luçon souleva une question de préséance entre lui et le curé de Saint-Pierre. Il semblait, en effet, assez naturel qu’un évêque eût le pas sur un curé. Mais Grandier était chanoine de la collégiale de Sainte-Croix et ce titre lui donnait le droit de préséance sur le prieur de Coussay. Tout autre que lui eût fait preuve de modestie et de bon goût, en laissant M. de Luçon au premier rang. Déjà l’évêque avait pris sa place, quand le curé de Saint-Pierre vint fièrement revendiquer ses droits. Il y eut un moment de tumulte. Personne ne pouvait croire à tant d’audace. L’évêque fut le premier stupéfait; mais, en homme bien élevé, il céda la place. Cet affront fait devant toute une population ne devait point être oublié. On sait combien celui qui, plus tard, devait s’appeler le cardinal de Richelieu, avait la mémoire des injures.