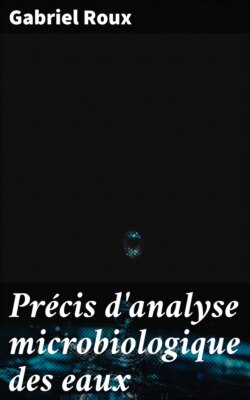Читать книгу Précis d'analyse microbiologique des eaux - Gabriel Roux - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LE LABORATOIRE D’ANALYSES MICROBIOLOGIQUES DES EAUX
ОглавлениеMatériel indispensable. — Four Pasteur. — Autoclave de Chamberland. Entonnoir à filtrations chaudes. — Etuves à incubation — Régulateurs. — Appareils de verrerie. — Instruments divers. — Réactifs et matières colorantes. — Stérilisation de l’eau.
Je veux, dans ce très court chapitre, établir l’inventaire du laboratoire du bactériologue qui désire pratiquer des analyses d’eau. La plupart des appareils, des instruments ou des objets de verrerie dont il aura à faire usage étant décrits avec détail dans le Traité de bactériologie du professeur Macé, de Nancy, comme dans les autres manuels de microbie, je serai très bref à leur sujet.
La condition essentielle qu’il s’agit de réaliser ici est l’asepticité parfaite, absolue, des récipients et des milieux de culture.
Il est aujourd’hui facile de répondre rapidement et sûrement à ce double desideratum.
Tous les récipients de verre: ballons, flacons, tubes à essai, pipettes, etc., seront, après avoir été munis à leur extrémité libre d’un fort tampon de ouate ordinaire, flambés au four Pasteur (fig. 2), dont on peut en quelques minutes élever la température à 150° et même 200° C. Avant d’y être placés, tous les objets de verrerie doivent, au préalable, avoir été lavés avec grand soin à l’eau acidulée, puis à grande eau et égouttés.
FIG. 2. — Four de Pasteur, pour flamber les ballons.
Les bouillons ou les substrata solides qui constitueront es milieux nutritifs de culture des bactéries, l’eau distillée qui servira à faire les dilutions devront toujours être placés dans des récipients flambés, comme il vient d’être lit, et seront stérilisés à l’autoclave de Chamberland fig. 3), sorte de marmite de Papin dont l’usage est aujourd’hui généralisé dans tous les laboratoires. La température peut, dans cet appareil, être élevée sous pression à 115°-120° C.; elle suffit, maintenue pendant quinze à vingt minutes pour détruire toutes les bactéries à la phase végétative et même à l’état de spores.
FIG. 3. — Autoclave de Chamberland.
Il est parfois nécessaire, lorsqu’il s’agit, par exemple, des milieux à la gélatine, de ne pas dépasser, dans l’opération de la stérilisation, une température de 100° et d’éviter des pressions supérieures à la pression atmosphérique. C’est dans ce but qu’ont été inventés les poêles à vapeur de Koch (fig. 4), de Chantemesse, etc. Il est possible de se passer de ces nouveaux appareils et d’utiliser, dans ces cas spéciaux, l’autoclave, en ayant soin de maintenir ouvert le robinet qui existe sur son couvercle pour permettre à la vapeur de s’échapper au fur et à mesure de sa production. L’autoclave se trouve alors transformé, à condition que l’ouverture du robinet soit assez large, en un véritable poêle à vapeur, où la température ne dépasse guère 100° C., tandis que la pression intérieure reste égale à celle de l’air ambiant.
FIG 4. — Stérilisateur à vapeur de Koch
FIG. 5. — Etuve de Pasteur.
FIG. 6. — Nouvelle étuve auto-régulatrice de d’Arsonval.
La description et le mode de fonctionnement de ces deux instruments fondamentaux étant donnés dans tous les livres de bactériologie, je renvoie à ceux-ci le lecteur, et particulièrement à l’excellent Manuel de Macé.
Il faudra encore dans le laboratoire du bactériologue analyste, parmi les grosses et coûteuses pièces, deux ou trois étuves à incubation.
Sans parler de celles très vastes, très commodes, mais aussi d’un prix très élevé, qui portent les noms de Pasteur (fig. 5) et de A. Gautier, je conseillerai celle d’Arsonval, nouveau modèle, qui a son régulateur propre (fig. 6), et, mieux, celles de Babès (fig. 7), de Hueppe qui m’ont rendu les plus grands services, ou même, à défaut, celles de Gay-Lussac, dont on se sert dans les laboratoires de chimie.
Ce qui constitue l’excellence d’une étuve, c’est son régulateur, car il peut être indispensable parfois d’avoir une température presque absolument invariable.
Je suis heureux de pouvoir décrire ici un de ces régulateurs, que j’utilise depuis plusieurs années, dont j’ai toujours été très satisfait et qui constitue une très heureuse modification apportée au régulateur à éther de M. le professeur Chauveau, par M. Ch. Pittion, préparateur au laboratoire de clinique médicale de M. le professeur Bondet, à la Faculté de médecine de Lyon (fig.8).
Si j’entre dans quelques détails au sujet de la construction de ce régulateur, dont la description n’a encore été donnée nulle part, bien que plusieurs laboratoires lyonnais le possèdent depuis longtemps, c’est parce qu’un expérimentateur quelque peu familiarisé avec le travail du verre peut lui- même le fabriquer, dans un laboratoire muni d’une lampe d’émailleur .
FIG. 7. — Grande étuve, modèle Babès, à deux compartiments.
Le fonctionnement du régulateur représenté par la figure ci-jointe repose sur la tension des vapeurs de l’éther; il convient donc très bien pour les températures supérieures au point d’ébullition de ce liquide (34°,5). Cet instrument n’est qu’une modification de celui que Chauveau a inventé et dont il a doté son laboratoire, il y a quelques années. Le régulateur de Chauveau était composé de deux parties distinctes, l’une fixe et plongeant dans l’eau de l’étuve, c’était un réservoir barométrique à mercure; l’autre, mobile dans le sens vertical, exigeait l’emploi d’un support spécial; on réunissait les deux pièces par un tube en caoutchouc rempli de mercure. L’ensemble constituait un appareil quelque peu encombrant et fragile. Celui de M. Pittion est d’une seule pièce et de construction facile.
FIG. 8. — Régulateur à mercure et éther, de M. Pittion.
Il se compose (fig. 8) d’un tube de verre A dont le calibre présente deux rétrécissements, le premier a au tiers de la longueur, le deuxième b commence au second tiers; à partir de b, le tube va en s’effilant jusqu’à son extrémité inférieure, où il ne possède plus qu’une lumière très étroite. Au point b est soudé un tube beaucoup plus large, fermé et arrondi à sa partie inférieure; le réservoir R communique librement avec le tube A. La partie supérieure du tube A est fermée par un bouchon percé d’un trou pouvant admettre à frottement un second tube B, de petit diamètre, rétréci à celle de ses extrémités qui plonge dans la lumière du tube A, soudé par l’autre extrémité à un tube transversal librement ouvert; l’ensemble de cette pièce a la forme d’un T présentant trois orifices. Enfin, dans le tube A, à deux centimètres environ de l’extrémité supérieure, s’ouvre une tubulure latérale C, portant elle-même une tubulure plus petite; cette dernière est réunie à l’une des branches supérieures du tube B par un petit tube en caoutchouc muni d’un robinet.
A l’aide d’une pipette recourbée, on a fait passer dans le réservoir R, rempli de mercure, quelques gouttes d’éther qui, en raison de leur densité, sont venues se rassembler à la partie supérieure r.
Le régulateur, ainsi constitué, est prêt à fonctionner. On le met en place en observant que le réservoir R soit complètement immergé dans le liquide de l’étuve. On réunit l’extrémité libre G du tube mobile au robinet du gaz, et, à l’aide d’un tube en caoutchouc, on fait communiquer l’extrémité de la tubulure latérale h avec le brûleur. Le fonctionnement et le réglage sont des plus simples. Le gaz arrive en G, passe librement dans le tube A, et de là arrive au brûleur par la tubulure C. L’étuve s’échauffe peu à peu. Dès que la température de 35° est atteinte, l’éther entre en ébullition; les vapeurs formées refoulent le mercure qui, ne trouvant pas d’autre issue, s’élève dans le tube A d’une quantité d’autant plus grande que la température est plus élevée. Lorsque le thermomètre accuse la température choisie, on abaisse le tube B jusqu’à ce que l’extrémité d arrive au contact du mercure. Aussitôt, le passage du gaz étant obstrué, le brûleur s’éteint. Pour éviter ce phénomène, qui nécessiterait des rallumages très fréquents, on a ouvert très légèrement le robinet O; le gaz, ne pouvant plus passer en d, trouve par là une issue et peut encore arriver au brûleur, où il donne une flamme très petite et incapable à elle seule d’exercer aucune influence sur la température de l’étuve. Cette température, par suite de l’extinction partielle du brûleur, baisse au bout de peu de temps; une partie des vapeurs d’éther formées se condense, le mercure descend et démasque l’orifice d; aussitôt un nouvel afflux de gaz se produit et se manifeste par une élévation de la flamme qui sera suivie bientôt d’un nouvel abaissement.
Lorsqu’il s’agit de régler l’étuve à une température supérieure à 78°, on remplace l’éther du réservoir par de l’alcool absolu.
Ce régulateur, on le comprend aisément, ne peut fonctionner au-dessous de 35° point d’ébullition de l’éther; aussi, pour les étuves devant être réglées à 20°, je recommande particulièrement le régulateur à mercure de Chancel (fig. 9), présenté par les Allemands dans leurs catalogues ou leurs livres sous le nom de Reichert.
Un entonnoir à filtrations chaudes (fig. 10) est indispensable pour la confection de la gélatine-peptone et des milieux à la gélose (agar-agar).
Des ballons de contenance variable, des tubes à essai de différents diamètres, des plaques de verre semblables à celles qu’a préconisées Koch, avec leur support à vis calantes, des cloches de verre, des éprouvettes graduées de différents calibres, des verres de montre et des capsules de porcelaine, quelques flacons d’Erlenmeyer, des capsules de Rietsch, dites de Pietri, des pipettes longuement effilées, complètent le matériel de verrerie le plus communément employé.
J’indiquerai encore dans cette nomenclature générale les fils de platine droits ou recourbés en crochet ou en anse à leur extrémité libre (fig. 11) (öse des Allemands), emmanchés dans une baguette de verre plein, les pinces de divers calibres, les lames (porte-objets) et lamelles (couvre-objets, covers) pour les examens microscopiques et enfin le microscope lui-même qui doit, par sa composition optique, donner au moins 700 diamètres et présenter la perfection la plus grande de ces sortes d’instruments, tant au point de vue de la pénétration que de la clarté.
FIG. 9. — Régulateur à mercure, de Chancel.
FIG. 10. — Appareil à filtration à chaud.
FIG. 11. — Aiguille en fil de platine.
Quelques appareils spéciaux restent encore dont la description trouvera plus logiquement sa place dans les chapitres où il sera question de tel ou tel procédé d’analyse .
Une chambre claire, et particulièrement celle d’Oberhauser qui permet de dessiner sur un plan horizontal, n’est pas indispensable, mais elle rendra, à celui qui pourra l’avoir, les plus grands services; son prix est, au reste, peu élevé. Il est nécessaire d’avoir aussi un certain nombre de thermomètres, les uns étalons pour le réglage des étuves, d’autres destinés à prendre la température des animaux en expérience, d’autres enfin tout à fait ordinaires.
Avec le matériel relativement restreint que je viens d’indiquer, un bactériologue quelque peu au courant de la technique des laboratoires de microbiologie pourra, sans grande dépense, pratiquer l’analyse biologique d’une eau quelconque au point de vue quantitatif, et même, avec de très simples instruments supplémentaires, tels que seringues à injection, appareil de contention pour lapins (fig. 12), etc., et quelques animaux, la compléter au point de vue qualitatif et expérimental.
Les réactifs dont on aura à faire usage sont les mêmes que ceux employés en Microbie générale, je me contente d’en énumérer les principaux: Alcool, éther, eau distillée, stérilisée, acides nitrique et sulfurique, acide phénique, liquide de Gram, couleurs basiques d’aniline et plus spécialement: violet de gentiane, fuschine, bleu de méthylène, chrysoïdine, etc., quelques couleurs acides comme l’éosine, de l’essence de girofle ou de bergamote, du baume de Canada dissous dans le Xylol, Thymol, etc., papier de tournesol, ouate ordinaire, capuchons de caoutchouc, étiquettes gommées, filtres en papier, etc.
FIG. 12. — Appareil de Czermak. La figure supérieure donne les détails de l’appareil, la figure inférieure montre un lapin immobilisé (Cl. Bernard)
Je suppose, bien entendu, le lecteur familiarisé avec la technique bactérioscopique générale et je n’entre dans aucun détail sur la préparation des milieux de culture, leur stérilisation, la manière d’opérer les. ensemencements, de pratiquer les colorations et les examens microscopiques. Je renvoie le débutant auquel cette technique serait étrangère aux nombreux ouvrages de bactériologie français et étrangers qui ont été publiés dans ces dernières années.
Je recommande particulièrement, en ce qui concerne ceux écrits ou traduits dans notre langue, en première ligne: le Traité pratique de bactériologie de E. Macé, dont une seconde édition parait en ce moment chez J.-B. Baillière et fils, puis l’œuvre considérable de Cornil et Babès: les Bactéries, qui en est à sa troisième édition (1890), la Technique microbiologique de Hueppe et Van Ermengem, traduite en Belgique, et son complément: les Microorganismes, de C. Flügge, traduit par le docteur F. Henrijean (Bruxelles, 1887). Enfin, parmi les manuels plus modestes, je citerai: le Précis de Microbie de Thoinot et Masselin (1889) et la Technique élémentaire de Bactériologie de Salomonsen, traduit par le docteur Ray. Durand-Fardel (Paris, 1891).
Je crois devoir, à propos du matériel du laboratoire de l’analyste, donner ici quelques-uns des procédés destinés à fournir l’eau stérilisée dont on a, à chaque instant, besoin et parfois en grande quantité.
L’eau peut être rendue aseptique à froid ou à chaud.
A froid, c’est grâce surtout à la filtration à travers les bougies du système Chamberland, que l’on obtient de l’eau microbiquement pure.
La figure 13 représente une bougie Chamberland isolée renfermée dans un cylindre métallique résistant dont la partie supérieure se visse au robinet de la canalisation; l’eau arrive dans ce cylindre purgé d’air au préalable, passe à travers le biscuit, gagne la paroi intérieure de la bougie dans un état de pureté parfaite et peut être, pour les besoins du laboratoire, recueillie goutte à goutte, à condition que le tube d’amenée ait été préalablement stérilisé, dans un flacon flambé et bouché à la ouate.
FIG. 13. — Filtre Chamberland à une bougie.
Si l’on veut obtenir des filtres Chamberland ce qu’ils doivent donner, c’est-à-dire un liquide rigoureusement aseptique, il faut avoir soin d’essayer d’abord la bougie à la pompe à air pour vérifier si elle ne présente pas de fêlures, la stériliser ensuite à l’autoclave avant la mise en service et répéter de temps à autre cette opération après usage, après avoir pris la précaution de brosser énergiquement sa surface extérieure.
La stérilisation à chaud s’opère en petit, dans les laboratoires, dans l’autoclave Chamberland ou des récipients, préalablement flambés au four Pasteur, bouchés à la ouate ou au liège et contenant la quantité d’eau nécessaire, sont exposés pendant vingt minutes ou demi-heure, à une température de 115°.
FIG. 14. — Ballon-pipette Chamberland.
On peut, afin de rendre plus commode la répartition de cette eau dans les ballons, tubes ou flacons dans lesquels se feront plus tard les dilutions, se servir du ballon-pipette Chamberland représenté par la figure 14 dans lequel le liquide pourra être plus facilement conservé à l’abri de tous germes.
MM. Rouart et Geneste-Herscher ont construit pour obtenir en grand la stérilisation des eaux suspectes un appareil assez compliqué (fig. 15) que je ne représente et décris ici que parce qu’il pourra rendre de
A. chaudière; B. échangeur; C. complément d’échangeur; D. classificateur; E. arrivée d’eau à stériliser; F. sortie de l’eau stérilisée; G. foyer; H. manomètre; I. niveau d’eau.
signalés services dans certaines localités affligées. d’épidémies dues à l’eau potable.
FIG. 15. — Appareil de MM. Rouart, Geneste et Herscher, pour stériliser les eaux à haute température.
Cet appareil se compose d’une chaudière A, d’un échangeur B, d’un clarificateur D et, quand cela est nécessaire, d’un complément d’échangeur C. La chaudière est formée d’un serpentin E dans lequel circule l’eau à purger de germes et d’un petit réservoir A servant de régulateur. L’échangeur consiste en un serpentin F dans lequel passe l’eau stérilisée; ce serpentin est enfermé dans un récipient B parcouru par l’eau à stériliser; le complément d’échangeur C comprend aussi un serpentin faisant suite à l’échangeur B et placé dans un réservoir ouvert à sa partie supérieure; enfin, le clarificateur D est tout simplement un appareil filtrateur formé de couches de gravier superposées destinées à arrêter au passage les matières ténues en suspension dans l’eau portée à haute température.
L’eau de la canalisation, amenée par un robinet dans le tube E, pénètre dans le récipient B, puis se dirige, suivant les flèches, en passant par le tube en S,EE, dans le serpentin de chauffage disposé dans l’intérieur du fourneau; durant ce parcours l’eau est portée à une haute température et pénètre dans la petite chaudière, puis en ressort par la tubulure FF, traverse le serpentin de l’échangeur, le complément d’échangeur C si cela est nécessaire et enfin se clarifie à travers le filtre de sable D.
La stérilisation est opérée à une température variant entre 115° et 130°, et il suffit de 1 kilogramme de charbon pour stériliser 100 litres d’eau. Encore une fois, je ne considère pas cet appareil comme faisant partie du laboratoire d’analyses, mais il est bon que le médecin et l’hygiéniste le connaissent, afin de pouvoir s’en servir, le cas échéant, en temps d’épidémie. C’est lui, en effet qui, d’après le docteur Gabriel Pouchet, qui a étudié avec soin son fonctionnement , donne, au point de vue bactériologique surtout, les résultats les meilleurs et les plus constants; pour obtenir, une stérilisation absolue et certaine il suffit de chauffer l’eau dans l’appareil, soit pendant quinze minutes à 120° centigrades, soit pendant dix minutes à 130°.
M. Vinay , dans son excellent manuel d’asepsie, a consacré quelques pages à la stérilisation de l’eau, qui joue, à l’heure actuelle, un si grand rôle en chirurgie et qui, suivant sa pureté ou son état de pollution, peut être une arme à deux tranchants et des plus dangereuses.
Il a montré, en se basant sur ses expériences et celles de M. L. Dor, qu’on ne pouvait avoir une confiance absolue dans toutes les bougies Chamberland, certaines parmi elles présentant de légères défectuosités de fabrication qui suffisent à rendre la filtration presque illusoire; il en est de même de l’ébullition simple. Aussi, accorde-t-il la préférence, pour les besoins de la chirurgie, au procédé de stérilisation de l’eau, tel qu’il a été introduit dans la pratique par M. le professeur Léon Tripier.
On se sert d’un ballon de verre aplati à sa partie inférieure et offrant une capacité de deux litres environ. Il est muni de tubes en verre très courts, dont l’un présente à son extrémité libre un renflement rempli de coton pour la filtration de l’air et dont l’autre reçoit un tube de caoutchouc sur lequel on place une pince de Mohr. On le remplit incomplètement d’eau pour que les deux tubes ne plongent pas dans le liquide. Ceci fait, on le place dans l’autoclave de Chamberland où il est soumis à une température de 120° pendant vingt à vingt-cinq minutes. Lorsqu’on veut se servir de ce ballon, il suffit de l’incliner et de régler l’écoulement de l’eau en pressant plus ou moins sur le tube de caoutchouc. Lorsqu’on veut faire cesser l’écoulement, on place la pince de Mohr et on redresse le ballon; de cette façon, l’air extérieur ne peut entrer librement.
Ce procédé très simple et commode peut aussi être utilisé dans le laboratoire pour avoir constamment à sa disposition l’eau stérilisée dont on a, à chaque instant, besoin.