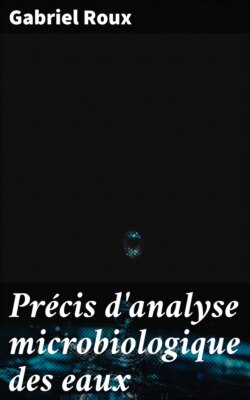Читать книгу Précis d'analyse microbiologique des eaux - Gabriel Roux - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ORIGINE DES MICROBES DES EAUX
ОглавлениеAseptieité théorique des eaux de source. — Origine des eaux atmosphériques et des eaux telluriques. — Circulation atmosphérique. — Circulation terrestre, superficielle et profonde. — Nappe souterraine. — Pureté microbique des atmosphères marines et de montagne. — Comment la pluie se charge de germes. — Pollution du sol superficiel. — Epuration par filtration. — Pureté ordinaire de la nappe souterraine. — Eaux de surface, leur richesse microbienne.
Il est certes bien difficile de se figurer un milieu cosmique absolument dépourvu de microorganismes, puisque ces derniers sont connus même à l’état fossile, dans les houilles ou certaines roches des âges paléozoïques. Cependant l’idéal d’asepticité parfaite existe, et précisément dans l’eau.
Pasteur et Joubert ont démontré depuis longtemps déjà que les eaux de certaines sources étaient pures au sens microbique du mot, que, puisées convenablement, elles ne renfermaient aucun germe vivant et restaient indéfiniment infertiles si on les conservait à l’abri des souillures accidentelles.
Nous pouvons donc, dans l’étude que nous allons entreprendre de l’origine des microbes des eaux, avoir une base solide d’orientation et un point de départ qui n’a rien de conventionnel ni de théorique.
Etant donné ce fait acquis: que les eaux de la nappe souterraine, à une certaine distance de la surface du sol, sortent de ce sol dépourvues de tout germe vivant, il sera plus facile de nous rendre compte des causes essentiellement nombreuses et variées de leur pollution.
Un rapide coup d’œil sur l’origine même de nos eaux potables est nécessaire ici.
On sait qu’une circulation incessante de l’eau sous ses différentes formes existe: entre la terre d’une part et l’atmosphère de l’autre, et réciproquement, de façon à représenter un circuit fermé.
Par évaporation, laquelle est plus ou moins intense suivant les lieux, les saisons et les climats, suivant aussi l’état de la température et de la pression barométrique, l’eau, sous forme de vapeur, est constamment restituée à l’atmosphère et cela surtout dans le voisinage des grandes masses liquides telles que les océans, les mers, les lacs, etc. Cette vapeur, qui peut acquérir une tension plus ou moins forte, persiste en cet état jusqu’ au moment où, rencontrant un condensateur, lequel est représenté ordinairement par une montagne d’élévation variable, elle passe à l’état de nuages (forme vésiculaire) lesquels, emportés par les vents, vont bientôt se résoudre en pluie ou en neige suivant la température. Comme la neige, sauf sur les plus hauts sommets, est toujours destinée à fondre tôt ou tard et à donner de l’eau liquide, c’est cette dernière que nous allons maintenant suivre à la surface ou à l’intérieur du sol.
Toute eau qui atteint la surface émergée du globe terrestre s’y divise dès l’abord en deux parts d’inégale valeur, suit deux routes différentes qui, en fin de compte, aboutissent, comme nous le verrons, dans un laps de temps plus ou moins long, à un réservoir commun: l’Océan.
De ces deux trajets terrestres l’un est superficiel, l’autre profond; une partie de l’eau tombée ruisselle en effet à la surface suivant les pentes et tend à gagner les portions les plus déclives, le thalweg de la vallée par exemple et le ruisseau ou la rivière qui l’occupent ordinairement; l’autre partie imbibe les couches superficielles du terrain, pénètre dans son intérieur et après un trajet qui varie d’un point à un autre, suivant la nature géologique du sol, vient se collecter enfin au-dessus d’une couche imperméable pour constituer ce que l’on nomme: la nappe d’eau souterraine qui peut elle-même être superficielle ou profonde. Le contenu de celle-ci revient à l’air libre, soit naturellement par l’intermédiaire des sources qui ne sont autre chose qu’un des affleurements de la nappe souterraine, soit artificiellement au moyen de puits de différents systèmes forés par l’homme ou jaillissant spontanément. Aussitôt rendue à la surface, l’eau qui avait été momentanément emprisonnée sous terre suivra le sort et partagera les vicissitudes microbiques de celle que nous avons vue ruisseler dès le début.
Les petits filets d’eau devenant des ruisseaux, puis formant des rivières qui se jetteront elles-mêmes dans les fleuves, notre eau de pluie tant superficielle que profonde reviendra enfin à son lieu d’origine: la mer, d’où partira un nouveau cycle entièrement analogue à celui qui vient d’être décrit sommairement.
Il est aujourd’hui facile, grâce aux documents déjà nombreux que nous possédons, de suivre dans ses différentes étapes les variations de cette eau au point de vue microbiologique, et l’enquête ainsi poursuivie nous donnera de précieuses indications sur l’origine même des microbes habituels des eaux.
L’appréciation exacte du lieu et du moment où s’opère la contamination sera d’autant plus aisée qu’indépendamment de la nappe souterraine que nous avons déjà vu être dépourvue de germes vivants, à condition qu’elle soit suffisamment profonde et protégée, nous allons constater de suite qu’à l’origine même de sa circulation atmosphérique l’eau sous forme de vapeur est d’une pureté microbique presque idéale.
Nous démontrerons du reste par des expériences précises empruntées à Miquel qu’il n’en peut guère être autrement.
Laissons de côté pour le moment les eaux océaniques qui réalisent cette conception mystique d’être en même temps le commencement et la fin, le point de départ et celui d’arrivée.
Leur étude bactériologique ne nous intéresse que médiocrement.
Nous pouvons en tous cas affirmer que l’eau de mer est riche en microorganismes de toutes sortes. Or la question se pose en ces termes: les tranches superficielles des Océans qui cèdent à chaque instant à l’atmosphère des torrents de vapeur d’eau laissent-elles s’échapper en même temps les infiniment petits qu’elles tiennent en suspension?
Pour répondre à semblable interrogation il s’agissait tout simplement de pratiquer de nombreuses analyses de l’atmosphère marine à différentes époques de l’année, au large et sur les côtes, en temps calme et au moment des grosses mers ou des tempêtes.
MM. le commandant Moreau et le docteur Miquel ont exécuté ces analyses en nombre tel et avec de si grandes garanties d’exactitude que je ne saurais mieux faire que de placer sous les yeux du lecteur quelques-uns de leurs résultats dont j’ai, pour plus de clarté, condensé les chiffres.
Du 26 novembre au 20 décembre 1884, lors de son sixième voyage de Bordeaux à la Plata à bord du paquebot des Messageries maritimes l’Amazone, M. le commandant Moreau pratique au moyen des tubes à bourres solubles 15 analyses d’air puisé un peu partout dans le parcours, le long des côtes ou en pleine mer; il aspire ainsi 27.041 litres d’air dont il capte, recueille et fait germer tous les organismes microscopiques susceptibles de se développer dans les conditions ordinaires. Or, ces 27.041 litres d’air lui donnent 26 bactéries et 5 moisissures, et, dans 5 analyses le résultat fut négatif quant aux schizomycètes, c’est-à-dire que dans 9980 litres, près de 10 mètres cubes d’air, il ne se rencontra pas une seule bactérie; les moisissures furent encore plus rares puisqu’elles firent défaut dans 11 analyses.
Dans un septième voyage de Bordeaux à la Plata à bord du Sénégal, 16 nouvelles analyses des atmosphères marines furent encore effectuées par le commandant Moreau et les résultats obtenus concordent absolument avec ceux que nous venons de faire connaître.
Du 3 au 24 mars 1885, 36.190 litres d’air furent aspirés sur les côtes du Brésil, à Rio-de-Janeiro, sur les côtes d’Afrique, aux Iles Canaries, en pleine mer et dans le golfe de Gascogne; ils donnèrent 34 bactéries et 5 moisissures. Trois fois le résultat fut entièrement négatif quant aux schizomycètes, soit 6865 litres qui furent trouvés microbiologiquement purs.
Les opérations bactérioscopiques doivent être singulièrement facilitées et sûres dans une semblable atmosphère!
En somme, et pour ne pas accumuler des documents qui sont semblables les uns aux autres, nous dirons que la totalité des analyses effectuées par MM. Moreau et Miquel à la date de 1886 est représentée par le nombre respectable de 112.855 litres d’air marin, soit, en chiffres ronds, environ 113 mètres cubes qui ont fourni 102 bactéries, c’est-à-dire à peu près 1 par mètre cube. Ces chiffres ont par eux-mêmes une trop grande éloquence pour qu’il soit nécessaire d’insister; ils constituent la meilleure et la plus probante réponse à la question posée ci-dessus.
Il n’est pas sans intérêt cependant de savoir que la richesse bactérienne de l’atmosphère des océans varie quelque peu suivant le voisinage ou l’éloignement de la terre ferme. Ainsi dans les analyses effectuées à au moins 100 kilomètres du continent la proportion des microbes descend à 0,6 par mètre cube, elle monte au contraire, lorsque la distance de la terre est inférieure à 100 kilomètres, à 1,8; enfin la proportion est un peu plus forte en pleine mer, lorsque celle-ci est grosse et houleuse (1 au lieu de 0,6), et diminue quand la mer est calme (0,3 au lieu de 0,6), d’où cette conclusion, formulée par Miquel:
En temps normal les océans ne cèdent pas à l’air les bactéries qu’ils renferment; cependant, quand la mer est grosse et houleuse, l’air marin se charge de bactéries, mais dans une très faible proportion.
Nous avons dit plus haut qu’un semblable résultat était à prévoir, étant données certaines expériences de laboratoire faites sur ce sujet.
Ces expériences, des plus intéressantes à bien des points de vue, sont encore dues à Miquel et sont rapportées dans son livre sur les Organismes vivants de l’atmosphère.
Elles ont pour but de démontrer la pureté microbique de la vapeur d’eau échappée des infusions putrides par le simple phénomène de l’évaporation. Le dispositif de l’expérience peut paraître quelque peu compliqué à la lecture, il est en réalité très simple . L’appareil se compose: d’une cloche tritubulée dont la base parfaitement rodée s’applique exactement sur un plateau de verre dépoli, d’un ballon suspendu au centre de la cloche, destiné à produire l’eau de condensation, et enfin d’un cristallisoir qui contiendra les liquides ou les substances putréfiées. Une des tubulures latérales de la cloche est munie d’un tube de verre recourbé qui servira en même temps à renouveler l’atmosphère de l’appareil et à introduire le liquide putréfié dans le cristallisoir; la seconde tubulure latérale, située en face de la première, reçoit un tube de verre recourbé en sens inverse du précédent et un thermomètre. L’appareil ainsi constitué est mis dans une étuve; un courant d’eau froide, grâce à un dispositif très simple, parcourt incessamment le ballon dont la calotte inférieure et extérieure se recouvre rapidement de fines gouttelettes qui grossissent, puis ruissellent et viennent enfin tomber dans une capsule de platine parfaitement flambée, qu’on a eu soin de placer sur un trépied, au-dessus de l’infusion septique.
De l’eau de Seine, de l’eau d’égout, des eaux saumâtres, des solutions absolument fétides et à odeur repoussante, distillées par ce procédé de façon à obtenir 50 centimètres cubes et même 100 centimètres cubes d’eau condensée, n’ont jamais présenté la moindre bactérie.
Dans un cas même l’eau de condensation avait conservé une odeur des plus nauséabondes et malgré cela, ensemencée à la dose énorme de 60 centimètres cubes dans des conserves nutritives variées, elle ne donna lieu à aucun développement microbien.
D’où Miquel conclut avec raison: «Cette expérience décisive ne laisse plus le moindre doute sur l’impuissance absolue de la vapeur à soulever des infusions le microbe le plus ténu, même quand son action est secondée par les courants d’air déterminés par le refroidissement incessant de l’atmosphère d’une enceinte très circonscrite.»
Et ce fait de l’asepticité de la vapeur provenant d’une masse d’eau quelconque est vrai aussi en ce qui concerne les portions émergées; l’eau évaporée de la surface du sol, dit encore Miquel, n’entraîne jamais de schizophytes.
De toutes ces assertions basées sur des expériences maintes fois contrôlées nous devons déduire cet axiome fondamental pour l’étude de la question qui nous préoccupe en ce moment, à savoir que, au début de sa circulation atmosphérique, l’eau est dépourvue de tout germe microbien vivant; nous représenterons cet état d’asepticité par le signe conventionnel 0.
De la surface des océans nous avons vu la vapeur d’eau s’élever suivant la direction des vents régnants jusqu’au contact de sommets plus ou moins hauts, lesquels jouent le rôle de condensateurs.
Il est bien évident que, chemin faisant, cette vapeur s’enrichit de quelques germes rencontrés çà et là, puisque nous savons qu’ils deviennent moins rares dans le voisinage de la terre ferme; cependant, étant donné, d’une part, que la condensation, c’est-à-dire la formation des nuages, s’opère sur les hauts sommets et que, d’autre part, l’atmosphère des montagnes élevées est microbiquement très pure, comme en témoignent les nombreuses analyses de M. de Freudenreich, le collaborateur alpin du docteur Miquel, l’eau, à l’état de nuages, doit être encore relativement très pauvre en microorganismes.
Les chiffres suivants donnés par M. de Freudenreich en font foi:
NOMBRE DE BACTERIES DANS 10 MÈTRES CUBES D’AIR (10.000 LITRES)
Il n’est pas nécessaire au reste de s’élever beaucoup, même au-dessus d’une ville populeuse, pour voir le nombre des bactéries décroître singulièrement; c’est ainsi qu’en ce qui concerne Paris Miquel a trouvé : à la mairie du IVe arrondissement, 462 germes de microbes par mètre cube et 28 seulement au Panthéon, tandis qu’il y en a 5500 dans la rue de Rivoli et 760 dans le parc de Montsouris.
Les nombres précédents sont pour nous très instructifs, parce qu’ils nous indiquent que la quantité des microbes de l’atmosphère augmente au fur et à mesure que l’on se rapproche du sol, et, bien que les germes aériens soient beaucoup moins nombreux qu’on ne le croyait à une certaine époque, ils représentent cependant pour l’eau un élément d’approvisionnement qui est loin d’être négligeable.
C’est en traversant sous forme de pluie ou de neige l’air atmosphérique que notre eau va commencer à s’enrichir de particules organisées et vivantes, et pour bien faire comprendre quelle est l’importance de cette source de germes peut-être est-il nécessaire de citer ici encore quelques chiffres.
En 1889, Miquel a trouvé à l’Hôtel de Ville de Paris, par mètre cube d’air, une moyenne de 9780 bactéries et de 1420 moisissures; le mois qui a fourni la plus forte proportion de schizomycètes est septembre avec 19.300 par mètre cube, celui dans lequel a été observé le minimum est février avec 3345.
A la place Saint-Gervais, la moyenne de neuf années, de 1881 à 1889, a été de 4520 par mètre cube.
A Lyon, dans une cour de l’Hôtel-Dieu où l’air est relativement stagnant, le docteur Rossi, au cours de recherches entreprises sous ma direction, dans le laboratoire de M. le professeur Bondet, pour sa thèse inaugurale , a constaté 1084 bactéries et 833 moisissures par mètre cube, et cela au mois d’octobre, alors que la température très basse était à peine de 5° C.
Au parc de Montsouris enfin, pendant sept ans, de 1881 à 1887, la moyenne des microbes récoltés par mètre cube d’air a été de 390 seulement.
Plus on s’éloigne des grands centres d’agglomération et plus l’air devient microbiquement pur, sans toutefois atteindre l’asepticité presque absolue des hauts sommets ou des atmosphères maritimes.
Cette courte digression, quelque peu étrangère à notre sujet, avait pour but de nous montrer d’où doivent provenir les nombreux germes que nous allons maintenant rencontrer dans l’eau de pluie et même dans la neige; nous réservons pour le moment l’origine de ceux qui ont été rencontrés dans la grêle.
C’est à partir de 1879 que Miquel a commencé à s’occuper de l’analyse systématique des eaux météoriques, et depuis 1880 le volume annuel de l’Observatoire de Montsouris nous apporte de précieux renseignements sur cette branche de la Microbie analytique. Dès la première année il put déduire de ses expériences multipliées une série de conclusions intéressantes, parmi lesquelles je citerai plus particulièrement celles-ci:
L’eau de pluie renferme à volume égal un nombre d’espèces moindre que les eaux qui circulent à la surface du sol; en toutes saisons la pluie, la grêle, la neige sont chargées d’organismes microscopiques, la neige toutefois est moins riche que les pluies d’été.
En tout cas, les eaux de pluie ont une richesse en microorganismes assez notable pour qu’il en soit tenu, dès à présent, grand compte dans l’étude des différents processus de pollution des liquides de boisson.
Au parc de Montsouris, des analyses pratiquées pendant trois années, de 1883 à 1886, on a pu déduire une moyenne de 4346 bactéries et de 4000 mucédinées par litre d’eau de pluie; or, la hauteur annuelle de pluie, à Montsouris, étant d’environ 60 centimètres, il y a donc, chaque année, déposés sur le sol, par mètre carré de surface, 4.500.000 germes, et ce chiffre est bien certainement inférieur à la réalité !
Les pluies les plus chargées en microorganismes sont celles des mois les plus chauds de l’année ou encore les premières averses des orages et celles qui succèdent à une suite de jours secs, mais il est inexact de dire que la pluie recueillie à la fin d’une journée pluvieuse est plus pauvre en germes que celle prise au commencement ou au milieu. Enfin, la richesse microbienne de ces eaux météoriques varie essentiellement avec les localités, même voisines; ainsi, à la caserne Lobau, les eaux de pluie sont plus chargées en germes que celles de Montsouris, mais il est juste de dire que l’air lui-même est, à ce point de vue, bien différent dans ces deux stations.
Voilà donc l’eau ayant terminé son trajet aérien et qui, partie avec 0 bactérie arrive à la surface du sol avec plus de 4.000 microbes par litre; son impureté est donc déjà bien manifeste, et en admettant même, ce qui n’est pas, que le substratum qui va recevoir ce liquide pollué soit, lui, parfaitement aseptique, il n’est pas difficile de comprendre comment le degré de pollution va aller en s’accentuant de plus en plus.
Deux conditions, essentiellement favorables à la végétation et à la pullulation des schizophytes, sont, en effet, réalisées dès que l’eau touche terre: un état de repos relatif et l’apport, en quantités notables, de matériaux nutritifs,
D’après Léone, il est vrai (Recherches sur les microorganismes de l’eau potable, etc., Rev. sanit. de Bordeaux et de la province, octobre 1886), l’agitation ne s’opposerait pas à la reproduction des microorganismes des eaux.
Il résulte, d’autre part, des quelques expériences instituées par M. V. Despeignes (Etud. expérim. sur les microbes des eaux, th. de Lyon, p. 22, 1891) qu’aucune différence sensible n’a pu être notée dans la pullulation des bactéries des eaux de Lyon dans les cultures au repos ou animées de mouvements rotatoires horizontaux.
Je pense néanmoins que les bactéries ont plus chance de pulluler une fois arrivées à la surface du sol que pendant le temps de chute de la pluie, fort court au reste.
Les conditions de cette pullulation sont, en ce cas, d’autant meilleures qu’il se rencontre toujours, çà et là, quelques tranches d’eau stagnante qui deviennent le centre d’une très active reproduction de la part des petites cellules qui s’y sont réfugiées.
Ces processus de biogénèse sont d’autant plus actifs que l’eau relativement pure du météore aqueux s’est chargée, chemin faisant, de principes azotés ou minéraux qui en ont fait un bouillon de culture, sinon excellent, du moins très suffisant. Nous verrons, au reste, bientôt combien, au point de vue alimentaire, sont peu exigeants les êtres infimes que nous étudions.
Il n’est donc pas étonnant que les 4346 germes primitifs soient bientôt représentés par des milliers et des millions d’individus issus des premiers et que l’eau puisée à la surface du sol soit déjà plus riche en microbes que celle qui provient directement de la pluie.
Mais, dans la réalité, l’eau du ciel est loin de rencontrer, lors de sa chute, un sol vierge de toute souillure. La croûte terrestre, sur une épaisseur plus ou moins considérable, très minime toutefois, mais en tout cas à sa surface même, contient des quantités énormes de germes de toutes sortes, microscopiques artisans des opérations incessantes d’analyse ou de synthèse dont la terre végétale est en même temps le laboratoire et l’objet.
Quelques chiffres vont nous donner une idée de l’importance de ce microcosme des couches superficielles du sol.
NOMBRE DES BACTÉRIES AÉROBIES PAR GRAMME DE TERRE
Tous ces chiffres s’appliquent à la surface seulement; au fur et à mesure que l’on s’enfonce dans la profondeur les microorganismes deviennent moins abondants, non pas progressivement, mais bien, ainsi que cela résulte des remarquables recherches de C. Frankel, tout d’un coup vers 1m,25 environ, de telle sorte que l’on trouve à ce niveau 100 fois moins de germes qu’à 25 centimètres au-dessus. En tout cas, toujours d’après C. Fränkel et la plupart des autres auteurs, les ensemencements avec de la terre prise à 4 et 5 mètres, même alors que cette profondeur appartient à la zone de la nappe souterraine, ne donnent plus de colonies ou n’en donnent que très exceptionnellement.
Le sol, en effet, qui dans ses couches superficielles constitue, dans la plupart des cas, un excellent milieu de culture pour les microbes aérobies perd, dans ses portions profondes, la majeure partie de ses qualités et notamment celle de pouvoir servir de milieu respiratoire. Aussi, les bactéries aérobies perdent-elles assez rapidement, à une certaine profondeur, le pouvoir de végéter et de pulluler. C. Frankel , étudiant plus spécialement à ce point de vue quelques bacilles pathogènes, a vu que le Bacillus anthracis perdait l’aptitude au développement à 3 mètres de profondeur, alors qu’à ce même niveau le bacille du choléra asiatique était encore capable de vivre, mais, circonstance curieuse, seulement pendant les mois d’août, septembre et octobre.
Quant aux bacilles typhiques placés dans les mêmes conditions, ils ne seraient réfractaires à la culture que pendant les mois d’avril à juin.
D’autre part, MM. Grancher et Deschamps, expérimentant sur la façon dont se comporte le bacille typhique dans le sol, sont arrivés aux résultats suivants: le bacille d’Eberth peut pénétrer à une distance maxima de 40 à 50 centimètres dans l’intérieur du sol et y vivre pendant un laps de temps de cinq mois et demi; il se conserve même mieux dans la terre que dans les cultures à l’air libre.
Mais tous les expérimentateurs sont d’accord pour admettre qu’au delà d’une certaine limite, la vie cesse absolument dans les profondeurs du sol, et c’est ainsi que s’expliquerait la pureté microbiologique parfaite de la nappe souterraine et des eaux de source.
Il est vrai que de semblables assertions ne peuvent que viser les bactéries aérobies, les seules qui dans le sol aient été convenablement étudiées jusqu’à présent. 11 se pourrait fort bien, ainsi que Macé l’insinue, que les anaérobies existassent là où les autres font défaut, et que les véritables frontières de la région aseptique dussent, de ce fait, être plus ou moins reculées.
Quoi qu’il en soit, ce qu’il nous importe d’enregistrer actuellement, c’est le fait de la disparition des germes aérobies dans la profondeur du sol et la pureté ordinaire de la nappe souterraine et des eaux de source, ce qui fait que, pour la seconde fois, nous constatons chez notre eau un état tel que sa richesse microbiologique peut être représentée par 0.
En écrivant plus haut: pureté ordinaire, au lieu de pureté absolue, j’ai eu l’intention d’indiquer quelques réserves. Il peut arriver, en effet, assez exceptionnellement il est vrai, mais peut être cependant plus fréquemment qu’on ne le croit, dans certains pays de contexture géologique spéciale, que des eaux de sources bien captées et recueillies avec toutes les précautions d’usage ne se montrent pas microbiquement pures, tant s’en faut, et cela malgré une épaisseur considérable de terrain filtrant.
C’est ainsi que, en 1889, M. Thoinot constata dans l’eau des sources qui alimentent la ville du Havre, lesquelles sont à 48 mètres en contre-bas du plateau calcaire de Gainneville à la surface duquel avaient été répandues des matières de vidanges provenant du Havre, 42.000 germes par litre dans une analyse et dans une autre 470.000; d’où cette conclusion qui, bien que s’appliquant à un cas particulier, est néanmoins susceptible d’être généralisée: que le terrain crétacé est parfois un filtre imparfait et que même une forte épaisseur de ce terrain ne saurait fournir aux nappes souterraines qu’une protection illusoire contre les microorganismes déposés à la surface du sol.
Nous voici revenus aux eaux de surface dont l’origine et aussi la composition biologique sont bien différentes, tout au moins à leur point de départ. Nous avons, d’une part, les eaux souterraines émergeant à l’air libre sous forme de sources qui, nous l’avons vu, sont, sauf quelques exceptions assez rares, absolument aseptiques au lieu de leur émergence, et, d’autre part, les eaux qui dès l’instant de leur chute ont ruisselé à la surface du sol et sont restées superficielles. Ces dernières sont constamment très riches en microbes; elles possèdent tout d’abord ceux qui préexistaient en elles à l’état de pluie ou de neige, plus les générations issues de ceux- ci dès qu’une stagnation relative a été obtenue, et enfin les espèces nouvelles déjà acclimatées à la surface du sol sur lequel la pluie est venue tomber. Cette triple addition donne un total considérable et il serait fastidieux de vouloir donner des chiffres, pour l’établissement desquels peu d’analyses, du reste, ont encore été faites.
Ce qu’il nous importe davantage de connaître, c’est la composition microbique de quelques eaux courantes qui ne sont que le mélange des eaux profondes et superficielles réunies les unes aux autres, tôt ou tard, pour gagner à nouveau le grand gouffre commun.
Ici les documents ne manquent point et nous ne pouvons que choisir parmi quelques-uns des plus récents d’entre eux.
BACTÉRIES DES EAUX COURANTES; PAR CENTIMÈTRE CUBE
Les écarts sont, on le voit, fort considérables ici. Certains bactériologues, je le sais, m’accuseront d’avoir groupé ensemble des valeurs non comparables, étant donné que les chiffres précédents sont le résultat d’analyses faites avec des procédés différents.
Je ne veux certes pas esquiver ce reproche et je discuterai bientôt en toute impartialité la question des méthodes d’analyse et des résultats obtenus. Mais pour le moment cette distinction ne me semble pas avoir grande importance, puisqu’il s’agit de démontrer simplement que les eaux courantes sont toujours plus ou moins riches en microorganismes: ce qui est fait.
Il me faudrait peut-être maintenant faire pour les eaux dormantes, lacs, étangs, et pour les puits, ce que je viens de tenter pour les eaux courantes, mais ceci nous entraînerait par trop en dehors du cadre qui m’est tracé et je me contenterai de dire que, comme pour les rivières, le nombre de bactéries est ici infiniment variable et soumis à des oscillations dont les causes très multiples commencent à être connues. Ainsi d’après Bujwid les puits de Varsovie renferment de 80 à 50.000 bactéries par centimètre cube.
Je voulais dans ce chapitre faire connaître quelle était l’origine réelle des microbes des eaux; je pense y être parvenu.
L’air, le sol sont les deux grands facteurs de la contamination, auxquels viennent s’ajouter dans les contrées peuplées les déjections de l’homme et des animaux, les détritus de toutes sortes résultant de l’alimentation et de l’industrie, et jusqu’aux débris d’origine végétale qui, le long des cours d’eau surtout, viennent à chaque instant apporter non seulement de nouveaux germes vivants, mais encore les éléments de la nutrition de ces infiniment petits.