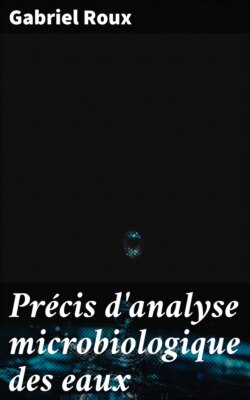Читать книгу Précis d'analyse microbiologique des eaux - Gabriel Roux - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
BUT ET UTILITÉ DE L’ANALYSE MICROBIOLOGIQUE DES EAUX
ОглавлениеLa notion des bactéries des eaux pouvant être pathogènes, substituée à celle de leur composition chimique. — Origines de l’analyse bactériologique. — École française et école allemande. — Analyse quantitative et analyse qualitative ou physiologique. — Quel est, de ces deux modes d’analyse, le plus utile? — Microbes aérobies et anaérobies, anaérobies facultatifs.
Les recherches de MM. Chantemesse et Widal, de M. Brouardel et de ses élèves sur le bacille d’Eberth et les relations existant entre la fièvre typhoïde d’une part et l’eau potable de l’autre ont rappelé, dans notre pays, l’attention sur l’analyse microbiologique des eaux, pressentie et indiquée par Pasteur, pratiquée déjà depuis longtemps par Miquel, et ont causé la vogue de ce nouveau mode d’investigations. Lorsqu’il a été prouvé, pour une des maladies les plus fréquentes et les plus graves, que c’était l’eau qu’il fallait surtout incriminer dans son étiologie (90 fois sur 100 d’après Brouardel), et que le principe nocif n’était pas telle ou telle substance chimique, mais bien un infiniment petit vivant, un microbe, tout le monde a pensé, avec assez de raison, que ce n’était plus au chimiste seul qu’il fallait, en ce qui concerne l’eau, demander la réponse à l’interrogation classique: bonne ou nuisible?
FIG. 1. — Formes des bactéries en général
1, 2, 3, 4. Coccus de différentes formes et grosseurs; 5, court bâtonnet; 6, long bâtonnet; 7, 8, formes renflées; 9, 10, filament; 11, 12, 14, formes spiralées; 13, forme spiruline; 15, filament ramifié.
Puisque le corps du délit était une de ces innombrables bactéries (fig. 1), les unes utiles ou banales, les autres, les mêmes parfois, pathogènes, c’était le Bactériologue qui devait être consulté, et qui le fut en effet.
Et alors parmi les microbiologistes qui durent, tant la nouvelle science avait marché vite, se spécialiser dès le début, quelques-uns se consacrèrent presque exclusivement à ces sortes d’analyses pour lesquelles, en raison de leur nouveauté, tout ou à peu près était à créer: principes, méthodes et technique.
Malgré les difficultés inhérentes à une telle entreprise les choses allèrent assez vite et les résultats furent dès le début satisfaisants, grâce aux méthodes générales inventées et préconisées en France par Pasteur, en Allemagne par Koch.
Ce dualisme de noms et de nationalités, nous allons le rencontrer constamment, chemin faisant, dans l’exposé des procédés de recherches, et c’est en combinant, somme toute, avec un sage et impartial éclectisme, les errements des deux écoles: française et allemande, que nous arriverons, sinon à la netteté et à l’absolutisme des analyses chimiques, tout au moins à une approximation suffisante pour être utile, assez sérieuse pour rester indiscutable.
Mais qu’on le sache bien, si les progrès accomplis à l’heure actuelle sont assez importants pour justifier l’apparition de ce livre, nous n’en sommes pas moins à l’aurore seulement d’une science qui va se perfectionnant chaque jour et donnera bientôt, nous en avons la conviction sincère, de magnifiques et surprenants résultats.
Je ne saurais trop le répéter, il ne faut au temps présent demander à l’analyse microbiologique des eaux que ce qu’elle peut donner; ce quelque chose est à la fois beaucoup et fort peu: beaucoup si l’on considère la jeunesse de la Microbie, le peu de temps qui nous sépare du jour où pour la première fois elle a commencé à compter dans l’encyclopédie des connaissances humaines, fort peu si nous réfléchissons aux problèmes que nous voudrions lui voir résoudre et qui restent encore insolubles. Bientôt je montrerai les lacunes, car j’estime que, dans un ouvrage loyalement écrit il faut proclamer bien haut et hardiment ce qui est acquis, ce qui est vrai, mais ne point céler non plus les défauts ni les imperfections.
Confesser notre ignorance est en ce cas, je le crois, faire œuvre, non pas seulement d’honnêteté scientifique, mais encore de progrès, puisqu’en appelant l’attention sur des desiderata nous pouvons avoir l’espoir de susciter des recherches qui les feront disparaître. C’est dans cet esprit que ce modeste volume a été écrit et peut-être, s’il est appelé à être utile à quelqu’un, servira-t-il autant par les inconnues qu’il indiquera que par les faits acquis qu’il s’efforcera d’enseigner.
Comme l’analyse chimique, l’analyse microbiologique en général est quantitative et qualitative; mais tandis qu’en Chimie la première est la plus estimée et aussi la plus utile, c’est le contraire en quelque sorte qui s’observe en Microbie.
En Chimie, au reste, la quantitative ne peut pas aller sans la qualitative; on ne peut doser des composants de corps que lorsqu’on connaît leur nature, tandis qu’il est possible de déceler celle-ci et de ne point s’inquiéter des proportions dans lesquelles chaque élément fait partie du composé ; et lorsqu’on demande à un chimiste si telle substance renferme oui ou non du plomb la réponse faite aura toujours une certaine valeur, que la quantité de plomb existant ait été oui ou non déterminée.
En tout cas, le chimiste procède toujours ainsi: il cherche si le plomb existe, d’abord: analyse qualitative; il évalue ensuite, la réponse étant, je suppose, positive, la quantité du métal: analyse quantitative. On procède un peu différemment en analyse microbiologique; et pour prendre un exemple parmi les problèmes qui doivent surtout préoccuper le médecin et l’hygiéniste nous supposerons la double question suivante:
Telle eau renferme-t-elle le bacille de la fièvre typhoïde?
Quelle est la teneur de cette même eau en bactéries quelconques (aérobies)?
En résolvant le premier problème nous aurons bien en réalité fait une analyse qualitative, puisque nous aurons cherché à déterminer la qualité d’un microbe: celui qui est lié à la dothiénentérie; mais en répondant à la seconde question posée, nous serons bien inférieurs au chimiste; nous dirons en effet: il y a, par exemple, 1500 bactéries par centimètre cube de l’eau analysée, mais sans préciser, tout d’abord, l’espèce à laquelle appartient chacun de nos 1500 individus. Nous aurons fait une analyse quantitative, mais dans laquelle les éléments comptés nous sont absolument inconnus quant à leur nature et à leurs propriétés. Nous nous trouvons ici dans le cas d’un chimiste qui déclarerait que dans tel échantillon il y a cinq éléments différents, mais qui ne les nommerait pas; et encore, lui, saurait qu’il a bien cinq corps distincts, tandis que nous, dans la supposition précédente, ne sommes pas censés savoir si nos 1500 individus appartiennent à une, dix, vingt ou cent espèces. Nous avons, que l’on me permette l’expression, compté des cailloux et non pas des roches ou des minéraux, ces derniers pris dans leur acception pétrographique.
Afin de déterminer avec exactitude à quelle espèce connue appartient chacun des 1500 individus que notre analyse quantitative a décelés, il va falloir nous livrer à toute une série d’opérations qui seront décrites bientôt et dont l’énumération seule démontre la longueur et la complexité : formes et dimensions, mobilité, réactions colorantes, aspect des colonies sur les milieux de cultures les plus variés, action chimique de ces mêmes colonies sur certaines substances (sucre, lait, albumine, etc.,) action biologique sur les animaux, sont autant de caractères qu’il est parfois indispensable de passer en revue les uns après les autres, avant d’en arriver à se faire une opinion absolue sur l’identité de l’organisme considéré.
L’analyse microbiologique de l’eau consiste en somme dans la recherche et la mise en évidence des microorganismes auxquels on donne le nom de Schizomycètes, Schizophytes, Bactéries, Microbes (fig. 1), que cette eau renferme.
Comme l’analyse chimique, nous venons de le voir, elle peut être quantitative ou qualitative, quantitative lorsqu’elle a pour but de compter purement et simplement les microgermes contenus dans un volume déterminé : comme 1 centimètre cube, qualitative lorsqu’elle s’efforce de séparer les unes des autres les diverses espèces microbiennes et de les déterminer spécifiquement.
Cette seconde variété de l’analyse bactériologique pourrait être appelée encore physiologique ou biologique parce qu’elle doit, pour rendre tous les services que l’on attend d’elle, constater de quelle façon chacune des espèces bactériennes isolées se comporte vis-à-vis l’organisme animal, nous instruire sur ses propriétés pathogènes ou seulement saprogènes, ou encore zymogènes.
On a beaucoup discuté et on discute toujours, plus encore peut-être aujourd’hui qu’à l’origine, sur l’utilité réelle, au point de vue de l’hygiène publique, de l’analyse microbiologique des eaux.
Les chimistes surtout, qui seuls étaient autrefois consultés sur la potabilité d’une eau et se trouvaient être, en cette matière, des oracles indispensables et tout puissants, ont protesté contre cette nouvelle branche de la Microbie.
Quelques-uns ont voulu lui dénier toute espèce d’importance ou bien, comme M. Denaeyer, au Congrès international d’Hygiène de Paris en 1889, revendiquer pour eux seuls le droit exclusif de pratiquer ces analyses biologiques en même temps que les chimiques.
D’autres cependant, plus circonspects, se contentent de considérer comme ayant peu de valeur les numérations pures et simples.
«Aussi longtemps, écrit M. Ch. Girard dans la Revue d’Hygiène, en 1887, que les hygiénistes compteront des bactéries sans savoir si elles sont pathogènes ou non, je considérerai leurs travaux comme une statistique intéressante peut- être, encombrante à coup sûr .»
Ce dernier membre de phrase est de trop, car toutes les recherches scientifiques, quelles qu’elles soient, à condition d’être consciencieusement poursuivies, sont intéressantes et utiles, si ce n’est à bref délai, tout au moins à une échéance plus ou moins longue. Les bactériologues de profession sont, au reste, absolument d’accord avec les chimistes sur l’intérêt prédominant de l’analyse qualitative, et notamment sur celui de la recherche des microbes pathogènes; pas un seul parmi eux ne soutiendra aujourd’hui le contraire.
Mais est-ce à dire que l’autre, la quantitative, soit absolument inutile et doive être considérée comme une collection de faits sans valeur et encombrants? Je ne le crois pas.
Indépendamment de l’intérêt d’ordre purement scientifique, qui n’est pas tant à dédaigner que cela, ces sortes d’analyses nous apportent souvent des éclaircissements précieux et inattendus, qu’elles seules peuvent fournir, sur des causes de pollution entre tel point et tel autre dans le parcours d’une canalisation, ou nous mettent sur la voie d’une source d’infection qu’il était impossible sans elles de soupçonner; elles nous renseignent encore sur les qualités ou les défectuosités d’une masse filtrante naturelle ou artificielle et présentent ainsi un intérêt de premier ordre.
Je connais, pour ma part, bien des exemples (il serait trop long de les rapporter ici) de semblables services rendus par l’analyse quantitative, exemples que j’ai signalés ailleurs ; et il est peut-être sage, pour ne rien préjuger de ce que les découvertes futures pourront nous apporter, de dire tout simplement, avec Meade-Bolton : «La détermination exacte de la qualité des espèces de bactéries trouvées dans une eau offre peut-être des résultats hygiéniques plus utilisables que la détermination du nombre total des bactéries.»
A. Lustig, qui, tout récemment, a publié un petit traité du diagnostic des bactéries des eaux, écrit, avec raison, en tête de sa préface, ces lignes que je reproduis textuellement parce qu’elles expriment de façon complète l’opinion de tous les bactériologues: «L’examen bactériologique de l’eau qui consiste uniquement à déterminer le nombre des germes vivants contenus dans un centimètre cube de liquide ne correspond pas entièrement aux exigences de la science moderne. On exige davantage; il est nécessaire d’obtenir, isolées en cultures pures, les diverses espèces de bactéries et d’indiquer leurs propriétés biologiques ainsi que toutes celles qui contribuent à la connaissance de l’action qu’exerce chaque forme déterminée sur les différentes substances nutritives...»
Ajoutons à la phrase précédente: «et sur les différents animaux soumis à leur action», et nous aurons ainsi la formule générale des services que l’on doit demander à l’analyse bactériologique des eaux.
Pasteur , on le sait, a depuis longtemps divisé, au point de vue de leur biologie générale, les microorganismes en deux grandes catégories: les Aérobies et les Anaérobies, les premiers ayant besoin, pour vivre et se développer, d’oxygène libre, les autres redoutant, au contraire, l’action de ce gaz; les recherches modernes ont fait découvrir des êtres intermédiaires entre les deux groupes précédents et qui peuvent vivre tour à tour avec ou sans oxygène: ce sont les Anaérobies facultatifs.
Jusqu’à présent, en raison des difficultés de technique qui arrêtent ceux qui veulent s’occuper de la culture systématique des Anaérobies, l’analyse bactériologique des eaux a porté surtout sur les Aérobies, et les divers procédés que j’aurai à décrire s’appliquent exclusivement à ces derniers. Il y a là une regrettable lacune qui ne tardera pas, je l’espère, à être comblée, mais que j’ai cru devoir, devant l’imperfection des moyens proposés, laisser telle qu’elle.
Ce manuel aura donc pour objet la recherche quantitative ou qualitative des Bactéries aérobies des eaux. (J’y ajouterai cependant quelques indications sommaires sur la façon dont on peut cultiver et isoler les Anaérobies.)
J’étudierai successivement: la provenance de ces bactéries, les différents procédés d’analyse quantitative, les méthodes suivies pour isoler les unes des autres les espèces rencontrées, faire leur diagnose et savoir surtout reconnaître certaines d’entre elles éminemment intéressantes pour l’hygiéniste et le médecin, comme l’est, par exemple, le bacille de la fièvre typhoïde; l’ouvrage enfin se terminera par une nomenclature des différentes espèces microbiennes qui ont, à l’heure actuelle, été rencontrées dans l’eau, nomenclature qu’accompagnera, pour chaque espèce, la description morphologique des cultures, sur plaques et dans le bouillon, empruntée aux auteurs qui, comme Eisenberg, Lustig, Weichselbaum, R. Mori, Adametz, Tils, etc, se sont plus particulièrement occupés de ces questions de diagnose.