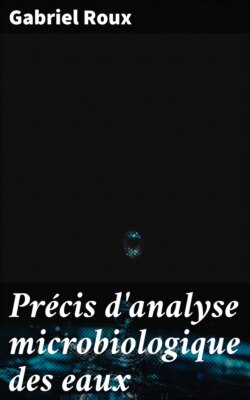Читать книгу Précis d'analyse microbiologique des eaux - Gabriel Roux - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ANALYSE QUANTITATIVE
ОглавлениеTrois méthodes principales: Examen microscopique direct, cultures dans les milieux liquides, cultures sur les milieux solides. — Examen microscopique direct. — Ses variétés: Examen immédiat, Examen après évaporation et coloration, Procédé de Certes. — Cultures dans les milieux liquides. — Analyses de Pasteur et Joubert. — Expériences et travaux de Miquel. — Koch et les milieux solides.
Nous avons déjà vu que l’analyse bactériologique de l’eau pouvait être quantitative ou qualitative et que cette dernière avait autrement d’importance que la première en ce qui concerne les intérêts de l’hygiène publique. Mais le plus ordinairement le bactériologue procède en même temps et par les mêmes opérations à l’une et à l’autre, il compte les individualités ou les colonies microbiennes renfermées dans un volume déterminé de liquide et il s’efforce par la même occasion de déterminer spécifiquement chacune des bactéries mises en évidence.
Comme néanmoins l’analyse quantitative précède dans la grande majorité des cas la qualitative et que l’emploi des méthodes qu’elle nécessite ne nuit en rien à la recherche ultérieure de la qualité de chaque microorganisme, c’est par l’étude de ces méthodes d’analyse quantitative que je débuterai.
Elles peuvent être réparties en trois principaux groupes que nous appellerons:
1° MÉTHODES PAR L’EXAMEN MICROSCOPIQUE DIRECT;
2° MÉTHODES PAR LES CULTURES DANS LES MILIEUX LIQUIDES;
3° MÉTHODES PAR LES CULTURES SUR LES MILIEUX SOLIDES;
L’ordre que je viens d’adopter est à peu près l’ordre chronologique de la découverte et de l’utilisation de ces différentes catégories de méthodes et nous fera en quelque sorte aller du simple au composé, la technique se compliquant, bien entendu, au fur et à mesure qu’elle se perfectionne.
1° MÉTHODES PAR L’EXAMEN MICROSCOPIQUE DIRECT. — Ce sont de beaucoup les plus simples et les plus anciennes et si j’ai écrit: MÉTHODES au pluriel, c’est parce qu’elles sont elles-mêmes, malgré leur extrême simplicité, subdivisées en plusieurs variétés ou procédés.
A. L’examen immédiat qui se pratique sans aucun artifice de préparation ou de coloration, en plaçant une goutte d’eau sur une lame de verre porte-objet préalablement flambée, et en la recouvrant d’une lamelle couvre-objet également flambée, a du exister depuis les origines même du microscope, et lorsque Leuwenhœck examinait, avec ses verres grossissants, une infusion ou une eau croupissante peuplées de ses infusoires, il employait semblable procédé. Un grossissement de 700 diamètres au moins est nécessaire ici pour que les bactéries soient visibles et encore celles-ci ne le deviennent-elles le plus souvent que grâce à leurs mouvements très actifs.
Ce procédé est, j’ai à peine besoin de le dire, des plus grossiers et très infidèle, et on est vraiment étonné de voir en 1886 le docteur Cahen, de Nancy, lui attribuer une telle importance que dans les conclusions de son travail il dit textuellement ceci: «Le procédé de choix ou même le seul procédé pratique à employer pour exécuter l’analyse biologique des eaux est l’examen microscopique immédiat.»
Si ces lignes avaient été écrites dix ans auparavant, ou si M. Cahen n’avait pas connu les travaux de Pasteur, Certes, Miquel, Koch, Fol, etc., auxquels il fait allusion dans sa thèse, jaurais à la rigueur compris ses préférences, mais dans les conditions et à l’époque où elles ont été exprimées elles me causent quelque surprise.
On peut évidemment par ce procédé voir quelques-uns des microbes des eaux surtout de celles très riches en microorganismes, particulièrement les bacilles, mais la plupart des microcoques et toutes les spores passeront inaperçus, ainsi que le fait très justement remarquer M. Dubarry qui a mis en usage à plusieurs reprises la méthode préconisée par M. Cahen et qui n’en a obtenu que de très médiocres résultats. Je me contente à la suite des essais que j’ai pratiqués moi-même de confirmer ces appréciations.
Le premier examen microscopique systématique de l’eau paraît avoir été fait par Harral sur les eaux de la Tamise et de Londres en 1850; il laissait déposer l’eau dans un tube à expériences et examinait au microscope une goutte du dépôt.
«La chimie, dit-il dans son travail de 1851, ne peut guère être adaptée fructueusement à la recherche de la nature des matières organiques des eaux; elle ne donne qu’une estimation assez grossière de leurs proportions et ne distingue pas les matières animales des végétales ni la matière vivante de la matière morte; elle ne nous dit rien des familles, genres et espèces des nombreux produits vivants contenus dans les eaux impures, ni de leurs allures et de leur développement, etc. Ces recherches sont plutôt du domaine du naturaliste, du physiologiste et du micrographe, et je crois avoir le mérite d’avoir appliqué pour la première fois les ressources fournies par ces diverses sciences et d’avoir procédé d’une manière pratique et scientifique tout à la fois à l’examen des conditions actuelles de l’eau en général, et en particulier de celle de la métropole.»
L’examen microscopique direct de l’eau et de ses sédiments a été encore pratiqué avec quelque succès, semble-t-il, en 1865, par Radlkofer, de Munich, en 1852 et en 1866, lors des épidémies de choléra, par F. Cohn, de Breslau, qui publia à ce sujet un mémoire extrêmement important.
Hirt de Breslau, en 1879, emploie aussi la même méthode dont il résume les procédés dans les trois recommandations suivantes:
1° Examiner successivement et immédiatement au microscope 20 à 30 gouttes de l’eau suspecte récemment puisée;
2° Examiner aussi le sédiment déposé par l’échantillon abandonné au repos pendant 5 à 6 jours;
3° Agir de la même façon pour la pellicule superficielle qui se forme quelquefois à la surface de l’eau au repos; et qu’il considère, malgré ses imperfections, comme la meilleure existant à cette époque (1879).
Hulwa a aussi suivi les mêmes errements pour l’étude systématique des eaux de l’Oder et de Breslau dont les résultats ont été publiés en 1885 dans un mémoire des plus intéressants .
Macdonald, dans la seconde édition de son Guide pour l’examen microscopique de l’eau potable, paru en 1883, conseille de procéder de la façon suivante: Un grand vase de verre est rempli de l’eau à examiner: puis un disque de verre ou mieux un verre de montre maintenu par une anse d’un long fil d’aluminium est descendu jusqu’au fond du vase qui est alors couvert avec soin et laissé au repos pendant vingt-quatre à quarante-huit heures. Au bout de ce temps l’eau est enlevée à l’aide d’un siphon formé par un tube de caoutchouc, de façon à ne laisser qu’une mince couche de liquide sur le disque ou dans le verre de montre. Celui-ci est alors soulevé soigneusement et posé sur plusieurs doubles de papier buvard de manière à sécher sa face inférieure et à enlever l’excès d’eau; il est ensuite transporté sous le microscope et examiné après avoir été recouvert d’une lamelle.
C’est un procédé tout à fait analogue que préconisent au point de vue de l’examen microscopique des eaux, Tiemann et Gärtner dans leur Précis d’analyse microscopique des eaux (1889).
Les micrographes et les biologistes de la station expérimentale de Lawrence au Massachussett ont singulièrement perfectionné les divers procédés d’examen microscopique des eaux, procédés auxquels les noms de leurs auteurs: Parker, L. Kean, miss C.-A. Woodman, Rafter, Williston (du Connecticut), Sedgwick -Rafter, sont restés attachés, au moins en Amérique.
Comme ces différentes méthodes, plus ou moins compliquées et sures, ont surtout pour but de décéler dans les eaux ordinaires et dans les eaux d’égout les organismes végétaux et animaux bien supérieurs aux bactéries, tels que: infusoires ciliés et flagellés, algues, diatomées, etc., je ne crois pas devoir les signaler autrement ici, et je renvoie le lecteur désireux de les connaître à la description détaillée qui en a été donnée dans le rapport du biologiste de la station de Lawrence, M. William T. Sedgwick.
A cette même station où dans ces dernières années on s’est occupé de l’examen chimique et biologique des eaux d’égouts l’analyse, bactériologique proprement dite est en effet pratiquée aujourd’hui suivant la méthode de Koch dans laquelle les godets de Piétri ont été substitués aux plaques de verre.
On trouvera dans le volume que je viens de signaler quelques précieuses indications concernant la flore bactérienne spéciale des eaux d’égout, et je décris à la fin de ce «Précis» dans sa partie systématique, les espèces nouvelles qui ont été décrites par M. Edwin O. Jordan, assistant biologiste-chef de la station de Lawrence, espèces dont quelques-unes me semblent particulièrement intéressantes.
B. Examen après évaporation et coloration. — Ce procédé préconisé tout d’abord par Koch constitue déjà sur le précédent un progrès appréciable. La goutte d’eau est évaporée au- dessus de la lampe sur une lamelle couvre-objet (cover) et le résidu qu’elle abandonne est coloré avec une solution de bleu de méthylène; on laisse sécher, on lave à l’alcool, on monte dans le baume et on examine au microscope à un grossissement l’au moins 500 diamètres. Etant donnée l’action élective bien connue du bleu de méthylène et des autres couleurs basiques d’aniline sur les bactéries celles-ci devraient être facilement constatables, si la production le cristaux ne gênait pas singulièrement l’observation. M. Cahen a fait subir à ce procédé quelques légères modifications de détail.
Il opère non plus sur une seule goutte d’eau, mais bien sur 10 à 15 centimètres cubes qui sont évaporés lentement au bain-marie, dans une capsule de porcelaine flambée, jusqu’à réduction de moitié. Il transporte alors au moyen d’une baguette de verre stérilisée par la chaleur une forte goutte de ce liquide ainsi concentré sur une lame porte-objet, moins fragile qu’un cover. La lame est placée sous une cloche de verre pendant vingt-quatre heures environ jusqu’à l’évaporation complète, puis le résidu est traité par de l’alcool concentré qu’on laisse évaporer pendant un quart d’heure, il est ensuite coloré avec du violet de gentiane, du bleu de méthylène ou mieux de la safranine et laissé en contact avec la solution colorante pendant vingt-quatre heures sous une cloche. On lave alors à l’alcool à 90°, on laisse sécher, on monte dans le baume et on examine avec un grossissement de 700 diamètres.
Le perfectionnement consiste ici surtout dans la substitution de l’évaporation lente à l’évaporation rapide au-dessus d’une flamme qui risquait de brûler et de détruire les microorganismes.
Ce procédé comme le précédent est des plus infidèles et ne peut être considéré que comme très approximatif.
C. Examen après précipitation par l’acide osmique. — Procédé de M. Certes. — M. A. Certes, qui déjà en 1880, avait, dans une note à l’Institut fait connaître les avantages que l’analyse micrographique des eaux pouvait retirer de l’emploi de l’acide osmique et des autres réactifs durcissants du protoplasma, fit, le 28 août 1882, au Congrès de l’Association française pour l’avancement des sciences, tenu à La Rochelle , une longue communication dans laquelle il préconisait à nouveau son procédé et en fixait d’une façon plus stricte le modus operandi. Ce procédé, essentiellement basé sur l’action fixatrice de certains produits chimiques et notamment de l’acide osmique, s’adresse non seulement aux microbes, mais encore et surtout à ces petits êtres végétaux ou animaux, infiniment supérieurs comme organisation aux bactéries, qui constituent la florule et la faunule microscopiques de la plupart des eaux. Ces infusoires, ces algues, ces microorganismes de toutes sortes sont tués, fixés instantanément dans leur forme, légèrement colorés et précipités dans le fond des récipients contenant le liquide à examiner.
Certaines précautions doivent, bien entendu, être prises, afin d’assurer la propreté absolue des flacons qui contiendront les échantillons d’eau, et pour empêcher leur contamination par des organismes ou des germes étrangers; comme elles ne présentent rien de particulier, il n’y a pas lieu d’y insister ici.
Je préfère indiquer, de façon plus complète que cela n’est fait d’ordinaire dans les ouvrages de bactériologie, le mode d’emploi des réactifs et notamment de l’acide osmique qui, encore maintenant, peut, dans certains cas spéciaux, être utilisé et rendre quelques services.
D’après M. Certes, le réactif le meilleur est l’acide osmique; puis viennent, par ordre d’efficacité : le bichlorure de mercure, la chaleur, l’iode, le chlorure de palladium, le bichromate de potasse, les couleurs d’aniline dissoutes dans la glycérine, dans l’alcool ou dans l’eau, qui peuvent parfois être employés successivement avec avantage.
L’acide osmique doit être en solution aqueuse à 1 pour 100, conservée dans un flacon hermétiquement clos.
Quant à l’analyse proprement dite, elle s’effectue de la manière suivante:
Dans une petite éprouvette ou dans un tube long et étroit, préalablement lavés soigneusement à l’alcool, aux acides et à l’eau bouillante, on introduit dix à douze gouttes de la solution d’acide osmique (1 centimètre cube de cette solution donne, avec un compte-gouttes ordinaire, 17 à 18 gouttes). L’eau à analyser, après quelques minutes de repos, est ensuite versée lentement (à la dose de 30 à 40 centimètres cubes) par fractions et en agitant à chaque fois pour assurer le mélange. De cette façon, les organismes en suspension se trouvent successivement en contact avec une solution à 1/2, 1/4, à 1/5 pour 100, sans que cependant la proportion du réactif, qui a pu être trop forte au début pour certains organismes, devienne trop faible à la fin pour les autres. Au bout de quelques minutes, on ajoute encore de l’eau distillée pour atténuer l’action de l’acide osmique et on laisse déposer.
On décante ensuite, surtout lorsqu’il s’agit de la recherche d’organismes très ténus comme les microbes, au bout d’au moins plusieurs heures et généralement de vingt-quatre heures, de manière à ne conserver que le dépôt ou sédiment dans 1 à 3 centimètres cubes de liquide. C’est ce dépôt qui est alors examiné au microscope, tel quel ou après avoir été coloré avec une couleur basique d’aniline en solution aqueuse, additionnée de glycérine au tiers.
On peut enfin, si l’examen microscopique ne doit pas être immédiat, conserver le sédiment en le plaçant dans de l’eau distillée phéniquée, ou dans un des liquides dont M. Certes donne les formules (liquides d’Allen, de Brun, de Petit, etc.).
Les résultats obtenus avec la méthode de Certes peuvent être excellents en ce qui concerne la constatation de certaines espèces d’infusoires, d’algues ou de diatomées; mais il nous apparaissent aujourd’hui comme bien peu importants pour l’analyse bactériologique des eaux; ils méritent cependant d’être rapportés, parce que le procédé qui les fournit peut être considéré comme une des premières tentatives les plus sérieuses et les plus scientifiques dans la voie que nous allons parcourir.
Les méthodes basées sur l’examen microscopique des eaux, avec ou sans opération préalable, ne purent, malgré les efforts et la grande confiance de leurs auteurs, satisfaire aux exigences des véritables bactériologues qui comprenaient fort bien que des êtres d’une petitesse aussi grande que les bactéries pouvaient et devaient, le plus ordinairement, passer complètement inaperçus.
Aussi, les microbiologistes se préoccupèrent-ils de bonne heure de substituer à ces procédés grossiers et infidèles une méthode plus sûre et plus scientifique et de faire pour les microbes de l’eau ce qu’on tentait depuis quelque temps déjà pour ceux des humeurs virulentes, c’est-à-dire les cultiver dans des milieux nutritifs appropriés.
Je ne peux, dans ce manuel, faire l’historique complet des tâtonnements qui aboutirent aux découvertes modernes. Qu’il me suffise de dire que, bien qu’en 1871, Burdon Sanderson ait fait quelques expériences qui démontraient, par des cultures positives, la présence de bactéries dans les eaux de Londres, ce sont MM. Pasteur et Joubert qui, en 1878, ont, les premiers, paru indiquer d’une façon formelle le procédé de culture en milieux liquides comme pouvant servir pour l’analyse microbiologique des eaux. Ils pratiquèrent eux-mêmes un grand nombre d’analyses et purent ainsi émettre un certain nombre de conclusions qui modifièrent quelque peu l’idée que l’on se faisait de la pureté de certaines eaux. Ils démontrèrent notamment que les eaux de rivière étaient très riches en germes microbiens, tandis que les eaux de source, puisées au lieu même d’émergence, n’en renferment absolument pas et que les eaux distillées des laboratoires, que l’on croyait si pures, étaient constamment contaminées, à moins qu’on eût pris soin de les recueillir dans des vases absolument privés de germes. Ces différentes constatations eurent un très grand retentissement et furent le point de départ de recherches qui, à bref dé - lai, donnèrent, entre les mains de Miquel, des résultats tels qu’une nouvelle méthode d’analyse microbiologique des eaux était spéciale, et présentant de sérieuses garanties d’exactitude. D’autre part, les travaux de Koch sur l’utilisation, en microbiologie, des milieux nutritifs solidifiables et particulièrement de la gélatine-peptone, modifièrent singulièrement la technique que l’on avait suivie jusqu’alors, et les Allemands ne manquèrent pas d’appliquer à l’analyse microbiblogique des eaux les nouveaux procédés de cultures sur milieux solides qui, quoi qu’on en ait voulu dire, ont constitué et constituent encore un immense progrès dans l’histoire de la Microbie.