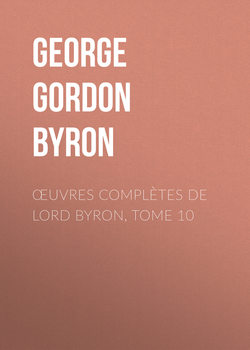Читать книгу Œuvres complètes de lord Byron, Tome 10 - George Gordon Byron - Страница 20
LETTRE XCI
Оглавление5 mars 1812.
Milord,
«Puis-je espérer que votre seigneurie voudra bien accepter un exemplaire de l'ouvrage ci-joint? Vous avez si complètement prouvé la vérité du premier vers de la strophe de Pope: Le pardon appartient à l'injure, que je me hâte de saisir cette occasion de donner un démenti au vers suivant. Si je n'étais bien convaincu que tout ce qui, dans ma jeunesse, s'est échappé d'une tête follement irritée, a fait sur votre seigneurie aussi peu d'impression qu'il en méritait, je n'aurais pas le courage (peut-être donnerez-vous à mon action un nom plus sévère et plus juste), de vous offrir un in-4° du même auteur. J'ai appris avec peine que votre seigneurie souffrait de la goutte: si mon livre peut vous faire rire de lui-même ou de son auteur, il aura du moins servi à quelque chose; s'il pouvait vous faire dormir, je m'en estimerais plus heureux encore; et puisque certains personnages facétieux ont dit, il y a plusieurs siècles, que les vers sont de franches drogues, je vous offre les miens comme de faibles assistans de l'eau médicinale.
»J'espère que vous me pardonnerez cette bouffonnerie comme les autres, et me croirez, avec le plus profond respect,
»De votre seigneurie,
»Le très-affectionné et obligé serviteur,»
BYRON.
Deux jours après son discours à la Chambre Haute, parut Childe-Harold 17; et l'impression qu'il fit sur le public fut aussi instantanée que profonde et durable. Le génie seul pouvait assurer la continuité du succès; mais, outre le mérite de l'ouvrage, on peut assigner d'autres causes à l'enthousiasme avec lequel il fut aussitôt reçu.
Note 17: (retour) Il envoya l'un des premiers exemplaires à sa sœur, Mrs. Leigh, avec l'inscription suivante:
«Offert à ma chère sœur Augusta, à ma meilleure amie, à celle qui m'a toujours aimé beaucoup plus que je ne le méritais, par le fils de son père, et son très-affectionné frère,
BYRON.»
Il y a des personnes qui veulent voir, dans le caractère particulier du génie de Byron, des traits frappans de ressemblance avec celui du tems où il a vécu; qui pensent que les grands événemens qui signalèrent la fin du dernier siècle, en donnant une nouvelle impulsion aux esprits, en les habituant aux idées libres et grandes, en ouvrant la carrière aux hommes entreprenans dans tous les genres, amenèrent naturellement la production d'un poète tel que Byron; qui, enfin, le considèrent comme le représentant de la révolution dans la poésie, aussi bien qu'un autre grand homme, Napoléon, en fut le représentant dans le gouvernement des états et la science de la guerre. Sans adopter cette opinion dans toute son étendue, il faut avouer que la liberté donnée à toutes les passions, à toutes les énergies de l'esprit humain, dans la grande lutte de cette époque, jointe au spectacle constant de ces vicissitudes épouvantables qui avaient lieu presque chaque jour sur le théâtre du monde, avait créé, dans tous les esprits, dans toutes les intelligences, un goût prononcé pour les impressions fortes, que les stimulans puisés aux sources ordinaires ne pouvaient plus contenter; on peut avouer encore qu'un asservissement abject aux autorités établies était tombé en discrédit, non moins en littérature qu'en politique, et que le poète dont les chants respireraient le plus complètement cet esprit sauvage et passionné du siècle, qui oserait sans règles et sans entraves s'avancer jusqu'aux dernières limites dans l'empire du génie, était plus sûr de rencontrer un public disposé à sympathiser avec ses nobles inspirations.
Il est vrai qu'à la licence sur les sujets religieux qui s'était débordée pendant les premiers actes de ce drame terrible, avait succédé pendant quelque tems une disposition d'esprit dans un sens diamétralement opposé. Non-seulement la piété, mais le bon goût s'étaient révoltés contre les plaisanteries et la dérision des choses saintes; et si Lord Byron, en traitant de tels sujets dans Childe-Harold, eût adopté ce ton de légèreté et de persiflage, auquel il est malheureusement descendu quelquefois dans la suite, toute l'originalité, toute la beauté de cet ouvrage n'eussent pu lui assurer un triomphe aussi prompt et si incontesté. Les sentimens religieux qui se sont développés dans toute l'Europe depuis la révolution française, comme les principes politiques nés du même événement, en rejetant toute la licence de cette époque, avaient conservé cependant son esprit de liberté et de recherche. Parmi les premiers résultats de cette piété ainsi agrandie et éclairée, est cette liberté qu'elle porte les hommes à accorder aux opinions et même aux hérésies des autres. Pour des personnes sincèrement religieuses, et par conséquent tolérantes, c'était sans doute un grave spectacle que celui d'un grand génie comme Byron, éclipsé par les ténèbres du scepticisme. Si elles avaient connu elles-mêmes auparavant ce que c'est que douter, elles éprouvaient une sympathie mélancolique pour lui; si au contraire elles étaient toujours demeurées tranquilles dans le port de la foi, elles jetaient un œil de pitié sur un malheureux encore en proie à l'erreur. En outre, quelqu'erronées que fussent alors ses idées en matière religieuse, il y avait dans son caractère et dans sa destinée quelques circonstances qui laissaient encore l'espoir qu'un jour plus pur pourrait luire pour lui. Son tempérament et sa jeunesse ne pouvaient faire craindre qu'il fût déjà endurci dans ses égaremens; on savait que, pour un cœur ulcéré comme le sien, il n'y avait qu'une source véritable de consolations: ainsi l'on espérait que l'amour de la vérité, si visible dans tout ce qu'il avait écrit, lui permettrait un jour de la découvrir.
Une autre, et l'une des causes qui, avec le mérite réel de son ouvrage, contribuèrent le plus puissamment à lui assurer le succès prodigieux qu'il obtint, fut sans doute la singularité de son histoire personnelle et de son caractère. La manière dont il avait fait son entrée dans le monde avait été assez extraordinaire pour exciter vivement l'attention et l'intérêt. Tandis que dans la classe à laquelle il appartenait, tous les autres jeunes gens de mérite s'y présentaient précédés des éloges et des espérances d'une foule d'amis, le jeune Byron y était entré seul, sans être annoncé, sans être attendu, représentant une ancienne maison dont le nom, long-tems enseveli dans les sombres solitudes de Newsteadt, semblait se réveiller en sa personne du sommeil d'un demi-siècle. Les circonstances qui suivirent la prompte vigueur de ses représailles sur ceux qui avaient attaqué sa gloire littéraire; sa disparition de la scène de son triomphe aussitôt qu'il eut vaincu, sans qu'il daignât attendre les lauriers qu'il avait mérités; son départ pour un voyage lointain, dont il laissait au hasard et au caprice le soin de fixer la durée et les limites: toutes ces circonstances successives avaient jeté un air aventureux sur le caractère du poète, et préparé les lecteurs à venir au-devant des impressions de son génie. En faisant une connaissance plus intime avec lui, loin de le voir tomber au-dessous de ce qu'ils avaient imaginé, ils découvrirent en lui de nouvelles singularités, de nouveaux motifs d'intérêt bien supérieurs à tout ce qu'ils avaient pu prévoir: tandis que la curiosité et la sympathie excitées par ce qu'il avait laissé transpirer de son histoire étaient encore enflammées davantage par le mystère qui environnait tout ce qu'il lui restait encore à raconter. Les pertes récentes qu'il avait faites, et qu'il avait si douloureusement ressenties, donnaient de la réalité aux idées que ses admirateurs s'étaient faites, et semblaient les autoriser à imaginer plus encore. Ce que l'on avait dit du poète Young, qu'il trouva l'art de faire partager ses chagrins particuliers au public, pourrait avec plus de force et de vérité s'appliquer aussi à Lord Byron.
Les avantages dont nous venons de parler agirent avec beaucoup de force dans le cercle de société avec lequel il se trouva immédiatement en contact, soutenus par d'autres qui eussent présenté assez d'attraction, surtout aux femmes, quand bien même il n'aurait pas possédé tant de grandes qualités. Sa jeunesse, la beauté noble et mâle de ses traits empreints d'une mélancolie gracieuse; la douceur de sa voix et de ses manières avec les femmes; la fierté qu'il déployait dans l'occasion avec les hommes; la singularité de tout ce que l'on rapportait de son genre de vie, si propre à exciter et à nourrir la curiosité: toutes ces petites circonstances, toutes ces habitudes concoururent à répandre promptement sa réputation. On ne saurait nier non plus que, parmi bien d'autres sources plus pures d'intérêt, l'on ne doive compter les allusions qu'il fait dans son poème à des passions heureuses; allusions qui n'étaient pas sans influence sur l'imagination d'un sexe qui se laisse vaincre avec moins de résistance par ceux que recommandent un plus grand nombre de succès antérieurs.
Il était convaincu, en partie peut-être par modestie que son rang était entré pour beaucoup dans les causes de la vogue de son livre. «J'en dois une grande partie, disait-il à M. Dallas, à mon titre de lord.» On serait d'abord disposé à croire qu'un charme de cette nature ne devrait opérer que sur des hommes d'un rang inférieur; mais ces paroles mêmes sont la meilleure preuve qu'il n'est point de classe où l'on sente et apprécie aussi vivement l'avantage d'être noble que dans la classe de ceux qui le sont. Il était naturel aussi que l'admiration de cette société pour le nouveau poète fût augmentée par le sentiment qu'il était sorti de son sein, et que leur ordre avait à la fin produit un homme de génie qui paierait amplement les arrérages de leur contribution dûs depuis si long-tems au trésor de la littérature anglaise.
Enfin, pour me résumer, si l'on considère tous les avantages que je viens d'énumérer, on pourra voir que jamais il n'a existé, et que probablement il n'existera jamais une intelligence aussi vaste, un génie aussi surprenant, aidé de tant de circonstances et de qualités qui captivent le monde et le jettent dans l'admiration. Aussi l'effet fut-il électrique; sa renommée ne passa pas par les gradations ordinaires, elle s'éleva et atteignit toute sa hauteur en un jour, comme un palais dans les contes de fées. Ainsi qu'il le dit lui-même dans ses Memoranda: «Je m'éveillai un matin et me trouvai un homme célèbre.» La première édition de son ouvrage fut enlevée en un moment; et comme les échos de sa renommée se multipliaient de tous côtés, les noms de Childe-Harold et de Lord Byron remplirent bientôt toutes les bouches. Les plus grands personnages vinrent s'inscrire à sa porte; et, parmi ceux-ci, plusieurs de ceux qu'il avait le plus maltraités dans sa satire: mais ils oubliaient maintenant leur ressentiment pour n'écouter qu'une généreuse admiration. Depuis le matin jusqu'au soir s'entassaient sur sa table des lettres, témoignages flatteurs de son succès; depuis le grave tribut des hommes d'état et des philosophes, jusqu'au billet romanesque d'un incognito, qui lui plaisait bien davantage, ou l'invitation pressante de quelque belle dame qui donnait alors le ton à la société fashionable. Londres, qui quelques semaines avant n'était pour lui qu'un désert, lui ouvrit l'entrée de ses cercles les plus distingués; et bientôt il se vit le personnage le plus recherché dans les assemblées les plus illustres.
M. Murray avait donné 600 livres sterling de ce poème; mais Byron en avait abandonné la propriété à M. Dallas 18, de la manière la plus simple et la plus délicate, disant en même tems que jamais il ne consentirait à recevoir un sou pour ses écrits, résolution dictée par l'orgueil et la générosité réunies, dont il se départit sagement dans la suite, quoiqu'elle eût été suivie jusqu'au bout avant lui par Swift 19 et par Voltaire. Ce dernier abandonna à Prault et à d'autres libraires le produit de la plupart de ses ouvrages; et quant aux autres, il en reçut quelquefois la valeur en livres, mais jamais en argent. Byron avait eu d'abord l'intention de dédier son ouvrage à son jeune ami, M. Harness; mais il y renonça en y réfléchissant plus mûrement. Après lui avoir annoncé ce changement de résolution dans une lettre qui malheureusement s'est perdue ainsi que plusieurs autres, il en donne pour raison que, plusieurs parties de son poème pouvant faire une impression défavorable pour lui-même, il craignait qu'une partie de l'odieux ne retombât jusque sur son ami, et ne lui portât préjudice dans la carrière qu'il se disposait à embrasser.
Note 18: (retour) Après lui avoir parlé de la vente et réglé tout pour la seconde édition, je dis: «Comment puis-je penser à la rapidité de la vente, aux profits qui en résulteront, sans songer… – À quoi? – Aux sommes que cet ouvrage pourra produire. – Tant mieux, je voudrais qu'elles fussent doubles, triples; mais ne me parlez pas d'argent. Je ne recevrai jamais d'argent pour mes ouvrages.» (Souvenirs, par M. Dallas.)
Note 19: (retour) «Je n'ai jamais, dit Swift dans une lettre à Pulteney. (12 mai 1735), reçu un sou de mes ouvrages, si ce n'est une fois.»
Peu de tems après la publication de Childe-Harold, le noble auteur vint me faire une visite le matin; et me mettant dans la main une lettre qu'il venait de recevoir, me pria de vouloir bien me charger pour lui de toutes les démarches que cette lettre pourrait nécessiter. Elle lui avait été remise par M. Leckie, auteur bien connu d'un ouvrage sur les affaires de la Sicile, et elle venait d'un des anciens coryphées du monde fashionable, le colonel Gréville. Son but était de demander de Lord Byron, comme auteur des Poètes anglais et les Journalistes écossais, une réparation convenable de l'injure que le colonel pensait avoir reçue dans certains passages relatifs à sa conduite comme directeur de l'Argyle-Institution, passages de nature, selon lui, à blesser son honneur. Il y avait dans la lettre du brave colonel des expressions un peu fortes, et que Lord Byron n'était pas disposé à laisser passer, quoiqu'il convînt bien d'avoir eu les premiers torts: «Aussi, me dit-il, lorsque je la lui remis, il n'y a qu'une manière de répondre à une pareille lettre.» Toutefois, il consentit à s'en remettre entièrement à moi sur toute cette affaire; et bientôt après, j'eus une entrevue avec le témoin du colonel Gréville. Je ne le connaissais aucunement alors: il me reçut avec la plus grande politesse, et montra toute la disposition possible de terminer à l'amiable l'affaire qui nous réunissait. Comme je commençai par lui représenter que les termes dans lesquels était exprimée la demande de son ami devaient être changés auparavant, il consentit avec empressement à lever cet obstacle. À sa prière, je biffai avec une plume les mots qui me semblaient inconvenans; et il se chargea de faire transcrire de nouveau la lettre et de me l'envoyer le lendemain matin. Dans l'intervalle, je reçus de Lord Byron les instructions suivantes:
«Pour le passage relatif aux pertes de M. Way, on ne parle nullement que le jeu ait été déloyal, comme on peut le vérifier dans le livre, où il est même expressément ajouté en note que les directeurs ignoraient complètement ce qui se passait. Que l'on ait joué à Argyle-Rooms, on ne saurait le nier, puisqu'il y avait des billards et des dés. Lord Byron les a vus personnellement en usage. On présume que des billards et des dés peuvent bien être appelés des jeux. Le mot admis, le président de l'institution ne saurait se plaindre d'avoir été désigné comme l'arbitre du jeu… ou bien alors qu'aurait signifié son autorité?
»Lord Byron n'a point d'animosité contre le colonel Gréville. Il lui semble qu'il a le droit de parler et d'écrire publiquement d'une institution publique, dont il était lui-même l'un des souscripteurs. Le colonel Gréville était le directeur reconnu de cette institution… Il serait trop tard maintenant de discuter sur ce qu'elle peut avoir de bon ou de mauvais.
»Lord Byron doit laisser au témoin du colonel Gréville et au sien, M. Moore, la discussion de la réparation de l'injure vraie ou supposée. Tout en ayant le plus égard à ce que peut exiger l'honneur du colonel, Lord Byron prie ces messieurs de ménager aussi le sien. Si l'affaire peut se terminer à l'amiable, Lord Byron fera tout ce qui est en son pouvoir pour amener un tel résultat, sinon il est disposé à faire raison au colonel Gréville de la manière qu'il lui plaira de choisir.»
Je reçus le matin la seconde lettre, avec le billet suivant de M. Leckie.
Mon Cher Monsieur,
«J'ai trouvé mon ami au lit, très-malade; je l'ai cependant déterminé à copier la lettre ci-jointe, avec les changemens convenus. Peut-être voudrez-vous me voir ce matin; je vous attendrai jusqu'à midi. Si vous préférez que je vienne vous trouver; dites-le moi: je suis tout à vos ordres.
»Votre très-affectionné, etc.»
G.T. LECKIE.
Avec des dispositions aussi favorables des deux côtés, il est presqu'inutile d'ajouter que l'affaire ne tarda pas à s'arranger de la manière la plus satisfaisante.
Puisque j'en suis sur le chapitre des duels, je profiterai de l'occasion pour extraire quelques détails piquans du compte rendu par Lord Byron de certaines affaires de ce genre, dans lesquelles il avait été, à différentes époques, employé comme médiateur:
«J'ai été appelé au moins vingt fois, comme médiateur ou second, dans de violentes querelles. J'ai toujours trouvé moyen d'arranger l'affaire sans compromettre l'honneur des parties, ou les entraîner à des conséquences mortelles; et cela dans des circonstances fort délicates quelquefois, et ayant à traiter avec des esprits emportés et irascibles, des Irlandais, des joueurs, des gardes-du-corps, des capitaines, des cornettes de cavalerie et autres gens ejusdem farinæ. Tout cela, bien entendu, dans ma jeunesse, quand je fréquentais des compagnies à tête chaude. J'ai porté des défis de gentlemen à des lords, de capitaines à des capitaines, d'hommes de loi à des conseillers, et une fois d'un ecclésiastique à un officier de gardes-du-corps; mais je trouvai celui-ci peu disposé à terminer cette sanglante querelle sans en venir aux coups. L'affaire était venue à propos d'une femme. Je n'ai jamais vu femelle se conduire si mal que cette créature sans ame et sans cœur; ce qui ne l'empêchait pas d'être fort belle. C'était une certaine Susanne C***. Je ne l'ai jamais vue qu'une fois, et ce fut pour l'engager à dire deux mots, qui ne pouvaient lui faire le moindre tort, et qui auraient eu pour effet de sauver la vie d'un prêtre ou d'un lieutenant de cavalerie. Elle ne voulait pas dire ces deux mots; et ni moi, ni N***, fils de sir E. N***, témoin de l'autre partie, ne pûmes les lui arracher, quoique nous eussions tous deux une certaine habitude du commerce des femmes. Je parvins toutefois à arranger l'affaire sans son talisman, et, je crois, à son grand déplaisir; c'était bien la plus infernale prostituée que j'aie jamais vue, et j'en ai vu un bon nombre. Quoique mon ecclésiastique fût sûr de perdre sa femme ou son bénéfice, il était aussi belliqueux que l'évêque de Beauvais. Il ne voulait pas se laisser apaiser; mais il était amoureux, et l'amour est une passion martiale.»
Quelque désagréable qu'il fût pour lui de voir les conséquences de sa satire entraîner des explications hostiles, il était incomparablement plus embarrassé dans les cas où l'on y répondait par des témoignages d'affection. Il se rencontrait journellement à cette époque avec les personnes que sa plume avait offensées personnellement ou dans leurs proches, et les politesses qu'il en recevait étaient, comme il le disait souvent en se servant du langage si fort de l'Écriture, comme autant de charbons ardens accumulés sur sa tête. Il était, en effet, on ne peut plus sensible au plaisir ou au déplaisir de ceux avec lesquels il vivait; et s'il avait passé sa vie sous l'influence immédiate de la société, on peut douter qu'il se fût jamais abandonné à cette énergie sans frein, dans laquelle il déploya ses talens, et dont il abusa quelquefois. Quand il publia sa première satire, la société ne lui avait pas encore imposé son joug salutaire, et au moment où il donna Caïn et Don Juan, il avait de nouveau brisé tous les liens qui l'y attachaient. De là cet instinct de solitude et d'indépendance auquel il a dû une grande partie de sa force. Une fois dans le domaine de sa propre imagination, il pouvait défier le monde entier; dans la vie réelle, on eût pu le gouverner par un froncement de sourcil, par un sourire. La facilité avec laquelle il sacrifia son premier avis, sur le simple conseil de son ami, M. Becher, est une grande preuve de la flexibilité de son caractère. Pour Childe-Harold, les opinions de MM. Gifford et Dallas eurent tant d'influence sur son esprit, que non-seulement il renonça à sa première idée de s'identifier avec son héros, mais encore il leur abandonna une de ses stances favorites, qu'ils avaient trouvée trop hétérodoxe. Peut-être même peut-on avancer que, si ces messieurs avaient voulu user davantage de leur influence sur lui, il eût consenti à faire disparaître toute la partie sceptique de son ouvrage. Toujours est-il certain que, pendant le reste de son séjour en Angleterre, il n'offrit rien de semblable à ses lecteurs, et que, dans les belles créations de son génie, qui illustrèrent cette époque et tinrent le public dans une admiration perpétuelle, la licence et l'amertume de son esprit furent heureusement restreintes par le sentiment des convenances. Le monde, en effet, n'avait pas encore vu ce dont il était capable, une fois qu'il se serait débarrassé de ses entraves. Quelque gracieux, quelque forts qu'eussent été ses ouvrages tant qu'il resta dans son sein, ce fut seulement quand il fut affranchi de tous liens, qu'il donna l'essor à son génie et s'éleva à cette hauteur prodigieuse où il put enfin déployer toute sa force. Quoique l'abus qu'il en fit soit déplorable, les excès mêmes de cette énergie sont si magnifiques, qu'on ne peut s'empêcher de les admirer en les condamnant.
Cette sensibilité, à l'égard de sa satire, qui m'a conduit aux remarques précédentes, est un des exemples qui montrent combien aisément cet esprit colossal eût pu être, je ne dis pas étouffé, mais comprimé par les petits liens de la société. L'agression dont il s'était rendu coupable, non-seulement était passée depuis long-tems, mais, plusieurs des plus offensés l'avaient entièrement pardonnée, et cependant, ce qui fait le plus grand honneur à son sentiment des convenances sociales, l'idée de vivre familièrement et sur un pied d'amitié avec les personnes sur les talens ou le caractère desquelles il avait exprimé une opinion si défavorable lui devint à la fin si insupportable, qu'avancé comme il l'était dans la cinquième édition des Poètes anglais, etc., il en vint à prendre la résolution d'anéantir tout-à-fait cette satire, et qu'il donna en conséquence à Cawthorn, son libraire, l'ordre de jeter l'édition entière au feu. Il sacrifia aussi dans le même tems, et par des motifs semblables, aidés, à ce que je pense, de quelques représentations amicales de lord Elgin ou de ses amis, la Malédiction de Minerve, poème dirigé contre ce seigneur, et dont l'impression était déjà fort avancée. Les Imitations d'Horace partagèrent le même sort, quoiqu'elles continssent moins de satires personnelles.
Pour prouver encore mieux combien il était sensible aux plus légers nuages qui pouvaient s'élever dans la société où il vivait, je n'ai qu'à citer les billets suivans qu'il adressa à son ami, M. William Bankes, craignant que celui-ci n'eût quelque raison d'être fâché contre lui.