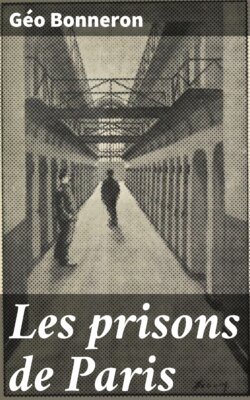Читать книгу Les prisons de Paris - Géo Bonneron - Страница 12
LE PERSONNEL ET LES RÈGLEMENTS
ОглавлениеL’administration et le règlement intérieurs. — Les directeurs, les employés, les gardiens. — La discipline et les punitions disciplinaires.
Depuis leur organisation jusqu’en 1888, les prisons de la Seine étaient administrées par le Préfet de Police sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur.
Un décret du 28 juin-20 septembre 1887, les a, après une longue enquête, rattachées directement au Ministère de l’Intérieur, les soumettant aux mêmes conditions d’administration et de contrôle que les établissements similaires des autres départements. Ce décret a retiré au Préfet de Police le droit de nomination des directeurs et des différents fonctionnaires, et ne lui a laissé que «les attributions qu’il exerçait précédemment comme tenant lieu des attributions du préfet du département de la Seine, en ce qui concerne les prisons».
Tout ce qui touche l’administration et le fonctionnement des établissements pénitentiaires est prévu et régi par le décret des 11-16 novembre 1885. Ce décret, soigneusement étudié par les hommes les plus compétents, est un véritable monument. Il ne laisse rien à l’imprévu, règle et détermine tout par le menu.
Nous le suivrons ici dans ses principales lignes.
Le personnel de direction et de surveillance varie naturellement suivant l’importance des maisons. Il est fixé pour chaque établissement par le Ministre de l’Intérieur.
Le Directeur est le représentant dans la prison de l’Administration pénitentiaire. Il est responsable de la marche et du fonctionnement régulier de tous les services. Tous les ordres émanent de lui; et quand ils sont donnés par une autorité supérieure, c’est seulement par son intermédiaire qu’ils doivent être transmis au personnel placé sous ses ordres.
La direction d’une prison est une œuvre fort délicate et très difficultueuse. Elle exige de celui qui en est chargé de l’intelligence, de l’énergie et du cœur. Et si au point de vue du résultat à obtenir l’amélioration des locaux, du régime et des services divers joue un grand rôle, la capacité et la compétence du directeur sont surtout à considérer. Tel fonctionnaire dévoué, se consacrant entièrement à son service, saura tirer un excellent parti de l’établissement le plus imparfait, et réussira là où tel autre, moins convaincu, ayant moins de cœur et de connaissances, échouerait totalement.
Les détenus se louent presque toujours des Directeurs. Ils reconnaissent leur dévouement et gardent un durable souvenir des marques d’intérêt qu’ils ont reçues d’eux. La plupart des directeurs conservent des lettres que leur ont adressées des prisonniers après leur libération, pour le remercier et leur dire ce qu’ils deviennent.
Les Directeurs sont divisés en quatre classes, basées sur le mérite personnel et ne tenant en rien à la résidence, à telle ou telle maison. Un même directeur peut sans changer d’établissement être successivement élevé de la quatrième à la première classe. Le traitement varie en proportion. A Paris, un directeur de 1re classe touche annuellement 6,000 francs; les émoluments des directeurs de 2e classe sont de 5,500 francs; ceux d’un directeur de 3e classe de 5,ooo, et ceux d’un directeur de 4e classe de 4,500 francs.
Les Directeurs sont logés dans les établissements qu’ils dirigent.
Le Gardien-chef est, sous l’autorité du directeur, chargé de la garde des prisonniers. Il est tenu d’assurer le maintien de l’ordre et de la discipline, l’exécution des services de propreté et d’hygiène dans toutes les parties de la prison. Il veille à l’exécution des clauses du cahier de charges passé avec le ou les entrepreneurs, et dirige tous les détails du service intérieur. Il est, en outre, chargé de tenir les différents registres prescrits par le Code d’Instruction Criminelle, ainsi que divers registres de contrôle et de comptabilité, de statistique, de punitions, de libérations, prescrits par les règlements, et qui varient suivant la classification et l’affectation des établissements pénitenciers.
Le Gardien-chef est toujours logé dans la prison. Il n’a le droit, sous aucun prétexte, de recevoir les détenus dans son logement. Les membres de sa famille ne doivent pas non plus pénétrer dans les locaux occupés par les détenus.
Les Gardiens ordinaires sont placés immédiatement sous les ordres du Gardien-chef. Il doivent, en toute circonstance, se conformer à ses prescriptions, et lui faire connaître de suite toutes les particularités ou difficultés qui peuvent se présenter dans le service.
Les Gardiens ordinaires autres que le Gardien-portier ne sont pas logés dans l’intérieur de la prison.
Le Gardien-chef et les Gardiens ordinaires sont tenus de porter constamment dans l’exercice de leurs fonctions le costume réglementaire. Il doivent garder une attitude régulière et propre, scrupuleusement militaire. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction ni se laisser détourner de leurs fonctions réglementaires par aucun service ou travail extérieur.
Il leur est formellement interdit, ainsi qu’à tous employés, agents ou préposés, d’accepter quoi que ce soit des détenus ou de personnes agissant pour eux, de se charger pour leur compte d’aucune commission, d’acheter ou vendre la moindre chose. Ils ne doivent pas user avec les détenus du tutoiement ou de langage grossier; il leur est défendu de boire ou manger avec eux ou leur famille, amis et visiteurs.
Il leur est également défendu d’agir auprès des détenus, directement ou indirectement, pour influer sur le choix d’un défenseur. Dans certaines prisons, notamment à Paris, quelques gardiens ne se font malheureusement pas scrupule de se montrer auprès des détenus, et moyennant rétribution, les agents d’avocats en quête d’affaires. On connaît au Palais tels avocats qui pratiquent en grand ce genre de rabattage, avec le concours, on pourrait dire la complicité, des gardiens des maisons de prévention. Le Conseil de l’Ordre est impuissant contre de pareils agissements, ou bien il veut fermer systématiquement les yeux. Il nous semble cependant que la dignité professionnelle souffre de semblables procédés et qu’il y aurait lieu de prendre des mesures contre ces avocats de proie.
Les gardiens des prisons sont généralement d’anciens sous-officiers, ou d’anciens militaires. Ils n’arrivent dans les prisons de Paris qu’après avoir fait un stage en province.
Le recrutement n’en est d’ailleurs pas aussi facile qu’on le pourrait croire. Les anciens militaires considèrent un peu cette situation comme un pis-aller.
Les appointements ne sont pas élevés, il s’en faut. A Paris, les gardiens-chefs, divisés en deux classes, ont des traitements de 2,400 francs et 2,100 francs. Viennent ensuite deux classes de premiers gardiens qui reçoivent 1,900 et 1,800 francs. Les gardiens ordinaires, divisés en cinq classes, ont des appointements variant de 1,700 à i,3oo francs. Il y a encore des gardiens-commis-greffiers, chargés d’un service particulier, et qui se distinguent des autres par l’enseigne de fourrier qu’ils portent au bras.
Les gardiens reçoivent en outre de leur traitement dix francs par mois pour allocation de vivres, et ils ont droit tous les jours à leur ration de pain, qu’ils emportent au dehors pour leurs repas.
L’Administration pénitentiaire se préoccupe avec raison de la situation et de l’avenir des gardiens, desquels dépend en bonne partie le fonctionnement régulier des prisons.
Chaque prison un peu importante possède une école élémentaire de gardiens. L’instituteur y fait des cours spéciaux, et donne des notes suivant le mérite. D’après ces notes sont choisis tous les trois mois un certain nombre de sujets qui sont envoyés à Paris à l’École supérieure des gardiens. Cette École supérieure fonctionne à la Conciergerie. Ceux qui y sont admis en suivent les cours pendant six mois, au bout desquels, sur le résumé de toutes leurs notes et par voie de concours, il leur est délivré un certificat d’aptitude à l’emploi de gardien-chef. Quelques mois après, et suivant les vacances, ils sont nommés gardiens-commis-greffiers, puis gardiens-chefs. Une fois gardiens-commis-greffiers ou gardiens-chefs, ils peuvent être admis sur leur demande à subir le concours administratif au Ministère de l’Intérieur. S’ils réussissent à cette épreuve, ils entrent alors dans l’Administration proprement dite, sont nommés commis aux écritures, teneurs de livres, etc., et en suivant la filière ils peuvent arriver jusqu’aux fonctions de directeur.
Ce système, qui a été mis en vigueur en 1893, a créé parmi les gardiens une émulation et un désir d’arriver qui donnent d’excellents résultats.
Si les détenus se louent généralement des directeurs, ils n’ont pas toujours les mêmes sentiments à l’égard des gardiens. Sans doute, il y a parmi ceux-ci des hommes d’un mérite réel, qui ont le sentiment juste de leur devoir et de la dignité de leurs fonctions; mais il s’introduit fréquemment dans leurs rangs des gens qui n’ont aucune aptitude pour une situation et des devoirs aussi délicats. Les détenus ont vite reconnu à qui ils ont affaire; si parmi leur gardiens il en est qu’ils respectent et estiment, et à qui ils obéissent avec le meilleur vouloir, il en est d’autres qu’ils exècrent et à qui ils ne restent soumis que par la crainte constante du châtiment.
Les jeunes gardiens surtout s’imaginent trop volontiers que dans le monde où ils arrivent il n’est possible de se faire respecter que par la sévérité et la dûreté du commandement. Les gardiens-chefs et les gardiens plus anciens dans le métier ne sauraient trop les mettre en garde contre un excès de sévérité, et les engager, au contraire, à la douceur poussée aussi loin que le permettent les exigences du service et le maintien strict de l’ordre.
Nous avons vu une lettre d’un détenu parlant des gardiens et disant: «Il y en a de bons, à qui on est content d’obéir et de faire plaisir; mais il y en a d’autres qui sont toujours de mauvaise humeur, qui gueulent tout le temps, et que nous détestons tous...»
M. Guillot, dans un de ses ouvrages, cite le fait suivant: «un surveillant récemment nommé, dit un détenu, me demandait en prenant le service quelques renseignements sur les hommes de l’atelier, je lui répondis: Ne voyez, n’entendez que ce qu’il faut absolument voir et entendre, fermez les yeux sur les choses insignifiantes. Votre prédécesseur irritait tout le monde, on ne travaillait plus, et pendant le mois dernier la moitié de l’atelier à été puni. Il suivit mon conseil. A la fin du mois, la feuille de paie était de 200 et quelques francs plus élevée que la précédente, il n’y avait pas eu de punitions et le gardien avait été tranquille ».
Les détenus ont une grande aversion pour leurs camarades qui sont très bien avec les gardiens. Ils croient en principe que cette bonne entente est la récompense de délations et de rapports. On a vu des prisonniers simplement soupçonnés de délation être roués de coups par leurs semblables, au point de rester plusieurs mois à l’hôpital. La délation est du reste un procédé peu recommandable, et si certains gardiens sans scrupules l’encouragent, elle est réprouvée par tous ceux qui ont conscience de leur dignité. Les directeurs la punissent chaque fois qu’elle leur est signalée; et l’on a vu des directeurs intelligents punir celui qui en était l’auteur plus sévèrement que celui qui en était l’objet, même quand celui-ci s’était vengé.
Si nous en croyons certains témoignages, les gardiens se laisseraient trop souvent prendre à l’appât du gain. Ils prêteraient leur concours moyennant finance à la violation des règlements qu’ils sont chargés de faire respecter. Ils exploiteraient les détenus d’une façon indigne...
Kropotkine qui, après plusieurs séjours dans les Maisons Centrales, a écrit sur les prisons en s’efforçant de les montrer sous un jour épouvantable, dit notamment:
«Vous savez qu’il est défendu de fumer en prison. Eh bien! tout le monde fume, seulement cette marchandise précieuse que l’on chique d’abord, que l’on fume ensuite, et que l’on prise enfin sous forme de résidu, se vend au prix de quatre sous la cigarette, ou cinq francs le paquet de dix sous. Et qui la procure aux détenus? — Les gardiens eux-mêmes, ou bien les entrepreneurs de travaux, seulement la taxe est exorbitante. Voici d’ailleurs comment cela se pratique. Le détenu se fait envoyer cinquante francs au nom d’un gardien. Sur cette somme, le gardien garde vingt-cinq francs et paie le reste au détenu en tabac fourni à des prix semblables à ceux que je viens de mentionner, ou bien c’est l’entrepreneur qui paie le travail en cigares».
Il est possible que de semblables abus se produisent. Pour être gardien de prison on n’en est pas moins homme, et l’Administration a beau trier et choisir le personnel qu’elle emploie, elle ne peut pas le mettre totalement à l’abri des tentations ou répondre qu’il n’y cédera pas. Mais nous ne pensons pas que pareilles choses puissent arriver dans les prisons bien tenues, où le directeur et le gardien-chef exercent une surveillance constante et adroite, dans les prisons de la Seine spécialement.
Dans les maisons de femmes, les gardiens ordinaires sont remplacés par des surveillantes.
Le règlement porte que tous les détenus doivent être fouillés à leur entrée dans la prison, chaque fois qu’ils en sont extraits pour être menés à l’audience ou à l’instruction, et chaque fois qu’ils y sont ramenés. Ils peuvent, en outre, être soumis à la fouille aussi souvent que le directeur ou le gardien-chef le jugent nécessaire. Il ne leur est laissé ni argent, ni bijoux, ni valeurs quelconques, sauf quelquefois et sur leur demande les bagues d’alliance auxquelles ils peuvent tenir particulièrement, et qui sont susceptibles de réveiller chez eux des pensées et des souvenirs utiles. Tous les objets trouvés sur les détenus sont déposés entre les mains du gardien-chef, et il en est tenu un compte exact, ou bien ils sont remis à la famille avec l’assentiment de l’intéressé. L’argent déposé au nom des détenus au moment de l’incarcération, ou versé plus tard à leur compte, peut être employé par eux à l’achat d’aliments supplémentaires ou en dépenses prévues et autorisées par le règlement.
Tout ce qui est apporté du dehors pour les détenus est visité. Les visiteurs doivent soumettre à l’examen du gardien à ce préposé les objets qu’ils peuvent être autorisés à remettre aux détenus.
On tolère aux prévenus de l’argent de poche jusqu’à concurrence de cinq francs.
Tous les détenus sont assujettis à la règle du silence, sauf les exceptions que nécessitent les besoins du service et le fonctionnement du travail dans les ateliers communs. En tout temps les cris, les chants, les rires à haute voix sont formellement interdits. Dans la plupart des prisons de courtes peines où les condamnés sont encore soumis au régime en commun, on ne défend en réalité que les conversations bruyantes; les paroles à voix basse sont tolérées. Il serait, en effet, à peu près impossible d’obtenir un silence absolu pendant toute la journée.
Les condamnés sont astreints tous les jours à la promenade ou marche en file indienne pendant un certain temps. Cette promenade est considérée comme une distraction en même temps que comme un exercice nécessaire à la santé. Les jeux de toute sorte sont interdits; toutefois certains jeux, ou plutôt sports, reconnus utiles à la santé de quelques détenus, et spécialement la gymnastique, peuvent être autorisés par le Ministre de l’Intérieur sur l’avis de l’Administration. La promenade en file indienne ou
«en queue de cervelas», comme disent les prisonniers, ne semble pas donner invariablement de bons résultats; on lui a reproché d’être débilitante et d’amener des troubles nerveux. Elle se circonscrit forcément dans des espaces trop restreints. Plusieurs auteurs la voudraient voir remplacée par différents jeux en usage dans les collèges, et surtout par la gymnastique qui n’est pas un jeu à proprement parler. Elle deviendrait ainsi une véritable récréation. Les prévenus et accusés ne sont pas astreints à la promenade et peuvent refuser d’y prendre part.
Il est interdit aux détenus de faire entre eux des dons, échanges et trafics de vivres.
Chaque détenu est obligé de faire son lit, d’entretenir sa cellule ou la place qui lui est assignée dans le dortoir commun. Les ateliers, réfectoires, couloirs, préaux sont entretenus par des condamnés désignés à cet effet par le directeur et le gardien-chef.
Les effets de literie varient dans quelques prisons. Nous verrons de quoi ils se composent dans les différentes maisons de Paris.
Les détenus ne doivent garder par devers eux aucun instrument dangereux, notamment des rasoirs. Cependant quelques-uns peuvent obtenir des directeurs l’autorisation de se raser eux-mêmes.
L’appel des détenus doit être fait au moins une fois par jour à des heures variables, ainsi qu’aux heures du lever et du coucher.
Les condamnés n’ont le droit d’écrire des lettres qu’une fois par semaine. C’est généralement le dimanche. Les prévenus peuvent écrire tous les jours. Les correspondances à l’arrivée et au départ sont lues et visées par le directeur ou le gardien-chef, sauf les lettres adressées à l’autorité administrative ou judiciaire et aux avocats ou défenseurs.
Quelques-unes de ces prescriptions varient forcément un peu dans les prisons où fonctionne le système cellulaire. Ce système devant dans un avenir le moins éloigné possible être appliqué partout, le règlement général de 1885 devra être modifié dans ce sens.
Sous le régime individuel, ainsi que nous l’avons vu précédemment, toute communication est interdite aux prisonniers entre eux pendant la durée de l’emprisonnement, à quelque catégorie qu’ils appartiennent. Le gardien-chef doit, en conséquence, tenir la main à ce qu’ils ne puissent se voir ni se parler, soit de cellule à cellule, soit à l’occasion de la circulation dans l’intérieur de la maison.
A son arrivée dans la prison, chaque détenu est averti du régime de l’emprisonnement individuel auquel il va être soumis, et des obligations qui en découlent pour lui. Les règles de la prison concernant les détenus sont, en outre, affichées dans toutes les cellules, et chaque dimanche il en est donné lecture à haute voix. Lors de son installation, le détenu doit reconnaître que tout est en parfait état dans sa cellule, suivant les indications du bulletin qui y est affiché.
Tous les jours, il est fait une visite minutieuse de l’intérieur des cellules et de leur mobilier, et les dégradations de toute nature sont constatées. (Sont considérées comme dégradations les dessins, écrits, barbouillages, malpropretés, en un mot tout ce qui peut laisser une trace sur les murs ou les meubles.) Le gardien-chef peut, par mesure de sûreté, prescrire, en outre, des visites dans les cellules aussi souvent qu’il le juge utile.
Les détenus qui ont commis des dégâts quelconques en doivent la réparation, qu’il y ait de leur faute ou non. S’ils n’ont pas l’argent nécessaire, l’Administration peut au besoin se récupérer par des retenues opérées sur leurs vivres autres que le pain. Les dégradations commises volontairement entraînent en plus une punition disciplinaire. Les gardiens ordinaires et même le gardien-chef sont responsables devant l’Administration des dégâts qu’ils n’auraient pas signalés en temps utile.
Les prévenus et les accusés peuvent se livrer dans leurs cellules à toutes les occupations compatibles avec l’ordre, la sûreté et la salubrité de la prison. Les condamnés sont astreints au travail qui leur est procuré par l’Administration.
Tout travail manuel est interdit les dimanches et les jours de fêtes religieuses reconnues.
A moins d’ordre exprès, les gardiens ne peuvent pénétrer dans les cellules occupées que pour les services régulièrement établis et aux heures fixées pour ces services.
Les personnes autorisées à visiter les prisonniers ne peuvent les voir qu’au parloir cellulaire, aux jours et heures déterminées pour chaque maison par le règlement particulier. Les permissions de voir les détenus dans leurs cellules ne peuvent être accordées qu’à leurs femmes, maris, ascendants, frères, sœurs, descendants, tuteurs. Ces autorisations spécifient la durée des visites. Elles sont très rarement accordées.
Les aumôniers et les personnes autres que les gardiens, ayant autorité ou surveillance dans la prison, peuvent pénétrer quand bon leur semble dans les cellules, soit seuls, soit accompagnés d’un gardien s’ils le jugent à propos.
Les détenus en cellule doivent avoir au moins une heure de promenade par jour. Il est autant que possible établi pour cela un roulement, de façon que tous les jours l’heure de cette promenade change pour chaque détenu, et qu’aucun d’eux n’occupe deux jours de suite le même promenoir cellulaire. La porte de chaque cellule n’est ouverte et le détenu ne sort que lorsqu’il il y a une distance suffisante pour empêcher toute communication entre lui et le précédent. Toutes les précautions sont prises pour que deux détenus ne puissent en aucune circonstance échanger une parole ou simplement un regard.
Le nom des détenus ne doit jamais être prononcé par qui que ce soit, ni dans les cellules, ni dans les promenoirs, couloirs, chemins de ronde, etc...
Le service de la propreté et de la distribution des vivres ne doit pas, autant que faire se peut, être confié plus d’une semaine aux mêmes individus. Ceci a pour but, non seulement d’empêcher que des rapports suivis et des ententes s’établissent entre les hommes de corvées et ceux qui sont dans les cellules, mais aussi de permettre à un plus grand nombre de se distraire et de prendre un exercice salutaire en dehors de la cellule.
Les détenus n’ont pas le droit d’ouvrir la fenêtre de leur cellule ou de la garder ouverte entre les heures du coucher et du lever; il leur est défendu d’y monter à quelque heure que ce soit. Ils ne doivent allumer et éteindre leur lampe ou bec de gaz qu’aux heures fixées.
Les heures du lever, du coucher, des repas, des promenades, et autres mouvements d’ensemble ou partiels sont fixés par le règlement particulier.
Les cellules doivent être tenues par ceux qui les occupent en état constant de propreté. C’est l’intérêt de chaque prisonnier individuellement aussi bien que de la collectivité ; et les gardiens y veillent sévèrement.
Pour assurer le maintien de l’ordre dans les prisons, l’Administration ne saurait compter seulement sur la force de persuasion et sur l’autorité morale. Elle est obligée d’avoir recours à des procédés d’une action plus tangible et d’une efficacité plus sûre.
Chaque établissement pénitentiaire renferme sa prison, véritable prison dans la prison, qui varie d’importance suivant la population. Ici, c’est tout un quartier spécialement aménagé ; là, ce sont simplement deux ou trois cellules d’isolement et de punition.
Les diverses infractions aux règlements dont peuvent se rendre coupables les détenus, sont passibles, suivant les cas, des punitions disciplinaires ci-après spécifiées:
La réprimande.
La privation de cantine, et, s’il y a lieu, de l’usage du vin.
La suppression des vivres autres que le pain pendant trois jours consécutifs au plus, la ration de pain pouvant être augmentée en cas de besoin.
La mise en cellule de punition pendant un temps qui ne devra pas dépasser quinze jours, sauf autorisation spéciale de l’autorité supérieure, sans préjudice des mesures plus graves prévues par l’article 614 du Code d’Instruction Criminelle, notamment de la mise aux fers.
Le directeur a, en outre, le droit de suspendre selon les cas et dans la mesure qu’il juge convenable:
L’usage de la promenade pendant trois jours au plus.
L’usage de la lecture pendant une semaine au plus, mais seulement quand le détenu aura lacéré, détérioré ou employé illicitement les livres à lui prêtés.
La correspondance pendant deux semaines au plus.
Les visites pendant un mois au plus.
Les détenus qui approchent de leur libération sont généralement autorisés quelques semaines auparavant à laisser repousser leur barbe et leurs cheveux. S’ils se rendent coupables d’infractions aux règlements, le directeur peut leur retirer cette autorisation. Ce simple retour à la tenue commune constitue souvent un châtiment très sensible.
Les peines disciplinaires et les restrictions concernant la promenade et la lecture sont applicables aux prévenus et accusés, ainsi qu’aux condamnés.
Les prévenus ne peuvent être privés des visites et de la correspondance qu’au cas d’abus manifeste dans l’exercice de ces facultés; ils ont toujours le droit d’écrire aux autorités et à leurs défenseurs.
Dans les Maisons Centrales et dans les prisons importantes, les punitions sont soumises au contrôle du Prétoire. Ce prétoire est une sorte de tribunal intérieur que préside le directeur et que composent le contrôleur ou sous-directeur, l’instituteur et le gardien-chef. Le détenu coupable est autorisé à fournir ses explications, mais il n’y a aucun assistant.
Dans les prisons départementales, les punitions sont infligées par le directeur ou même par le gardien-chef, à la charge pour celui-ci d’en aviser immédiatement le directeur dans son rapport du jour.
«Rendre la justice à des détenus, à d’aussi fins connaisseurs en injustice est la tâche la plus élevée des directeurs». (Herbette.)
On s’exagère généralement dans le public la sévérité des punitions disciplinaires infligées dans les prisons.
Tous les moyens de correction violente, ainsi que tous les châtiments corporels, sont absolument interdits.
Les peines les plus dures sont l’envoi en cellule disciplinaire et l’envoi à la salle de discipline.
La salle de discipline ne peut fonctionner que dans les maisons de détention en commun. Elle est faite pour ceux que l’isolement ne rendrait pas meilleurs et qu’on ne saurait laisser satisfaire en cellule «leur instinct de fainéantise et d’immoralité ». Le condamné y est astreint à rester la journée entière sous la surveillance immédiate d’un gardien dans une salle particulière. Il doit marcher pendant un certain temps, après quoi il s’assied, presque accroupi sur un escabeau de bois très bas, puis il reprend sa marche pour s’asseoir encore et remarcher encore. Les temps de repos et les temps de marche sont déterminés strictement. Ce procédé, qui a pour unique effet d’user les forces du détenu, comme on userait dans une cage la force d’une bête, a été vivement attaqué ; on est cependant obligé de l’employer de temps en temps.
Les fautes punies par les différents châtiments que nous venons d’énumérer sont des fautes purement disciplinaires. Les plus communes sont les suivantes, que nous relevons au hasard dans un registre de punitions d’une prison de Paris:
«s’est battu;... a abandonné son travail; — s’est moqué d’un gardien;... a détérioré les objets de travail;... a caché du tabac dans son pain;... a perdu un livre de la bibliothèque;... a pris une attitude insolente devant un gardien;... a écrit à un autre détenu une lettre ordurière;... a refusé de travailler...»
Les punitions disciplinaires ne font pas obstacle aux poursuites judiciaires auxquelles peuvent donner lieu les crimes et les délits caractérisés dont les détenus se rendent coupables. Mais il importe que la plupart des fautes soient punies immédiatement et sans ostentation, de façon que les détenus ne puissent pas chercher une distraction dans leur envoi devant une juridiction ordinaire.
La mise en vigueur d’une discipline sévère, son respect absolu, ne sont pas incompatibles avec la bonté et l’indulgence.
Il faut que le prisonnier se rende bien compte qu’il est sans force contre le règlement, qu’il ne peut rien tenter contre l’ordre établi, et que le moindre essai de rébellion tournera contre lui et sera expié. Mais il faut qu’il comprenne aussi et croie bien que la Société, représentée par l’Administration, n’a aucune haine contre lui personnellement, qu’elle ne veut que son amélioration et qu’il a tout intérêt à s’y prêter et à se conduire docilement.
Il appartient aux directeurs, aux gardiens-chefs et même aux gardiens ordinaires de savoir appliquer le règlement d’une façon discrète et intelligente, et de ne faire qu’un usage modéré des sévérités que ce règlement met à leur disposition. Ils peuvent, s’ils savent s’y prendre, inculquer aux détenus un profond respect pour l’ordre de choses établi, et presque de l’amour pour ceux qui y tiennent la main.
Le rôle du gardien idéal serait «de ne jamais laisser passer inaperçue la moindre infraction, ne jamais se laisser aller à la moindre injustice, à la moindre colère, et ne jamais se départir d’un calme absolu».
Les gardiens ne sauraient montrer trop de tact et d’attention quand il s’agit de signaler une infraction. Ils doivent respecter dans une certaine mesure le malheur qui frappe les prisonniers, prendre en considération l’état d’esprit de ces hommes séparés du reste du monde, retirés de la vie. Il leur est assez facile avec un peu d’habileté de discerner ceux qui conservent encore de bons sentiments, et de connaître et signaler ceux qui font étalage de leur immoralité ou de leur indiscipline. Ils doivent ne se laisser toucher par aucune menace, aucune flatterie ou complaisance, et se mettre aussi en garde contre un excès de sensibilité. La distribution d’une justice irréprochable est plus nécessaire encore en prison que dans la Société. Chaque prisonnier ne souhaite et ne désire l’injustice que si elle tourne à son profit personnel. Autrement il réclame la justice et l’égalité la plus absolues, et il aide au besoin l’Administration à les établir et à les maintenir. Le condamné qui se sent victime d’une injustice quelconque en éprouve un ressentiment qui suffirait à l’empêcher de s’amender s’il en avait eu l’idée.
Deux grands principes doivent demeurer en l’esprit du condamné, aussi importants l’un que l’autre: l’autorité incontestable de l’Administration et sa justice absolue.«Bon autant qu’on peut, dupe jamais, telle est la règle de la pratique pénitentiaire, dit M. Herbette. Les détenus se révolteront contre un chef parce qu’il est indulgent mal à propos, ils resteront soumis à celui qui exerce dans la rigueur une exacte justice... Un directeur faible serait un mauvais directeur. Il aurait à punir beaucoup pour n’avoir pas su punir à temps. Il aurait de grosses mutineries pour avoir ménagé quelques indisciplinés...»
La plupart des condamnés se conduisent d’ailleurs très docilement. Et dans certaines maisons où le directeur s’attache aux principes d’indulgence et de philanthropie on arrive presque à éviter les punitions.
Il y a cependant des détenus réfractaires à toute discipline, des individus qui ne peuvent ou ne veulent se plier à aucune règle, et qui ont la haine instinctive et irraisonnée de tout ce qui touche à l’autorité.
On a vu des prisonniers avoir tout à coup de véritables crises de folie furieuse, se jeter sans aucune raison sur leurs gardiens, les frapper, les mordre, en véritables animaux, parce que c’étaient des gardiens. Il y en a qui se vantent d’avoir démoli plusieurs gardiens. Quelques-uns arrivent à un tel degré d’exaspération, qu’ils se jetteraient sur n’importe qui ou n’importe quoi, défoncent les portes et les planchers de leurs cellules, se cognent la tête aux murs...
Contre de pareilles brutes, le personnel ne doit se défendre que passivement, ne jamais frapper, rester calme, ne pas se laisser aller à un désir de vengeance.
Tout n’est donc pas rose dans la vie des gardiens.
On cite à l’actif de ces modestes fonctionnaires des traits héroïques. Plusieurs ont donné de beaux exemples de courage et de présence d’esprit.
M. Herbette rapporte l’histoire d’un vieux gardien qui, un jour, s’approcha les bras croisés d’une sorte d’hercule furieux, armé d’un tranchet et acculé dans un coin d’atelier où il s’était fait une barricade, en lui disant simplement avec le plus grand calme: «Jetez ça!» Et l’homme, vaincu par tant de froide énergie, jeta son tranchet sans mot dire et s’en alla en cellule sans essayer le moindre mouvement de résistance.
Dans chaque prison ce sont presque toujours les mêmes qui sont indisciplinés, et se voient infliger les punitions. L’insubordination est un engrenage. Les peines se suivent, s’enchaînent. Une fois qu’un détenu a commencé, il semble qu’il ait toutes les peines du monde à en sortir. C’est une pente qui mène loin.
Kropotkine raconte qu’il a vu de près, à Clairvaux, ce que peut être le sort d’un insoumis. «Un paysan réputé comme tel pourrissait dans le quartier de punition. Las d’une telle vie, il frappa un gardien. Il fut condamné à perpétuité. Alors il se suicida. Et n’ayant aucune arme à sa disposition, il finit par y arriver en ne mangeant que ses propres déjections».