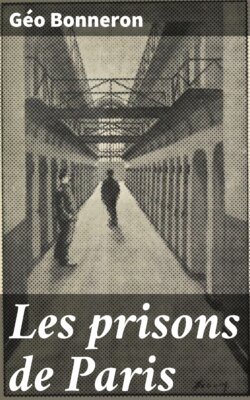Читать книгу Les prisons de Paris - Géo Bonneron - Страница 8
LES PRISONS COMMUNES ET LES PRISONS CELLULAIRES
ОглавлениеAvantages et inconvénients des deux systèmes. — La réforme des prisons.
La peine matérielle garantissant la peine morale, et ayant d’ailleurs par elle-même une valeur considérable, est la privation de la liberté. Cette peine doit être proportionnée aux principes de justice et aux nécessités de la répression.
Pour assurer la privation de la liberté, il y a deux systèmes: le système de la détention en commun et le système de la détention individuelle ou cellulaire.
De toute évidence, il existe entre les deux procédés une différence radicale, et si l’on admet la supériorité et les meilleurs résultats de l’un, on se trouve forcément amené à abandonner l’autre dans la pratique.
La détention cellulaire ou individuelle, sans aucune communication avec personne, soit par la parole, soit même par la vue, implique d’elle-même une aggravation sensible de la peine, en même temps que plus de dignité dans la façon de subir cette peine.
Les statistiques publiées par l’Administration ont depuis longtemps démontré l’augmentation constante de la récidive. On en a voulu voir la raison dans un fonctionnement défectueux du système pénitentiaire; et tous les hommes compétents, non seulement de France mais des autres nations civilisées, ont cherché le remède à ce mal. On a mis en avant comme un moyen d’une efficacité certaine le régime de l’emprisonnement cellulaire. Il a été publié sur ce sujet, dans les différents pays, des monceaux de volumes, le régime cellulaire ayant tout de suite eu ses détracteurs acharnés en même temps que ses défenseurs convaincus. Ici on préconisait la détention individuelle pour toutes les peines sans distinction de durée. Là on la repoussait entièrement. Ailleurs, enfin, on l’acceptait, mais seulement pour les peines d’une durée minime. C’est ce dernier système qui a prévalu en France.
Le régime cellulaire a eu son origine aux États-Unis, où il a commencé à être mis en pratique pour les grands criminels vers la fin du siècle dernier. La conception première en appartient à un jurisconsulte et criminaliste anglais nommé Jérémie Bentham, qui pour ses efforts philanthropiques mérita de recevoir de la Convention le titre de citoyen français.
Le régime de l’emprisonnement cellulaire a lui-même été appliqué suivant deux systèmes différents: le système dit Auburnien et le système Philadelphien ou Pensylvanien.
Le système Auburnien, ainsi appelé parcequ’il fut expérimenté d’abord à Auburn, État de New-York, ne comporte la séparation individuelle que durant la nuit; il laisse pendant la journée les condamnés travailler et prendre leurs repas en commun, sous la condition du silence absolu.
Le système Philadelphien a eu sa première application à Philadelphie, à la prison de Cherry-Hill. Il sépare individuellement les détenus pendant le jour comme pendant la nuit. Ce système est celui qui a été reconnu le plus avantageux et le meilleur; il a presque partout triomphé sans conteste et est appliqué ou applicable dans les limites du possible dans toutes les maisons de courte peine. Au début, il fut vicié par des rigueurs exagérées. Les législateurs le poussèrent jusqu’à ses extrêmes limites et il devint une véritable séquestration: les condamnés, enfermés dans leurs cellules sans en jamais sortir, n’avaient aucune communication avec le monde extérieur, pas même avec leurs gardiens. Aujourd’hui, le système cellulaire, tel qu’il est appliqué généralement, n’est pas du tout la séquestration absolue. C’est la séparation des détenus entre eux. Mais le condamné doit avoir avec les employés de la prison, les aumôniers, les membres des Sociétés de Patronage, des communications journalières. Il se livre dans sa cellule à un travail constant, tempéré par la lecture et par l’étude. Il y reçoit l’instruction scolaire qui lui manque et l’éducation morale qui le préservera d’une rechute. Il en sort une ou deux fois par jour pour faire des promenades dans un préau solitaire. (Garraud.)
Le régime cellulaire a été pour la première fois élaboré en France, en 1840 par une commission nommée par la Chambre des Députés.
Il reçut alors un commencement d’exécution. On construisit (de 1845 à 1850) la Maison d’arrêt de Mazas, exécutée strictement d’après le système cellulaire.
Déjà en 1833, on avait appliqué à la Petite-Roquette, maison d’éducation correctionnelle, le système d’isolement pendant la nuit, en maintenant pour la journée le travail en commun sous la condition d’un silence sévère.
A la suite des premiers essais qui laissèrent quelque peu à désirer, le régime cellulaire fut violemment attaqué dans la Presse, et jusqu’à la Tribune des Chambres. Un revirement se produisit, et le décret du 27 août 1853 en décida l’abandon.
De 1853 à 1856, on lui substitua le régime de séparation par quartiers, qui établissait parmi les détenus des divisions basées sur la situation sociale, l’âge, la durée des peines, l’état de récidive, la plus ou moins bonne conduite pendant la détention. Cette classification n’allait pas sans de grandes difficultés. Sur quoi l’établir d’une façon certaine et judicieuse? Il ne pouvait y avoir de criterium absolu. Et forcément elle restait, dans beaucoup de cas, arbitraire et livrée à l’appréciation souveraine du directeur de la prison ou des gardiens.
Enfin un mouvement s’est dessiné en faveur d’un retour, complet cette fois, au régime cellulaire. Une enquête parlementaire fut prescrite à ce sujet par l’Assemblée Nationale en 1872, et des Rapports consciencieux et très édifiants furent présentés au nom de la Commission par MM. Bérenger et d’Haussonville. A la suite de cette enquête, la loi du 5 juin 1875 a réglé pour l’avenir les conditions et procédés de détention.
L’article premier de cette loi stipule que «les inculpés, prévenus et accusés, seront individuellement séparés pendant le jour et la nuit». On ne saurait trop louer cette disposition. C’est surtout aux prévenus, peut-être innocents, en tous cas non encore reconnus coupables, qu’il importe d’épargner la corruption résultant de la vie en commun avec la population démoralisée et démoralisatrice des prisons.
Quant aux condamnés à l’emprisonnement correctionnel, la loi les partage en deux classes: ceux qui sont condamnés à un emprisonnement inférieur à un an et un jour, et ceux qui sont condamnés à plus d’un an et un jour.
Les condamnés à un an et un jour et au-dessous subissent leur peine dans les prisons départementales et sont soumis à l’emprisonnement individuel.
Pour les condamnés à plus d’un an et un jour, l’emprisonnement cellulaire est seulement facultatif. Ils peuvent, sur leur demande, être soumis à ce régime.
La durée de peine sous le régime de l’emprisonnement cellulaire est de plein droit réduite d’un quart quand elle est supérieure à trois mois; ce qui revient à dire qu’au-dessus de trois mois trois journées d’emprisonnement en cellule sont comptées comme quatre journées de prison commune.
Cette nouvelle façon de procéder fait donc bénéficier les condamnés d’une notable diminution dans la durée des peines; et l’on comprend tout l’intérêt qu’il peut y avoir pour eux non seulement à s’y soumettre mais encore à la réclamer.
Aucun condamné n’est contraint à l’emprisonnement cellulaire pendant plus de neuf mois. S’il passe plus longtemps en cellule c’est qu’il le veut lui-même, l’a demandé et obtenu, dans son propre intérêt, désireux de rapprocher le plus possible l’époque de sa libération, même au prix d’une captivité incontestablement plus dure qu’il juge pouvoir supporter.
Si nous en croyons les rapports établis et publiés par l’Administration pénitentiaire, le régime cellulaire ainsi pratiqué ne présente pas d’inconvénients au point de vue de la santé du détenu; d’autant plus qu’il ne s’oppose à aucune mesure d’hygiène, à aucun exercice. Les promenades dans les locaux à ce destinés peuvent être effectuées par chaque condamné individuellement, sans communication avec ses semblables.
Cependant, nous devons dire pour être complets, que certains économistes se sont prononcés nettement contre le régime cellulaire, affirmant que malgré les déclarations optimistes et peut-être intéressées de l’Administration, en dépit de ses préoccupations d’hygiène et des mesures par elle prises, il ne peut manquer d’être préjudiciable à la santé de ceux qui le subissent. Spécialement, depuis l’application de ce régime les cas d’aliénation mentale seraient devenus beaucoup plus fréquents parmi les prisonniers, les suicides seraient plus nombreux. — Ces affirmations ne manquent malheureusement pas d’une certaine exactitude. Dans les premiers temps du régime cellulaire, des faits regrettables se sont produits, notamment à Mazas, qui avait acquis dès sa création la plus douloureuse renommée. Il sévissait dans cette prison de véritables épidémies de suicide. Un inspecteur de la Sûreté, opposé au régime cellulaire, avait réussi à se faire un album édifiant à cet égard. Cet album représentait soixante détenus de Mazas dans la position où ils avaient été trouvés suicidés dans leurs cellules. Plusieurs s’étaient non pas étranglés mais étouffés par la simple compression du cou qu’ils avaient appuyé sur le bord de leur lit tendu. Jusqu’au dernier moment, le moindre mouvement, le plus faible effort eut suffi pour les ramener à la vie. Et ce mouvement, cet effort, ils ne l’avaient pas tenté, dans leur folie de mourir, dans leur rage d’en finir avec la misérable existence qu’on leur faisait mener.
Ce sont là des cas exceptionnels. Heureusement. Et maintenant que le travail fonctionne régulièrement dans les prisons cellulaires, les cas de suicide et de folie sont retombés à des proportions normales.
Il y a parmi les condamnés des catégories bien tranchées. Et l’on comprend facilement combien il doit être pénible pour un homme ayant à passer quelques mois en prison, en raison d’une première faute pouvant très bien rester unique, de se trouver constamment mélangé à la tourbe des voleurs de profession et des pires malfaiteurs. Le régime cellulaire supprime cette malsaine promiscuité dont les déplorables résultats sous tous les rapports n’ont été que trop démontrés.
La détention cellulaire, du reste, est, à de très rares exceptions près, toujours réclamée par les détenus qui en sont à leur première condamnation; tandis que les récidivistes la redoutent et recherchent avidement la société de leurs co-détenus. Ce fait seul suffirait presque à démontrer la supériorité du régime de l’emprisonnement cellulaire sur le régime de la détention en commun.
Dans les prisons de longue peine le régime peut, d’après notre législation, s’améliorer par une sorte d’alliance ou de transaction entre les deux systèmes. Dans ce système mixte, la détention individuelle est réservée pour la nuit, et la vie en commun est maintenue pendant la journée, au moins en ce qui concerne le travail et les repas. C’est une application du système Auburnien.
L’une des grandes objections opposées dans la pratique au régime cellulaire, c’est qu’il complique considérablement la question du travail, dont nous nous occuperons en un prochain chapitre. Mais cette difficulté n’est pas insurmontable, et dans les maisons de détention récemment construites suivant le modèle cellulaire, l’Administration en a su triompher.
La loi du 5 juin 1875 a décidé que toutes les prisons pour courtes peines ne pourraient plus être construites et aménagées que suivant le type cellulaire. Les vieilles prisons devront être transformées au fur et à mesure que les ressources des départements propriétaires, aidés par l’État, le permettront. La réforme sera longue à accomplir entièrement.
Il existe déjà en France un bon nombre de prisons construites, aménagées et dûment classées suivant toutes les règles de la détention individuelle. De plus, dans toutes les maisons appliquant encore le système de la détention en commun ont été arrangés des quartiers spéciaux et des chambres séparées, permettant d’appliquer le régime individuel à un nombre considérable de détenus.
A Paris, il n’y a pour le moment que trois maisons de détentions satisfaisant dans leur ensemble aux conditions de l’isolement cellulaire: Mazas, la Maison de justice ou Conciergerie, et la Petite-Roquette. Mazas est resté à cet égard la prison-type et compte 1135 cellules. C’est la plus importante prison cellulaire de France. La Conciergerie n’en compte que 76, mais en aura bientôt un plus grand nombre.
La prison de la Santé se composait jusqu’à ces derniers temps de deux parties. Dans l’une, de 500 cellules, l’emprisonnement cellulaire était pratiqué de jour et de nuit; dans l’autre, également de 500 cellules, on appliquait la régime Auburnien. Des aménagements actuellement en cours en feront une prison tout à fait cellulaire.
Le Dépôt, près la Préfecture de Police, sorte d’antichambre des autres prisons, n’est disposé qu’en partie pour la détention individuelle. Il comprend 197 cellules réparties en deux quartiers, dont 91 pour les hommes et 96 pour les femmes, plus 8 cellules d’aliénés ou cabanons. Il y règne donc, étant donné le nombre d’individus qui s’y trouve constamment, une promiscuité regrettable là plus que partout ailleurs, les détenus n’y étant que prévenus, souvent innocents, ou en tout cas toujours réputés tels jusqu’à preuve du contraire. La moitié à peu près des personnes amenées au Dépôt doit subir le régime de la salle commune.
Les autres prisons parisiennes: Saint-Lazare, la Grande-Roquette, Sainte-Pélagie, ne sont pas aménagées pour l’emprisonnement individuel. Le régime en commun continue à y être appliqué. Il existe pourtant à Sainte-Pélagie un certain nombre de cellules installées dans des conditions défectueuses. Il y a également à la Grande-Roquette environ 240 cellules ne répondant pas aux conditions d’hygiène désirables et qui servent pour le régime auburnien.
Ces prisons ne sont guère utilisables pour le régime cellulaire. Le seul parti à prendre est de les démolir. Il est décidé en principe que les prisons préventives devront seules rester à l’intérieur de Paris et que les prisons de peine seront reconstruites hors de la ville dans des endroits suffisamment éloignés des agglomérations urbaines.
Mazas, la Grande-Roquette, les maisons de correction de Saint-Lazare et de Sainte-Pélagie, sont destinées à disparaître dans un avenir plus ou moins éloigné. Quand?... Chez nous, on sait que rien ne dure comme ce qui est décrété provisoire. Mazas et Sainte-Pélagie seront probablement démolis dans le courant de 1898.
En 1825, la Préfecture de Police réclamait déjà la reconstruction de la prison de Saint-Lazare. En 1884, un vœu a été adopté par le Conseil général de la Seine tendant à la suppression de cette maison dans le plus bref délai possible. Un projet de la Préfecture de Police consisterait à faire de Saint-Lazare une maison de traitement exclusivement réservée aux femmes malades.
Au milieu de tous ces projets, la vieille prison du Faubourg-Saint-Denis continuera vraisemblablement encore longtemps à servir d’épouvantail à toute une partie de la population féminine de Paris.