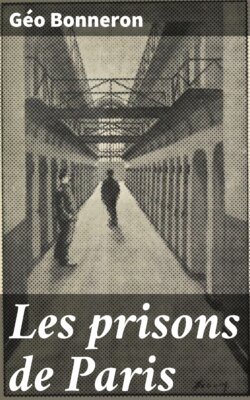Читать книгу Les prisons de Paris - Géo Bonneron - Страница 14
RÉGIME. — NOURRITURE. — HYGIÈNE
ОглавлениеLe régime des prisons est le même pour tous les détenus depuis 1855. Il n’y a plus d’inégalités dans l’application des peines que celles résultant forcément de la différence des locaux.
Cette différence est encore assez sensible pour que certaines maisons jouissent parmi les malfaiteurs d’une bonne ou mauvaise réputation, pour qu’ils désirent faire leur temps dans telle prison plutôt que dans telle autre.
La nourriture des prisonniers est réglée d’après ce principe: l’alimentation doit être limitée à ce qui est nécessaire pour l’entretien des forces vitales. Les forces que le détenu dépense au travail, il doit les réparer au moyen de vivres supplémentaires achetés par lui sur le produit de ce travail.
Un problème se posait. Il fallait, d’un côté, observer les lois de l’humanité qui défendent d’imposer au détenu des privations et des souffrances inutiles. D’un autre côté, il ne fallait pas, poussant trop loin la philanthropie, rendre le régime assez attrayant pour que la prison devienne un lieu de refuge où les malheureux s’abriteraient, assurés d’y trouver ce qui leur manque dans la vie libre.
On a tranché la difficulté en accordant au prisonnier strictement ce dont il a besoin, et en le mettant à même de se procurer un peu de supplément au moyen du produit de son travail. Ce supplément, s’il est presque un besoin, a aussi de cette façon un caractère de récompense et d’encouragement qui a sa valeur.
Autrefois les prisonniers ne recevaient pour leur nourriture que ce qu’on appelait «le pain du Roi» et de l’eau. C’est en 1829 que l’usage de la viande commença à être introduit dans les prisons. C’est également à cette époque qu’un matelas remplaça la traditionnelle paillasse, la fameuse «paille humide des cachots».
«Le nombre des repas, dit l’article 50 du règlement de 1885, est de deux par jour. En toute saison, le repas du matin a lieu à neuf heures, et celui du soir à quatre heures. Le repas du matin se compose d’une soupe aux légumes; le repas du soir de trois décilitres de haricots, lentilles ou riz, soit au beurre, soit à la graisse de saindoux. Le dimanche ce repas est de 100 grammes de viande désossée, avec des pommes de terre. Les individus soumis au régime cellulaire, qui est considéré comme affaiblissant, ont en outre même quantité de viande le jeudi. Tous les détenus font aussi un repas gras aux fêtes de l’Ascension, l’Assomption, la Toussaint, Noël, 1er janvier, lundi de Pâques et 14 juillet. La ration journalière de pain est de 85o grammes pour les hommes et de 800 grammes pour les femmes».
Il est manifeste que ce régime n’est que bien juste suffisant. Cependant il n’est pas plus sévère que celui auquel se soumettent volontairement certains religieux, les Trappistes, par exemple. Il ne peut pas altérer la santé des détenus, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels, qu’il est toujours facile à l’Administration éclairée par les médecins de prévenir et d’empêcher. Il arrive même souvent qu’il rétablit la santé chez des gens fatigués par les excès. Mais il n’en est pas moins fort pénible à ceux qui ont l’estomac un peu exigeant. L’État, pour diminuer autant que possible les dépenses considérables que lui impose l’entretien des prisonniers, les oblige à se nourrir en partie avec leur argent personnel, soit que cet argent leur provienne de leur travail, soit qu’il leur vienne du dehors. On ne saurait lui en faire un reproche.
Cependant beaucoup de personnes compétentes et de médecins ont, à différentes reprises, protesté contre la nourriture par trop frugale accordée aux détenus, surtout aux hommes. On pourrait sans doute modifier le régime. On y arrivera peut-être. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’avec le système actuel un détenu se conduisant bien et travaillant normalement a le moyen de se nourrir d’une façon très convenable avec l’argent qui est mis à sa disposition sur ses gains.
Les détenus ne reçoivent jamais devin ni de boissons alcooliques. Le régime alimentaire est un peu plus substantiel dans les Maisons Centrales que dans les prisons départementales, en raison de la durée des détentions.
A Paris, les femmes à Saint-Lazare et les enfants à la Petite-Roquette ont également un régime un peu plus doux. A Saint-Lazare le vin est permis et la cantine ouverte plus largement. A la Petite-Roquette, l’Administration fournit aux jeunes détenus !a nourriture saine indispensable à leur âge. Leurs gains, plus modestes que ceux des détenus adultes, ne leur permettraient au reste pas d’acheter à la cantine de quoi subvenir à tous leurs besoins.
Dans l’intérieur de chaque prison il existe une cantine. C’est un débit de boissons et d’aliments où les détenus se procurent, sous certaines règles établies, les vivres supplémentaires dont ils ont besoin. Ils peuvent y acheter tous les jours 500 grammes de pain de ration, une portion de légumes, des œufs, du lait, du fromage. Trois fois par semaine, ils peuvent acheter une ration de ragoût ou de fruits.
L’usage du vin, de la bière, du cidre et de toute boisson fermentée est interdit aux détenus valides condamnés. Toutefois ils peuvent acheter à la cantine sur le produit de leur travail une ration de vin qui ne peut excéder 30centilitres par jour, ou une ration de bière ou cidre ne dépassant pas 50 centilitres.
L’Administration peut toujours pour raison d’hygiène autoriser l’usage du vin aux frais du condamné, dans une proportion n’excédant pas Go centilitres par jour. Dans les prisons de Paris cette latitude est généralement accordée.
L’eau-de-vie et les liqueurs sont toujours interdites, aussi bien aux détenus qu’aux prévenus. L’usage du café acheté à la cantine est autorise.
Le tabac est interdit sous toutes ses formes aux condamnés et aux jeunes détenus. Les prévenus peuvent seuls en faire usage, de la façon qu’indiquent les règlements spéciaux de la maison où ils se trouvent.
Les prévenus ont le droit d’acheter à la cantine chaque jour 500 grammes de pain de toute qualité, deux portions de viande ou de poisson, des légumes, fruits et autres aliments dont l’usage est autorisé dans la prison, ainsi que 75 centilitres de vin ou un litre de bière ou cidre.
Le tarif de la cantine est établi deux fois par an. Il est soumis à l’Administration et approuvé par elle; et il ne peut y être apporté aucune modification. Ce tarif doit rester constamment affiché dans les ateliers et réfectoires, et doit être porté à la connaissance des détenus en cellule.
La dépense d’un détenu à la cantine ne peut, dans les prisons de Paris, excéder 1 franc par jour.
Les vivres pris en cantine ne peuvent être distribués qu’aux heures des repas. Les gardiens-chefs y doivent veiller, et doivent s’assurer également qu’il n’est pas distribué d’autres aliments que ceux portés au tarif, et dans les proportions fixées. Les cantines, comme elles fonctionnent actuellement, donnent lieu à des abus, et leur suppression a été plusieurs fois demandée. Elles font un peu ressembler la prison à une auberge, et tendent à diminuer l’égalité de peine en permettant à certains détenus robustes et habiles de se procurer des douceurs interdites à d’autres plus faibles ou moins adroits, mais tout aussi méritants.
Les détenus sont tous partisans de la cantine, et ils y dépensent la presque totalité de l’argent qui leur est abandonné par l’Administration. Ils se plaignent seulement de l’élévation des tarifs. Ces tarifs devraient, en effet, être abaissés aux extrêmes limites du bon marché.
Si les détenus dépensaient moins à la cantine, ils trouveraient à leur sortie un pécule un peu plus fort. Et cela vaudrait sans doute mieux pour eux.
Les prévenus, jouissant d’une partie de leurs droits, ont la faculté de renoncer aux vivres ordinaires de la prison et à ceux supplémentaires de la cantine, pour faire venir leur nourriture du dehors. Ils peuvent alors se faire apporter: du pain à discrétion, une soupe, deux plats ou portions de viande ou de poisson, légumes, œufs, beurre, fromage, lait, fruits, avec 75 centilitres de vin ou un litre de cidre ou bière.
Pour user de cette faculté, les prévenus doivent déclarer qu’ils renoncent formellement aux vivres de la maison et à ceux de la cantine.
La remise des vivres ainsi apportés du dehors peut être faite en une seule fois à l’heure de l’un des repas, ou bien en deux fois au moment des deux repas. Tout ce qui est introduit dans la prison est soigneusement examiné et vérifié par les gardiens avant d’être remis aux destinataires, afin qu’il ne puisse y être glissé rien d’illicite ou de dangereux. Les papiers enveloppant les aliments doivent être d’une couleur unie, sans aucune inscription. Les journaux ne sont pas acceptés.
Les prévenus et accusés conservent en prison leurs vêtements personnels.
Les individus subissant une condamnation de un mois et au dessous ne sont pas tenus de porter le costume pénal. Ils peuvent le réclamer s’ils y trouvent un avantage, si leurs vêtements ordinaires ne leur semblent pas suffisants, ou s’ils veulent les économiser.
Les condamnés à plus d’un mois et moins de trois mois peuvent conserver leur costume personnel, à moins que l’exercice de cette faculté ne nuise au bon ordre, aux conditions de surveillance et de propreté de l’établissement, auquel cas ils sont contraints de porter le costume pénal.
Au dessus de trois mois, les condamnés sont tenus de porter le costume réglementaire. Certains d’entre eux, en raison de la nature de leur condamnation, ou pour d’autres considérations, peuvent en être dispensés. Ces dispenses, accordées sur demande par l’Administration, sont personnelles et peuvent toujours être révoquées d’un moment à l’autre.
Quelques auteurs ont contesté la nécessité d’un costume pénal, le présentant comme une flétrissure qu’il faut éviter le plus souvent possible. «Le vêtement produit un effet puissant sur le détenu, surtout à la première condamnation. Quand on les a habillés, on les voit tout honteux d’apparaître attifés de pareille façon, ouvriers ou autres...» (Kropotkine.)
Mais, d’un autre côté, le costume des prisonniers n’est-il pas un excellent moyen de rendre difficiles les évasions, d’assurer la discipline, et de maintenir une stricte égalité ?...
C’est pour satisfaire ceux qui condamnent le costume et ceux qui le déclarent nécessaire que l’Administration a établi les catégories ci-dessus indiquées.
Les détenus peuvent obtenir pour des raisons d’hygiène et de santé la permission d’ajouter à leur vêtement disciplinaire d’autres vêtements plus chauds ou plus commodes, à la condition que l’aspect extérieur général du costume ne soit pas modifié.
A l’arrivée des détenus en prison, leurs effets personnels sont lavés ou nettoyés et désinfectés à l’étuve; puis, s’ils ne doivent pas les conserver, ils sont empaquetés, étiquetés, inventoriés, et mis en magasin, pour être rendus à leurs propriétaires à la sortie.
Les condamnés obligés au port du costume pénal ne doivent pas garder leur barbe. Ils sont rasés une fois par semaine en hiver et deux fois en été. En hiver, on leur coupe les cheveux tous les deux mois, en été tous les mois.
Il est donné un bain de corps à tous les détenus à leur entrée en prison, sauf le cas de dispense individuelle. On leur en donne ensuite un tous les mois, et aussi souvent que le médecin le juge convenable. Les détenus prennent un bain de pieds tous les quinze jours. Il est donné pour cela de l’eau chaude à ceux qui en font la demande.
Chaque détenu, soit en cellule, soit au régime commun, doit occuper un lit séparé. Il est tenu de se déshabiller pour se coucher.
Le coucher du prisonnier comprend: une couchette en fer, une paillasse, un matelas, un traversin en paille, une paire de draps, une couverture de coton en été, et deux couvertures dont une de laine en hiver. Les draps sont changés tous les mois.
Les heures de lever sont: 6 heures 12 pendant les mois de janvier, février, mars, avril, octobre, novembre et décembre; et 5 heures en mai, juin, juillet, août et septembre.
Le coucher a lieu, du 1er mai au 30 septembre, à 9 heures, et pendant les autres mois à 8 heures.
Les prisonniers peuvent être sous certaines conditions autorisés à veiller soit dans les ateliers, soit dans les cellules. Ces veillées ne doivent pas se prolonger au delà de dix heures.
Le service de santé comprend dans les prisons:
La visite des détenus portés comme malades ou indisposés.
Le traitement des maladies des détenus ou du personnel de surveillance.
Les opérations médicales et chirurgicales, à moins de cas particulièrement graves.
Le contrôle des préparations alimentaires ou pharmaceutiques destinées à l’infirmerie.
L’inspection, à des époques périodiques, des différents locaux de la prison.
La tenue des écritures médicales.
Un médecin est attaché à chaque établissement pénitentiaire. Quand l’établissement est important, il y a quelquefois un ou plusieurs internes.
Il y a également dans chaque prison une infirmerie comprenant plusieurs salles communes, des salles d’isolement et, au besoin, un certain nombre de cellules.
Le médecin est tenu de faire chaque jour une visite dans la prison. Il doit voir tous les détenus malades ou indisposés qui se sont déclarés tels ou sont signalés par les gardiens.
Sauf le cas d’affections épidémiques ou contagieuses, les détenus malades sont, dans les maisons communes, soignés dans les salles ou chambres de l’infirmerie; dans les prisons où fonctionne le système cellulaire l’infirmerie est elle-même cellulaire.
Les détenus malades sont l’objet de soins éclairés et consciencieux. Il faut rendre cette justice à l’Administration qu’elle ne leur marchande rien de ce dont ils ont besoin. Pour eux, et tant que dure leur maladie, la position de détenu disparaît devant celle de malade.
A l’infirmerie, les malades ne sont plus soumis au régime ordinaire. Leur alimentation est toute spéciale. Elle n’est déterminée par aucune règle, c’est le médecin qui la fixe pour chaque cas, suivant ce qu’il juge meilleur.
Les malades ont également un coucher beaucoup plus confortable. Leurs lits, plus larges que les lits ordinaires, comprennent une couchette, un matelas, un traversin, un oreiller de plume avec une taie, une paire de draps et deux couvertures.
La paille des paillasses est renouvelée aussi souvent que le médecin le croit nécessaire et, en tout cas, après chaque décès. Les matelas et traversins sur lesquels un détenu est décédé sont rebattus et désinfectés, et les toiles sont lavées ainsi que les couvertures.
On comprend facilement qu’en prison, encore plus qu’au régiment, il ne manque pas d’individus tout disposés à simuler des maladies ou des indispositions pour bénéficier du régime de l’infirmerie. Un contrôle très sévère est exercé par les médecins et par le personnel de surveillance pour éviter la fraude et les abus qui pourraient se produire. Grâce à ce contrôle, les simulateurs, si habiles qu’ils soient, sont facilement reconnus, et punis comme ils le méritent.
L’Administration pénitentiaire fait de louables efforts pour maintenir la population des prisons dans des conditions de santé et d’hygiène aussi parfaites que possible. Cette grave question intéresse au plus haut point non seulement le monde des détenus, mais encore les habitants des villes où se trouvent les établissements pénitenciers. Les agglomérations de détenus deviendraient facilement, si l’on n’y tenait aussi soigneusement la main, des foyers d’infection, où demeureraient en permanence et d’où rayonneraient les germes de toutes les maladies. Dans les temps d’épidémies, les habitants d’une prison mal tenue seraient décimés. Or les états dressés par l’Administration ont démontré que pendant les dernières épidémies la population des prisons, soumise à une propreté forcée, a été moins éprouvée que la population libre.
D’après les statistiques, la prison paraît affecter la santé des femmes plus que celle des hommes. Mais il faut considérer que les femmes en prison sont souvent en traitement autant qu’en correction, que beaucoup d’entre elles sont atteintes de maladies contagieuses ou chroniques, et que, de plus, elle sont presque toujours soumises à l’emprisonnement en commun.
Les cas d’aliénation mentale sont relativement assez fréquents chez les prisonniers. Il n’y a pas lieu de s’en étonner. Beaucoup d’entre eux étaient avant leur incarcération des alcooliques invétérés ou des gens abrutis par les excès les plus dégradants. «Souvent, dit M. le Dr Bancel, médecin de la Maison Centrale de Melun, l’état moral des détenus n’est pas très sain; parmi eux se trouvent beaucoup d’individus qu’on peut appeler demi-intelligences ».
Il est à remarquer du reste que les cas de folie se produisent surtout chez les condamnés de l’espèce la plus pervertie. Ils sont aussi plus fréquents dans les maisons de courte peine que dans les Maisons Centrales.
A la fin de chaque année, le médecin fait, sur la situation sanitaire de la prison, un rapport d’ensemble, ainsi que sur le caractère et les causes des maladies qui ont atteint les prisonniers.
Ce rapport, augmenté des observations du directeur, est transmis à l’Administration Centrale.