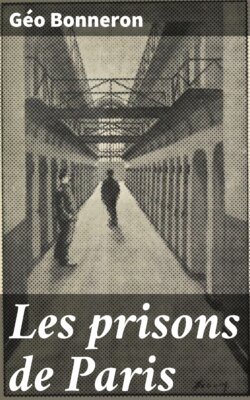Читать книгу Les prisons de Paris - Géo Bonneron - Страница 16
LES CULTES ET L’ENSEIGNEMENT
ОглавлениеLes trois cultes et leurs ministres. — Les services d’enseignement. — Les conférences. — L’enseignement moral.
Il n’y a pas de sentiment plus sacré et plus respectable que le sentiment religieux. On peut croire ou ne pas croire; on doit respecter ceux qui ont une foi, ceux qui s’attachent à une espérance, ceux qui marchent vers ce qui leur semble la lumière.
Le principe de la liberté de conscience est un de ceux que tout le monde reconnaît et proclame. Après quelques années d’intolérance affichée, après des tentatives infructueuses contre la religion et l’idée de Dieu, notre Société semble revenir toute tremblante vers les anciennes croyances.
La liberté de conscience est respectée même chez les individus placés sous l’autorité de l’Administration pénitentiaire.
«Cette indépendance morale, dit M. Herbette, est une réalité qui, dans toutes les prisons, s’affirme durant le cours des plus fortes et des plus longues peines, même pour le condamné à mort, jusqu’au moment où sa tête tombe sous le couteau. C’est un privilège laissé au récidiviste le plus endurci comme un gage d’espérance, comme un moyen de relèvement que la Société ne se croit que le droit de lui enlever».
La liberté de conscience implique la faculté de croire ou de nier, la liberté de la vérité au même titre que celle de l’erreur. Le détenu n’est donc soumis à aucune contrainte morale, à aucune pression religieuse. Il reste maître de son individualité intime, de son moi, à la seule condition de ne se livrer à aucune manifestation pouvant blesser la susceptibilité de ses co-détenus, de ne commettre aucun acte attentatoire à la liberté d’autres consciences.
L’obligation ou la défense de pratiquer telle ou telle religion et d’en suivre les exercices léseraient au même degré la conscience du prisonnier. Il faut qu’il ait la faculté de se conformer aux exercices du culte auquel il a appartenu ou auquel il déclare vouloir appartenir, ou bien de ne suivre aucun culte, de ne pratiquer aucune religion.
Cette liberté pleine et entière de se prononcer entre les différents cultes reconnus, ou de se tenir strictement en dehors de tous, est scrupuleusement respectée.
Au commencement du siècle, les exercices religieux étaient obligatoires dans les prisons. Le règlement du 30 octobre 1841, jugé très libéral pour l’époque, dit que «l’assistance aux offices religieux est obligatoire pour le condamné ».
Ce n’est qu’en 1882 qu’une ordonnance ministérielle a prescrit de «ne pas considérer comme catholiques ceux qui déclarent ne pas vouloir être traités comme tels».
Enfin le règlement de novembre 1885 a consacré le principe de la liberté religieuse, en spécifiant que «l’assistance aux offices religieux n’est pas obligatoire pour les détenus qui ont déclaré ne pas vouloir les suivre».
Dans chaque prison, il est pourvu aux services religieux par les ministres des cultes reconnus auxquels appartiennent les détenus.
Ces ministres sont nommés par le Ministre de l’Intérieur, après avoir été présentés par l’autorité religieuse compétente et proposés par le Préfet. Ils ne reçoivent pas de traitement proprement dit et ne sont pas considérés comme fonctionnaires. Il leur est alloué une indemnité, ainsi qu’aux médecins, architectes, et à certains instituteurs.
Le service religieux comprend les exercices de chaque culte suivant les usages et aux jours consacrés. L’aumônier ou le ministre doit aussi prêter son ministère à tous les détenus malades ou valides qui en font la demande.
Il y a dans chaque établissement des locaux affectés au service religieux; dans les prisons importantes, où les trois cultes reconnus sont représentés, il y a donc une chapelle, un temple protestant et une synagogue.
Les locaux servant aux exercices religieux doivent être exclusivement réservés aux prisonniers. L’accès en est interdit à toute personne du dehors. Les servants du culte peuvent être choisis par les directeurs ou les gardiens-chefs parmi les détenus se conduisant bien, et avec leur consentement.
Les aumôniers d’une prison doivent remplir personnellement les fonctions dont ils sont chargés. Ils ne peuvent pas se faire remplacer sans l’autorisation de l’Administration. Ils célèbrent leurs offices dans les locaux à ce affectés les dimanches et fêtes, ou jours fixés par l’autorité, suivant les cultes. Ils visitent les détenus dans leurs cellules.
Pour tout ce qui touche au service intérieur, les ministres des cultes sont placés sous l’autorité du directeur. Ils doivent se conformer aux règlements généraux et particuliers.
A Paris, un aumônier catholique est attaché à chaque prison. Un seul pasteur est chargé d’assurer le service de la religion protestante dans toutes les prisons de la Seine. Les protestants condamnés à plus d’un an sont envoyés soit à la Maison Centrale de Poissy, soit à celle de Loos, qui ont chacune un aumônier protestant. Un rabbin est attaché à la prison de la Santé. Il est chargé de visiter ses coreligionnaires dans les autres prisons de la Seine. Les Israélites ayant à subir une détention supérieure à un an, sont envoyés à Poissy où ils ont un rabbin.
Les détenus en général sont plutôt disposés à suivre les exercices religieux. Quelques-uns y voient une distraction à ne pas dédaigner. D’autres, dans l’espoir d’être mieux notés, simulent une dévotion et une foi qu’ils n’ont pas, font les bons apôtres auprès des aumôniers, recherchent leurs visites dans la pensée d’en obtenir quelques douceurs. D’autres, enfin, et c’est le plus grand nombre, acceptent volontiers les enseignements et les exercices religieux parce qu’ils ont gardé de leur jeunesse des souvenirs faciles à réveiller, et que, presque instinctivement, se sentant malheureux, ils éprouvent le besoin naturel de chercher un refuge, un secours, une espérance. Ceux-là, parce que dans la détresse on se tourne vers Dieu, vont dans leur misère vers la religion qui leur tend toujours les bras, vers l’aumônier qui les réconforte par de bonnes paroles et leur fait espérer, malgré tout, des jours meilleurs, la possibilité de l’amendement et de la vie honnête et normale...
Dans certaines prisons, le service des aumôniers est trop chargé. Ils ne peuvent pas, malgré leur bonne volonté, donner satisfaction à tout le monde. Les détenus s’en plaignent parfois. Dans une lettre d’un prisonnier, nous lisons: «Nous savons qu’il y a des ministres des cultes, mais on ne voit jamais trace d’aumônier. Les dimanches seulement les détenus croient qu’il se dit une messe, ou plutôt s’en doutent, parce qu’on entr’ouvre la porte des cellules».
L’Ancien temple protestant de la Santé.
Les détenus, peu au courant des choses, s’imaginent que cela vient de l’indifférence de l’aumônier. M. Guillot cite une note de l’un d’eux où se trouve cette phrase: «Le pasteur et le rabbin visitent chaque semaine leurs coreligionnaires; le curé, probablement parce qu’il en a trop, ne visite que les détenus qui lui demandent un entretien; je ne crois pas que ces visites lui fassent perdre beaucoup de temps».
L’Administration pénitentiaire ne saurait trop faciliter la tâche des aumôniers dans les prisons. La religion est le plus puissant moyen de moralisation. Et il importe que ses ministres ne rencontrent aucun obstacle, aucun mauvais vouloir, dans l’accomplissement de leur bienfaisante mission.
Avant que l’obligation de l’instruction fût proclamée par nos lois, elle a été imposée à la population pénitentiaire.
Le règlement de 1885 dit: «Les condamnés âgés de moins de quarante ans, illettrés, sachant seulement lire ou imparfaitement écrire, sont astreints à recevoir l’enseignement».
Les prévenus et accusés n’ont à cet égard aucune obligation.
Un service d’enseignement primaire est organisé dans les prisons dont l’effectif le comporte. Suivant les endroits et suivant son importance, ce service est confié soit à un instituteur de profession, soit au gardien-chef ou à un gardien spécialement désigné et recevant une allocation supplémentaire.
L’enseignement est donné aux détenus au moins pendant une heure par jour. Si l’aménagement des locaux ne permet pas de le donner simultanément, il peut l’être dans les cellules. Dans tous les cas, l’instituteur se rend, quand il est nécessaire, auprès des détenus pour leur donner des explications particulières et s’assurer de leurs progrès. Dans les prisons où il existe une école cellulaire, une partie du temps de la classe est consacrée à une lecture à haute voix que fait l’instituteur, en l’accompagnant au besoin d’explications supplémentaires.
Les individus qui, en raison de leur âge trop avancé, ne reçoivent pas l’instruction primaire, sont conduits au moins trois fois par semaine à l’école, où il leur est fait une lecture à haute voix.
Les écoles doivent être organisées de manière à servir aux détenus qui sont illettrés et à ceux qui possèdent déjà une certaine instruction. Il appartient aux instituteurs d’établir des sélections et de ne faire suivre les mêmes cours qu’à ceux présentant à peu près le même degré d’instruction.
«Les écoles doivent procurer aux détenus non seulement les connaissances qui leur font défaut, mais aussi un enseignement propre à les moraliser. Cet enseignement, sans blesser les croyances professionnelles d’aucun détenu, doit être pénétré de l’esprit religieux, élément indispensable de moralisation». (Ve Congrès International pénitentiaire. Paris, 1895.)
Il arrive fréquemment que, certains détenus, qui, à leur entrée, possédaient des notions spéciales, sont admis à les augmenter ou les compléter. Des cours de dessin, de musique, peuvent à cet effet être organisés.
L’Administration ne refuse pas aux condamnés les plus aptes, et d’ailleurs suffisamment méritants, les consolations et les distractions utiles que peuvent leur procurer des études particulières susceptibles de leur servir après leur libération.
«L’individu ayant l’âge de responsabilité pénale, qui fait de ses forces et de ses facultés un usage mauvais et illégal est comme un émancipé qui mésuserait de ses droits. La justice le remet en état de minorité entre les mains de l’Administration pénitentiaire. Il doit donc être contraint à l’enseignement et au régime d’hygiène morale, comme il l’est à l’hygiène physique et au travail». (Herbette.)
Dans les prisons où les détenus sont des enfants, les services d’instruction sont naturellement beaucoup plus développés et fonctionnent avec une parfaite régularité.
Si l’obligation d’apprendre n’a pu être imposée que jusqu’à quarante ans, âge auquel le plus souvent au lieu de s’instruire on commence à oublier, l’enseignement moral doit s’étendre à tous les détenus sans exception. Il est donné à tous et toujours. Aucun d’eux ne doit être considéré comme incurable et abandonné.
On ne se rend guère compte des obstacles que rencontrent souvent les personnes chargées de dispenser cet enseignement moral, des circonstances pénibles, décourageantes, des multiples difficultés au milieu desquelles il leur faut accomplir leur apostolat.
Les aumôniers, les instituteurs ont à remplir un rôle de dévouement et d’abnégation, où ils rencontrent à chaque pas les pires déboires, où ils se heurtent contre toutes les formes de mauvaise volonté et toutes les inerties, et où, en échange de tant de peine, ils ne rencontrent que des satisfactions modestes, cachées, dont nul ne leur sait gré ni ne leur rend témoignage.
Dans le but d’instruire et démoraliser les détenus d’une façon agréable et intéressante, il est organisé dans les prisons des conférences, et des lectures à haute voix sont faites fréquemment. Les conférences sont confiées aux fonctionnaires et agents chargés de ce service, ou quelquefois à des personnes étrangères autorisées par le Ministre. Quand les conférenciers sont étrangers à l’Administration, ils doivent soumettre leurs sujets au directeur et les faire approuver. La conférence est un puissant moyen de réveiller les bons sentiments des prisonniers. Elle ne doit pas d’ailleurs avoir d’autre but, et doit conserver un caractère d’austérité excluant tous sujets ou développements frivoles. Les conférenciers doivent cependant faire en sorte que leurs discours ne soient pas ennuyeux, qu’ils ne ressemblent pas à des sermons arides, à des objurgations. Ils doivent commencer par plaire et intéresser. L’enseignement moral a besoin d’être rendu attrayant.
Les lectures à haute voix ont lieu tous les dimanches et jours fériés. Dans les cas de chômage, elles sont plus fréquentes, de façon à ne pas laisser les détenus à leurs pensées. Il est nécessaire en tout temps d’occuper l’esprit des détenus, et de les distraire; quand il est impossible de leur donner de l’ouvrage cette occupation intellectuelle devient indispensable.
Dans chaque établissement pénitentiaire existe une bibliothèque composée d’ouvrages autorisés par l’Administration et portés sur un catalogue approuvé par le Ministre de l’Intérieur, ou de volumes dont une décision ministérielle autorise l’introduction dans la maison.
Tous les détenus au repos reçoivent en communication les livres qu’ils demandent; les prévenus n’étant pas obligés au travail les obtiennent en tout temps. Dans les maisons où le travail fonctionne d’une façon régulière et suivie, des livres sont mis à la disposition des prisonniers, sur leur demande, au moins une fois par semaine.
Les bibliothèques ont pour but d’aider à l’amendement et à l’instruction des détenus. Outre les livres religieux et moraux, elles contiennent des ouvrages intéressants: récits de voyages, et d’aventures, livres de découvertes, publications illustrées, etc...
Une bibliothèque. — La Santé.
L’Administration, pour composer ces bibliothèques, accepte le concours de particuliers et de sociétés philanthropiques. Ce concours peut être surtout précieux pour procurer aux détenus de nationalité étrangère des ouvrages écrits dans leur langue. A cet effet, des échanges ont même été effectués entre les administrations pénitentiaires des différents pays.
Le dernier Congrès International de Paris a émis le vœu qu’il soit mis entre les mains des prisonniers une publication hebdomadaire spéciale, dont la rédaction serait contrôlée par l’Administration.
Les bibliothèques des prisons sont confiées à des bibliothécaires, presque toujours les instituteurs.
Les livres prêtés aux détenus sont mentionnés sur un registre spécial tenu à cet effet par le bibliothécaire. La date de la remise et celle de la rentrée y sont inscrites.
Les échanges de livres entre détenus sont sévèrement prohibés. Toute lacération ou annotation est punie disciplinairement. On n’arrive malheureusement jamais à empêcher certains détenus d’abîmer les livres de la bibliothèque, d’y faire des dessins et des annotations. Et on a beau châtier les coupables, les volumes n’en restent pas moins lacérés et maculés. Aussi dans différentes maisons a-t-on créé une bibliothèque de faveur, qui ne sert qu’aux détenus d’une bonne conduite reconnue, et dont les ouvrages sont plus soignés, plus intéressants.
Les instituteurs ayant le sentiment de leur mission, — et ce sont presque tous, — et les gardiens-chefs s’efforcent de guider les détenus dans le choix de leurs lectures. Ils connaissent les gens à qui ils s’adressent, distinguent quel livre convient à celui-ci et à celui-là. Ils tiennent compte du degré d’instruction de chacun, de l’éducation qu’il a reçue, de sa situation sociale, de son état d’âme actuel. Ils doivent savoir graduer les lectures si besoin est, commencer souvent par des livres presque exclusivement d’images, qui forcent l’attention sans la moindre fatigue, arriver ensuite à des ouvrages renfermant des enseignements susceptibles d’éveiller des sentiments généreux.
Tel détenu se montrera accessible à la pitié, tel autre se laissera remuer par les sentiments de famille, les sentiments d’affection filiale ou conjugale. A moins qu’ils ne le demandent à bon escient, on évite de donner aux détenus, surtout au début, des livres trop sévères, trop religieux, d’un sens aride, qui pourraient les lasser et les dégoûter de la lecture. L’enseignement, la leçon, doivent être présentés sous des couleurs attrayantes, déguisés pour ainsi dire sous des dehors souriants. L’agréable fait ainsi accepter l’utile.
«Quelle importance a le choix des aliments fournis par la lecture à des cerveaux impressionnables, troublés ou anémiés, tels que ceux d’un grand nombre de prisonniers, on le devine, dit M. Herbette. Mais ce que l’on ressent moins quand on n’a jamais perdu la libre disposition de soi-même, c’est l’état moral de ceux qui en sont privés tout à coup, ne fût-ce que pour une courte durée. Ne connaissant plus l’esclavage ni le servage, nos contemporains ne savent vraiment plus apprécier cette joie: faire ce que l’on veut, aller où l’on veut. Accusé ou condamné, le prisonnier qui n’a pas encore l’habitude, qui, heureusement pour lui, souffre encore de l’asservissement, sent peser sur sa tête les murailles qui l’enserrent. Et comme il lui faut encore par besoin invincible la liberté et l’espace, c’est par l’imagination qu’il cherche l’espace, et qu’il retrouve la liberté ».
Aussi ne faut-il pas s’étonner si les livres les plus demandés par les détenus sont ceux de voyages, d’aventures lointaines, de récits de plein air, où les pauvres enfermés trouvent le plus l’illusion de ce qui leur manque tant...
Les efforts continus de l’Administration pénitentiaire tendent donc tous à la régénération morale du détenu, essaient de l’arracher à un passé douloureux et de l’orienter vers un avenir honnête.
Ce but est-il atteint? Rarement, il faut le reconnaître. Le terrain est trop mauvais, trop volontairement aride. La bonne semence est étouffée à mesure qu’elle est jetée.
Il importe pourtant de ne jamais se décourager. Les difficultés de la tâche la rendent plus attachante. Tous les auteurs sont d’accord sur ce point. Dans ses intéressants travaux sur Paris malheureux, M. Maxime du Camp, notamment, s’est efforcé de démontrer que l’emprisonnement ne saurait être exclusivement correctif, que «le temps de la peine doit être employé à agir sur le détenu, à lui faire comprendre que le bien est supérieur au mal, non seulement au point de vue général, mais encore au point de vue de l’intérêt individuel».
Les consciencieuses études de M. d’Haussonville sur la criminalité et les causes et les moyens de la réprimer peuvent aussi être utilement consultées à ce sujet.
Trop souvent et malgré tout la prison produit ou augmente chez le prisonnier la haine de la société, avec, comme corollaire, le désir de se venger. Ces idées sont presque le résultat naturel de la privation de la liberté.
Le désir de vengeance engendre la récidive. Et il est constaté que le fait qui ramène un homme en prison est neuf fois sur dix plus grave que celui pour lequel il avait été condamné la première fois. Les récidivistes semblent avoir pour devise: de plus en plus fort. Ils glissent sur un terrain où ils peuvent difficilement s’arrêter, et ils s’enfoncent de plus en plus.
«La prison tue en l’homme toutes les qualités qui le rendent mieux approprié à la vie en société, affirme amèrement le révolté Kropotkine. Elle en fait un être qui fatalement devra revenir en prison, et qui finira ses jours dans un de ces tombeaux en pierre sur lesquels on inscrit Maison de détention et de correction, etque les geôliers eux mêmes appellent Maisons de corruption».
Il est très rare qu’un prisonnier admette comme méritée et équitable la peine qui lui a été infligée. Presque tous se déclarent victimes d’une injustice, prétendent qu’ils n’ont pas eu de chance, qu’une autre fois ils seront plus heureux. L’un d’eux, un pauvre bonhomme déjà grisonnant, nous disait avec une mélancolie aiguisée de colère sourde: «Ah! nous sommes ici, nous autres les voleurs, les tout petits voleurs... je n’ai pas volé cent francs, moi, monsieur!... mais les gros, ils sont bien tranquilles chez eux... et dans la rue on les salue très bas, et ils sont décorés!..» Hélas!... notre monde est ainsi fait et fonctionne de telle façon que cela n’est pas entièrement faux; nous le savons tous... Et ceux-là ont parfois raison qui soutiennent que la prison est faite pour les maladroits et les imbéciles, et non pas pour les criminels.
Une nouvelle école de criminologie, à la tête de laquelle se distingue Lombroso, a voulu, ces dernières années, expliquer et dans une certaine mesure excuser les crimes, voir partout des irresponsables au lieu de coupables. Elle a émis la prétention d’expliquer le crime par la conformation physique, d’assimiler le libre arbitre à un rêve creux de métaphisycien, une force irrésistible, une impossibilité de faire autrement pouvant toujours être invoquée.
L’ancienne synagogue de la Santé.
Ce système, si l’exactitude en était démontrée, aurait pour résultat de modifier totalement le régime pénitentiaire, dans sa conception comme dans son fonctionnement. Supprimant les possibilités d’amendement, il rendrait inutile toute tentative d’enseignement moral, en déterminant un certain nombre d’individus fatalement destinés au mal, pour qui le bien quoi qu’on tente serait impossible; individus qui seraient reconnaissables à certains signes et qu’il n’y aurait plus qu’à mettre hors d’état de nuire à leurs semblables. Les prisons, dès lors, ne seraient que des asiles d’aliénés, des hôpitaux, ou encore des ménageries, où seraient gardés ces êtres irrémédiablement mauvais et inconscients.
Cette théorie admet naturellement la parenté de l’homme et de l’animal. Quelques-uns de ces adeptes la poussent plus loin, déclarant que l’homme et le singe ne font qu’un. «Nous ne descendons pas du singe, a dit M. Albrecht au Congrès International d’anthropologie criminelle tenu à Rome en 1886, nous sommes de vrais singes, nous ne formons qu’une seule espèce: simia homo». C’est flatteur pour le singe; mais l’homme a peut-être le droit de protester.
Lombroso a cru démontrer, — il a dressé pour cela des statistiques et des tables savantes, — que la plupart des habitants des prisons ont quelque défaut dans l’organisation du cerveau. Il a reconnu que, à très peu d’exceptions près, les habitants des bagnes ont les bras plus longs que le reste de l’humanité... Il admettrait presque que la Société a le droit de prendre des mesures de protection contre tous ceux à qui on reconnaît tel ou tel signe de criminalité inéluctable.
D’autres auteurs ont mis surtout en avant l’hérédité dans le crime. A les entendre, les enfants des criminels seraient forcément destinés à être eux-mêmes criminels. D’autres encore ont signalé l’influence des causes physiques extérieures sur les actes des hommes. Il paraît que les actes de violence contre les personnes prédominent en été, tandis qu’en hiver ce sont les actes contre la propriété qui sont plus fréquents. Un professeur italien, E. Ferri, a tracé des courbes de criminalité en regard des courbes de la température et de l’état hygrométrique de l’air. Ces courbes ont des variations parallèles.
L’École socialiste avancée et l’École anarchiste, de leur côté, ne veulent voir en tout et partout qu’une coupable, qu’une responsable: la Société. «Les esprits les plus intelligents de notre siècle, déclare un écrivain anarchiste, travailleurs et penseurs, proclament hautement que la Société entière est responsable de chaque acte anti-social commis dans son sein... C’est la Société elle-même qui fabrique chaque jour des êtres incapables de mener une vie honnête de labeur; ces êtres imbus de sentiments anti-sociaux, elle les glorifie quand leurs crimes sont couronnés de succès, elle les envoie au bagne quand ils n’ont pas réussi».
Et ces rêveurs d’un ordre social idéal prophétisent que «lorsque la Révolution aura complètement modifié les relations du capital et du travail, lorsque nous n’aurons plus les oisifs, et que chacun pourra travailler suivant ses inclinations pour le bien de la communauté, lorsqu’à chaque enfant on aura enseigné à travailler de ses bras et à aimer le travail manuel, en même temps que son esprit et son cœur auront reçu un développement normal, — nous n’aurons plus besoin de prisons, ni de bourreaux, ni de juges...»
On conçoit combien de pareilles affirmations s’écartent de l’École classique, qui, au contraire, base la culpabilité et la pénalité sur l’initiative individuelle et sur l’affirmation du libre arbitre.
Quelles sont les familles où l’on ne trouverait pas en cherchant bien quelques-uns des caractères, des traits d’organisation que l’école de Lombroso donne comme indicateurs sûrs de la folie criminelle?... Quels sont les individus qui pourraient affirmer qu’ils n’ont physiquement aucun point de ressemblance avec des criminels?...
Quant aux utopies socialistes ou anarchistes, à la société future où les prisons n’auront plus leur raison d’être, tout cela est trop beau pour être possible, hélas!...
Ce qui est vrai, ce que l’on doit admettre, c’est que le degré de culpabilité varie infiniment suivant les cas, les circonstances et les sujets. Il n’y a pas deux hommes ayant commis le même crime qui soient coupables de la même façon, au même point. Si la justice qui frappe et condamne ne peut pas varier les peines autant qu’il le faudrait, il appartient à l’autorité qui applique ces peines, aux directeurs, aux gardiens-chefs, aux aumôniers et instituteurs d’étudier chaque conscience en vue du redressement moral, d’ausculter et de pénétrer chaque âme, ainsi qu’un médecin dans un hôpital le fait pour chaque malade.
Le système cellulaire rend beaucoup plus facile cette étude de chacun. Il facilite aussi au détenu le retour au bien. Dans le régime commun, celui qui voudrait se repentir et s’amender, — et combien ne demanderaient pas mieux! — a à lutter contre une sorte de respect humain; il lui faut subir les railleries des autres, de ceux qui sont ancrés dans le mal et veulent y persévérer. L’atmosphère est démoralisante. S’il éprouve des velléités de conversion, ces sentiments sont bientôt étouffés, annihilés. — A quoi bon?... — Et il reste comme les autres, dans le tas, inerte, s’abandonnant, subissant l’influence ambiante...
Pris individuellement, il est permis d’affirmer qu’aucun n’est entièrement mauvais. Et parmi des milliers qui sont regardés et se regardent eux-mêmes comme tout à fait perdus, une très large proportion peut être rappelée à une bonne pensée, à de bonnes résolutions.
«Mais ils deviennent facilement pires, si on ne sait pas leur donner l’occasion, la possibilité de la réflexion et le bénéfice d’être compris et soignés individuellement. Alors ils périssent, ils meurent à la vie sociale et leur cadavre moral infecte l’atmosphère d’un poison terrible» : (Chandler, Outlines of Penology.)
Différentes sociétés privées secondent l’Administration pénitentiaire dans ses tentatives en vue de l’amélioration morale des détenus. Il en existe à Paris et dans les départements. Parmi ces sociétés, les unes sont ouvertement catholiques, d’autres ouvertement protestantes, et d’autres enfin ne se recommandent d’aucune religion, ne s’appuyant que sur les sentiments de charité et de philanthropie. Quelques-unes s’adressent spécialement aux femmes détenues.
Les membres de ces sociétés obtiennent de l’autorité la permission de visiter les prisonniers, de leur porter des consolations, des encouragements, et même de leur procurer dans une sage mesure quelques adoucissements matériels. Ils s’occupent aussi du patronage des détenus après leur libération, leur facilitent la rentrée dans la vie honnête, les surveillent discrètement, leur procurent des places, les aident au besoin pécuniairement.
De tout temps, la visite des prisonniers a été considérée comme une œuvre pie, comme une forme de la charité. Chez les premiers chrétiens, l’usage existait déjà de porter des secours aux prisonniers. Saint Vincent de Paul fut en son temps l’ange consolateur des prisons de France. Mabillon, s’occupant des prisonniers en 1714, disait dans un de ses sermons: «Quand on va les visiter, que ce ne soit pas pour un moment, qu’on les écoute». Cette manifestation de charité était très à la mode sous Louis XIV. Tartuffe ne parle-t-il pas des aumônes qu’il distribue dans les prisons?...
Pendant la tourmente révolutionnaire les visites ne cessèrent pas. Dans son poème de La Pitié, Delille rendit hommage aux visiteurs charitables qu’il appelait «la Providence des prisons».
Les visites des personnes étrangères peuvent aider considérablement à la moralisation. Elles ont aussi l’excellent effet de soustraire pour quelques instants et assez fréquemment le détenu à sa solitude si pénible.
Les détenus sont du reste toujours libres de refuser toute entrevue de ce genre. Et il est bien recommandé aux membres des sociétés de patronage de respecter scrupuleusement la volonté des prisonniers et leur liberté de conscience.
Les visiteurs doivent également n’enfreindre en rien l’ordre établi dans la maison, de manière que la discipline et le travail ne souffrent pas de leur présence.
Les personnes admises à pénétrer dans les établissements pénitentiaires doivent avoir le don d’éprouver et d’inspirer la sympathie. Il leur faut montrer la plus grande douceur et une patience que rien ne rebute. Elles ont à se mettre en garde contre une sensibilité exagérée et à ne pas se laisser prendre à des apparences souvent trompeuses. Beaucoup de détenus, s’ils jugent avoir affaire à quelqu’un de facilement influençable, n’hésitent pas à jouer la comédie du repentir et des bons sentiments, dans l’espoir des douceurs qu’ils pourront obtenir. Un succès trop rapide avec de pareils sujets n’est le plus souvent qu’un succès apparent. Et il n’est pas toujours aisé de discerner ceux qui jouent la comédie et ceux qui sont de bonne foi. Les directeurs et les gardiens s’y trompent eux-mêmes.