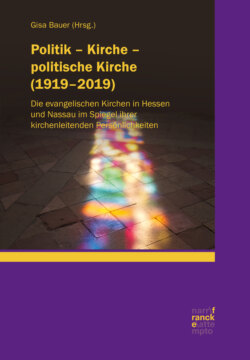Читать книгу Politik – Kirche – politische Kirche (1919–2019) - Группа авторов - Страница 11
3. Les Grecs anciens et nous
ОглавлениеÀ partir de ce qui vient d’être énoncé, le lien avec notre situation actuelle apparaît incontestable. Si la culture grecque incarne la pluralité et l’opposition des points de vue sur les questions ultimes, on peut croire qu’il existe une certaine isomorphie entre ces traits culturels et la disposition d’esprit qui est la nôtre. Dans un texte issu d’une conférence de 1958, intitulé « En quoi croit l’Occident », Karl Popper, insistant pour rappeler que, de manière tout au moins définitive, « il n’y a rien que l’on puisse prouver », mais qu’il est évident qu’« on peut avancer des arguments et soumettre des points de vue à l’examen critique1 », Popper donc en venait à cette déclaration selon laquelle c’est « la discussion critique [qui] est le fondement de la libre pensée de l’individu2 ». Et on sait que pour lui, cette tradition bien spéciale de la discussion critique, et qu’on peut appeler la tradition du rapport critique à la tradition, remonte pour l’essentiel à la Grèce ancienne3. Maintenant, qu’en est-il du problème de la croyance ? Popper répondait : « Nous devrions être fiers de n’avoir pas une, mais de nombreuses idées, de bonnes et de mauvaises ; de n’avoir pas une croyance, une religion, mais de nombreuses, bonnes et mauvaises », et il conclut que si l’Occident « s’unissait autour d’une idée, d’une croyance, d’une religion, cela serait la fin, notre capitulation, notre soumission inconditionnelle à l’idée totalitaire4 ». Il va de soi que si on entretient ce point de vue, on s’éloigne de la thèse d’un Occident essentiellement chrétien ou d’une Europe fondamentalement chrétienne, idée qu’on entend de plus en plus fréquemment ces derniers temps5, non pas que le christianisme ne forme pas, de fait, un élément important de la tradition européenne, mais parce qu’il a d’entrée de jeu baigné dans l’hellénisme, s’est trouvé initialement mêlé à sa forte conceptualité, à sa diversité radicale aussi, et qu’il s’est ainsi d’entrée de jeu trouvé dilué doctrinalement. C’est comme cela que le christianisme a pu devenir peu à peu, bon gré mal gré, le véhicule d’autre chose que de simplement lui-même. Or le danger du fanatisme, qu’il soit chrétien, musulman ou juif, est toujours là, inscrit dans une certaine mesure dans le code même du monothéisme, dans la mesure où le monothéisme a quelque chose de la Gegenreligion. Dans ce qu’on pourrait appeler l’hénothéisme ou le monothéisme inclusif, l’idée du dieu premier coexiste naturellement avec la présence possible d’autres dieux et par extension d’autres croyances ; en revanche, le monothéisme exclusif contredistingue la religion de l’unique et vrai dieu, de celle des fausses croyances en plusieurs dieux, ou en un seul dieu mais autre que celui qu’elle reconnaît elle-même6. De ce point de vue-là, comme on l’a fait remarquer, il est clair que la cultuelle antique pourrait a contrario « contribuer à réduire l’un des maux qui accablent [notre société], à savoir le conflit religieux7 », et il est manifeste aussi que ce n’est pas le christianisme en tant quel tel – ou le judaïsme ou l’islam – qui peut mener éventuellement à la terreur et à l’inhumanité, « c’est bien plutôt l’idée d’une idée une, unitaire, la croyance en une croyance une, unitaire et exclusive8 ».
En défendant le pluralisme des croyances et des modes de vie, c’est en même temps une vertu cardinale qu’on défend et qui se trouve à la base du pluralisme : la modestie intellectuelle9, fondée sur le fait fondamental de notre faillibilité intrinsèque, sur laquelle insistait déjà, rappelle Popper, Voltaire10. Ce type d’approche ou d’attitude esquisse en creux un horizon possible de connaissances négatives. Le principe de notre faillibilité intrinsèque nous amène en effet à postuler que les positions, opinions ou croyances d’autrui sont dignes d’attention, susceptibles de critiques mais en soi respectables, puisque émanant de personnes dont le libre-arbitre est à la base comparable au nôtre, etc.
Or, le principe de faillibilité nous amène également à reconnaître qu’un certain nombre de prises de position, d’hypothèses, de dogmes ou de principes a priori, lesquels échappent à toute démonstration rationnelle, pèsent néanmoins lourdement dans les conduites humaines et méritent considération. Je donne un exemple bien concret : le recours à l’idée d’un principe ultime de l’ensemble de la réalité, d’un inconditionné dernier rendant raison de la totalité des choses – l’horloger derrière l’immense horlogerie, si on veut –, est un phénomène qu’on voit se répéter à travers bien des conceptualités différentes, y compris dans plusieurs des théologies minimales grecques que j’ai décrites plus haut. En son noyau, il y a là comme un enseignement sinon sur la nature intrinsèque du principe en cause, du moins sur la propension de l’esprit humain à postuler l’existence d’une telle cause – une sorte de prénotion, pour reprendre le vocabulaire épicurien –, et donc une espèce de connaissance négative en son cœur encore une fois, et qui n’enlève rien au fait que d’autres sensibilités, d’orientations opposées, affleurent parallèlement, le désir par exemple de s’abstenir de tout postulat métaphysique touchant une cause première – agnosticisme ou athéisme –, ou d’en rester au principe du sans pourquoi, à la manière d’Angelus Silesius, « Die Ros’ ist ohn’ Warum, sie blühet weil sie blühet11 ». Qu’on s’en réfère à une version agnosticiste, exemplariste ou aphairétiste d’économie théologique, la pensée grecque a d’emblée ouvert la voie à une théologie minimale moins contraignante, théologie du μηδὲν ἄγαν, du « rien de trop », entre renonciation métaphysique et asservissement ou emprise dogmatiques.