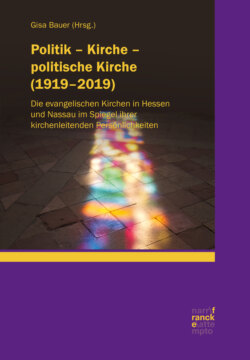Читать книгу Politik – Kirche – politische Kirche (1919–2019) - Группа авторов - Страница 8
Résumé
ОглавлениеL’héritage métaphysique grec se caractérise par sa diversité, son ouverture et sa retenue. Le caractère non autoritaire et relativement apolitique du sacré polythéiste grec – même si des cultes civiques existaient bel et bien en Grèce antique – a été relevé par nombre de spécialistes. Sur le plan des spéculations philosophiques, une même diversité et retenue s’observent, tant et si bien que l’idée de connaissances négatives ou restrictives ou minimales s’avère consubstantielle à la pensée grecque elle-même, et on peut aller jusqu’à dire que c’est sur son exemple ou sur sa lancée que nombre de tentatives contemporaines s’interprètent et se comprennent.
Il faut songer qu’il existe quelque chose comme un art grec de n’être pas tellement avisé sur la nature intrinsèque de l’arrière-monde, digne encore aujourd’hui d’être médité, exercé et élargi.
« Philosophy is not a Matter of Faith, but Reason, Men ought not to affect (as I conceived) to derive its Pedigree from Revelation, and by that very pretence seek to impose it Tyrannically upon the minds of Men, which God hath here purposely left Free to the use of their own Faculties, that so finding out Truth by them, they might enjoy that pleasure and Satisfaction, which arises from thence ».
Ralph Cudworth, The True Intellectual System of the Universe (1678), 12–13
Je voudrais commencer le présent exposé en lisant un extrait du fameux satiriste Lucien de Samosate, lequel va comme suit :
TIMOCLÈS : Tu peux voir si ce syllogisme est conséquent et si tu peux le faire chavirer : « S’il y a des autels, il y a des dieux ; or il y a des autels, donc il y a des dieux. » Que réponds-tu à cela ? DAMIS : À condition de commencer par rire tout mon soûl, je vais te répondre […]. C’est que tu ne te rends pas compte que tu as accroché ton ancre – et une ancre sacrée – à un fil ténu. En liant l’existence des dieux à l’existence des autels, tu crois avoir fait là ton amarrage solidement. Ainsi donc, puisque tu affirmes ne pouvoir rien citer de plus sacré que cela, partons maintenant ! TIMOCLÈS : Tu reconnais donc que tu as perdu, en partant le premier ? DAMIS : Oui, Timoclès ; car comme ceux qui subissent des violences de la part de certains, nous te voyons réfugié auprès des autels. Eh bien, au nom de l’ancre sacrée je veux faire maintenant un pacte avec toi, sur les autels mêmes, de ne plus débattre de ces questions1.
L’extrait que je viens de lire est tiré d’un des essais les plus célèbres et les plus provocants que Lucien de Samosate ait écrit, le Zeus tragique, dont voici l’intrigue résumée : un stoïcien (Timoclès), défenseur de l’idée de providence, est opposé à un épicurien (Damis) qui en conteste l’existence, et cela devant un public de dieux, y incluant Zeus, inquiet à juste titre du dénouement du débat, tant la finesse des raisonnements critiques de Damis l’emporte sur les arguties de Timoclès.
À la lecture de l’essai, il apparaîtrait en effet que c’est bien Damis qui s’impose comme le vainqueur de la joute qui l’oppose à Timoclès, les dieux eux-mêmes se révélant penauds devant la tournure des événements. Or Damis, curieusement, au lieu de profiter de son succès et de clamer haut et fort sa supériorité – l’idée même de l’existence possible d’une providence divine se trouvant battue en brèche –, s’arrête avant l’affront final en renonçant au fond à la victoire qui se trouve pourtant à portée de sa main : il laisse à son belligérant le refuge qu’il s’est trouvé, aussi factice peut-être soit-il, dans l’idée que le doute qu’il a fait naître eu égard aux croyances divines de ce dernier lui suffit, qu’au-delà de cela, si quelqu’un souhaite trouver refuge en tel ou tel dogme, en tel ou tel autel, qui serait-il, lui Damis, pour y faire obstacle ?
Après tout, dans l’incertitude qui est celle toute naturelle du sceptique vis-à-vis de l’existence des dieux (j’y reviendrai), à défaut d’avoir davantage de raisons de pencher d’un côté plutôt que de l’autre, l’opinion populaire qu’ils existent, attestée par tant et tant d’autels, n’équivaut-elle pas à une sorte de preuve, indirecte certes, mais pratique et concrète tout de même, de leur existence ? Ainsi en Protagoras 322 a de Platon, la construction d’autels est-elle donnée par Protagoras lui-même, dans le mythe qu’il raconte sur l’origine des cités, comme une conséquence de la participation au lot divin qui est le propre de l’homme :
Puisque l’homme participait au lot divin, il fut d’abord, du fait de sa parenté avec le dieu, le seul des animaux à honorer les dieux, et il entreprit d’ériger des autels et des statues des dieux.
Damis fait ainsi montre, au moment de son triomphe, d’une retenue de bon aloi, d’une sorte d’autolimitation critique du savoir qui le préserve de toute forme d’intransigeance. En dépit des doutes qu’il laisse visiblement planer, le respect des croyances d’autrui s’impose à lui. Procédant ainsi, on peut dire que Damis se maintient dans la ligne maîtresse de la culture grecque, c’est-à-dire dans la reconnaissance d’un savoir tout à la fois varié et incertain, philosophiquement questionnable ou réinterprétable – dans certains cas allant jusqu’à la via negativa et l’aphairétique –, qu’on peut avoir des dieux.
Un bref détour par ce qu’on peut appeler la religiosité des Grecs apparaîtra ici nécessaire. Je vais sans doute énoncer dans ce qui suit des choses que chacun d’entre vous connaît, mais je crois que ce bref détour est nécessaire pour mettre en relief le cadre sur le fond duquel l’idée de connaissances négatives, en contexte grec, peut possiblement se détacher.